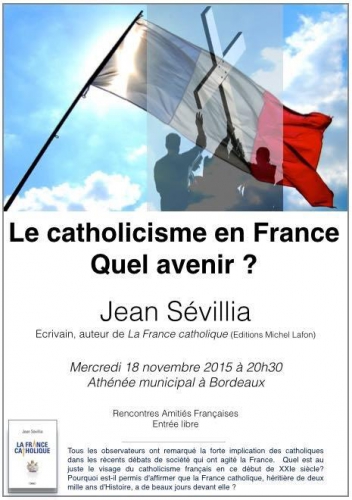
- Page 35
-
-
Que des problèmes !

-
Manolo, tu n’es qu’un dégonflé !
Tu me déçois, Manolo ! Tu me déçois beaucoup. Rappelle-toi ce que je t’ai dit le 8 avril 2014, sur RMC, alors que tu venais d’être nommé Premier ministre :
« Tout d’abord, Manolo, comme on t’appelle en Espagne, on va se tutoyer, comme on le fait en Espagne. Ecoute, Manolo, tu as une seule grande décision à prendre, et tout de suite : annoncer officiellement la fin du monopole de la sécurité sociale. Et d’un coup d’un seul, tes 50 milliards, tu les as.A l’heure où je te parle, Manolo, plus de 300 000 Français se sont assurés en dehors de la Sécu. Et ils s’en portent merveilleusement bien. Mais les autres, ceux qui ne savent pas, ou qui ont peur, est-ce que tu y penses, Manolo ? Il y a en France 15 millions de personnes qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts, 8 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs. C’est la Sécurité sociale avec ses charges monstrueuses qui est responsable de ce désastre.
On peut s’assurer mieux et pour beaucoup moins cher qu’à la Sécu, et on y gagne beaucoup de pouvoir d’achat. Et les entreprises, Manolo, tu y as pensé ? Il y en a trois millions, des petites, des moyennes, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Toutes pourraient embaucher un ou deux salariés si le chef d’entreprise était libéré des charges insensées du RSI. C’en serait fini du chômage de masse en France !
Alors, Manolo, tu sais ce qu’il te reste à faire : montre-nous que tu as des cojones, pas comme les bataillons de couilles molles de la classe politique. D’ailleurs, rappelle-toi, tu étais à Matignon avec Lionel Jospin en 2001, quand il a pris l’ordonnance qui a abrogé le monopole de la sécurité sociale.
Alors à toi de jouer, Manolo. Hasta luego, hombre ! »
Cela fait dix-neuf mois que tu es Premier ministre, Manolo. Dix-neuf mois de perdus ! Les entreprises continuent de crever sous le poids des charges sociales, et toi, tu passes ton temps à te montrer partout en France et à ne rien faire, à crier comme un perdu à l’Assemblée nationale contre tout le monde sans jamais rien proposer de concret.
Pourtant, le 31 mars dernier, sur RMC et BFMTV, tu as déclaré : « Le RSI est un désastre. Ca ne marche pas ! » Et qu’as-tu fais face à ce désastre ? Rien. Ou plutôt si : tu as nommé une commission qui finalement considère que le RSI ne marche pas si mal ! Tu as l’air de quoi, Manolo ? Il y a un désastre, et toi tu laisses le désastre continuer. Manolo : tu es coupable de non -assistance à pays en danger, à Français en danger ! Tous les jours, des travailleurs indépendants se suicident, et toi, Manolo, tu t’en fous !
Je vais te donner un dernier conseil, Manolo. Un dernier, parce qu’après tu n’auras qu’à te débrouiller tout seul. Supprime le RSI, Manolo ! Tout de suite ! Il ne pourra jamais s’en sortir, non seulement parce qu’il est structurellement déficitaire, mais aussi parce que les indépendants le quittent en masse. Le RSI est foutu, Manolo. Rien ne le sauvera. Alors colle-lui une balle dans la tête, par charité et surtout par souci d’arrêter les tortures qu’il inflige à ceux qui n’ont pas le courage de le quitter. Les indépendants qui le peuvent contracteront des assurances privées, et ceux qui ne le peuvent pas auront la CMU, comme n’importe quel étranger qui arrive en France.
Voilà mon plan, Manolo. Adopte-le d’urgence. Parce qu’après, je ne réponds plus de rien, tant je sens la fureur monter dans le pays. Tiens, je vais te dire, Manolo. Quand Franco est mort, un ministre s’est écrié : « Oui, il est mort. Mais qui va aller le lui annoncer ? » Tu le sais aussi bien que moi, Manolo : la Sécurité sociale est morte. C’est ton boulot d’aller l’annoncer !
Adios !
Claude Reichman -
Burundi : la descente aux enfers ?
A l’initiative de la France, le Conseil de Sécurité des Nations Unies s’est réuni, lundi 9 novembre, pour discuter de la situation au Burundi. Enfin ! Jusqu’à présent, les dirigeants occidentaux étaient très occupés avec la crise syrienne et les centaines de milliers de migrants et autres réfugiés qui affluent vers - et à travers - l’Europe. Les projecteurs de nos grands médias étaient quant à eux braqués dans la même direction. La crise qui se développe depuis des mois au Burundi ne semblait pas attirer d’attention internationale. Depuis des mois, dans différents articles et lors d’émissions de radio, je n’ai eu de cesse que de tenter de tirer le signal d’alarme au sujet du Burundi. Ce pays, où j’ai vécu quelques mois alors qu’il semblait avoir atteint le fond de l’abîme, a eu, depuis plus d’un demi-siècle, plus que sa part de massacres. L’histoire est-elle en train de se répéter ? La vie politique du Burundi semble toujours avoir été marquée du sceau de la violence.
Violence avant même l’indépendance, lorsque, le 13 octobre 1961, le charismatique prince Louis Rwagasore[1], fils du Mwami et leader de l’UPRONA[2], devenu chef du gouvernement depuis seulement 14 jours, fut assassiné par un jeune Grec, sans doute manipulé par le pouvoir colonial belge. L’UPRONA venait de remporter les élections législatives.
Violence encore lorsque 15 janvier 1965 le premier ministre Pierre Ngendandumwe fut à son tour assassiné. Triste année que cette année-là qui vit ensuite des militaires hutu tuer d’autres militaires, tutsi ceux-là, puis des politiciens hutu être éliminés par des politiciens tutsi. Ces tueries entre tutsi et hutu allaient se reproduire, cycliquement, durant les décennies suivantes et marquer durablement la vie politique burundaise.
Violence toujours, en 1969, lorsque des politiciens et des militaires hutu furent arrêtés et tués par le régime militaire à dominante tutsi.
Paroxysme de violence, surtout, en 1972, lorsque l’ancien roi Ntare V fut assassiné par des insurgés hutu tentant de renverser le pouvoir militaire tutsi. En représailles, 100 000 personnes, voire plus, essentiellement hutu, furent impitoyablement massacrées. Cette épouvantable tragédie en annonçait malheureusement d’autres, tant au Burundi qu’au Rwanda voisin.
La violence, toujours la violence, en 1988, lorsque de nouveaux massacres firent 20 000 victimes. Et, durant toutes ces années 60, 70 et 80, une succession de régimes militaires toujours dirigés par des officiers tutsi, tous originaires de la même localité de Rutovu, dans la province Bururi : le capitaine Michel Micombero qui prit le pouvoir en 1965 et qui mit fin à la monarchie fut renversé en 1976 par le colonel Jean-Baptiste Bagaza, lui-même chassé du pouvoir par le commandant Pierre Buyoya en 1987. Ce dernier militaire eut pour mérite de tenter d’apaiser les tensions entre les Hutu et les Tutsi et, ce faisant, de renforcer l’unité nationale. Il fit entrer autant de Hutu que de Tutsi dans ses gouvernements et eut le courage de mettre son pays sur la voie de la démocratie, avec la tenue d’élections multipartites en 1993. Élections qu’il perdit, les Hutu, majoritaires, ayant voté pour le candidat d’opposition, Melchior Ndadaye, un Hutu. Buyoya eut l’élégance d’accepter le résultat et de se retirer en transmettant le pouvoir au vainqueur. Mais ses anciens collègues de l’armée eurent moins de scrupules puisque, trois mois seulement après son élection, Ndadaye fut arrêté par des militaires et tué, ainsi que six de ses ministres et que le président du Sénat.
Terrible période que ces années 1993-1996 qui virent le Burundi être ensanglanté par la guerre civile, à la suite de l’assassinat du président Ndadaye. Combien de Burundais périrent durant ces années-là ? Pas moins de 200 000. Victimes de combats entre armée à dominante tutsi et rébellion hutu, mais surtout victimes de massacres aveugles commis de part et d’autre : hommes, femmes et enfants hutu exécutés par la soldatesque tutsi, hommes, femmes et enfants tutsi éliminés par des hommes armés de la rébellion hutu, aveuglés par la haine.
Le pire, dans cette violence génocidaire qui débuta en 1993, c’est qu’elle contribua probablement à engendrer le génocide rwandais. Tout ce qui se produisait au Burundi était colporté, exagéré, utilisé par les factions rwandaises qui y trouvèrent des arguments pour se radicaliser et exacerber la haine. L’assassinat des dirigeants hutu burundais, perpétré par des militaires tutsi, renforça la conviction des extrémistes hutu rwandais qu’il ne fallait reculer devant rien pour tenter de sauver le pouvoir hutu, au Rwanda. Les massacres de civils tutsi burundais redoublèrent l’ardeur des combattants tutsi rwandais à en finir avec un régime à dominante hutu. L’homme qui assurait l’intérim de la présidence burundaise, Cyprien Ntaryamira, fut d’ailleurs victime des évènements rwandais, puisqu’il mourut aux côtés du président Juvénal Habyarimana lorsque l’avion présidentiel de ce dernier fut abattu en phase d’atterrissage, à Kigali, le 6 avril 1994. Les deux guerres civiles s’entremêlèrent souvent, puisque des Burundais ou des réfugiés rwandais au Burundi combattirent au Rwanda et que l’inverse se produisit également.
En 1996, Pierre Buyoya, le militaire putschiste de 1987, le président sortant défait en 1993, revint au pouvoir. Non, il ne fit pas vraiment un nouveau coup d’État. Il se contenta de ramasser ce qui restait de pouvoir dans un pays à feu et à sang. La communauté internationale riposta en isolant le Burundi, en votant des sanctions contre lui. Buyoya engagea cependant des négociations avec la rébellion et un accord de paix fut signé à Arusha en l’an 2000, permettant ainsi au pays de sortir de l’engrenage sans fin de la violence et de s’engager dans une période de transition. Cette transition permit l’intégration de l’opposition hutu aux institutions de la République. En 2003 Pierre Buyoya céda la présidence au vice-président hutu issu de cette opposition, Domitien Ndayizeye. Cette période s’acheva en 2005 avec l’adoption d’une nouvelle constitution et l’organisation d’élections. Ces dernières virent la victoire sans appel de l’ancien chef de la rébellion armée, Pierre Nkurunziza, et de son mouvement, le CNDD-FDD[3], transformé en parti politique. Le nouveau président est le fils d’un politicien hutu, tué lors des massacres de 1972. Réélu pour un second mandat en 2010, Nkurunziza s’est à nouveau présenté en 2015, foulant ainsi aux pieds les accords de paix d’Arusha qui stipulaient, dans leur article 7, que le président « est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels. » C’est cette insistance à se représenter qui provoqua la crise politique de 2015. La Cour Constitutionnelle valida pourtant sa candidature, mais le vice-président de cette même cour s’enfuit en Belgique, dénonçant les pressions exercées sur lui-même et sur ses pairs, ainsi que les menaces de mort. Depuis le mois d’avril, Bujumbura a été le théâtre d’imposantes manifestations contre cette nouvelle candidature. En mai, il y eut même une tentative de coup d’État, organisée par un ancien chef d’état-major qui se réfugia au Rwanda après l’échec du putsch. La médiation est-africaine, menée par le chef de l’État ougandais, n’a pas permis de trouver une sortie de crise, le président ne renonçant pas à sa candidature et l’opposition demeurant ferme sur ses principes. Il y avait d’ailleurs une certaine ironie dans la désignation de Yoweri Museveni comme « médiateur » ! Cet homme, arrivé au pouvoir en Ouganda 1986 après avoir eu le dessus dans une épouvantable guerre civile, est demeuré depuis lors à la tête de son pays en modifiant la constitution à sa convenance et en se présentant à des élections gagnées d’avance. Au moment même de sa désignation, il préparait d’ailleurs sa candidature pour les élections de 2016. Quelle crédibilité un tel homme pouvait-il avoir auprès d’une opposition burundaise luttant contre une nouvelle candidature de Nkurunziza ? Les élections burundaises, tant législatives que présidentielles, eurent lieu, mais elles furent boycottées par l’opposition. C’est donc sans surprise que le CNDD-FDD remporta la majorité absolue lors des législatives de juin et que le président-candidat gagna son troisième mandat aux présidentielles de juillet. Cependant, ces victoires ne découragèrent ni l’opposition ni les manifestants, malgré la répression policière. Depuis, la violence n’a pas cessé, en particulier dans les quartiers de la capitale acquis à l’opposition. Des gens disparaissent, d’autres sont arrêtés et, pour certains, leurs corps criblés de balles sont ensuite retrouvés dans la rue. La société civile burundaise n’a pas été épargnée par ce nouveau cycle de violences. Pierre-Claver Mbonimpa, un activiste des droits de l’Homme renommé, déjà plusieurs fois arrêté, a ainsi réchappé de justesse à une tentative d’assassinat, le 3 août. Blessé par balles, il a été évacué en Belgique, où il se trouve encore, en convalescence. Le 9 octobre, c’est son son gendre qui a été assassiné. Le 6 novembre, le corps de son plus jeune fils a été retrouvé au bord d’une rue. Quelques heures plus tôt, il avait été arrêté par la police. Selon des témoins, le corps portait des traces de blessures par balles. Dans la nuit du 7 au 8 novembre, ce sont 9 personnes qui furent froidement abattues dans un bar, par des hommes en uniformes. Les propos menaçants de certains officiels, en particulier ceux du président du Sénat, n’ont fait qu’exacerber la tension, laissant craindre que des massacres de grande ampleur ne soient en préparation. Durant tous ces mois de crise, des dizaines de milliers de Burundais ont préféré prendre le chemin de l’exil, au Rwanda et en Tanzanie, comme à l’époque de la guerre civile.
Le Rwanda, dirigé d’une main de de fer depuis 1994 par un dictateur tutsi, Paul Kagame, semble déterminé à déstabiliser son voisin. Le général burundais auteur du putsch manqué de mai y a reçu bon accueil et il semble avoir la volonté de mener la lutte armée contre Nkurunziza depuis le Rwanda. Ces derniers jours, Kagame s’est livré à de violentes attaques verbales contre son collègue burundais, l’accusant de se préparer à massacrer son peuple. Il est vrai que Kagame est un spécialiste de la question, puisqu’il est lui-même arrivé au pouvoir grâce à deux massacres de grande ampleur, l’un commis par ses ennemis, l’autre par ses propres troupes. Kagame semble cependant oublier un détail : c’est la volonté de Nkurunziza, au pouvoir depuis 10 ans seulement, d’être élu pour un troisième mandat qui a déclenché l’actuelle crise burundaise. Or, le dictateur rwandais, au pouvoir depuis 21 ans, est en train de faire modifier la constitution afin de parvenir à se représenter en 2016 et - pourquoi pas ? – de demeurer au pouvoir jusqu’en 2034 ! Pourquoi ce qui est inadmissible au Burundi le serait-il moins au Rwanda ? Pourquoi la communauté internationale s’est-elle montrée si véhémente à l’égard du président burundais et si discrète au sujet du processus engagé au Rwanda ? Et surtout, pourquoi Kagame est-il tellement persuadé que le peuple rwandais demeurera indéfiniment docile sous sa férule, alors que le peuple burundais n’a pas hésité à descendre dans la rue pour faire entendre sa voix ? Kagame a donc bien tort de jeter de l’huile sur le feu burundais, car le brasier rwandais risquerait bien, lui aussi, de se rallumer. Il sera alors bien difficile de l’étouffer.
Rwanda et Burundi sont deux pays voisins de langue et de culture similaires. Leurs sociétés sont divisées par le même clivage hutu-tutsi, et toutes deux ont été traumatisées par des éruptions de violences qui firent des centaines de milliers de victimes, tant hutu que tutsi. Tout ce qui se passe dans l’un des deux pays a toujours des répercussions dans l’autre. Il est donc urgent de tout entreprendre pour arrêter l’engrenage sanglant au Burundi, dans l’intérêt des deux peuples. Le Burundi est un pays magnifique. Ses montagnes verdoyantes plongent dans les eaux bleues de l’incomparable lac Tanganyika. Sa terre est fertile et suffirait largement à nourrir sa population. Ses troupeaux de vaches aux cornes immenses sont la fierté de leurs éleveurs. Ses athlétiques et talentueux tambourinaires ont fait la renommée du pays à travers le monde. Le peuple burundais, après avoir surmonté tant d’épreuves tragiques, mérite de vivre en paix, en paix avec lui-même. Le président Nkurunziza saura-t-il sortir de sa crise de paranoïa actuelle et prendre l’initiative d’un véritable dialogue inter-burundais ? En agissant ainsi, il se grandirait et gagnerait sa place dans l’Histoire du Burundi et celle de l’Afrique. L’un de ses prédécesseurs, Pierre Buyoya, a su, à deux reprises, renoncer au pouvoir et le transmettre pacifiquement. Aujourd’hui, Buyoya compte parmi les sages de l’Afrique, continent qu’il parcourt inlassablement afin d’offrir ses services d’homme de paix. Puisse Pierre Nkurunziza suivre son exemple !
Hervé Cheuzeville
[1] Fils du Mwami (roi) Mwambutsa IV
[2] Union pour le Progrès National
[3] Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie
http://www.vexilla-galliae.fr/actualites/europe-international/1630-burundi-la-descente-aux-enfers
-
Nous sommes le jour d'après...
Le Salon beige avait relayé cet article de fond du colonel Michel Goya publié sur son blog le 25 octobre dernier. Il s'interrogeait sur l'incapacité des autorités françaises à réagir à un attentat de grande ampleur. Il avait intitulé son article "Le jour d'après la grande attaque". Il est intéressant de le relire :
"C’est donc à peu près entendu, la guerre de la France contre les organisations djihadistes qui dure déjà depuis vingt ans durera encore sans doute au moins autant. Dans le cadre de cette lutte, il est à peu près certain aussi que la foudre, la grande, celle qui fend les montagnes, ne nous épargnera pas éternellement. Les attaques de 2012 et 2015 ont été dures et surprenantes, en fait surtout dures parce que nous, nos dirigeants en premier lieu, avons été surpris alors que de nombreux éléments indiquaient que cela surviendrait. On ne peut introduire la notion de résilience dans le livre blanc de la défense de 2008 et n’en tenir aucun compte, se féliciter régulièrement de déjouer des attentats et ne pas assumer que nous ne pourrons jamais tous les éviter. Ces attaques, et même celles de janvier dernier, qui ont provoqué beaucoup d’émotion, ne sont pourtant encore que peu par rapport aux dizaines d’attentats massifs et d’attaques dynamiques qui ont frappé diverses nations du monde depuis 2001. La première des responsabilités serait d’expliquer que cela arrivera très probablement sur notre sol dans les mois ou années à venir.
Cette grande attaque, par exemple sous la forme d’un commando venu de Libye éclatant en cellules autonomes de massacre au cœur de Marseille ou d’une équipe de snipers frappant les foules parisiennes une nuit du nouvel an…ou tout autre procédé pourvu qu’il soit stupéfiant, sera sans doute finalement bien traitée, c’est-à-dire contenue et réprimée, par les services de police. Le dispositif de l’opération Sentinelle, aura peut-être même cette fois une autre utilité que psychologique. Cela limitera les effets mais n’empêchera pas des dizaines, voire des centaines, de victimes et un immense choc. Tout cela a été parfaitement décrit par ailleurs, en particulier ici et ici.
Il reste à savoir ce qui se passera le jour d’après. Quelle sera la réponse à ce qui, bien plus qu’en janvier, ressemblera vraiment aux attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ? La France faisant partie des ennemis privilégiés de plusieurs organisations djihadistes, il est probable que tout cela a déjà été anticipé. Les discours forts sont déjà écrits, les actions diplomatiques, les plans de mobilisation des forces de réserve, ainsi que les plans d’engagement des forces déjà prêts pour vaincre l’ennemi…
C’est de l’ironie. Il est probable qu’il n’en est rien. S’il y a bien un message que la France a envoyé après les attentats de janvier c’est bien qu’elle avait été surprise et qu’elle le serait encore plus en cas événements particulièrement graves. Car il ne faut pas confondre les réactions qui ont suivi, le déploiement précipité des militaires dans les rues de métropole comme on injecte une forte dose d’anti-dépresseur, la légère inflexion dans la réduction des budgets et des effectifs, l’engagement momentanée du groupe aéronaval dans le Golfe, la loi sur la sécurité comme des signes d’une réelle stratégie. Une stratégie suppose en effet la définition d’un chemin vers la victoire et la fin de la guerre, et ce chemin on ne le voit guère. Pourtant, quand on cumule tous les moyens engagées dans la « guerre » annoncée par le Premier ministre en janvier, nous sommes au niveau de l’« engagement majeur » (une expression pour justement éviter le mot « guerre ») prévu par le Livre blanc de 2013 et certainement contre l’ennemi prévu par ce même document, tout simplement parce qu'il n'y en a aucun (juste toujours la même liste de menaces). La confusion n’est d’ailleurs toujours pas dissipée, le même Premier ministre qui déclarait la « guerre » annonce maintenant de fait des actions de « police » en Syrie.
L’épée est donc déjà sortie mais pour quel effet ? Nous avons engagé deux brigades dans les rues de métropole afin de rassurer un peu les Français, nous tentons d’endiguer les organisations armées nord-africaines avec 3 000 hommes et quelques aéronefs en limite d’un sous-continent très fragile et de la taille de l’Europe, quant à nos 12 avions de combat au Proche-Orient, ils réalisent 3 % d’une campagne de frappes qui n’obtient que des résultats mitigés contre l’Etat islamique. Le moins que l’on puisse dire est que vu de Raqqa notre contre-djihad manque singulièrement de punch et nous sommes pourtant à notre maximum.
Quel sera alors la réponse stratégique si un commando de l’Etat islamique ou d’al-Mourabitoune parvient à tuer d’un seul coup à tuer autant de civils que le Lashkar-e-Toiba à Mumbai en 2008, soit dix fois plus qu’à Paris en janvier dernier ?
Il faudra alors d’abord expliquer aux Français, pourquoi dans ce pays qui produit 2 200 milliards d’euros de richesse chaque année, l’Etat a la plus grande difficulté à en dégager 62 pour assurer ses missions régaliennes, celles qui assurent la sécurité des Français avec une armée, une police, une système judiciaire et pénitentiaire, une diplomatie. Pire encore, il faudra expliquer pourquoi on a diminué en permanence ces moyens, pourquoi on a baissé la garde alors qu’on ne cessait de dire, y compris dans les documents officiels, que le monde qui nous entourait était toujours plus dangereux. Il sera alors difficile à la même classe politique qui a initié et organisé cette baisse de la garde depuis plus de vingt ans de persuader qu’elle est capable de porter le fer avec fermeté et efficacité contre l’ennemi. Que ceux qui ont provoqué le phénomène avec légèreté soit en mesure de le traiter avec gravité. Que ceux qui ont invoqué des contraintes extérieures pour ne pas agir, notamment européennes, soit capables d’un seul coup de s’y soustraire. Que ceux qui faisaient des affaires avec les monarchies du Golfe, y compris un ancien Président de la république et un ancien chef d’état-major des armées, n’ont pas fermé les yeux sur leur prosélytisme salafiste dévastateur.
La grande attaque sera peut-être le coup grâce, non pas de la France qui a résisté à bien plus, mais d’une certaine France. Le balancier permanent entre l’ouverture et la sécurité, pour l’instant oscillant, basculera largement du côté cette dernière dans un pays à cran. Les conséquences politiques internes en seront sans doute considérables, en particulier en période électorale. Les conséquences sociétales le seraient aussi, ce serait d’ailleurs peut-être un des objectifs de l’attaque. Il faudra gérer la crise autrement que par des slogans, des numéros verts et la désignation de « référents » antiracistes. Il faudra gérer des colères de tous côtés et on ne voit pas très bien comment cela évoluera.
-
Fascisme, Fascismes, National socialisme
1. Définitions
Le fascisme est une idéologie de troisième voie, se présentant à la fois comme antimarxiste et comme anticapitaliste, et que l’on peut qualifier du terme plus général de socialisme national. Sa version italienne, celle fondée par Benito Mussolini, met surtout l’accent sur le rôle de l’état et de l’imperium (le pouvoir de commandement), d’où son symbole, le faisceau des licteurs romains. Sa version allemande, le Nationalsozialismus, met en revanche l’accent sur le concept de la race, du Volk c’est à dire du peuple considéré dans une perspective essentiellement ethnique.
De nombreux mouvements politiques entre 1880 et 1945 peuvent être définis comme fascistes. Ainsi la Tchernaya Sotniya russe (Centuries Noires) du début du siècle, la Falange de Jose-Antonio Primo de Rivera en Espagne, le Movimento Nacional Sindicalista de Rolão Preto au Portugal, la Garde de Fer roumaine de Zelea Codreanu puis d’Horia Sima, le Zbor serbe de Dmitri Ljotic, les Croix Fléchées de Ferenc Szalasi, sont des partis fascistes. On peut considérer l’Union du Peuple Russe de Doubrovine, fondée en 1905, comme le premier parti fasciste.
Pour définir un parti ou un état fasciste, un certain nombre de critères sont nécessaires. Le fascisme est d’abord un socialisme c’est à dire qu’il s’oppose au capitalisme, mais il s’oppose également au marxisme perçu comme un faux socialisme, car mondialiste et donc à terme capitaliste, en défendant un socialisme national. Les chefs fascistes proviennent très majoritairement de la gauche socialiste et sont donc perçus comme des adversaires par la droite. C’est le cas de Mussolini, qui vient du P.S.I, ou d’Hitler, issu de la S.P.D, mais aussi de Mosley, venu du Labour Party, de Quisling, venu du parti communiste norvégien, ou encore de Doriot, issu des rangs du P.C.F, et de Déat, transfuge de la S.F.I.O.
C’est également un nationalisme mais révolutionnaire. A la vision droitière et cléricale de la nation, style Action Française ou Salazarisme, le fascisme oppose une nation enracinée et une société en accord avec ses valeurs ancestrales. Ainsi, le rejet national-socialiste du christianisme se justifie par la valorisation des idéaux germaniques et, entre autres, du culte des divinités germano-scandinaves, culte émanant du peuple lui-même. En conséquence, le fascisme met naturellement en avant le paganisme, celui du peuple auquel chaque parti fasciste s’adresse. C’est surtout le dieu suprême des vieux paganismes que les fascistes sollicitent — le Wotan/Odhinn germanique des SS, l’Ukko finnois du Lapua, l’Isten hongrois de Szalasi ou encore le Jupiter romain.
Face à la double concurrence sur les questions économiques, sociale-démocrate d’une part, libérale-démocrate d’autre part, le fascisme se fait également corporatiste. Il propose de moderniser le principe des anciennes corporations d’avant-1789 afin de forger un syndicalisme national où la grève est remplacée par la concertation entre travailleurs et employeurs à l’intérieur d’une même structure appelée corporation et, sur le plan national, dans une chambre corporative. C’est le sens du corporatisme italien ou encore de l’Arbeitsfront allemand.
Le fascisme est également favorable à la formation d’une Nouvelle Europe dans une perspective aryaniste. L’idée européenne tend à remplacer le nationalisme étriqué par un nouveau nationalisme, résolument moderne. L’Internationale Fasciste forgée par Mussolini répond à cette exigence comme y répond l’union des Fascistes dans le cadre de l’Europe allemande face aussi bien à la Russie marxiste qu’à l’Occident libéral. La Waffen-SS, dans laquelle près de 300.000 non-allemands issus de trente nations différentes et provenant de partis fascistes combattront, est également une confirmation de cette solidarité fasciste qui dépasse le nationalisme ancien, fidèle aux nations anciennement définies, pour promouvoir un nationalisme socialiste et européen. Cela explique pourquoi, en France, tant d’hommes de gauche dans le cadre de la collaboration ont combattu au service de l’Allemagne national-socialiste, comme Marcel Déat, Paul Marion, Gaston Bergery, Victor Arrighi, Pierre Laval ou Jacques Doriot.
Il faut également constater que l’arrivée au pouvoir des fascistes s’est faite selon deux conditions.
En premier lieu, il s’agit de l’abandon, provisoire et hypocrite, d’une partie du programme socialiste. Ainsi la «gauche national-socialiste», c’est à dire les partisans de la «fidélité absolue aux idées socialistes», comme les frères Otto et Gregor Straßer ou encore Ernst Röhm, le chef de la S.A, ont été sacrifiés par Hitler. Si une telle tactique n’est pas mise en œuvre ou si le modèle allemand est imité de manière trop servile, comme le firent Mussert aux Pays-Bas, Quisling en Norvège ou Clausen au Danemark, c’est l’échec.
En second lieu, le machiavélisme d’Hitler ou de Mussolini consiste, alors que leur parti fasciste est le premier parti du pays, au-delà de 30% des électeurs, à profiter de leur position de force et à s’allier tactiquement avec la droite conservatrice voire libérale en mettant l’accent sur le rejet du communisme ou du chaos. Cette alliance leur permet d’arriver démocratiquement au pouvoir, justifiant d’un réel soutien populaire. Les marxistes, ne comprenant la politique que par le prisme réducteur et déformant du matérialisme historique et de l’économisme, parlèrent du fascisme comme du stade suprême du capitalisme et comme un mouvement financé par les patrons, ce qui ne résiste pas aux faits. Comme le pense David Schoenbaum, on peut parler pour le national-socialisme de véritable «révolution brune». De la même façon, les chefs fascistes se rapprochent de l’Eglise, d’où la signature de concordats, ce que Napoléon, aussi antichrétien que Mussolini et Hitler, avait déjà fait. Là encore, il n’y a rien de sincère. Hitler a besoin du parti Zentrum, catholique, pour obtenir les pleins pouvoirs et Mussolini veut bénéficier d’un crédit supérieur dans l’opinion italienne et internationale.
En effet, lorsque les fascistes ont les mains libres et peuvent exprimer leur caractère révolutionnaire, le programme socialiste resurgit. Ainsi la République sociale italienne de Mussolini de 1943 à 1945, a pris des mesures farouchement socialistes, notamment de nombreuses nationalisations. Cela a été grandement facilité par la trahison des conservateurs lorsque la défaite devient possible. Mussolini est ainsi chassé du pouvoir en 1943 sous la pression des hiérarques réactionnaires, dont Ciano, et du roi d’Italien Victor-Emmanuel III. En 1944, c’est la droite conservatrice qui tente d’assassiner Hitler et de prendre le pouvoir par un coup d’état. A partir de cette rupture, Hitler comme Mussolini montrent leur vrai visage socialiste et révolutionnaire.
Il convient également d’évoquer l’antisémitisme et le racialisme, terme plus précis et plus juste que «racisme», du fascisme. Si le racisme est pratique, le racialisme est théorique. Il apparaît plus important dans le national-socialisme allemand mais aussi dans les divers fascismes français ou encore dans les mouvements fascistes d’Europe centrale et orientale que dans le fascisme italien par exemple ou dans des pays comme l’Espagne, l’Irlande, le Portugal et la Grèce. Mais il appartient en théorie à l’ensemble des fascismes. L’antisémitisme fasciste est essentiellement de gauche, mais de celle du XIXème siècle. De Blanqui à Jaurès, en passant par Fourier, Proudhon, Bakounine, Regnard, Malon ou même Marx, la gauche européenne défend un antisémitisme athée ou néo-païen, bien distinct du vieil antisémitisme chrétien.
En effet l’antisémitisme fasciste s’explique par le rejet du christianisme, religion sémitique, mais aussi celui du bolchevisme, considéré comme juif, et du capitalisme, lui aussi perçu comme juif. Il s’explique également par l’aryanisme fasciste, qui perçoit les Juifs comme des membres particulièrement nuisibles de la race sémitique ou en tout cas des étrangers au monde européen. Les Juifs sont, a priori au même titre que les Arabes, des ennemis, puisqu’ils visent à négrifier l’Europe et à avilir ainsi, par le métissage, la «noble race aryenne» ; les Sémites de manière globale seraient ainsi responsables à leurs yeux de la mort de l’empire romain par l’abâtardissement et par la christianisation.
Le racialisme fasciste apparaît comme une extension de l’antisémitisme mais pas seulement. Gregor Straßer souligne, par exemple, la menace qui pèse sur l’Europe de la part aussi bien du monde négro-africain que de la Chine. La race aryenne ou blanche étant supérieure, ce qu’elle a prouvé sur le terrain par son avancée scientifique, technique mais surtout culturelle, les autres races sont vues comme inférieures. Le métissage favorise toujours les éléments racialement inférieurs et abâtardit la race, risquant même d’engendrer des dégâts irrémédiables. Pour défendre la race aryenne, il faut donc combattre les autres races. L’axe Berlin-Tokyo apparaît donc comme une trahison de l’idéal aryo-fasciste. De même, le refus de la part d’Hitler d’intégrer les Slaves, les Indiens voire les Latins dans son aryanisme est une autre trahison, coûteuse puisque responsable de la défaite du IIIème reich. -
C’est confirmé : un des terroristes est rentré en Europe en se faisant passer pour un « migrant »
C’est l’information la plus important de ces dernières 24h. C’est la preuve que les combattants de l’État Islamique se sont servis des frontières grandes ouvertes et de la pleurniche autour des migrants pour nous attaquer. Il faut diffuser cette information au maximum et demander l’inversion immédiat des flux migratoires.
-
Zoom : Ukraine : La population du Donbass, première victime de la crise (13-11-2015)
Lien permanent Catégories : actualité, Europe et Union européenne, géopolitique, lobby 0 commentaire -
Attentats : qui arrêtera de mentir ? Qui osera le mot qui tue ?
Depuis cette nuit, la France est en deuil. Elle est en guerre, aussi. L'ennemi se déclare lui-même, annonce la couleur sans ambages, tue sur notre sol, nous sommes en guerre. La France ce matin se vêt de noir, elle est en deuil. Les politiques, chef de l'Etat en tête - il était bien dans son rôle - y sont allés de leur déclaration, le visage grave et le tweet épique; les larmes affleuraient.
Mais la gravité du moment, qui devrait électriser la France, la faire se réveiller en sursaut de cet affreux cauchemar, n'a pas suffi, politiques et médias dorment toujours, du sommeil nauséeux de l'alcoolique. Un mot, un seul, qui aurait pu montrer que la France a pris la mesure du danger, n'a pas été prononcé : le mot qui tue, le mot "islamique". Car c'est bien aux cris d'"Allah Ouakhbar" que des Français sont morts. Les alcooliques reprendront une dose accrue de Padamalgam, continueront de mentir par omission et... les islamistes recommenceront. Plus fort, plus grave, plus souvent. Notre-Dame de France, ayez pitié de la Fille aînée de l'Eglise de votre Fils.
Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, immigration, insécurité, islamisme, lobby 0 commentaire -
Et après ?
On connait la chanson, selon cette tribune de nouvelles de France.
Et un et deux zéro pour les islamistes. Paris vit à nouveau des scènes de guerre. Les médias s’emballent enchaînant les gros titres, les superlatifs et les « alertes infos ». On cherche l’exclusivité ou l’image choc. Les citoyens s’affolent dans les rues et consultent frénétiquement leur Smartphone. Les politiques s’agitent dans tous les sens à coup de déclarations et de tweets. Par correction, ayons bien sûr une pensée pour les familles des victimes qui n’ont rien demandé.
Dans les jours qui viennent, on va nous ressortir les experts en terrorisme nous expliquant que la menace est permanente et que les forces de l’ordre ont fait preuve d’un grand professionnalisme. D’autres justifieront ces actes en ressortant la jeunesse difficile de ces pauvres types livrés à eux-mêmes et que la société a rejetés. On interrogera la vieille du coin qui nous dira qu’Ahmed ou Kader étaient des gens biens, tout à fait intégrés et serviables. Hollande prendra un ton grave, Valls un ton martial, Cazeneuve un ton technocrate pour nous expliquer que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des Français, que des plans rouge, jaune, violet ou indigo ont été activés. On va réunir des conseils de guerre en cascade et convoquer les ministres à l’Elysée pour donner l’impression que tout est sous contrôle. On va déployer policiers et militaires à tous les coins de rues.
« Hollande, l’ami de l’Arabie Saoudite et du Qatar, va reprendre de l’altitude dans les sondages. Il sait tellement bien surfer sur le sang. »
Puis viendra le temps des commémorations, des marches blanches, des discours creux et de l’émotion. Ah l’émotion ! Le point névralgique qui permet de neutraliser toute réflexion, de tuer tout débat, de soumettre tout dissident. Vous allez les voir défiler en boucle ces images de visages fermés, en larmes, de citoyens bras dessus, bras dessous. On nous serinera le pas d’amalgame. On nous rappellera les valeurs de la république. Il faudra afficher « Je suis Bataclan » ou « Je suis Stade de France ». On sera prié de jouer l’unité nationale. Tous ceux qui penseront différemment seront insultés et voués aux gémonies. Hollande, l’ami de l’Arabie Saoudite et du Qatar, va reprendre de l’altitude dans les sondages. Il sait tellement bien surfer sur le sang.
Quand les esprits se seront calmés et que d’autres sujets d’actualité auront pris le relais, le ministère de l’Intérieur confessera discrètement qu’il s’agissait d’individus fichés. Celui de la Justice avouera que certains sortaient de prison. Mais Valls voudra reprendre l’avantage et annoncera une énième loi antiterroriste… C’est-à-dire ? Une loi pour remettre l’ordre dans les banlieues et envoyer l’armée affronter le trafic d’armes ? Une loi pour contrôler définitivement les frontières ? Une loi pour renvoyer les illégaux chez eux ? Une loi pour autoriser les citoyens à s’armer et leur donner une chance de se défendre face aux islamistes ? Non, vous n’y pensez pas. Ce sera une loi pour surveiller et restreindre un peu plus les libertés des honnêtes gens. Bref, une loi inutile contre nos adversaires, comme d’habitude.
« Après avoir séché ses larmes, une majorité de citoyens va continuer de refuser la réalité par lâcheté. La société multiculturelle ? C’est bien. L’immigration ? C’est sympa. L’islamisation ? C’est une vue de l’esprit. »
Puis, le plus important sans doute, après avoir séché ses larmes, une majorité de citoyens va continuer de refuser la réalité par lâcheté. La société multiculturelle ? C’est bien. L’immigration ? C’est sympa. L’islamisation ? C’est une vue de l’esprit. Non, ces attentats, c’est la faute à pas de chance ma pauvre Lucette… On était un vendredi 13 je vous rappelle. Puis avec l’extrême droite qui souffle sur les braises, ça ne peut pas s’arranger.
Bizarrement, je ne croirai pas à tout ce cirque. Je continuerai d’être un affreux fasciste qui considère l’arrêt de l’immigration comme une priorité vitale et qui supplie nos gouvernants d’admettre que nous sommes en guerre avec l’islam. Bizarrement, comme rien de tout cela ne sera envisagé, je m’attends à d’autres événements du genre. Et si le prochain attentat était un 11 septembre à la française ?