Collin Cleary, L’appel aux dieux, essai sur le paganisme dans un monde oublié de dieu (Les Editions du Lore, 2016)
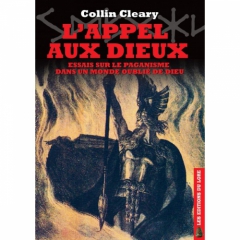 Qu’il est dur d’être païen ! Ou plus exactement « néo-païen ». Qu’est-ce que cela peut bien dire d’ailleurs « néo-païen » ? Peut-on être culturellement et/ou cultuellement « néo-païen » ? Et surtout à quoi cela peut-il « servir » d’être ou de se proclamer du paganisme en général ?
Qu’il est dur d’être païen ! Ou plus exactement « néo-païen ». Qu’est-ce que cela peut bien dire d’ailleurs « néo-païen » ? Peut-on être culturellement et/ou cultuellement « néo-païen » ? Et surtout à quoi cela peut-il « servir » d’être ou de se proclamer du paganisme en général ?
La nébuleuse « néo-païenne » en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique recouvre un ensemble d’individus, de groupes et d’organisations les plus différentes les unes des autres, dont les conceptions et la praxis diffèrent toutes autant. Ne parlons même pas de l’identité spirituelle du « néo-paganisme » : Grecque ? Germanico-nordique ? Celte, voir même Indo-aryen ? En ce qui nous concerne,l’identité spirituelle du « néo-paganisme » devrait se référer au triumvirat Boden – Blut – Geist (Terre, sang, esprit) "ordonné évidemment du supérieur à l'inférieur et en accord avec l’être particulier de chacun."
Néanmoins,et en admettant que l’on a trouvé son identité spirituelle « néo-païenne », c’est-à-dire sa propre « paganité », il est somme toute difficile, pour certaines personnes se réclamant du (néo) paganisme, d’agir contre la vacuité spirituelle qu’ils ressentent en eux. En effet point de praxis religieuse établie officiellement ; d’expériences de communion avec les dieux, seul ou en groupe ; de corpus de textes sacrés et considérés comme tels ou même d’épisodes recensés de théophanie par exemple. Enfin, une psyché modelée par des siècles et des siècles de christianisme, même sécularisé dans diverses idéologies modernes (laïcité issue des lumières et marxisme principalement) est indéniablement un frein à la redécouverte puis à l’incarnation de notre « paganité ». En conséquence il n’est pas rare dans notre vaste milieu politique de voir certains se convertir au catholicisme. L’appel aux dieux, essai sur le paganisme dans un monde oublié de dieu de l’auteur américain Collin Cleary pourrait bien marquer les esprits ou plutôt les ouvrir aux dieux.
Fondateur du journal TYR – Myth- Culture – Tradition aux cotés de Joshua Buckley et Michael Moynihan, Collin Cleary est également membre de la Rune-Gild. Le lecteur aura l’occasion d’en savoir plus sur l’auteur via l’introduction. Il serait plus parlant de citer les influences de Collin Cleary et elles sont nombreuses : Julius Evola, Hegel, Lao-Tseu, Heidegger, Alain Danièlou et Alain de Benoist, Platon et Aristote ainsi que son ami Edred Thorsson. Cleary fait preuve d’une véritable maitrise des concepts développés par les philosophes précités et, quant à sa connaissance des doctrines orientales, elle impose également le respect. Bref, vous l’aurez compris, nous avons affaire en la personne de Collin Cleary à un érudit. Tout simplement.
Les Editions du Lore ont eu l’excellente idée de faire traduire certains essais de Cleary et de les rassembler dans le présent recueil. Celui-ci est divisé en trois grandes parties : « Néo-paganisme », « Paganisme nordique » et « Parmi les ruines ». Nous nous concentrerons principalement sur la partie intitulée « Néo-paganisme » car elle recèle deux essais, Connaître les dieux et L’appel aux dieux qui sont fondamentaux et fondateur de la pensée de Collin Cleary.Par ailleurs, une critique intitulée Paganisme sans dieux : Alain de Benoist et Comment peut-on être païen ? entrera en résonance avec les interrogations exprimées plus haut dans mon introduction. Les deux autres parties seront naturellement évoquées et commentées.
« Néo-Paganisme »
I. Connaître les Dieux
Dans cet essai paru en 2002 dans le premier volume de la revue TYR : Myth – Culture – Tradition, Collin Cleary expose la théorie de base de ce qui deviendra son système de pensée. En premier lieu, une mise au point salutaire quant au concept de « l’ouverture aux dieux » s’impose. En effet cette dernière est le plus souvent biaisée, faisant même office de simulacre car envisagée uniquement d’un point de vue moderne, c’est-à-dire, dans ce cas précis, rationaliste, alors que « l’ouverture au divin est rendue possible par un point de vue plus fondamental : l’ouverture à l’être des choses elles-mêmes », soit un parti pris heideggerien . La compréhension du divin passe donc belle et bien par une ouverture, mais une ouverture au sensible, véritablement naturelle pour les hommes, et non pas par une ouverture rationnelle. On comprend ainsi que c’est notre fermeture qui n’est pas naturelle. Le premier pas vers une réouverture consiste en un « changement radical dans notre manière de nous orienter vis-à-vis des êtres, et ceci doit commencer par une critique radicale et impitoyable de tous les aspects de notre monde moderne. »
Selon Collin Cleary les hommes sont naturellement prédisposés à « l’ouverture à l’être » mais aussi à se fermer : « La nature humaine, comme vie réelle en présence de ce qui est «supérieur » (le surnaturel, le divin, le transcendant, l’idéal), existe dans une tension constante entre deux impulsions jumelles : l’impulsion à s’ouvrir au supérieur, et l’impulsion à se fermer à lui. L’une est l’impulsion à atteindre une chose plus grande que nous-mêmes, la laissant nous diriger et (littéralement) nous inspirer. L’autre est l’impulsion à nous fermer à elle et à nous élever nous-mêmes au-dessus de tout. Par manque d’un meilleur mot, je désignerai cette dernière tendance par le mot de Volonté. Les deux tendances – ouverture et Volonté – sont présentes dans tous les hommes. Elles expliquent la grandeur des hommes, ainsi que leur coté obscur. »
Cette notion centrale de « Volonté », que l’on pourrait comparer à « l’esprit Faustien » décrit en son temps par Oswald Spengler, bien que « naturelle et nécessaire à la nature humaine » doit être canalisée. Effectivement, si elle n’est pas bridée, la Volonté devient irrémédiablement un « humanisme titanique » dont le principe serait de « faire de l’homme la mesure, d’exalter l’homme comme le but et la fin de toute l’existence, de plier toutes les choses aux désirs humains. » Cette impulsion à l’arrière-gout d’hubris résonne en nous d’une manière tragique car on comprend que la Volonté est la « pneuma », le souffle vital de toutes les philosophies issues des Lumières. Cleary confirme cette impression : « l’âge moderne est l’Âge de la Volonté, l’âge de l’Humanisme Titanique. La modernité est unique dans l’histoire humaine, parce qu’à aucune autre époque la Volonté n’a aussi complètement triomphé de l’ouverture. »
Cette fermeture au divin est progressive. La première étape est une séparation entre les hommes et la nature, osmose qui est capitale si l’on veut connaître les Dieux : « L’ouverture à la nature […] rend possible l’ouverture à un autre monde de forces et de pouvoirs – un monde qui contient et qui pourtant transcende la nature. C’est le monde des dieux. Nous fermer au monde naturel signifie inévitablement nous fermer au divin. » Nos ancêtres avaient en effet un lien direct avec la nature, condition sine qua non pour expérimenter les dieux. Le rapport « hommes - nature » était évidemment différent. De facto, La nature apparaissait autrefois comme une force coercitive, indomptée, qui inspirait à la fois respect et crainte. Et cette césure c’est la « Volonté » qui, via son avatar, « l’esprit faustien », va en être responsable. Elle opéra à un véritable bouleversement qui se réalisa, dans le cas qui nous intéresse ici, de deux manières. Premièrement, une « césure technique » qui va d’abord permettre aux hommes de se protéger de la nature avant de dévier vers une maitrise, puis vers une domination. Dès lors on comprend que l’homme moderne, du fait de son mode de vie éminemment bourgeois, rien que par sa quête du confort absolu qui l’induit dans un doux cocon hédonisto-matérialiste, est ontologiquement un être fermé. Deuxièmement, la « Volonté » opère à une « césure métaphysique et spirituel » prométhéenne qui s’accomplit elle aussi de deux façons distinctes : « La première est la manière que j’ai déjà décrite : l’homme peut rejeter le divin, déclarer qu’il n’a pas besoin de lui » ; soit le meurtre de Dieu conceptualisé par Friedrich Nietzsche, envisagé en tant qu’acte de naissance, en quelque sorte, du rationalisme et du scientisme modernes. « La seconde manière est de tenter de concevoir une méthode spéciale de combler le gouffre séparant l’homme du divin, sans nier la réalité de ce dernier. Cette méthode est appelée mysticisme. Les mystiques pensent qu’ils s’élèvent jusqu’à l’union avec le divin. Ils ne voient pas que ce processus pourrait aussi bien être décrit dans l’autre sens : l’abaissement de Dieu au niveau de l’homme. La divinisation de l’homme et l’anthropomorphisation de Dieu sont la même chose ».
Mais alors comment réaliser l’ouverture aux dieux ? Pour commencer Cleary préconise de créer un « espace », une « clairière » selon les mots du philosophe allemand Heidegger, pour accueillir les dieux. Comme nous l’avons vu précédemment, il est impératif de modifier en profondeur notre relation à la spiritualité, à la religion et au divin en éradiquant : « l’approche moderne pour comprendre la religion [qui] consiste à la traiter comme l’une des nombreuses activités auxquelles les hommes participent […]. La vérité, cependant, est que c’est dans la religion que l’on trouve l’être même de l’homme. ». Et pour conclure cette entrée en matière, l'auteur émet quelques suggestions, développées plus en détail dans un appendice inédit, pour parachever cette fameuse ouverture. Ces suggestions, nous préférons ne pas les dévoiler et laisser le lecteur les découvrir par lui-même. Elles ne font pas figure de lois mais de pistes, sans doute perfectibles, voir discutables. Nous conclurons en citant Collin Cleary : « Les dieux se trouvent aux limites extérieures de notre perception de la réalité, définissant le réel pour nous. L’explication prend place seulement à l’intérieur de ces limites ».
II. L’appel aux Dieux, la phénoménologie de la présence divine
Ce second essai qui, à l’instar du premier, fut publié dans la revue TYR : Myth – Culture – Tradition est une continuation de Connaitre les dieux ; texte pionnier dans la démarche spirituelle de Cleary et faisant également office de « mindset ». Après un bref rappel des causes de notre « fermeture aux dieux » (« pour les modernes, la nature n’a essentiellement pas d’Être : elle attend que les humains lui confèrent une identité » et « en nous fermant à l’être de la nature, nous nous fermons simultanément à l’être des dieux. ») l’auteur rentre dans le vif en exprimant sa thèse : « notre émerveillement devant l’être de choses particulières est l’intuition d’un dieu, ou d’un être divin. »
A travers un développement où se côtoient Platon, mais aussi les études linguistiques indo-européennes, Heidegger ou l’alchimie taoïste, Collin Cleary apporte une perspective nouvelle et originale de notre relation et de notre compréhension du divin, a fortiori d’une manière intelligible. Mais une fois de plus, nous pensons qu’il n’est pas de notre rôle de faire découvrir les observations et conclusions de l’auteur. En un sens cela briserait la « magie » et priverait l’auteur de déployer son talent envers son tout nouveau public francophone. Toutefois nous nous devons d’apporter quelques précisions :
Primo : les conceptions du divin polythéistes et monothéistes sont essentiellement dissemblables. Dès lors le lecteur devra faire attention à ne pas user (involontairement ou non) de réflexes trompeurs issus d’une culture monothéiste, même sécularisée. Pour autant il n’est pas non plus nécessaire de faire partie d’un « coven » de Wiccas pour comprendre la weltanschauung polythéiste.
Deuxio : Il serait maladroit d’utiliser le terme de paganisme. En effet le terme paganisme vient du latin paganismus/paganus communément traduit par « paysan ». Il est donc question dans ce cas-là d’un ancrage territorial, en l’occurrence la ruralité, avec ses particularismes, notamment ses lieux de cultes (les sources par exemple) et ses geniiloci. Hors, Cleary ne parle pas de nature en tant que Bios mais comme l’en soi ainsi (ensemble de forces, en particulier de la vie, ou principe supérieur, considéré comme à l'origine des choses du monde, de son organisation). En bon lecteur de Julius Evola, il s’orienterait plutôt vers une spiritualité solaire et ouranienne telle qu’elle fut défendue par l’auteur de Révolte contre le monde moderne.
Tercio : Il ne faut pas s’attendre à un déballage de Modus Operandi pour faire apparaître Thor, Lugh ou Hekate dans votre salon comme si quelconque formes de théophanie pouvaient être commandées et livrées chez vous comme une vulgaire pizza. Les réflexions de Collin Cleary appartiennent plus au domaine métaphysique, au sens « Evolien » du terme. Mais pas de méprise : L’appel aux dieux n’est pas un essai pompeux et abscons. Malgré moultes références mythologiques et philosophiques, Cleary réussit avec brio à rendre son sujet accessible grâce des exemples clairs.
Quartio : le lecteur ne sera peut-être pas d’accord avec l’auteur. Soit car sa vision et son expérience du divin sont différentes, soit car le rationalisme avec lequel nous sommes nourris depuis notre plus jeune âge est encore trop présent. Vouloir expliquer le divin par la raison ne fut pas toujours une réussite (comme détaillé dans l’essai Connaître les dieux).
III. Paganisme sans dieux : Alain de Benoist et Comment peut-on être païen ?
Dans la quatrième remarque au sujet du texte précédent, nous mettions en évidence que le lecteur ne sera pas forcément en phase avec la vision du polythéisme de Cleary. Il est justement question ici d’une confrontation de visions entre celle de l’auteur et celle d’Alain de Benoist, plus précisément le Alain de Benoist de l’époque de Comment peut-on être païen ? (1). Bien que l’on sente le respect de Cleary envers le chantre historique de la Nouvelle Droite Française, il décoche néanmoins des flèches aiguisées comme des lames de rasoir : « Essentiellement, ce que Benoist nous présente est un humanisme athée qui se réapproprie certaines attitudes et des valeurs des anciens païens, mais qui évite leur religion ».
Effectivement, nombre d’entre nous furent plus que surpris lors de la lecture du livre d’Alain de Benoist. Pour commencer le titre a de quoi induire en erreur et aurait plutôt dû être Comment ne pas être monothéiste ? Alors certes, les critiques envers les religions abrahamiques sont valides et pertinentes mais demeurent prépondérantes par rapport au développement de la « paganité ». Nous y voyons, comme le souligne Collin Cleary, l’influence capitale de Nietzsche sur de Benoist : « l’approche de Benoist dans Comment peut-on être païen ? est, du début à la fin, nietzschéenne. Il ne fait aucune tentative pour le dissimuler : Nietzsche est cité à de nombreuses reprises dans tout le livre. En fait, un commentaire peu charitable sur la position de Benoist dans cet ouvrage serait de dire que c’est un humanisme nietzschéen déguisé en paganisme ».
Le « paganisme faustien » défendu par Alain de Benoist a forcément de quoi déplaire à Collin Cleary car, qui dit « paganisme faustien » dit « esprit faustien », soit une forme paroxystique de la « Volonté » concept défini par l’auteur dans Connaître les dieux. C’est ce qui fait dire à Cleary qu’Alain de Benoist se réapproprie maladroitement le concept nietzschéen d’Übermenschen(surhommes) pour caractériser ontologiquement nos ancêtres païens ; « l’anthropocentrisme […] est l’essence du nouveau paganisme de Benoist », c’est-à-dire une erreur primordiale quant à la compréhension du polythéisme pratiqué par nos ancêtres.
Pour Alain de Benoist les dieux seraient des créations humaines dont le substantif consisterait en des valeurs anthropomorphisées, ce qui confirmerait la thèse d’un humanisme athée d’essence nietzschéenne et paganisant. Là se situe la divergence première entre Alain de Benoist et Collin Cleary : « Sa position est fondamentalement athée ; la mienne théiste ». D’où un questionnement légitime quant à la notion objective de vérité (religieuse), et encore une fois l’auteur deComment peut-on être païen ?, au même titre que Nietzche, se complait dans un relativisme moral qui « découle de son engagement en faveur d’un relativisme général concernant la vérité en tant que telle ». « Là se trouve le problème-clé avec l’approche de Benoist concernant la vérité et les valeurs : il a simplement accepté la prémisse du monothéisme, selon laquelle le seul standard d’objectivité devrait se trouver à l’extérieur du monde. Rejetant l’idée qu’il existe un tel standard transcendant, il en tire la conclusion que l’objectivité est donc impossible ». Et en conclusion « le relativisme de Benoist concernant la vérité et les valeurs semble être tout à fait étranger au paganisme » si bien que « ces difficultés philosophiques avec cette position sont très graves, et probablement insurmontables ».
Quiconque espérait un développement théiste de la « paganité » fut assez déçu de constater que cette dernière se résumait, dans le livre d’Alain de Benoist, à une Weltanschauung ainsi qu’à l’affirmation d’une pseudo « paganité » à travers l’opposition radicale et viscérale aux monothéismes abrahamiques. Du même coup, la Weltanschauung exprimée par Alain de Benoist est sujette à caution. On peut en conclure que trop de Nietzsche tue le païen. Collin Cleary se réfère comme nous l’avons vu à Heidegger ainsi qu’à Aristote. Sa « paganité » n’est pas figée dans le passé, d’autant plus qu’elle est évolutive. Bref, la brillante critique théiste qu'il fait remet les pendules à l’heure, pour ne pas dire les idées à l’endroit…
« Paganisme nordique » et « Parmi les ruines »
Bien que nous ayons préféré nous attarder sur la première partie du recueil, les deux autres sont loin, très loin d’être dépourvues d’intérêt. Une fois de plus Collin Cleary s’affirme comme un érudit et un penseur brillant. De nature spéculative pour la plupart, ces essais sont, au même titre que les deux premiers textes présents dans L’appel aux dieux, des portes d’entrée vers de nouveaux espaces : libre au lecteur de scruter l’horizon à travers ces portes entrouvertes ou bien de franchir le pas.
Les textes de la partie intitulée « Paganisme nordique » démontrent les connaissances de l’auteur pour les théogonies germano-nordiques, « indiennes », la tradition indo-européenne et la Tradition au sens où l’entendirent René Guenon et Julius Evola. Il faut en outre saluer la sagesse acquise par Cleary via sa pratique et ses études personnelles sur le Zen, le tantrisme, le yoga ou encore le taoïsme. Ce cocktail détonnant ne doit aucunement dérouter le lecteur, bien qu’à première vue cela puisse être compréhensible : Quel rapport y a-t-il entre la tradition scandinave et la tradition indo-aryenne des Vedas ? Pour Collin, ces doctrines et ces mythologies contiennent des morceaux de ce que put être la Tradition. Evola la décrivait en ces termes : « au-delà de chaque tradition, plus profondément que chacune d’elles, il y a la Tradition – un corpus d’enseignements de caractère métaphysiques, donc totalement indépendant des contingences humaines et temporelles » (2).
L’interpénétration des philosophies grecques et allemandes, des mythes européens et des doctrines orientales et ce, malgré leurs différences de nature, s’avère particulièrement efficiente. C’est l’un des points forts de l’auteur. Les essais Quel dieu Odin adorait-il ? et Notes philosophiques sur les runes sont les travaux les plus intrigants de cette partie. Le premier aborde le thème de l’obtention de la connaissance runique par Wotan/Odin, déité primordiale de la théogonie nordique mise en perspective avec une autre déité, du panthéon indien celle-ci : Rudra/Shiva. Le deuxième essai, quant à lui, traite de la runologie d’un point de vue philosophique en usant de la tripartition hégélienne. Cette association a priori farfelue est pourtant cohérente. Mais n’étant (malheureusement) pas spécialiste des runes, nous nous garderons de proclamer cette démarche comme probante.
Enfin la dernière partie, « Parmi les ruines » est plutôt surprenante car elle analyse, sous la forme de deux textes, la cultissime série Le Prisonnier, puis l’autobiographie du cinéaste Alejandro Jodorowsky. Le premier est plus « politique » que le deuxième qui cherche à démontrer le caractère tantrique des expériences du réalisateur d’El Topo. Les arguments se tiennent, comme toujours chez Collin Cleary mais cette dernière partie est peut-être moins exaltante que le reste de l’ouvrage à défaut d’être originale.
A la fin de l’essai Le voyage spirituel d’Alejandro Jodorowsky, Cleary pose une question cruciale : « Mais comment revenir aux dieux, ou les faire revenir vers nous ? C’est la question qui tenaille les Traditionalistes radicaux et les neo-païens. Comment pouvons-nous faire cela alors que toutes les forces culturelles sont déployées contre nous, et alors que nous sommes tous – pour dire la vérité – des enfants de la modernité ? ». Nous citerons une fois de plus Julius Evola, car la réponse de Collin Cleary est une paraphrase du premier : « Dans une époque de dissolution générale, la seule voie que l’on peut essayer de suivre, c’est justement La Voie de la Main Gauche, malgré tous les risques que cela comporte » (3). La Voie de la Main Gauche est ni plus ni moins, si on l’envisage de façon imagée, la faculté à devenir imperméable à la dissolution du Kali Yuga. C’est opérer à une mithridatisation dont le monde moderne est, en totalité, le poison. Pour ceux qui sont éclairés par la Lux Evoliana cela fait office de simple rappel ; cela sera sans doute pour d’autres une occasion de découvrir l’œuvre d’Evola.
L’appel aux dieux, essai sur le paganisme dans un monde oublié de dieu est un appel à ceux qui aspirent à incarner « l’homme contre le temps »de Savitri Devi, c’est-à-dire à l’être qui va inlassablement à contre-courant, le courant étant, vous l’aurez compris, le monde moderne. L’un de ses attributs, le plus néfaste à coup sûr, est la désacralisation et la dé-spiritualisation absolues ; le remède est par conséquent la réouverture au divin prôné par Collin Cleary. Nous lui sommes redevables de mettre en lumière de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités pour cette réouverture. Une chose appréciable demeure dans le fait qu’à aucun moment il n'y a distanciation entre lui et nous. Pas de ton ex cathedramais une honnêteté, un sentiment de simplicité qui mettent en confiance et qui pondèrent une impressionnante connaissance philosophique et mythologique.
En conclusion, L’appel aux dieux, essai sur le paganisme dans un monde oublié de dieu est, selon nous, un ouvrage capital et assurément un futur classique. Nonobstant les nombreuses références philosophiques et théogoniques, le message qui sous-tend l’ouvrage est limpide. En conséquence, ces références ne doivent nullement rebuter le néophyte. Ce recueil s’adresse aux néo-païens et aux tenants de la Tradition Primordiale quel que soit leur niveau ou leur approche de la spiritualité. Dans l’introduction de Julius Evola, le visionnaire foudroyé(4), Jean Mabire déclarait à propos du penseur du haut des cimes que « Ceux qu’il a éveillés ne pourront plus jamais se rendormir ». Nous espérons qu’il en sera de même pour Collin Cleary et son œuvre.
Donatien/C.N.C.
Notes :
- Alain de Benoist,Comment peut-on être païen?, Albin Michel, 1981.
- Julius Evola, Impérialisme Païen, Éditions Pardès, 2004.
- Julius Evola, Le Chemin du Cinabre, Éditions Archè, 1983.
- Collectif, Julius Evola, le visionnaire foudroyé, Editions Copernic, 1977
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/archive/2016/04/06/chronique-de-livre-collin-cleary-l-appel-aux-dieux-5784905.html
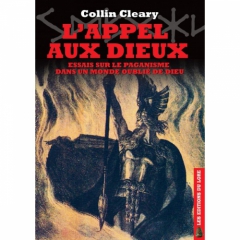 Qu’il est dur d’être païen ! Ou plus exactement « néo-païen ». Qu’est-ce que cela peut bien dire d’ailleurs « néo-païen » ? Peut-on être culturellement et/ou cultuellement « néo-païen » ? Et surtout à quoi cela peut-il « servir » d’être ou de se proclamer du paganisme en général ?
Qu’il est dur d’être païen ! Ou plus exactement « néo-païen ». Qu’est-ce que cela peut bien dire d’ailleurs « néo-païen » ? Peut-on être culturellement et/ou cultuellement « néo-païen » ? Et surtout à quoi cela peut-il « servir » d’être ou de se proclamer du paganisme en général ?