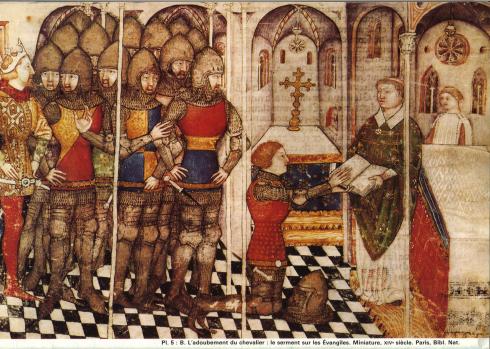Décédé le 25 février 2010 à l’âge de 65 ans, Jean-Claude Valla est une figure qui compte dans ce que la médiasphère a improprement appelé la « Nouvelle Droite » puisqu’il en fut l’un des co-fondateurs. Les éditions Alexipharmaque viennent d’éditer ses Souvenirs qui sont des Mémoires inachevés. Rédigé entre les années 1990 et le début de la décennie 2000, cet ouvrage intitulé Engagements pour la civilisation européenne retrace une partie de sa vie.
Né en 1944 à Marcigny dans le Sud de la Saône-et-Loire, le jeune Valla est très tôt happé par deux passions qui le tiendront jusqu’à la fin : la politique et la Bourgogne. Lycéen à Roanne, sous-préfecture et deuxième ville de la Loire, il fonde un fantomatique Comité des lycéens roannais pour l’Algérie française au lendemain de la semaine des barricades d’Alger en janvier 1960. Il s’affilie très jeune au mouvement poujadiste et rejoint sa branche juvénile, l’Union de défense de la jeunesse française dont il devient le responsable départemental car unique militant…
Il tempère son militantisme poujadiste par une adhésion quasi-charnelle à sa petite patrie qu’est la Bourgogne. Déjà épris d’histoire, Jean-Claude Valla aime sa terre natale. De son enfance passée à Marcigny, il a « conservé un attachement profond à la Bourgogne (p. 19) », particulièrement « la Bourgogne mythique des Nibelungen ou la Bourgogne héroïque du Téméraire (p. 21) ». Ce régionalisme original se concrétise en hiver 1972 par la sortie d’un périodique, Grande Bourgogne, qu’il co-anime avec Pierre Vial. Mais, faute d’audience et de succès, ce numéro n’a pas de suite.
Un profil populiste, régionaliste et nationaliste révolutionnaire précoce
Le régionalisme de Valla peut se définir comme culturel et nullement folklorique (au sens désobligeant du terme). Son intérêt pour la politique l’incline aussi vers le nationalisme étatique, rénové et révolutionnaire. Élève dans une classe préparatoire à Lyon afin d’intégrer la « Grande Muette », il rêve en ce temps « d’une armée de type nassérien, capable de prendre le pouvoir lorsque les intérêts du peuple étaient en jeu et d’être le fer de lancer de la nation (p. 43) ». À la même époque, il rencontre un mouvement qui porte une vision nationaliste ardente et actualisée : la F.E.N. (Fédération des étudiants nationalistes) dont les motivations l’attirent, lui qui a « du nationalisme une conception plus dynamique, plus révolutionnaire, et surtout plus ouverte à l’Europe (p. 34).
Privilégiant l’activisme aux amphithéâtres universitaires, Jean-Claude Valla devient rapidement une personnalité connue des quelques militants lyonnais de la F.E.N. ainsi que des policiers qui l’arrêtent souvent pour le placer en garde à vue. Le livre contient des anecdotes savoureuses qui rappellent l’abjection permanente de la police du Régime. Remarqué par les instances dirigeantes, il monte à Paris à l’automne 1965, s’occupe de la logistique de la revue Europe Action et devient le factotum de Fabrice Laroche alias Alain de Benoist : « Je lui servais, par exemple, de coursier pour aller chez les éditeurs chercher ses livres en service de presse (p. 70). »
Militant dans la capitale des Gaules, Jean-Claude Valla a auparavant animé divers bulletins universitaires spécialisés dont Les Sept Couleurs conçu pour les étudiants en lettres. Sous le pseudonyme de Jacques Devidal, il publie en janvier 1965 un retentissant « Nous, les nationalistes de gauche » qui, malgré une évocation de José Antonio Primo de Riviera, indispose les éternels droitards compassés. Il y estime avec raison que « le nationalisme devait définitivement tourner le dos à la droite conservatrice (p. 49) ». Dans le même temps, ce « nationalisme » soucieux de justice sociale acquiert une autre dimension, au-delà de la simple nation politico-historique : « Nous étions européens, parce que nous étions conscients de la communauté de destin des peuples du Vieux Continent (p. 78). » Déjà s’élaborait instinctivement en lui la riche thématique des trois patries régionale, nationale et continentale complémentaires. Il n’est dès lors guère surprenant qu’il se réfère souvent à quelques figures « solidaristes » ou nationales-syndicalistes comme José Antonio, le Flamand Joris van Severen, les Allemands Ernst von Salomon et Ernst Jünger.
Toutefois, au moment où il entame cette rédaction, il revient un peu sur son engagement régional et européen. Il considère ainsi « que l’État-nation est une réalité encore bien vivante. Il m’arrive encore de le regretter, mais c’est ainsi. Des siècles d’histoire ont forgé cette entité. […] certes, après avoir subi pendant deux siècles la dictature des principes abstraits de la Révolution, il n’est pas mauvais que les Français redécouvrent leurs racines régionales et, au-delà de ces racines, prennent conscience de l’héritage culturel qu’ils ont en commun avec les autres Européens. Mais aujourd’hui, c’est notre survie collective qui est menacée, que ce soit par l’immigration, la construction de l’Europe de Maastricht ou l’impérialisme culturel américain. Nous avons un devoir de résistance et ce n’est pas le moment de détruire les dernières digues qui nous restent, aussi vermoulues soient-elles (p. 81) ». Est-ce si certain à l’heure de la post-modernité bouillonnante ?
Ces souvenirs incomplets rapportent aussi en trois chapitres la fondation et le développement du G.R.E.C.E. : Valla en fut le premier secrétaire général, le premier titulaire au « Secrétariat Études et Recherches », le premier rédacteur en chef de la revue Éléments et le principal responsable des Éditions Copernic. Sur la chronologie de la création de cette « société d’influence (p. 115) », il réfute le témoignage d’autres cofondateurs tels Maurice Rollet, Chancelier du G.R.E.C.E. Dans sa contribution au Mai 68 de la Nouvelle Droite, Maurice Rollet mentionne une réunion préparatoire en janvier 1968 autour de douze participants dont Valla. Or ce dernier faisait son service militaire en Allemagne à Villingen et était ce jour-là en pleines manœuvres hivernales dans la Forêt Noire. Qui se trompe ? Le témoignage d’autres participants serait éclairant…
Dégagé des obligations militaires, Jean-Claude Valla commence une carrière de journaliste pour plusieurs titres dont Valeurs actuelles où officie un ancien dirigeant de la F.E.N., François d’Orcival, devenu atlantiste et méfiant envers ses anciens camarades et dont le parcours professionnel le conduira bien plus tard à l’Institut. Il passe ensuite reporteur à Détective dont il garde un souvenir formateur. « Rien de tel que le fait divers pour former un journaliste, lui apprendre à se débrouiller, à découvrir la vie dans ce qu’elle peut avoir de sordide, à faire preuve de persuasion pour que celui qu’il doit interroger consente à lui ouvrir sa porte (p. 102). »
Au contact hebdomadaire de la vieille droite décatie
Il relate en outre le lancement du Figaro Magazine et des hostilités inattendues. On apprend que « les rapport entre Le Figaro Magazine et sa maison-mère n’étaient pas bons. […] les deux rédactions […] vivaient retranchées de part et d’autre de la rue du Mail (p. 165) ».
Jean-Claude Valla assure la liaison entre les deux titres et va chaque semaine dans le bureau de Max Clos, le directeur du quotidien, afin d’éviter les doublons. Mais, aigri, l’équipe du Figaro reprend les mêmes sujets avec son point de vue ringard au point que Valla est bientôt contraint de leur remettre de faux sommaires… Le succès du Figaro Magazine attise donc la rancœur d’une vieille garde qui « n’en tirait que jalousie et tremblait devant les censeurs de la presse de gauche (p. 166) ». Trente ans plus tard, hormis Thierry Maulnier naguère et aujourd’hui Éric Zemmour, ce journal est toujours le porte-parole d’un Hexagone imbécile, bourgeois, atlantiste et libéral-conservateur ! Quant à Max Clos, ce collectionneur des batailles perdues, il s’est réincarné en Yvan Rioufol dont le bloc-notes du vendredi exprime parfaitement les idées creuses de cette droite stérile dont le sarközysme est la dernière manifestation en date. Valla n’est pas dupe sur le lectorat du Figaro Magazine. « Cette France profonde était probablement trop frileuse pour prendre le risque d’un véritable affrontement. Aujourd’hui encore, elle prête une vieille complaisante aux marchands de sable du R.P.R. et de l’U.D.F. Cocue, mais toujours contente (p. 30). » Les récentes et gigantesques manifestations contre le mariage inverti et la politique gendériste de rejet des valeurs familiales confirment ce jugement sévère. Un certain dimanche 2013, les manifestants auraient pu occuper la « plus belle avenue du monde » et marcher sur l’Élysée, Flamby finissant alors comme un simple Ben Ali… Par couardise et légalisme naïf, ils ont rejeté cette possibilité dangereuse pour se donner à une U.M.P. encore plus nocive que son frère jumeau, le P.S. À ce public-là de Hexagons (Hexacons ?) catho bien élevés, on se doit de préférer un autre public, plus hardi, plus organisé, plus violent.
Malgré quelques critiques, il faut aussi regretter que Jean-Claude Valla ne fasse pas le bilan complet de l’entreprise métapolitique à laquelle il a étroitement participée. Il évoque en trois pages le cas du Club de l’Horloge qui, au départ, « ne s’adressait théoriquement qu’à de hauts fonctionnaires ou à des étudiants qui se destinaient à l’École nationale d’administration (E.N.A.) (p. 129) ». S’il revient sur les causes de la séparation entre ce club de pensée, créé par deux grécistes, Yvan Blot et Jean-Yves Le Gallou, et le G.R.E.C.E., Valla ne s’y attarde guère, peut-être parce que les deux stratégies employées (la métapolitique dans la sphère culturelle par l’entrisme dans le journalisme ou la parapolitique dans la sphère politicienne par l’entrisme dans des partis politiques) ont largement échoué. On peut même craindre que le « gramscisme technologique » suive un destin identique. Internet est un outil susceptible de favoriser un pseudo-activisme du clavier qui est une nouvelle forme de passivité militante. Les nouvelles techniques d’information et de communication ne remplacent pas le militantisme de rue.
Outre une différence d’ordre sociologique (le G.R.E.C.E. s’adresse à des journalistes, des enseignants et des étudiants tandis que le Club de l’Horloge cherche surtout de futurs hauts fonctionnaires), d’autres divergences majeures ont fait bifurquer sur des voies distinctes deux structures à l’origine proches :
— une divergence idéologique à propos du libéralisme, combattu par les grécistes et adapté dans un discours conservateur et national par les « horlogers »;
— une divergence géopolitique : le Club de l’Horloge soutient assez vite l’Occident et son fer de lance, les États-Unis d’Amérique, tandis que le G.R.E.C.E. prend dès le début de la décennie 1980 des positions neutralistes, tiers-mondistes et tiercéristes;
— une divergence politique avec le soutien gréciste à l’Europe impériale alors que les membres les moins anti-européens du Club de l’Horloge défendent au mieux une coopération intergouvernementale assez lâche;
— une divergence religieuse qui, avec la question du libéralisme, demeure un point déterminant d’achoppement. Alors que le G.R.E.C.E. n’a jamais caché son paganisme, le Club de l’Horloge défend pour le moins un christianisme catholique d’ailleurs bien affadi par l’Église conciliaire.
Par ailleurs, cet ouvrage comporte, hélas !, quelques règlements de compte propres au genre. Ainsi Roland Gaucher est-il qualifié de « roi de l’approximation (p. 70) ». Jean-Claude Valla se soucie de la souplesse intellectuelle d’Yvan Blot dont l’« évolution […] pouvait paraître plus inquiétante (p. 131) ». Finalement, il se « félicite aujourd’hui que son ralliement au Front national lui ait permis de retrouver sa liberté intellectuelle et de renouer sans honte avec ses vieux amis (p. 132) ». C’était bien sûr avant 1998…
Saluant au passage la personnalité bien oubliée de Louis Rougier, Jean-Claude Valla se montre en revanche fort critique envers Guillaume Faye. On est surpris qu’il regrette que « le G.R.E.C.E. soit devenu après mon départ, et en grande partie sous l’influence de Guillaume Faye, beaucoup plus monolithique et trop souvent prisonnier de la langue de bois (p. 126) ». Jugement abrupt et maladroit quand on consulte l’ensemble des travaux produits entre 1979 et 1986. On aurait plutôt apprécié lire une explication pertinente sur cette tentative avortée d’union (en fait absurde, voire insensée) entre des modérés libéraux et des révolutionnaires de droite dans le cadre de l’Alternative pour la France, cette entente illusoire du feu et de l’eau.
Du journaliste d’influence à l’historien de combat
Les souvenirs de Jean-Claude Valla s’arrêtent à son éviction du Figaro Magazine. Il tente ensuite l’aventure de Magazine Hebdo, vaincue par la complicité tacite de la gauche morale subventionnée et la pitoyable droite affairiste. Il en restera un bulletin confidentiel d’informations politiques, La Lettre de Magazine Hebdo. Au milieu des années 1980, Jean-Claude Valla va ensuite reprendre le titre d’une revue d’Emmanuel Berl de l’Entre-Deux-Guerres, Marianne (sans rapport avec le magazine éponyme fondé par de pseudo-rebelles…). Ce Marianne-là ne trouvera pas non plus son lectorat.
Valla rejoint un temps la rédaction de Minute. Puis, à partir du n° 29 de mai 1990, il entre au Choc du Mois, d’abord comme éditorialiste, puis comme chroniqueur impertinent dans la rubrique du « Carnet de voyage en Absurdie ». Il quitte Le Choc du Mois à son n° 60 de janvier 1993, pour prendre la direction de Minute. Certes, « Jacques Devidal » intervient encore dans le n° 65 de juin 1993 du Choc.
L’actualité va bientôt l’inciter à abandonner son habit de journaliste pour revêtir celui de l’historien rebelle. La scandaleuse affaire Touvier le révulse : il n’hésite pas à s’investir en faveur de l’ancien milicien et en tire en 1996 une contre-enquête remarquable. Auteur d’une biographie sur Doriot chez Pardès, il lance des Cahiers libres d’histoire qui examinent régulièrement un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale. En outre, à une époque où la liberté d’expression historique n’était pas encore pénalisée par des lois liberticides, il ne cachait pas son révisionnisme.
Véritable « contre-historien » qui va à l’encontre des vérités officielles judiciairement établies, il écrit dans deux publications successives d’un vieux compagnon de route, Dominique Venner : Enquête sur l’histoire, puis La Nouvelle Revue d’Histoire. Hors de tout cursus universitaire et académique – le jeune Valla n’a jamais passé le moindre examen -, il devient sur le tard un historien percutant, à mille lieux des dociles caniches de l’Alma mater.
Cet ouvrage posthume éclaire une partie de l’existence de la fameuse « Nouvelle Droite » mais son histoire intellectuelle reste toujours à faire.
Georges Feltin-Tracol http://www.europemaxima.com/?p=3695
• Jean-Claude Valla, Engagements pour la civilisation européenne. Souvenirs, préface de Michel Marmin, Alexipharmaque, coll. « Les Réflexives », 2013, 191 p., 19 €. (B.P. 60 359, 64 141 Billère C.E.D.E.X.).