culture et histoire - Page 1637
-
Insurrection - St Georges
-
Jean Zay au Panthéon : une provocation immense
Communiqué spécial du Comité National d’Entente relatif au « Panthéon », présidé par le Général de corps d’armée (2s) Dominique Delort :
"Nous condamnons,
Depuis la Révolution, 75 hommes et femmes ont été honorés par la Nation pour avoir marqué l’histoire de France. Les choix ont été difficiles à faire et parfois des familles s’y sont opposées comme celles de Péguy et de Camus.
Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et Jean Zay devraient faire leur entrée au Panthéon le 27 mai 2015, lors de la journée nationale de la Résistance, selon la déclaration faite par le Président de la République lors de son discours en hommage à la Résistance, le 21 février 2014 au Mont Valérien.
Les trois premiers sont des résistants et répondent à l’objet de cet hommage, il n’en est pas de même pour Jean Zay. Certes il a été interné avant d’être lâchement assassiné en juin 44 mais tant d’inconnus et de célébrités sont morts les armes à la main ou dans des camps d’extermination, après des faits de résistance, que cela ne fait pas de lui un héros. Il n’y a pas si longtemps à propos du capitaine Dreyfus l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, déclarait : « Dreyfus est une victime, certes d'un courage exceptionnel, mais une victime, et le propre du héros c'est d'avoir le courage de choisir son destin ». Jean Zay est une victime.
En cette année du Centenaire de la Grande guerre la provocation est ailleurs. Elle est immense, elle est inoubliable. L’auteur ne l’a jamais reniée, l’aurait-il fait qu’il est des fautes inexcusables, celle de l’atteinte au symbole par excellence de notre patrie, de notre pays, de notre nation, le Drapeau.
Il faut avoir entendu ou lu «... Terrible morceau de drap coulé à ta hampe, je te hais férocement, Oui, je te hais dans l’âme, je te hais pour toutes les misères que tu représentes… Que tu es pour moi de la race vile des torche-culs ….»
Nous condamnons totalement un éventuel transfert des cendres de Jean Zay au Panthéon. Il est des injures qui ne se rachètent pas et qui ne peuvent s’oublier au moment de prétendre au Panthéon. Certains diront qu’à 20 ans il a commis une faute et qu’il était bien jeune mais 20 ans c’est déjà assez vieux pour mourir pour la France pendant la Grande Guerre, la Résistance et la Libération, aujourd’hui lors des opérations extérieures, en Afghanistan, au Mali, en RCA !
Il est hautement préférable de transférer les cendres d’un Résistant, d’un Français Libre, d’un Soldat de la 1ère armée, métropolitain ou « indigène », inconnu, aux côtés de ceux qui sont la mémoire de la France. Les Français s’y retrouveront comme aussi tous les adhérents des associations patriotiques et du monde combattant ici présentées."
-
C’était un 14 mars : prise de Cholet par les Contre-révolutionnaires
 Cette journée de 1793, quelques jours seulement après le début du soulèvement des paysans vendéens, ceux-ci sont parvenus à s’organiser et à se trouver des chefs en les personnes de Jacques Cathelineau (simple colporteur et sacristain de Pin en Mauges) et de Jean-Nicolas Stofflet (garde-chasse).
Cette journée de 1793, quelques jours seulement après le début du soulèvement des paysans vendéens, ceux-ci sont parvenus à s’organiser et à se trouver des chefs en les personnes de Jacques Cathelineau (simple colporteur et sacristain de Pin en Mauges) et de Jean-Nicolas Stofflet (garde-chasse).
L’Armée catholique et royale, dont de nombreux membres ne sont armés que de faux, parvient, ce jour du 14 mars 1793, à prendre Cholet, ville importante.Les 3 pôles d’insurrection vendéenne :
* L’armée du Marais autour de Léger
* L’armée d’Anjou autour de Cholet
* L’armée du centre dans le bocage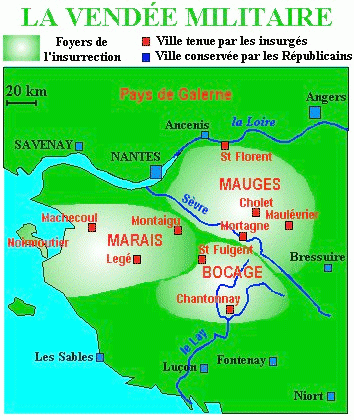
Après cette première prise de Cholet et avec un chef à son image, l’armée paysanne progresse vers Chalonnes-sur-Loire (au sud d’Angers) puis Thouars.
La Guerre de Vendée, que Napoléon qualifiera de Guerre de géants a commencé…
Six mois après la prise de Cholet, les Bleus emmenés par Kléber et Marceau, parviendront à récupérer la cité, après des combats acharnés.
En mars 1794, Stofflet reprend la ville. Louis Turreau la fera alors entièrement brûler… -
ALGER 1830 Une colonie fiscale turque
Suite au voyage de M. Sarkozy en Algérie et aux débats qu’il a suscités, il nous a paru opportun de nous interroger sur ce qu’était ce pays avant la colonisation. Nous avons demandé à J.-P. Péroncel-Hugoz, qui fut correspondant du Monde à Alger, et dont les livres témoignent d’une profonde intelligence de tout ce qui a trait au monde musulman, de nous éclairer à ce sujet. Nous le remercions de nous avoir adressé la précieuse analyse suivante.
En 1830, l’Algérie n’existait pas. La France allait l’inventer. Le mot même d’”Algérie” a été forgé par nous. On ne connaissait alors que “la Régence d’Alger”, abri de pirates et corsaires islamo-méditerranéens, colonie fiscale ottomane depuis le XVIe siècle. Le pouvoir turc ne contrôlait guère que la bande côtière jusqu’à Médéa, et encore seulement les localités où le sultan-calife de Constantinople entretenait des soldats, souvent d’ailleurs chrétiens renégats, anciens captifs convertis par intérêt à l’islam : les fameux “Turcs de profession”... De temps en temps, une mehalla, cohorte armée, partait en quête de l’impôt dû à la Sublime-Porte. Les Juifs indigènes, eux, interdits de port d’armes, en tant que dhimmis de l’islam (“protégés-assujettis”), et majoritairement citadins, ne pouvaient échapper au fisc auquel ils devaient en particulier un impôt appliqué à eux seuls (et aux chrétiens libres, s’il y en avait eu) : la gizya. Les Arabo-Berbères, de même foi que les Turcs, et donc supportant sans trop rechigner l’autorité de leur coreligionnaire, le dey, adoubé par Stamboul, se faisaient en revanche tirer l’oreille pour verser la taxe impériale. Il fallait aller la quérir dans les douars ou les médinas, au besoin par le cimeterre. On ne parlera jamais pour autant de “colonialisme” ottoman (ni a fortiori arabe bien que celui-ci ait auparavant lésé ou détruit les cultures berbères...), bien que cette domination n’ait laissé derrière elle que quelques forteresses, minarets, villas et recettes de sucreries, tandis que la colonisation française, si bénéfique en matière de santé, travaux publics, distribution d’eau ou extension des terres arables se trouve sans cesse sur la sellette. Pourtant, loin d’avoir pris l’allure d’un “génocide” (comme celui des Amérindiens par les Anglo-Saxons), la mainmise française sur l’Algérie fit passer la population autochtone, en un gros siècle, de 3 millions à 9 millions d’âmes...
Dû à notre philanthropie chrétienne armée de nos thérapeutiques, ce bienfait démographique, qui explique d’ailleurs notre éviction finale du pays, ne sera jamais au grand jamais reconnu par les Algériens car il provient de non musulmans. Il n’y a pas d’autre explication. Au reste, ce comportement socio-confessionnel est général et normal en Islam. Il est exacerbé en Algérie par l’échec absolu du “socialisme islamique” au pouvoir depuis l’indépendance en 1962, échec que Ben-Bella, Boumediène, Bendjedid, et à présent le président Bouteflika n’ont pu masquer qu’en menant à hauts cris en permanence le procès du “colonialisme” français, face auquel la France officielle n’a jamais réagi, en dépit des munitions historiques à sa disposition.
Alger en 1830 était aussi l’un des derniers ports nord-africains - sinon le dernier depuis que l’Empire chérifien en 1818 avait mis fin à l’activité corsaire de Salé -, conservant une activité de “course” en Méditerranée avec abordages de nefs commerçantes et enlèvements de civils sur le littoral des États chrétiens, d’où un marché d’esclaves en Alger, l’esclavage étant, on le sait, licite en islam. Charles X, roi très-chrétien s’il en fut, brûlait de réduire ce “nid de pirates”. Il y fut encouragé par le coup d’éventail intempestif que le dey d’Alger donna un jour de 1827 à notre consul à propos - et c’est là où la France, pour une fois, était fautive - d’une dette du Directoire pour une livraison de blé que lui avait alors fourni la Régence. Le rachat de ladite dette par deux hommes d’affaires israélites, Bacri et Busnach, avec en outre peut-être un tripatouillage souterrain de Talleyrand, explique que le dossier ait traîné jusqu’à la fin de la Restauration et doive être signalé comme l’une des causes de l’expédition de 1830 à Sidi-Ferruch. Vu le contexte international de l’époque, si la France n’était pas à ce moment-là intervenue militairement en Alger, l’envieuse Albion (en concurrence ou en tandem, peut-être avec l’Espagne, laquelle n’avait quitté Oran, à la suite d’un séisme, qu’à la fin du XVIIIe siècle) y serait probablement allée, et le Maghreb ne serait pas aujourd’hui aussi largement francophone : deux Tunisiens sur trois, un Algérien sur deux, un Marocain sur trois utilisent à présent la langue de Bugeaud et Lyautey...
Péroncel-Hugoz* L’Action Française 2000 n° 2739 – du 3 au 16 janvier 2008
* Ancien correspondant du Monde en Alger, directeur de “La Bibliothèque arabo-berbère” chez Eddif, à Casablanca, Péroncel-Hugoz vient de publier Petit journal lusitan (Le Rocher, Monaco). -
chouans Jean Pax Mefret
-
Insurrection - Flic Républicain
-
Les identités plutôt que le P.I.B.!
Plus de quatre ans après le référendum interdisant les minarets, le peuple suisse fait encore des siennes. Il vient d’adopter de justesse des mesures de préférence nationale et de limitation des flux migratoires. D’abord abasourdie par ce résultat non prévu par les sondages, la grosse presse a violemment critiqué le choix souverain des Helvètes et leur prédit une future régression économique.
Il est intéressant de relever que les arguments de part et d’autre du Léman et du Jura ne correspondent nullement. Journalistes stipendiés et Commission eurocratique de Bruxelles mettent en avant l’économie et la morale tandis que les Suisses rappellent que l’immigration pèse sur la tranquillité publique, entraîne la saturation des infrastructures ferroviaires et routières, oblige la construction de nouveaux bâtiments qui réduit une surface agricole utile peu étendue du fait du relief, favorise la hausse du prix du m2, ce qui contraint de nombreux ménages suisses à venir clandestinement s’installer dans leurs résidences secondaires du pays français de Gex.
Par son vote cinglant du 9 février 2014, le peuple suisse s’attaque au cœur même de la globalisation, à savoir la libre circulation des biens, des capitaux et des individus. À l’idéal d’open society colporté par les oligarchies mondialistes et leurs larbins médiatiques, les citoyens de la Confédération helvétique préfèrent les vertus de la société fermée. Véritable pied-de-nez aux altermondialistes et aux libéraux libertaires progressistes, cette décision devrait aussi faire réfléchir tous les chantres du libéralisme conservateur, du national-libéralisme et du conservatisme libéral sur leur engagement idéologique. Soit ils avalisent les mantra libéraux, acceptent l’ouverture illimitée au monde et condamnent l’initiative helvétique – ils s’affirmeraient dès lors comme la faction droitarde et con-conservatrice du mondialisme -, soit ils approuvent cette votation et doivent par conséquent abandonner leur foi naïve dans le libéralisme pour retrouver un conservatisme anti-libéral de bon aloi.
Ce dilemme ne se limite pas à la seule question immigratoire. Il tend à se généraliser avec des problématiques saillantes autour de la G.P.A. et du mariage inverti, voire avec le travail du dimanche chaudement approuvé par quelques têtes de linottes libérales-conservatrices.
La limitation de l’immigration risque de nuire aux performances économiques de la Suisse. Et alors ? À rebours des incantations maladroites de certains décroissants « de gauche », la remise en cause radicale de la « Mégamachine » ne proviendra pas des catastrophes climatiques ou du dérèglement météorologique, mais d’une véritable prise de conscience identitaire, soucieuse des paysages et d’un enracinement indéniable à travers des communautés charnelles d’appartenance.
Organisme de guerre aux ordres de l’Infâme, l’agence de notation Moody’s menace de retirer son triple A à la Suisse qui a si mal voté. Elle juge en effet que « limiter l’immigration est susceptible d’affecter le potentiel de croissance du pays, sa richesse et sa solidité économique dans son ensemble (Le Figaro, 19 février 2014) ».
Qu’une société fermée fasse perdre plusieurs points de P.I.B. et de croissance n’est pas dramatique si elle parvient à s’auto-suffire et, surtout, à maintenir sa cohésion ethno-civique interne. Contrairement à ce qu’avance Laurence Fontaine qui célèbre le marché dans le quotidien gaucho-libéral Libération, le marché, ce facteur de déstabilisation des cadres traditionnels organiques, n’est pas primordial. Elle a en revanche raison d’asséner que « le marché est la condition sine qua non pour avancer vers l’égalité des droits (entretien avec Laurence Fontaine, « Le marché peut être progressiste, les pauvres doivent en profiter », Libération, 22 – 23 février 2014) ». Le marché n’est donc pas ce « prussianisme renforcé », auteur d’un ordre concret comme le soutient Jacques Georges (« Vive le marché ! », mis en ligne sur Europe Maxima, 17 octobre 2009). Avec la mondialisation, il est devenu ce corrupteur de toute sociabilité tangible désintéressée. Combattre son hégémonisme exige une révolution culturelle intégrale.
Outre la nécessaire relocalisation des activités économiques, la réhabilitation de l’artisanat et de la paysannerie bio, un discours identitaire sérieux se doit de promouvoir le salaire de citoyenneté, la réduction draconienne du temps de travail à trente ou trente-deux heures ainsi que le retour concerté à la terre et la déconcentration démographique assumée des grandes agglomérations. Dans la recherche indispensable de l’auto-suffisance alimentaire, les milliers d’intermittents du spectacle, de journalistes, d’étudiants en psycho, etc., serviraient utilement dans les campagnes bien loin d’une artificialité urbaine grégaire.
La défense des identités signifie enfin le rejet total de la démonie de l’économique. Cela réclame une force d’âme remarquable capable de se déprendre de l’imaginaire de la consommation et du productivisme. Il faut désormais avertir les masses hébétées et droguées de matérialisme douceâtre qu’elles se sauveront que si elles redeviennent des peuples fiers d’eux-mêmes. Comme les Suisses du centre de la Confédération…
Georges Feltin-Tracol
-
Entretien avec Alexis Arette, auteur de Fils d’homme, je t’ai fait sentinelle
« Lorsque les responsables
deviennent des privilégiés,
si le vice est le soutien
de leur prospérité,
ils feront tout pour garder le pouvoir
jusqu’au déluge ! »Entretien avec Alexis Arette, auteur deFils d’homme, je t’ai fait sentinelle (Propos recueillis par Fabrice Dutilleul)
Quel sens donnez-vous au mot « Sentinelle » tiré de l’ordre donné par Dieu au Prophète Ezéchiel : « Fils d’homme, je t’ai fait sentinelle » ?
La réponse est dans la Bible. La Sentinelle, c’est l’homme lucide, à qui Dieu fait devoir d’annoncer l’ennemi, c’est-à-dire l’avancée des périls dans la société. Bainville disait « On a toujours les conséquences ! », et il n’est pas du tout certain que la phrase que l’on a prêtée à Louis XV : « Après moi le déluge ! » ne soit pas celle d’un visionnaire qui se sentait impuissant devant la perversité du siècle. De bonnes connaissances et l’exercice de la logique devraient établir des lois de sauvegarde, mais lorsque les responsables deviennent des privilégiés, si le vice est le soutien de leur prospérité, ils feront tout pour garder le pouvoir jusqu’au déluge ! Aujourd’hui, ni Soljenitsyne, ni Xavier Emmanuelli, ni Maurice Allais ne sont perçus comme sentinelles, et la République des repus continue d’appliquer le précepte mortel de Rousseau : « Écartons les faits, ils n’ont rien à voir à l’affaire » !
Qu’apporte de nouveau ce livre par rapport à vos précédents ouvrages ?
Des documents. Ils constituent la preuve que nous avons eu de tout temps des sentinelles et que, généralement, elles ne sont pas écoutées. Mais nous avons les textes de leurs prévisions. Il était bon de les réunir pour examiner leurs concordances. Il ne peut y avoir de science historique qu’à la lueur des concordances. Et c’est pour cela qu’après le déluge qui se prépare, l’« empirisme organisateur » de Charles Maurras retrouvera la place qui lui est due. Et si le langage religieux qu’emploient les sentinelles du passé peut paraître anachronique à notre époque, il faut se souvenir que l’on ne peut absolument pas juger le passé sur nos critères d’aujourd’hui, mais aussi que les lois du Décalogue restent le fondement justicialiste, c’est-à-dire le « garde fou » de la cité.
Peut-on vraiment accorder quelque crédit à des « prophéties » ?
Quant Edgar Cayce, « prophète » laïque s’il en fut, prédit, au moment où la Russie Soviétique occupe la moitié de l’Europe, que le régime tombera, et que la Russie sera un rempart du monde chrétien, on est obligé de dire, en voyant Poutine faire ostensiblement le signe de la croix, que Cayce avait bien « vu » l’avenir. Quant une religieuse, à l’époque où la Monarchie française semble donner le bon ton à l’Europe, prédit sa chute et l’exécution du Roi, il faut bien admettre qu’elle a reçu des dons qui ne sont pas communs.
Par ailleurs, il faut considérer aussi que les « voyants » sont parfois dotés de pouvoirs exceptionnels, comme les « bilocations », par exemple. Mais depuis la découverte de la « relativité » par Einstein, le temps n’est plus une donnée impénétrable, et les vrais visionnaires arrivent à s’y mouvoir. Mais bien sûr, il y a aussi les charlatans…
Croyez-vous vraiment que l’on puisse changer le cours funeste des évènement ?
Je n’ai pas craint, en cours d’ouvrage, de me répéter pour l’affirmer. J’ai montré la puissance de la pensée dans la formation par exemple des « ectoplasmes ». Et si, malheureusement, je suis tributaire d’une pensée folle qui me fait déplacer des objets sans le vouloir, la télékinésie consciente existe bien, même si les cas sont rares. Il n’est pas jusqu’à l’efficacité des « placebo » qui ne manifeste la puissance de la foi ! Avec la parole du Christ : « Si vous aviez la foi comme un grain de Sènevé, vous déplaceriez les montagnes », nous sommes entrés dans un domaine que l’on croyait réservé à la sorcellerie ! Et bien, il existe aussi un domaine inconnu de la « Bonne Pensée » qui vous fait « magicien ». Et c’est par l’Oraison que la pensée humaine redevient à l’image de la pensée divine : Créatrice ! Oui, on peut décider de gravir une montagne au lieu de la descendre ! Oui, l’ouverture du troisième œil est peut-être pour demain !
Vous dénoncez la Franc-Maçonnerie avec insistance dans votre livre. Englobez-vous, dans vos réserves, toutes les obédiences maçonniques, ou seulement certaines ? Nombre de Franc-Maçons se déclarent « croyants », chrétiens notamment…
On peut être « croyant » en croyant à n’importe quoi. Être chrétien, c’est différent et catholique encore autre chose. En fait, l’exposé des idéaux franc-maçons est conforme aux grandes vertus tirées de l’Évangile, mais la pratique en est souvent contraire. Il suffit de lire le ministre Vincent Peillon pour savoir que la destruction de la religion catholique est son but, afin d’instaurer à la place la religion maçonnique. Mais ce citoyen n’est que l’expression du « Grand Orient » qui a supprimé la référence au « Grand Architecte de l’Univers, » et qui, de ce fait, n’a plus rien à voir avec les Maçons bâtisseurs de Cathédrales.
Certaines obédiences comme la Grande Loge Nationale Française sont restées strictement « spiritualistes » et même proches du catholicisme, comme les Rose-croix. Il résulte de cette diversité « évolutive » que c’est surtout par prudence que l’Église a porté un jugement d’ensemble négatif… Pour ma part, c’est la part « sataniste » de la maçonnerie que je combats. Mais j’observe avec beaucoup d’attention l’évolution des obédiences. Car l’Esprit souffle où il veut !
Fils d’homme, je t’ai fait sentinelle d’Alexis Arette, éditions de L’Æncre, collection « Patrimoine des Religions », dirigée par Philippe Randa, 362 pages, 35 euros.
BON DE COMMANDE
à renvoyer à : Francephi diffusion - Boite 37 - 16 bis rue d’Odessa - 75014 Paris - Tél. 09 52 95 13 34 - Fax. 09 57 95 13 34 – Mél. diffusion@francephi.com
Commande par internet (paiement 100 % sécurisé par paypal ou carte bancaire) sur notre site www.francephi.com.
-
A lire et à faire lire : « Jean Bastien-Thiry, De Gaulle et le tyrannicide »
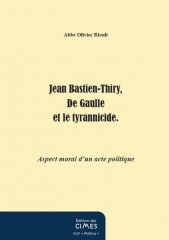 Alors que nous commémorions hier la mort du lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry, rappelons la sortie, il y a quelques mois, d’un petit livre à lire.
Alors que nous commémorions hier la mort du lieutenant-colonel Jean Bastien-Thiry, rappelons la sortie, il y a quelques mois, d’un petit livre à lire. Sous la plume de l’abbé Rioult, il s’agit d’une excellente étude historique et morale, appuyée sur la doctrine de Saint Thomas d’Aquin concernant le « tyrannicide », à propos de l’action de ce militaire chrétien.
Était-elle morale ? Bien sûr…Jean Bastien-Thiry, De Gaulle et le tyrannicide, aspect moral d’un acte politique. 62 pages, 8 €. Editions des Cimes. Disponible ici.
« Le 22 août 1962, à Clamart, un attentat visait le chef de l’État et manquait de peu son objectif.
Ce fut la plus fameuse tentative de meurtre à l’encontre du général De Gaulle.Le 11 mars 1963, son instigateur, le colonel Jean Bastien-Thiry, était fusillé. Il est le dernier en France à avoir été victime de ce procédé.
« Comment un homme, doté de profondes convictions catholiques et d’un bagage culturel supérieur, a-t-il pu en arriver là ? » se demanda la presse de l’époque.
Quant au motif de « tyrannicide » que Jean Bastien-Thiry a avancé pour justifier moralement « l’opération Charlotte Corday », était-il acceptable ?
L’auteur répond ici à ces questions. En s’appuyant sur les réflexions de Saint Thomas d’Aquin – le « Docteur commun » de l’Église –, il étaye solidement son analyse par d’utiles et implacables rappels historiques.
Nous sommes invités ici à réouvrir un douloureux procès, qui souleva des interrogations morales et politiques de la plus haute importance. »
-
hommage aux paras du 8 éme RPIMa / Chanson de J-P Mefret " AFGHANISTAN "