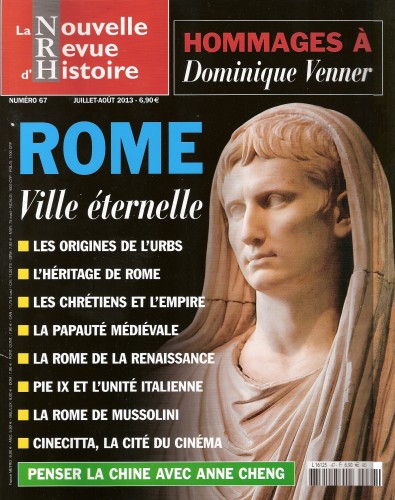Une philosophie des limites
D’une formule détournée de la célèbre maxime de Marx et Engels, Michéa a résumé la spécificité de la modernité libérale : « Déracinés de tous les pays, unissez-vous sur l’égide du marché mondial ! » Elle résume l’aboutissement logique de la pensée progressiste et mécaniste tant des Encyclopédistes que des Lumières. Partisans de la destruction de l’Ancien Régime, ils concevaient une anthropologie nouvelle – celle des droits de l’homme – destinée à émanciper l’humain d’obligations communautaires jugées rétrogrades et liberticides. Dans les fausses oppositions entretenues aujourd’hui par le terrorisme intellectuel et l’ingénierie sociale, l’idée de Progrès se trouve attribuée à la gauche, éternel camp du Bien depuis 1945. Droite et gauche sont prétendument opposés et absolutisés comme des concepts dont la seule évocation résumerait le contenu. Il ne s’agit pourtant que d’une construction, des mots choisis qui entendent s’imposer comme la seule réalité légitime. Toute critique ne pourrait se faire qu’avec cette opposition droite / gauche pour système de référence. A l’examen, l’obsolescence de ce clivage impose de rechercher une grille analytique alternative. Comme le rappelait Lasch, la foi progressiste peut se retrouver à droite, avec la recherche de la destruction des barrières morales (rebaptisées du terme diabolisant de « discriminations »), de l’expansion économique illimitée et le développement de l’individualisme. Droite et gauche officielles sont ainsi bien plus proches que ne le sont la droite économique de la droite politique (ce que Soral nomme la droite des valeurs). (1) Lors d’un colloque du GRECE, Alain de Benoist écrivait qu’il était insensé de se dire ni de droite, ni de gauche, car nous serions à la fois et de droite, et de gauche. Une nouvelle axiologie, qu’a proposée par exemple Arnaud Imatz, se veut par-delà droite et gauche ; d’une part, les révolutionnaires et conservateurs partisans de l’enracinement, d’autre part les révolutionnaires et conservateurs promoteurs du déracinement.
Chez Simone Weil, l’enracinement, nourriture pour l’âme humaine, s’entend comme « la participation active, réelle et naturelle à l’existence de sa collectivité », sans laquelle l’homme se couperait d’un besoin vital. D’aucuns parleront toutefois de la libération de l’enracinement comme de l’affranchissement d’un carcan, évolution naturelle vers l’émancipation. Néanmoins, la démocratisation du renseignement militaire nuance ce postulat : une guerre psychologique et économique est menée sous des prétentions libératrices. (2) Revenons dans l’Amérique des années 1920. Stuart Ewen, historien de la publicité, a démontré comment publicitaires et industriels se sont associés pour concevoir une « théorie générale des instincts », avec l’aide des psychologues et chercheurs en sciences sociales. Par action sur notre champ cognitif, exacerbation des pulsions et marginalisation sociale des réfractaires, la société de consommation naissante s’est attachée à détruire les solidarités traditionnelles, les cultures enracinées et leur sens de la mesure et de l’éthique afin de se pérenniser (modèle exporté en Europe avec le plan Marshall). L’homme fut progressivement déraciné, coupé du sens des limites et des conventions, privilégiant le bien contre le lien. La critique anticapitaliste ploya sous les assauts de la propagande quotidienne, relayée et légitimée par les « experts » (on pourra relire avec profit Propaganda de Bernays).
En fin de compte, une étude même succincte de la question de l’enracinement, au moyen d’auteurs officiellement de bords antagonistes, suffit pour comprendre que se positionner en termes de droite ou de gauche est une fumisterie. Le clivage déterminant reste celui qui oppose les enracinés, ces défenseurs d’une anthropologie de la souveraineté, contre les déracinés, ces idiots utiles de la servitude invisible d’Attali et consorts.
Chez Weil, l’enracinement se circonscrit comme un milieu vital, le pays (petite patrie ou nation). Les détracteurs argueront qu’il s’agit là d’une simple construction idéologique. Pourtant, l’anthropologue spécialiste de l’interculturel Edward T. Hall entérine cette analyse : l’éthologie a découvert l’inscription de la territorialité dans le code génétique des animaux. Abeille, chien, etc., tout animal appréhende l’espace d’une manière prédéfinie, même si l’homme interagit davantage avec son biotope. La notion d’espace vital se révèle un matériau psychique indispensable tant chez l’animal que chez l’homme, variable selon l’environnement. Pour Hediger, la territorialité assure à la fois des fonctions de régulation démographique, de socialisation par le jeu et l’apprentissage, et une sécurité, un refuge en cas de problème. En résumé, « elle coordonne […] les activités du groupe et assure sa cohésion. »
La théorie du système général proposée par Ludwig von Bertalanffy appuie ces analyses. Tout système possède des lois, qu’il se doit de respecter pour continuer de fonctionner. Le concept de système est large. Il comprend tant une modélisation mathématique, un jeu d’équation, une machine, qu’un protozoaire, un homme, une société ou un système cosmique. La conception déracinante de l’homme par les Lumières et leurs émules appréhende l’homme comme le rouage interchangeable et sans attache d’une machine régie par un Grand Horloger. Cette conception mécaniste s’apparente à un système dit fermé. Exemple typique, la main invisible du Marché qui harmoniserait, dixit les libéraux, l’offre et la demande et assurerait le doux commerce et la satisfaction de chacun, par autorégulation. Au vu de la dérive post-moderne, ce prétendu équilibre se rapproche au contraire des dérives inhérentes à tout système fermé, conformément à la seconde loi de la thermodynamique : avec le temps, tout système tend inexorablement à un désordre grandissant – nommé entropie –, qui devient maximal s’il ne se régule pas convenablement.
Comme toute matière vivante, l’homme est un système dit ouvert. Dynamique, il interagit au moyen de son idiosyncrasie et de son habitus. L’organisme présente des caractéristiques semblables à celles des systèmes en équilibre. Un système se dit « fermé » si aucune matière n’y entre ni n’en sort. Il est « ouvert » dans le cas contraire. Loin d’être une monade, l’homme naît en individu socialisé au sein d’un groupe qu’il ne choisit pas. Il se construit doublement au cours de sa vie : au travers d’une socialité primaire, faite de relations en face à face avec ses compatriotes ; par une socialité secondaire, constituée par ses expériences successives au cours de son existence. Apte au dialogue, il échange avec ses semblables au moyen de référents linguistiques communs. Pour rester intelligibles, ces derniers doivent comporter certains éléments de fixité et ne s’altérer qu’avec le poids du temps. Par le partage de référents similaires, les hommes d’une même communauté s’appréhendent, vivent ensemble au moyen d’une hiérarchie symbolique. Il s'agit d'informations qui font sens au même titre pour l'un ou l'autre des membres de la communauté et auxquels ils se soumettent conjointement – que ce symbolisme soit l'autorité incarnée par un chef, les us et coutumes, les interdits. L'enracinement de l'homme, ou conscience territoriale, apparaît donc comme « un système de comportement fondamental propre à tous les organismes vivants, y compris l'homme. »
Il n’est pas pour autant la panacée. Dans un cadre tant intra qu’inter-communautaire, des mécanismes de dissensus social existent, que Bateson nomma schismogenèse. Un déséquilibre entre la schismogenèse symétrique (la rivalité mimétique) et la schismogenèse complémentaire (la relation entre dyades antinomiques) peut créer un désordre du système, exacerber les tensions et mener le système à sa perte. En termes systémiques, l’entropie (le désordre) et la néguentropie (l’ordre) oscillent autour d’un ensemble de normes vitales (la métavaleur). Pour éviter l’écroulement du système, cette métavaleur doit rester comprise entre un minimum et un maximum de toxicité, à l’instar du corps humain. Il n’existe donc pas, en prenant l’acception progressiste, de sens de l’histoire. Il y a toujours une tension dans le rapport aux exigences systémiques, seules normes de références réellement productrices de sens et de viabilité.
De fait, une analyse par le type de psychologie politique à l’œuvre au sein d’un système semble plus adéquat, comme l’a proposée Marilia Amorim. L’époque traditionnelle voit le primat du Mythos, ce récit commun intégrateur avec les bases symboliques que nous avons vues précédemment. L’époque moderne libérale, avec le primat du Logos (discours scientifique, démonstratif) a détruit l’Ancien Régime. Malgré tout, le tissu social perdure grâce à la conservation des formes de socialité populaires traditionnelles, un sentiment d’enracinement fort et une continuité avec des éléments du passé. Par la suite, la mystique républicaine (pensons ici aux Croix-de-Feu, pas à la maçonnerie) s’est substituée à l’ancien Mythos en assurant une certaine continuité. Aujourd’hui, la Mètis prime : chacun ruse contre autrui pour survivre dans un monde individualisé. La transgression est généralisée pour maximiser son profit. Systémiquement, nous assistons à une sortie hors des limites que requiert l’homéostasie (l’équilibre). Déraciné, l’homme ne peut pas se retourner sur lui-même puisque les référents communs sont sans cesse balayés au profit du mouvement, du progrès et du futur. Manœuvre dilatoire, les critiques conservatrices sont qualifiées d'anachronisme, de ce qui « n'est plus adapté à l'époque. » Par son refus de se cantonner aux limites imposées par le système humain, le progressisme sort de celles-ci. Il déracine et se déracine. Il est une thanatocratie, un système de mort de l'homme. Le vocable de totalitarisme semble inadéquat, au regard du 20ème siècle. Au sein d'une démocratie, le déracinement représente plutôt un danger par « érosion de l'intérieur de ses fondements spirituels, culturels et psychologiques. »
( 1 ) « L'identification, par tous les moyens et à des fins bien nettes de propagande, de la droite politique à la droite économique, est elle aussi une contre-vérité patente. Entre les deux, en effet, il n'y a pas identité, il y a même souvent opposition totale. » Imatz (Arnaud), Par-delà droite et gauche. Histoire de la grande peur récurrente des bien-pensants, p.58.
( 2 ) La littérature sur le sujet est trop large et sortirait du cadre de notre étude. Nous pourrons toutefois citer quelques ouvrages : La subversion (Roger Mucchielli), La guerre cognitive et Les chemins de la puissance (dirigés Par Christian Harbulot et Didier Lucas, de l’École de Guerre Economique), La guerre du sens. Pourquoi et comment agir dans les champs psychologiques (général Loup Francart), l'ensemble des essais de Vladimir Volkoff qui se rapportent à la désinformation, ainsi qu'en langue originale Low intensity operation. Subversion, insurgency and peacekeeping (général Frank Kitson). Pour ce dernier, le journaliste Michel Collon apporte quelques éléments explicatifs de la doctrine Kitson et qui donnent quelques pistes quant à son enjeu et ses implications actuelles.
L’enracinement, simplement, pourrait donc s’appréhender comme une philosophie des limites, dans tous les domaines. La liberté n’est pas un insatiable gain quantitatif. Elle est une possibilité de choix à amplitude variable et prédéfinie par le biotope collectif du sujet. A l’envers du postulat droit-de-l’hommiste, écrit Weil, les droits ne découlent que de l’exercice préalable des obligations. On peut dès lors rejoindre Maurras pour qui 1793 était contenu en germe dans 1789. L’abstraction du principe révolutionnaire de liberté rompt avec le concret du quotidien et porte les menaces du déracinement, pouvant mener à la terreur par la réification d’autrui. Une fois érigés en dogme, les droits de l’homme sont devenus une aliénation ethnocentrique et utopique. Pour faire sens, explique Maurras dans L’ordre et le désordre, la liberté doit être un commencement et non une fin en soi : « Le tort essentiel du principe de liberté, c'est prétendre suffire à tout et tout dominer. Il se donne pour l'alpha et pour l'oméga. Or, il n'est que l'alpha. Il est simple commencement. » Chez lui comme chez Weil, il est besoin de hiérarchiser les symboles, de distinguer le principal du secondaire, soumettre l’inférieur au supérieur, ce que la liberté n’enseignerait pas. Perçue comme une fin en soi, elle individualise et divise, alors que le partage de vérités empiriques transmises par la vie politique unit au contraire, en consacrant des conceptions communes, des idées positives, par les valeurs contre-révolutionnaires d’autorité, de hiérarchie et d’aristocratie, conditions naturelles de l’ordre. Un ordre que Weil définit comme « un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. » Une liberté trop large, à l’instar de la modernité libérale où l’homme choisit ses fins au lieu de les découvrir, nuirait à l'utilité commune et ne serait donc pas ressentie comme une jouissance de la liberté ni comme un bien. Déracinant, le règne du quantitatif et de l’affranchissement des limites mènerait par conséquent à l’esclavage, à une faim insatiable.
L’égalité peut se voir appliquée la même critique du quantitatif. Elle « consiste dans la reconnaissance publique, générale, effective, exprimée réellement par les institutions et les mœurs, que la même quantité de respect et d'égards est due à tout être humain, parce que le respect est dû à l'être humain comme tel et n'a pas de degrés. » L'inégalité de l'ancienne France s'est révélée plus ou moins stable. Pernoud nuance ce constat, en rappelant que l’Église, « source de mobilité sociale, a grandement encouragé l'affranchissement des serfs. » Maurras précise que la Monarchie permettait de s'élever plus certainement et qu'avec la Révolution les castes n'ont pas été abolies. Quoi qu'il en soit, tranchent Guénon et Evola, l'Ancien Régime s'articulait autour de quatre ordres complémentaires : autorité spirituelle, aristocratie guerrière, caste bourgeoise, masse laborieuse. La révolution française aurait pour sa part créé une inégalité mobile, donnant des aspirations d'élévation sociale. Le quantitatif a supplanté l'altérité, une nouvelle réalité a été construite : les hommes ne se considèrent plus comme différents mais comme inégaux. Chez Maurras, c'est justement cette inégalité qui permet le progrès, en préservant du relativisme des valeurs. La recherche de l'égalité absolue, au contraire, mènerait au nivellement vers le bas. Le Vrai deviendrait alors le produit de la majorité, et non plus d'une norme transcendante. Quelle que soit la légitimité d'une obligation, si la collectivité la juge dispensable, une barrière serait franchie. Au contraire, dans une communauté enracinée, le bien commun doit s'imposer aux individus au-delà de leurs préférences individuelles. En dernier lieu, Weil et Maurras préconisent, chacun avec des caractéristiques différentes, une articulation entre égalité et inégalité. La philosophe en fait une question d'équilibre, afin que le respect ne soit pas altéré. Pour cela, ajoute-t-elle, la différence se doit d'être de nature pour être acceptée. Une différence de degré risquerait d'introduire des comparaisons et donc des jalousies entre les hommes.
Les limites imposées par l'enracinement résultent entre autres de la circonscription géographique dans une nation donnée ou à défaut une « petite patrie ». Le particularisme de chaque culture n'en est que plus aisément conservé. Le libéralisme, analyse Lasch, critique ce qu'il considère comme de l'arriération et du provincialisme. Il exalte l'altérité mais masque en réalité sa négation au bénéfice d’une volonté d'imposition du Même, ce que montre aujourd'hui la tendance à qualifier de dictature tout régime ne correspondant pas aux canons de la démocratie libérale occidentale – à l'exception notable des partenaires économiques. Cette tendance résulterait de l'incapacité à concevoir une altérité de nature, non de degré. Encore que, remarque Imatz, différents types de démocratie existent mais sont également diabolisés comme n'étant pas des démocraties. L'ethnocentrisme post-moderne pratique de fait l'inversion accusatoire. Notre démocratie libérale (centrée sur la liberté) correspondrait à l'individu sans appartenance, l'homme monade, déraciné. La démocratie populaire (avec pour cœur théorique l'égalité) représenterait le primat des classes laborieuses érigées comme seule classe réellement existante. La démocratie organique, enfin (articulée autour du concept de fraternité), serait davantage décentralisatrice et assimilable à un corps – davantage systémique donc : tout organe a une fonction et doit participer pour cela à la vie commune et aux décisions politiques, à divers niveaux. L'enracinement seul garantirait une démocratie effective : « La démocratie au sens strict est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire le pouvoir d'une collectivité organique mise en forme par l'histoire au sein d'une ou plusieurs unités politiques données. Elle est une communauté de destin dans l'universel. De sorte que toute doctrine politique dont la mise en œuvre favorise la désagrégation ou l'indifférenciation des peuples, ou encore l'effritement de la conscience populaire au sens d'une conscience d'appartenance à cette entité organique qu'est le peuple, peut être considérée comme non démocratique. » (1) Nous pouvons ajouter à cela qu'à l'époque féodale, des assemblées communales permettaient de décider des affaires locales. Tout le monde y avait le droit de vote, y compris les femmes. La monarchie pouvait donc se montrer démocratique, là où la démocratie se passe aujourd’hui tant de l’avis que du vote des peuples.
Une critique « enracinée » « tente de mêler l'universel et le particulier, l'abstrait et le concret. » Le sens des limites préserve un tant soit peu du solipsisme et de la volonté d'imposer sa conception du monde à autrui. Là où le progressisme est un évolutionnisme, l'enracinement, plus proche de la tradition, ne déconsidère pas d'emblée autrui en fonction d'une culture différente. Les valeurs prégnantes entre Nous et les Autres possèdent des dénominateurs communs. Chez Imatz, « c'est l'amour de son peuple et de sa famille qui inclinent davantage à comprendre, à respecter et à aimer d'autres peuples et d'autres familles. » Il n'est pas ici question de dilution d'identités diverses au sein d'un mélange, avertit Weil : chaque communauté spécifique se doit de conserver la richesse de sa propre culture. Chaque collectivité est unique, a son originalité. Les influences extérieures, poursuit la philosophe, ne doivent pas être des apports mais des stimulants qui rendent la vie de l'homme plus intense (où l'on pensera à l'anthropologie et aux diverses manifestations de don / contre-don, comme dans la Kula chez les Trobriands observés par Malinowski, ou l’agonisme des Kwakiutl dans le Nord de l’Amérique). Il s'agit, au sens de George Orwell, d'un patriotisme ordinaire. A la différence de ce qu'il nomme abusivement nationalisme – faute d'autres termes, de son propre aveu –, le patriotisme est défensif. Il implique l'idée de penser l'autochtonie de sa culture comme supérieure, mais sans prétendre l'imposer aux autres. Les différences entre nations, par exemple, reposeraient sur « d'authentiques différences de mentalité ».
Chez le populiste Burke, le patriotisme est défendu comme un préjugé. Preuve de sobriété morale, signe de sagesse, le préjugé est pour lui conforme à « la décence ordinaire (common decency), et les « sentiments naturels », l'aiguillon spontané du cœur. » Lasch prend l'exemple du préjugé de « chevalerie » qui empêche de s'affranchir des conventions sociales dans les rapports envers l'autre sexe. Il ne correspond pas à un acte isolé mais prend sens en tant qu'élément de la manière de voir le monde et d'appréhender la cité transmis par un symbolisme spécifique. Le préjugé crée notamment des automatismes, une adaptabilité, un esprit d'initiative salvateur dans les situations critiques et qui fait défaut à la raison, « spéculation librement fluctuante, désincarnée et gratuite, totalement indifférente aux suites du cours donné d'une action ». Il permet de ne pas franchir la distance déracinante entre Nous et les Autres. En ce sens, pour Burke, un « voile de décence » est nécessaire. Il s'oppose à ce que Rawls nommera deux siècles plus tard un « voile d'ignorance », où chacun ignore la position sociale de l'autre, ce qu'il possède, ce qu'il est, et où les individus sont « mutuellement indifférents ». Or chez Evola, « l'individu, dans l'acception courante, est quelque chose d'intermédiaire entre la personne – c'est-à-dire l'homme fidèle à des valeurs supérieures, doté d'une qualité propre et d'une dignité précise –, qui est au-dessus de lui, et la simple masse informe, qui est au-dessous de lui [...] La révolution individualiste ne saurait correspondre qu'à une phase intermédiaire, transitoire, du processus de désagrégation des sociétés traditionnelles. » Au contraire, l'enracinement implique de connaître ce qu'est l'autre, d'accepter la différence et d'être liés les uns aux autres, de ne pas s'atomiser dans l'indifférence de son prochain (le prochain n’étant pas ici, cela va de soi, l’allogène décérébré pleurnichard et amerloquisé – ni la tarlouze, ni le trans’, ni l’emo, ni un dégénéré de la Fistinière).
Approfondissons sur l'aspect « concret » d'une critique enracinée. Approcher l'autre comme différent de nature, en lui conférant un respect égal quel que soit son rang, participe du maintien des conventions sociales. Là où la recherche de la richesse, de l'obtention d'un poste à haute responsabilité peut impliquer de s'affranchir de certaines limites par une intelligence mètis malveillante, la simplicité de l'enracinement invite plus facilement à rester droit envers ses concitoyens. De plus, l'enracinement politique préserve de « parachutages » et autres considérations seulement géographiques ; un élu local enraciné rend directement compte à des citoyens concrets. Le déracinement, où le réseau remplace le lien, ne garantit plus que l'élu gardera un rapport minimal avec la réalité quotidienne et les préoccupations de ses administrés. Enracinés, même sans liens directs les uns avec les autres, les gens ordinaires sentent avoir une part de responsabilité envers les enfants des autres – ce que l'on retrouve encore de nos jours dans certains villages français comme dans des communautés à l'étranger. Lasch écrivait à ce sujet que « quand l'épicier du coin ou le serrurier gronde un enfant qui a traversé sans regarder, l'enfant apprend quelque chose qui ne peut pas être appris simplement dans le cadre d'une éducation formelle. Ce que l'enfant apprend, c'est que des adultes qui n'ont pour tout lien entre eux qu'un voisinage accidentel maintiennent certaines normes et assument la responsabilité du quartier. » Jacobs emploie la formule de « confiance publique banale », finalement assez proche des qualités de décence ordinaire (common decency) qu'Orwell remarquait chez les gens ordinaires. Dans un autre essai, Lasch souhaitait que l'éducation dépasse le simple stade de la famille nucléaire pour s'étendre dans un large cercle qui fasse sens et permette de retrouver la valeur perdue du tissu social.
Au sein d'une communauté enracinée, où chacun est respecté pour ses spécificités propres, les relations se font en dehors du cadre utilitariste préconisé par le déracinement. Pensons sur ce dernier point à John Rawls. Bien qu'il tentât une – médiocre – approche systémique avec sa Théorie de la Justice, il reste qu'il ne proposait que des droits abstraits, où les hommes seraient mutuellement indifférents les uns par rapport aux autres. Sans mystique commune, sans transcendance, il suffirait que certains voient dans leur intérêt le fait de tromper les autres, ou que les ingénieurs sociaux travaillent à exacerber les pulsions à visée consumériste et de manipulation politique des affects (voir Stuart Ewen, Consciences sous influence) pour que l'édifice s'écroule. Ceci, si tant est qu'il ait pu fonctionner à un moment, ses implications étant contraires à la psychologie humaine et à ses besoins biologiques d'animal social. Précisons qu'une communauté enracinée n'est pas forcément géographiquement restreinte ni agraire ou limitée à une classe sociale unique – les ouvriers par exemple. Transclasses, avec dans un premier temps un passé commun (la guerre) puis une mystique – nationale – partagée, les Croix de Feu, par la suite Parti Social Français, menés par le colonel de La Rocque, en sont une illustration. Encore aujourd'hui, selon les historiens, le PSF reste le plus grand parti de masse de l'histoire de France, organisé autour d'une expérience perçue comme faisant sens et avec une solidarité due à l'enracinement et à l'acceptation des différences de nature entre les différentes classes laborieuses. Le tout, avec une conception organique de la démocratie ; républicaine, donc plus en phase avec la structure mentale collective de l'époque que le monarchisme contre-révolutionnaire de l'Action Française de Charles Maurras.
( 1 ) « La démocratie référendaire serait la porte ouverte à la démagogie, à la folie, aux passions et à l'irrationnel. L'argument est de poids, mais il convient d'ajouter qu'on ne voit pas pourquoi le risque ne serait pas encouru par la démocratie représentative. La délégation, l'exercice du mandat, n'empêchent en rien la manipulation des parlementaires par des lobbies, bras économiques de pouvoirs forts invisibles. Le risque est le même, et à ce propos les exemples ne manquent pas. », Imatz, op cit., p.38.
Ethnocentrisme, chronocentrisme et quantification
Les principaux indicateurs de richesse d'une société se montrent incapables de comparer l'enracinement et le déracinement. Dans les deux cas que nous analyserons, ils sont liés à l'idéal moderne de Croissance et de Progrès. Ils sont en cela dépourvus de potentiel émique, capacité à envisager une société du point de vue des autochtones, tels qu'ils ont construit et organisé leur réalité commune. Le PIB, Produit Intérieur Brut, se révèle exemplaire. Dans son discours du 18 mars 1968, Bob Kennedy déclarait que cet outil mesurait tout « sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». Le PIB est quantitatif, et donc exclusivement centré sur l'économie. Par ailleurs, il connaît de nombreux biais qui le discréditent même pour ses partisans. Mesurant l'activité économique, il se montrera plus conséquent dans un pays où des coûts sont engagés contre la maladie, la délinquance et les destructions (notamment celles dites « créatrices ») que dans une nation paisible et où les citoyens sont en bonne santé. Le PIB d'un pays détruisant son environnement pour y substituer des infrastructures bétonnées et faisant fonctionner à plein régime les produits de consommation du tertiaire sera par conséquent bien plus élevé que celui d'un pays agricole peu monétarisé. La dimension qualitative n'est nullement prise en compte.
L'IDH (indice de développement humain) développé par les économistes Amartya Sen (maqué avec une Rotschild) et Mahbub ul Haq s'est voulu un outil de rupture avec cette approche strictement économique du PIB. L'objet d'étude du nouvel indicateur résulterait d'une combinaison trifactorielle : l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Le niveau d'éducation reste un critère ethnocentrique. Relatif au savoir et à la prise de décision, il ne caractérise nullement la qualité de l'éducation dispensée. Michéa comme Viatteau relèvent à cet égard que l'école post-moderne démontre qu'on peut tout savoir sans rien comprendre. L'esprit critique de nos sociétés régresse vers l'infantile et la pensée magique, sujet à la suggestion et perméable à la propagande. Dans une société enracinée, l'éducation se dispense parfois autrement, comme l'a montré Lasch dans son analyse sur l'éthique des limites des fractions les plus modestes de la classe moyenne. En rupture avec l'idée de développement – liée au Progrès et à l'évolutionnisme du sens de l'histoire, qui prescrit l'abolition des frontières et le déracinement généralisé –, certaines communautés conservent leurs caractéristiques du passé. Leur culture reste organisée autour de l'église, de la famille et du quartier. La continuité de la communauté prime sur l'individu, la solidarité sur la promotion personnelle, on cherche à conserver les modes de vie existants, la hiérarchie envers les aînés, l'honneur plus que l'ambition matérielle. Dans certains cas, les parents cherchent à privilégier l'autonomie de leur enfant. Ils peuvent le dispenser de scolarisation pour l'orienter plus tôt vers le travail, par exemple pour acquérir plus rapidement sa propre maison et pouvoir – ou non – y fonder un foyer.
Le niveau de vie est critiquable au même titre. Il prend en compte la parité de pouvoir d'achat, ainsi que la mobilité ou l'accès à la culture. Dans une communauté enracinée, une auto-production limite les flux financiers et monétaires, la question de la parité de pouvoir d'achat y apparaît donc quelque peu anachronique. Il en va de même pour la mobilité. En quoi être « mobile » est-il synonyme de nourriture pour l'âme humaine, pour faire nôtre la terminologie de Weil ? Faut-il la prendre comme acception de « capacité au déracinement » ? On pourrait alors déclarer que la mobilité a rapport avec l'émancipation. Mais ici encore, l'émancipation serait davantage synonyme de libéralisation, d'affranchissement de limites et de refus des contraintes. En revenant sur la corrélation entre progrès et pauvreté établie par Henry George, Christopher Lasch écrivait que « plus le capitalisme en venait à être précisément identifié à la satisfaction immédiate et l'obsolescence planifiée, plus implacablement il détruisait les fondements moraux de la vie de famille. [...] La passion de la marche en avant avait commencé à impliquer le droit de repartir à zéro chaque fois que devenaient excessivement pesants les engagements. » Enraciné, l'homme peut faire preuve de mobilité, dans la mesure où celle-ci fait sens, enchâssée dans un système auquel elle est liée. Pour pallier l'excès néguentropique, la mort systémique que constituerait l'absence d'une certaine souplesse, une capacité de mouvement doit être rendue possible. Dans L'enracinement, Weil disposait au sujet des paysans qu'un enracinement trop fort finit par produire un déracinement par l'ennui. Il fallait, pensait-elle, donner aux paysans le moyen de voyager dans les campagnes de France et à l'étranger. La mobilité, contrairement à l'IDH, a ici un but mais n'en est pas un.
Il en va autrement pour les déracinés. Lasch donne l'exemple des élites – qui par leur position dans les structures de pouvoir déterminent les tendances dominantes de l'orientation sociale. Ces derniers, proches du Jacques Attali qui se satisfait de n'avoir pour seule patrie qu'un ordinateur portable, voient le monde comme des touristes. Dénués de patriotisme, qui suppose un certain enracinement, ils se font apologètes du multiculturalisme, mais en tant qu'objet de consommation exotique propice à flatter les sens et un faux universalisme sans engagement durable aucun. Cet imaginaire encensé par ses bénéficiaires, poursuit Michéa à la suite de Lasch, constitue l'envers d'une société décente. Comme Weil, Michéa ne conçoit pas d'interdire les voyages, mais souhaite rompre avec la politique frénétique du mouvement. Pour cela, il conviendrait de « [réhabiliter] les idées de lenteur, de simplicité volontaire, de fidélité à des lieux, des êtres ou des cultures et, avant tout, l'idée fondamentale selon laquelle il existe (contrairement au dogme libéral) un véritable art de vivre dont la convivialité, l'éducation du goût dans tous les domaines et le droit à la « paresse » (qui ne saurait être confondue avec la simple fainéantise) constituent des composantes fondamentales. » De plus, conclut-il, le nomadisme attalien ne saurait être universalisé sans contradiction en raison de limites matérielles et écologiques. Ce cosmopolitisme reste donc un « privilège d'enfant gâté ».
Cette dimension économique ressort dans le roman social de Maurice Barrès Les Déracinés. L'auteur y fustige le centralisme jacobin qui faisait de Paris le cœur de toutes les attentions à l'instar de ce qu'on appelait encore récemment le rêve américain. Des lycéens lorrains sont incités à partir pour la capitale par leur enseignant, Bouteiller. Tant que l'histoire se déroule en Lorraine, l'auteur ne mentionne pas les différences de classe. Une fois sur Paris toutefois, le lien d'un enracinement partagé entre les anciens lycéens se détériore progressivement. François Sturel, protagoniste principal, est hébergé chez une riche famille. Il a le loisir d'y côtoyer Astiné Aravian, une femme d'Orient, qui nourrit ses rêves de découverte d'un ailleurs, de l'exotisme. Deux autres de ses camarades, Racadot et Mouchefrin, sont pour leur part sans le sou. Ils logent ensemble dans une chambre de bonne dans des conditions misérables. Décidés à monter un journal pour survivre financièrement, ils sont progressivement abandonnés par leurs anciens amis, qui sont parvenus à trouver racine dans leur nouvelle vie parisienne. Racadot demandera vainement une aide financière à son père. Ce dernier refusera en arguant qu'au pays lorrain tout était en place pour qu'il dispose d'une bonne situation professionnelle, assurée par les réseaux de solidarité enracinés de la petite patrie. L'histoire se terminera tragiquement pour Racadot, puisqu'après avoir commis un meurtre contre une riche femme pour dérober son argent et disposer de quoi survivre, il sera mené à l'échafaud. Dès le premier des deux tomes de son essai, Barrès écrivait que les jeunes Français étaient élevés « comme s'ils devaient un jour se passer de la patrie. On craint qu'elle leur soit indispensable. Tout jeunes, on brise leurs attaches locales. » Mais ce n'est pas tant le déracinement qu'il voue aux gémonies, ni un certain goût pour l'exotisme. On le sait, Barrès admirait la culture hispano-arabe de la ville de Tolède et de la toile du Gréco, cœur de son récit Greco ou le secret de Tolède, et il fut l'objet de railleries pour avoir une maîtresse berbère. Ce qui est critiqué dans Les Déracinés est le fait de ne pas pouvoir se raciner à nouveau. (1) En écrivant que « ces trop jeunes destructeurs de soi-même aspirent à se délivrer de leur vraie nature, à se déraciner » (2), Barrès cherche à expliquer que le milieu privilégié pour se réaliser et disposer d'assises solides, de solidarité, est la petite patrie, celle où l'on a ses racines empiriques. Le déracinement brise les solidarités traditionnelles, éloigne par la division économique, et crée sur le long terme des regroupements seulement affinitaires – ou de classe.
Nous retrouvons peu ou prou les mêmes éléments de critique chez Pasolini, en particulier dans son analyse du libéralisme-libertaire de mai 68. Pour l'auteur italien, rapporte Imatz, « la contestation de 68 avait pratiquement aidé le nouveau pouvoir à détruire les valeurs dont le néo-capitalisme entendait bien se débarrasser : la tradition, le sens du sacré, l'attachement aux racines, à l'identité culturelle et historique, le lien organique avec une communauté d'hommes et de valeurs. » En prenant le contre-pied de Barrès, Pasolini écrit Le rêve d'une chose. Le déracinement n'y est que peu conté, lorsque trois amis communistes décident de passer le rideau de fer, dont ils reviendront désillusionnés et avec la nostalgie du pays, ici entendu dans le sens de la petite patrie charnelle. Bauman rappelle qu'encore peu après la Deuxième Guerre Mondiale, le « pays » rural était circonscrit au voisinage immédiat, soit un rayon d'environ vingt kilomètres. Dans son roman, Pasolini défend une vision solidaire de la vie communale. Les familles sont pauvres, mais les liens tissés et entretenus quotidiennement assurent une vie en communauté où personne n'est délaissé. Les générations y sont soudées, une famille habite sous un même toit et ne laisse pas ses plus vieux membres dépérir. L'industrie, la technique et la précarité de la condition ouvrière y sont indirectement critiqués : l'accident de travail mortel du livre – une explosion – se produit dans une usine. Loin du libéralisme, conscient de la lutte des classes – l'épisode des ouvriers qui se rendent chez le patron – sans verser dans la caricature matérialiste et infantile freudo-marxiste, Pasolini défend une vision organique des rapports sociaux. Les gens ordinaires y sont pauvres, mais la vie y est riche en sens, malgré la scolarisation limitée et une mobilité faible.
Le critère IDH de l'accès à la culture entretient le même flou que le niveau de vie. Parle-t-on de culture d'un point de vue quantitatif ? De biens de consommation assimilés à de la culture ? Sur ce point, l'enracinement présente des choix adverses de la modernité libérale et progressiste. Nous avons vu précédemment avec Lasch que des membres d'une même communauté géographique – ou d'une même culture – ont un sentiment de responsabilité envers les enfants des autres. Sur le plan de l'altérité, l'enracinement contraint (sans acte positif) l'homme à se confronter à la différence de nature de ses compatriotes. Dans un système dit « développé » – comprendre occidental ou occidentalisé – les liens se tissent en fonction des intérêts partagés : profession, affinités politiques, centres d'intérêt. Dans une communauté enracinée, les hommes sont habitués dès leur enfance à côtoyer des êtres de toutes tendances, professions et intérêts car les limites posées par une vie enracinée rendent difficile une autonomisation de la sphère sociale commune. En outre, l'accès à la culture ne passe pas forcément par le medium scriptural. La transmission peut être orale, et davantage pratique que la théorie dispensée par les cultures modernes. A la différence des livres ou du télé-enseignement, le face-à-face se verrait davantage favorisé. Notons ici que dans le projet qu'elle souhaitait voir se réaliser, Simone Weil préconisait une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. La pensée devait y être liée à l'application pratique, dans le travail, afin de pénétrer « dans la substance même de l'être ».
En résumé, les outils de la modernité s'avèrent inaptes à saisir la quintessence de la vie enracinée. Économistes, politiciens et intellectuels déracinés sont incapables de construire une nouvelle réalité en passant à un métasystème, une échelle d’observation supérieure. De là, ils pourraient concevoir que les formes de vie traditionnelles sont une différence de nature, un type logique différent dans l'appréhension de la vie et de la socialité. Il ne s'agit pas d'une différence de degré qui devrait et pourrait être résorbée par la suppression des socles conservateurs dans les valeurs des gens ordinaires. L'helléniste Marcel Detienne, dans un essai récent, fustigeait l'identité nationale ; il le faisait toutefois en précisant en fin d'ouvrage qu'il se prononçait en tant que cosmopolite, donc étranger aux implications de la vie communautaire. (3) Abusivement, il établissait un lien direct entre Hitler et celui qui aurait été un proto-nazi, Maurice Barrès. L'argument employé par Detienne provient de la formule du socialiste national, « la terre et les morts ». Pourtant, explique Imatz, le nationalisme républicain de Barrès ne cherche pas à restaurer le passé, mais à établir une continuité avec lui. La terre et les morts n'est pas une doctrine raciale au sens biologique, mais au sens historique. Ploncard d'Assac le rappelle : chez Barrès il n'y a pas de race française, mais un peuple français, une nation française, c'est-à-dire une collectivité de formation politique. Partisan de la restauration des corporations, Barrès professe un enracinement par-delà droite et gauche : il est les deux à la fois dans la mesure où l'on admet une gauche sensible au social et une droite s'occupant principalement de l'intérêt national, englobant elle aussi le souci du social. Une vision que l'on retrouve chez le « barrésien Charles de Gaulle », dont la proposition de participation provient directement de Barrès.
( 1 ) « Ces jeunes gens, ces déracinés, le problème est maintenant de savoir s'ils prendront racine.
C'est un livre où l'on doit voir un esprit qui a la tradition, non un esprit réactionnaire. Je montre comment ces jeunes gens sont déracinés ; je ferai voir comment Saint-Phlin sait demeurer raciné ; je ferai voir en outre les efforts des autres pour reprendre racine et Rœmerspacher y parviendra pleinement. On a déjà vu que Racadot et Mouchefrin échouent. », Barrès (Maurice), Mes cahiers, tome premier, p.218
( 2 ) A l'instar de Paul Bourget (à qui Les Déracinés est dédié) et de son Disciple, Barrès pointe la responsabilité des maîtres dans les actes des élèves : « On peut se croire à dix-sept ans révolté contre ses maîtres ; on n'échappe pas à la vision qu'ils nous proposent des hommes et des circonstances. » (tome premier, p.12) Il reprend ce propos explicitement à la fin de son second tome, au travers de la bouche de Bouteiller, qui devenu député s'adresse à l'un de ses anciens élèves devenu son porte-parole en ces termes : « Tout à l'heure, mon cher ami, quand vous me traitiez si généreusement, j'admirais votre talent, que j'ai prédit, vous vous en souvenez, dès 1880 ; mais ce que j'admirais surtout, c'est que vous vous soyez à ce point affranchi de toute intonation et, plus généralement, de toute particularité lorraine. » (tome second, p.259)
( 3 ) « Il est temps de demander courtoisement à mon vis-à-vis « non-autochtone » d'où il vient, s'il est comme moi, un nomade sans racines (...) », Detienne (Marcel), L'identité nationale, une énigme, p.144.
Réenraciner sans pathologie
Notre société liquide contemporaine ne détruit pas pour autant la nécessité de l'homme de posséder une assise sociale. Lasch exposait que « la disparition de presque toutes les formes d'association populaire spontanée ne détruit pas le désir d'association. Le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. » Diverses structures se sont proposées de recréer du lien, que ce soit au moyen des BAD (bases autonomes durables) SEL (système d'échange local), AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) ou de l'exode urbain pour repeupler les petites localités. L'enracinement reste un sujet de préoccupation, en particulier là où les villes historiques ont été transformées en « pôles urbains » réclamés par la compétition économique mondialisée. Dans un tel contexte, la question identitaire a progressivement émergé sur la scène politique, jusqu'à occuper une part importante de l'espace public. Selon Bauman, elle est le produit d'une crise d'appartenance. Nous nous demanderions qui nous sommes à une époque où la réponse ne coule plus de source. Alain de Benoist propose la même analyse en expliquant le raisonnement subjectif contemporain relatif à ce domaine : « pour me réaliser, je dois me trouver, et pour me trouver je dois savoir en quoi réside mon identité. » Se réenraciner de manière cohérente suppose donc de faire preuve de critique envers les dogmes de la société de masse, et de savoir distinguer l'enjeu réel qui se cache derrière la réponse à apporter. En effet, l'ingénierie sociale des gouvernants ne s'oppose pas à ces préoccupations, à condition toutefois qu'elles ne menacent pas l'économie de marché ni n'aboutissent à une remise en cause des inégalités de classe – puisque le fait social total contemporain est le capitalisme, et que le rapport est entre autres fonction de l'argent possédé par chacun. Les différences sont encouragées – le droit à la différence est remplacé par le devoir d'appartenance –, mais à condition qu'elles soient relativisées sur un plan horizontal. La seule question qui importe n'est plus que l'inégalité d'accès au marché et à la consommation. En dernier ressort, il importe que la réalité construite par les citoyens corresponde aux souhaits des élites. De préférence, la critique sera donc intégrée au système, ritualisée, et par là inoffensive. Les détracteurs du déracinement s'opposeront en croyant proposer un système alternatif. Toutefois, la limitation de leur perception par l'aliénation les empêchera de voir qu'ils appartiennent en réalité au même métasystème. Ils ne constitueront alors qu'une entropie nécessaire à la régulation du mécontentement, sans toutefois représenter un danger réel.
Michéa définit l'identitaire comme la « vie collective enracinée dans une culture particulière. » Aujourd'hui cependant, la pluralité des sens attribués à ce concept en rend les contours et les implications flous. Bauman constate que le règne du quantitatif s'applique également à l'identité. Le sous-jacent n'est pour autant pas analogue aux multiples racines dont l'homme aurait besoin et que propose Weil. L'homme doit se construire tout au long de sa vie et se perfectionner par l'apport d'éléments donnés par le milieu naturel dans lequel il vit et se confronte. De plus, les racines dans un cadre limité doivent aider à appréhender les degrés supérieurs sans entrer en contradiction ni conflit avec eux, ajoute Imatz : « L'enracinement dans une identité régionale, ethno-historico-culturelle, doit permettre de renforcer le sentiment d'appartenance aux autres unités de destin dans l'universel que sont la nation et la communauté européenne. » Le cumul post-moderne des identités n'est en rien comparable. Il se fait dans des « groupes » ou « communautés virtuelles ». Les identités y sont éphémères, cumulables, substituables, interchangeables, allant parfois jusqu'à franchir la barrière du genre sexuel. Toujours plus loin, elles aboutissent dans notre société judiciarisée à la multiplication des revendications de micro-communautés autoproclamées. Il s'agit de ce que Maffesoli appelle – pour en dresser le panégyrique – le temps des tribus. Il s'agit là du sens sociologique, en rien comparable avec les implications réellement tribales des communautés traditionnelles. La détermination particulière, « tout agencement symbolique concret supposé enfermer un sujet (qu'il soit individuel ou collectif) dans les limites d'un héritage historique ou naturel donné », est niée. Dans ces « communautés-patères », l'engagement demandé pour adhérer et partir est faible. Le voisinage accidentel dont nous avons précédemment parlé est remplacé par le « réseau de connexions ». Atomiste jusqu'au bout de sa logique, ce modèle est essentiellement textuel, car le visuel, le face-à-face, comprennent une dimension intimidante à laquelle il est impossible de se soustraire par le zapping ou la conversation différée des SMS et tchats. La tradition est remplacée par la mode et le tribalisme qui l'accompagne, « lancée par un capitalisme consumériste qui est rapidement en train de substituer aux communautés de quartier des centres commerciaux, ruinant par là ce particularisme même qu'il nous vend avec empressement comme une marchandise. »
La question politique de l'enracinement comprend des écueils à éviter. La diabolisation du différentialisme – de nature – aurait entraîné des résurgences pathologiques du nationalisme. Il proviendrait du refus du droit à un peuple d'être lui-même. Les mouvements dits identitaires cherchent alors à renouer avec leurs racines. Néanmoins, la différence entre un passé réel ou mythifié est ténue. En étudiant les variations concomitantes, nous pouvons remarquer que de telles réflexions se sont amplifiées à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Conformément à la géo-ingénierie des néo-conservateurs, l'idée de « choc des civilisations », reprise de manière détournée et falsifiée des travaux de Samuel Huntington, s'est répandue. (1) Elle a contribué à racialiser toujours davantage le débat, par une méthode proche de la stratégie dite du choc, où l'on provoque une panique dans la population afin de produire une réaction voulue. La tactique est connue : un bouc émissaire est désigné comme responsable des malheurs et danger principal pour la survie du groupe. Les hommes sont manipulés, orientés vers des éléments isolés pour entretenir la croyance que l'ennemi a été démasqué. Là où l'irrationnel domine, lorsque les pulsions de peur sont exacerbées, les hommes tombent dans le piège de l'unilatéralité. La recherche de racines ne se créera donc pas à partir de, mais en réaction à. On se constitue en négatif face à un ennemi désigné, ce qui « n'exprime pas l'identité », mais « en révèle la perte ». Il ne s'agit là que d'un ersatz, construit idéologiquement pour répondre à une situation donnée. Peu importe que dans les faits les régimes intégristes d'Arabie Saoudite et du Qatar entretiennent des relations économiquement prospères avec les États-Unis, l'Angleterre, Israël et la France, l'Islam sera désigné comme le nid de terroristes contre lesquels il faut se protéger – en ignorant par ailleurs le fait que les conférences à l’École militaire, où se réunissent des personnes haut placées, soient accessibles en présentant une simple pièce d'identité. Certes, la racaille allogène pullule telle un cancer et nous avons dépassé démographiquement le seuil systémique de toxicité raciale, mais gardons à l’esprit que les « valeurs » dont se réclament ces sous-merdes aliénées sont essentiellement celles de ce qu’Abauzit appelle la sous-culture mercantile anglo-saxonne. Quant au communautarisme des allogènes, il est une tentative d’enracinement pathologique. Il est vrai, toutefois, que nous devons noter, si nous voulons vraiment appréhender l’altérité, l’incompatibilité civilisationnelle de cultures incapables de vivre en harmonie avec les valeurs françaises, fussent-elles traditionnelles – cette critique pouvant s’appliquer à la fortune anonyme et vagabonde du nomade éternel.
L'enracinement se réduit alors à un simulacre – de Benoist nous rappelant par ailleurs que l'Histoire démontre que la Mêmeté n'empêche nullement les conflits internes. En termes d'ingénierie sociale, il ne s'agit que de la mise en pratique de la doctrine Kitson et de l'anthropologie appliquée de Gregory Bateson. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, ce dernier expliqua que pour maintenir un peuple colonisé, « inférieur », sous domination, il ne fallait pas chercher à détruire tous les éléments de ses traditions ni les diluer dans la culture de l'idéologie dominante, celle des intérêts des élites au pouvoir. Il s'avérait bien plus judicieux de les faire survivre en tant que folklore, afin que le dominé ait l'impression que le colon respectait ses racines. A notre époque, la question des mouvements identitaires porte essentiellement sur la problématique ethno-raciale, mais très peu sur la remise en cause des inégalités économiques, dans un monde régi par l'argent. Si les hommes ont besoin d'un imaginaire, d'un mythos, De Benoist rappelle que dans son versant pervers l'exaltation de la solidarité nationale avait été destinée à freiner la lutte des classes. Le Bloc identitaire n'aura par exemple pas de problème à inviter Hervé Juvin en conférence pour l'écouter défendre l'identité, alors que ce dernier fait par ailleurs la promotion de la privatisation de toutes les sphères du vivant. Le choix du retour à ses racines profondes est un réflexe sécurisant, puisque la territorialité assure ce rôle. A l'heure de l'abstraction et de la désagrégation nationale dans un ensemble technocratique désincarné, le concret prime : « Mieux vaut alors être un vrai Breton, Normand, Flamand, Occitan, Corse ou Basque qu'un Français hasardeux. La défense de la région, du « pays », de la petite « patrie charnelle », c'est l'attachement à un sol, à un parler, à des coutumes, à des hommes. »
Mais comme nous l'avons introduit, se réenraciner implique le choix d'une orientation politique. Renouer implique d'avoir conservé des liens, et de prendre la mesure de la continuité historique, « sens d'appartenir à une succession de générations qui, nées dans le passé, s'étendent vers le futur. » Peu ou prou, le réenracinement oblige à retrouver le sens des traditions perdues. Ceci se distingue de l'esthétisme passéiste. Weil mettait en garde lorsque certains conservateurs en appelaient à un passé fictif. Une fois le passé détruit, ajoutait-elle, celui-ci ne revient jamais. Maurras en avait lui-même conscience. Sa méthode d'analyse prend pour base la Tradition, « ce qui a duré, ce qui a réussi séculairement. » Mais cette tradition doit être critique, elle doit tirer les leçons du passé, et non se complaire dans une position adolescente d'un imaginaire confortable et fallacieux. Imatz en appelle également à la Tradition dans son analyse du non-conformisme, qui aurait deux subdivisions : 1) la pensée traditionnelle, organique, qui voit la différence et l'inégalité sous l'angle de la complémentarité. La hiérarchie y est « une relation d'englobement du contraire et d'inclusion du différent. » ; 2) la réflexion politique conservatrice-révolutionnaire, qui cherche à jeter un pont entre la Tradition et la Révolution. Les opposés sont conciliés dans une approche hégélienne : « associer, combiner, surmonter les contraires relatifs. » Dans les deux cas, « il ne s'agit pas de restaurer ce qui est d'hier, mais de donner forme nouvelle à ce qui est de toujours. La tradition n'est pas le passé ou le contraire de la novation, mais le cadre dans lequel doivent s'effectuer les novations pour être significatives et durables. » En conclusion, réenraciner ne peut se dispenser du sens du passé, qui revient à inscrire l'individu dans la continuité historique, les filiations et les fidélités, sans pour autant tomber dans la pathologie de la construction idéologique qui ne sera qu'une forme de la schismogenèse symétrique inter-communautaire. Les revendications identitaires ne peuvent bien entendu pas être homogénéisées, en particulier à cause des différences individuelles dans les conceptions. Mais le pouvoir politique s'appuie dessus pour diaboliser toute critique et revendication d'enracinement qui le mettrait réellement en danger en sortant du Marché. Les valeurs n'étant alors pas marchandisables, elles seront caricaturées par les élites qui les présenteront sous un angle réactionnaire et névrotique plutôt que de tenir compte de leurs aspirations. Ce qui peut expliquer, dans une certaine mesure, la double pensée orwellienne de la société liquide : « Les migrants ont bien sûr le droit de faire souche dans le pays d'accueil tout en conservant leurs racines, leurs cultures originelles, qui ne manqueront pas d' « enrichir » de leurs « différences » ledit pays ; en revanche, les autochtones encore enracinés sont invités à oublier leur histoire et leur culture, à « s'ouvrir » et à se dépouiller de leur identité. »
( 1 ) Voir le récent Rapport sur le mondialisme de Pierre Hillard (disponible par Mecanopolis), Choc et simulacre du Collectif européen pour une information libre, ainsi que les thèses du think tank Project for a new american century (PNAC).
Dans une perspective de réenracinement sans résurgence pathologique d'une identité essentialisée ou idéologiquement construite, la mémoire est à distinguer de la nostalgie. Lasch confirme le piège post-moderne de cette dernière, « jumelle idéologique » du progrès. Tous deux auraient une vision synchronique du passé, « statique et intangible ». En rompant avec la continuité historique, la nostalgie se refuserait à revenir sur les erreurs commises. Loin d'une Tradition critique à laquelle elle pourrait prétendre s'apparenter, elle entretient la croyance en un âge d'or – à distinguer toutefois du sens qu'il prend chez les penseurs de la Tradition et qui qualifie une détention du pouvoir par les autorités spirituelles. A l'image de l'anarchisme conservateur d'Orwell, expliquait Michéa, toute critique anti-capitaliste se doit de posséder des dimensions conservatrices, afin de protéger les fondements de la vie en commun. Mais la nostalgie « sape la capacité à faire un usage intelligent du passé », notamment en dépréciant le présent. Elle affaiblit le passé, car elle ne souhaite pas le préserver comme y invite Simone Weil, ni le défendre, mais le restaurer sans tenir compte des mutations dans les structures psychologiques du sujet collectif. De Benoist s'appuie sur Ricoeur et rappelle pourtant que l'identité comprend une part de mêmeté mais également d'ipséité, de dynamisme ; elle est « ce qui nous permet de toujours changer sans jamais cesser d'être nous-mêmes ».
Lasch privilégie le concept de mémoire sur celui de nostalgie. La mémoire relie passé et présent et assure par-là la continuité historique. Malgré sa volonté de table rase, la Révolution française, comme toute révolution, s'est appuyée sur des valeurs héritées de l'époque traditionnelle d'Ancien Régime. La mémoire utilise le passé pour enrichir le présent en envisageant passé, présent et futur comme continus. Mais Alain de Benoist émet des réserves sur son usage, lorsque le militantisme et la propagande la récupèrent pour la détourner du domaine historique au champ politique, ce qui rend l'appel à la mémoire ambiguë. Par ailleurs, la mémoire se constitue d'autant de parts d'oubli. Elle est « autant transmission qu'occultation », un « tri dans l'héritage » qui procède par préférences et non par prétention à l'objectivité. Assez proche de Lasch dans sa préoccupation, De Benoist invite donc davantage à un recours aux sources plutôt qu'à un retour aux sources, afin de surmonter l'obstacle épistémologique que constitue la confusion avec la nostalgie et l'usage malveillant de la mémoire.
Sur le plan politique, alors, comment éviter les réactions pathologiques ? En premier lieu, comme y invitait Orwell, s'approprier, ou plutôt se réapproprier sa langue pour sortir du piège du discours préfabriqué par les ingénieurs sociaux. (1) Si le pire qualificatif dans la biens-pensance gauchiste reste l'accusation de fascisme, Michéa, conformément à l'hypothèse Sapir-Whorf selon laquelle le langage conditionne la pensée, précise qu'« un tel régime de pensée doit définir à la fois un cadre linguistique contraignant (« croissance » et non « accumulation du capital », « intervention humanitaire » et non « guerre néo-coloniale », « tentation populiste » et non « exigence démocratique », etc.), une manière manipulatrice de poser tous les problèmes (de façon à rendre d'emblée impossible toute solution contraire aux intérêts des riches et des puissants) et des schèmes de pensée mécaniques dont il est « politiquement incorrect » de s'écarter un tant soit peu. » A partir de la réhabilitation d'une correspondance entre le signifiant et le signifié, la réflexion sur le populisme développée par Christopher Lasch peut être proposée. Comme dans le cas de la dyade mémoire / nostalgie, il s'interroge sur un enracinement avec pour base le populisme (le vrai) ou le communautarisme. Ce dernier n'est pas à confondre avec la culture communautaire, qu'Imatz qualifie (par un jugement positif) de populisme, à l'opposé d'une culture libérale qui serait oligarchique. Le communautarisme trouverait ses fondements dans les mêmes vertus que l'enracinement : traditions populaires, coutumes, préjugés, sentiments habituels. (2) La critique communautarienne récuse l'abstraction juridique du libéralisme pour inscrire l'homme dans une « communauté constitutive » qui, le précédant, fonderait ses valeurs et normes. L'homme ne saurait se passer d'un montage normatif arbitraire, comme dans la common decency orwellienne où l'on a une conscience ancrée de choses « qui ne se font pas ». Mais si populisme et communautarisme rejettent tous deux le Marché et l’État-providence au profit d'une troisième voie par-delà droite et gauche et sont réservés voire critiques envers le progressisme des Lumières, le second serait davantage enclin aux compromissions avec l’État-providence et à l'éthique de la compassion. Plus proche d'une vision de la société à la Nancy Fraser, les questions de sexe et de race domineraient progressivement les « divisions réelles », de classes. En outre, cette approche interdirait les jugements de valeur sous prétexte de ne pas froisser les membres de telle ou telle communauté et contribuerait à tribaliser progressivement la société, conformément aux vœux du Marché.
Le populisme recueille davantage l'approbation de Lasch. Mais qu'est-il ? Il se situerait par-delà droite et gauche, dans des « sociétés en crise de transition », lorsque apparaît une rupture entre l'élite et la base sociale, rupture notamment due à l'extrême « verticalité du pouvoir », une schismogenèse complémentaire exacerbée sans contrepoids ni légitimité. Le populisme est un vœu de démocratie intégrale. Dorna (qui en bon frère trois points, donc de mauvaise foi, assimile Le Pen au nazisme, mais se montre bien plus tendre envers Bernard Tapie – une passion de géomètre partagée, sans doute) le résume par la formule de Victor Hugo « Le réel gouverné par le vrai. Voilà le but. » et expose que ce phénomène « est, avant toute autre chose, un sentiment, une attitude morale, un rejet de l'aliénation du monde capitaliste et de la fragmentation de l'humanisme. » Ici, comprendre un humanisme maçonnique, des Lumières, bien entendu, donc profondément anti-humaniste. Pour Lasch, loin d'être un refus de la démocratie – dans ses diverses acceptions, de nature et non de degré – il est au contraire une demande profonde de démocratie lorsque les élites s'autonomisent de la nation et des préoccupations des gens ordinaires. En général, un homme fort et providentiel est recherché pour mener la révolte contre l'aliénation. Deux alternatives existent quand apparaît le populisme au sein d'une société : soit l'explosion révolutionnaire, soit l'implosion conformiste. Sémantiquement, il fait appel à des notions à forte charge affective : le peuple, la nation, la démocratie. La vérité s'y énonce en termes mythologiques, car les croyances fonderaient la cohésion sociale. Les conditions d'apparition du populisme sont liées à la crise et aux sociétés bloquées – nous dirons plutôt en perte de sens, déracinées –, où l'âme collective dépérit. La puissance qui galvanise laisse place à l'apathie qui accable et fait douter. Le populisme naît par la « désillusion démocratique », car pour Dorna la démocratie est une méthode mais pas une doctrine.
L'enracinement tel que pensé par Simone Weil peut entrer dans le cadre populiste – repensons à la devise poujadiste « servir et non se servir », proche des vertus exaltées par la philosophe. Comme dans l'un de ses articles, elle propose dans son essai la suppression générale des partis politiques, qui divisent plutôt que d'unir et contiennent en germe le totalitarisme. La réflexion d'Evola suit un cheminement différent mais pour un résultat également conforme à la Tradition. Il soutint l'Italie fasciste et son parti unique, mais sa logique intellectuelle sous-tend qu'il ne s'agissait là que d'une phase de transition entre la démocratie partisane et la Tradition, où le parti unique s'effacerait devant l'absence de parti.
En son sens politique, l'antipopulisme est donc une démophobie. Pour Lasch, le populisme est attaché à une éthique du respect. Il rejette tant la déférence que la pitié. Simple et direct, il ne craint ni les jugements moraux ni l'éthique de la responsabilité. Il récuse la culture de l'excuse et l'angélisme envers la pauvreté. Mais le respect dont il fait preuve s'oppose à la conception de Richard Sennett que critique Lasch, pour qui les pauvres devraient être respectés en tant que tels, maintien du statu quo de la misère, tandis que Lasch est partisan de la lutte des classes pour abolir les conditions de vie infamantes au lieu d'avoir de la compassion. Dans leur rapport au Progrès, les populistes privilégient la compétence (lopin de terre, petite boutique, vocation utile) sur le consumérisme et l'idéal moderne de la quantification. Le métier, travail concret producteur de valeurs utiles, y prime sur l'emploi, travail abstrait qui produit des valeurs d'échange et se révèle instable en raison de l'interchangeabilité des employés. L'emploi (la tertiarisation le démontre aujourd'hui) crée de l'instabilité et maintient l'homme sous domination, prolétarisé, puisqu'il est soumis aux fluctuations managériales qui freinent son autonomie. Le travail concret requiert un effort, « clé ultime de tout perfectionnement individuel et de toute estime de soi ». A l'égal de l'enracinement décrit par Weil, le populisme réclame une vie sociale consciente de ses limites. Malgré des obstacles quant à la mise en œuvre effective de ses moyens – Lasch écrivait en 1991 – la conception de l'humain présentée par cette orientation politique représente une piste de réflexion privilégiée sur l'enracinement, l'estime de soi et l'altérité, pour une rupture envisageable avec la société liquide : « L'idéal d'une propriété à la portée de chacun incarnait un éventail plus humble d'attentes que l'idéal de consommation universelle, un accès universel à une prolifération de produits. Elle incarnait en même temps une définition de la vie bonne plus énergique et plus exigeante. La conception progressiste de l'histoire impliquait une société de consommateurs suprêmement cultivés ; la conception populiste, un monde entier de héros. »
***
Pour résumer, le déracinement, aidé de son principe actif, la mobilité, a transformé le lieu du politique en flux du politique. La sortie du symbolique au profit du système marchand a changé l'homme de sujet en objet, « [condamné] à l'errance dans le perpétuel présent, c'est-à-dire à une fuite en avant qui n'a plus ni but ni fin. » Le réfractaire est diabolisé, marginalisé, accusé d'être un réactionnaire voire un fasciste. L'homme est dépouillé de sa souveraineté ; faute d'altérité réelle, il ne peut construire de frontière, tant physique que mentale, et s'appuyer sur une base solide qui lui permettra de se réaliser comme sujet ; sans liberté de pensée, où ce n'est pas la liberté mais la pensée en tant que processus intellectuel qui se réduit à la portion congrue, conditionnée par la novlangue du tittytainment promu par Bzrezinski (3), l'individu est aliéné sans en avoir conscience ; sommé de se conformer, il obéit à la pression du groupe, à l'instar d'une expérience de Asch, sous peine d'ostracisme, et se voit niée sa faculté d'autonomie cognitive dans le champ politique. La post-modernité, progressiste, liquide, libérale-libertaire, détruit les conditions nécessaires à la souveraineté tant de l'individu que de la communauté nationale, à savoir la maîtrise de son destin. La pédagogie de ceux que l'on appelle les « experts » s'y joint, qualifiant toute réaction, tout regard vers l'arrière de pathologie. (4) Lorsque les gens ordinaires souhaiteront adapter le système à l'homme, il leur sera répondu que c'est l'homme qui doit s'adapter au système. Une vision qui permet au consultant Michel Hébert de s'inscrire en faux contre « la sémantique « immobilisante » du monde de l'ordre, du monde « bien rangé ». » Nous devons, écrit-il, nous adapter à la réalité, sans cesse changeante. Refuser le prévisible, le fixe, et apprendre « à parler « fluently » le nouveau langage du marketing et de la communication », en disant « oui à l'ère de l'imprévisible : celui du 21ème siècle. » (5) Face aux exhortations au déracinement, pour quelle politique de l'enracinement faut-il opter ? Les réponses peuvent être multiples, comme le démontrent les sensibilités diverses des auteurs que nous avons sollicités pour notre étude. Nous raciner à nouveau en tant qu'individus et sujet collectif passe par la réappropriation de notre souveraineté dans divers domaines. Linguistiquement, parler une langue concrète, comme y invitait Orwell, en refusant les principes abstraits ; refuser l'impasse communicationnelle, la langue aseptisée d'une post-modernité polémophobe, qui refuse le conflit. Se rapprocher en cela de la conception philosophique chinoise de l'homme, pour qui rien n'est intangible mais le produit d'un contexte. Concomitamment, y adjoindre une critique maussienne (ou batesonienne) : l'homme est potentiellement capable tant d'agôn que de partage, ce qui au moyen d'un symbolisme qui véhicule et organise le sens réalise un certain équilibre schismogénique. Ontologiquement, Weil propose une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. Elle implique de sortir du salariat et du monde de l'argent, mobile par nature, ces deux éléments transformant les gens ordinaires en « immigrés sur leur propre sol ». Cela suppose de sortir du système marchand actuel, financiarisé et à l'économie virtuelle, où la tertiarisation empêche la réalisation de l'homme au sein d'une activité professionnelle transcendante. Ne pas craindre une vie dite ordinaire, faite notamment de limites et de contraintes, en délaissant le règne du quantitatif. Refuser à ce titre, les conclusions de Watzlawick : puisque nous construisons chacun notre réalité, nous ne devons pas être contraint car nous serions alors sous le joug d'une réalité autre, mais pas plus légitime. La vie en commun suppose de partager une certaine réalité commune grâce à des référents symboliques que nous n'avons pas choisis. S'il n'est pas pour autant question d'abolir la logique marchande, précise Michéa, il est suggéré de la supprimer en tant que fait social total, centre névralgique autour duquel sont soumises les populations. Quant au passé, nous l'avons vu précédemment, la Tradition critique de Maurras tout comme l'anarchisme tory d'Orwell et le sens de la continuité historique requièrent de prendre le passé pour base, non pour mythe. La question que tout individu pourrait se poser serait non pas, comme le proposait Orwell : « Cela me rend-il plus ou moins humain ? », en raison des catégories de perception préimplantées par le pouvoir dans le champ cognitif des sujets. La méthode à suivre, d'après nous, gagnerait en pertinence si elle reprenait cette réflexion de Julius Evola : « C'est justement aux fins de l'action qu'il est fondamental de connaître la genèse des négations et des erreurs qu'il convient de combattre. Sans quoi, même en toute bonne foi, on peut tomber dans des erreurs dangereuses. Ce que nous voulons dire par là, c'est que, en luttant contre la forme destructrice prise par une idée pervertie et déformée, il peut arriver aussi facilement qu'on lutte aussi contre cette idée en elle-même, ne sachant pas la reconnaître par manque de principes adéquats, ce qui a pour résultat d'accroître la confusion et le désordre. Remonter le processus de dégradation et d'inversion est au contraire le seul moyen de séparer le positif du négatif, d'attaquer le mal à la racine et d'atteindre les véritables points de repère nécessaires pour l’œuvre de reconstruction. » Le tout, en gardant à l'esprit l'hypothèse que le clivage déterminant de la post-modernité ne se situerait pas entre une droite et une gauche, quelles qu'elles soient, mais entre déracinés et enracinés, par-delà droite et gauche.
http://www.scriptoblog.com
( 1 ) « Penser clairement est un premier pas, indispensable, vers la régénération politique. », in Orwell (George), Essais, articles, lettres, volume IV, 38, « La politique et la langue anglaise », p.159.
( 2 ) Nous pouvons y adjoindre cette citation de Barrès, au sujet de Bouteiller : « Déraciner ces enfants, les détacher du sol et du groupe social où tout les relie, pour les placer hors de leurs préjugés dans la raison abstraite, comment cela le gênerait-il, lui qui n'a pas de sol, ni de société, ni, pense-t-il, de préjugés ? », in Les Déracinés, tome I, op cit., p.21
( 3 ) « Tittytainment, selon Brzezinski est une combinaison des mots entertainment et tits, le terme d'argot américain pour désigner les seins. Brzezinski pense moins au sexe, en l'occurrence, qu'au lait qui coule de la poitrine d'une mère qui allaite. Un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettrait selon lui de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète. [...] On voit émerger la société des deux dixièmes, celle où l'on devra avoir recours au tittytainment pour que les exclus restent tranquilles. », Martin (Hans-Peter) & Schumann (Harald), Le piège de la mondialisation, cité in Gouverner par le chaos, p.44.
( 4 ) Sur le rôle des « experts » dans la diabolisation des enracinements, on pourra se reporter à Ewen (Stuart), Consciences sous influence, op cit., Viatteau (Alexandra), La société infantile, op cit., ainsi qu'à Lasch (Christopher), La culture du narcissisme, op cit. Michéa en traite également dans la quasi-totalité de ses essais.
( 5 ) Hébert (Michel), « Do you speak fluently the new marketing and advertising language ? », http://www.influencia.net/fr/actualites1/you-speak-fluently-the-new-marketing-and-advertising-language,47,2072.html, 2 novembre 2011.__________
La synthèse présentée paraphrasant et citant beaucoup, je me suis dispensé des notes de bas de page pour ne pas fatiguer inutilement le lecteur avec des renvois sur des numéros de page. Pour information, je joins seulement une petite bibliographie indicative pour qui souhaiterait aller directement aux sources :
- Amorim (Marilia), Raconter, démontrer, ... survivre.
- Anonyme, Gouverner par le chaos.
- Barrès (Maurice), Les déracinés, deux tomes ; Mes cahiers, tome I.
- Bateson (Gregory), La Nature et la Pensée.
- Bauman (Zygmunt), Identité.
- Caillé (Alain), Anthropologie du don. Le tiers paradigme, 276 p.
- Collectif, Le 11 septembre n'a pas eu lieu...
- De Benoist (Alain), Nous et les autres. Problématique de l'identité.
- Detienne (Marcel), L'identité nationale, une énigme.
- Dorna (Alexandre), Le populisme.
- Evola (Julius), Phénoménologie de la subversion : L'antitradition dans ses écrits politiques, 1933 à 1970.
- Ewen (Stuart), Consciences sous influence. Publicité et genèse de la société de consommation.
- Hall (Edward T.), Le langage silencieux ; La dimension cachée.
- Imatz (Arnaud), Par-delà droite et gauche. Histoire de la grande peur récurrente des bien-pensants.
- Kitson (Frank), Low intensity operations. Subversion, insurgency and peacekeeping.
- Lasch (Christopher), La culture du narcissisme : La vie américaine à un âge de déclin des espérances ; Culture de masse ou culture populaire ? ; Le Seul et Vrai Paradis. Une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques ; La révolte des élites et la trahison de la démocratie.
- Maurras (Charles), L'ordre et le désordre.
- Michéa (Jean-Claude), L'Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale ; Le complexe d'Orphée. La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès.
- Orwell (George), Essais, articles, lettres, tomes II et III.
- Pasolini (Pier Paolo), Le rêve d'une chose., Gallimard, 1965.
- Pernoud (Régine), Pour en finir avec le Moyen-Âge.
- Ploncard d'Assac (Jacques), Doctrines du nationalisme.
- Rawls (John), Théorie de la justice.
- Viatteau (Alexandra), La société infantile.
- Von Bertalanffy (Ludwig), Théorie générale des systèmes.
- Watzlawick (Paul, dir), L'invention de la réalité. Contributions au constructivisme. Comment croyons-nous ce que nous croyons savoir ?
- Weil (Simone), L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain ; Note sur la suppression générale des partis politiques.
Articles
- (Non signé), « Actualité des stratégies de manipulation de Gregory Bateson, ancien agent de l'OSS », Horizons et débats n°35, 13 septembre 2010, disponible sur Mecanopolis.
- Hébert (Michel), « Do you speak fluently the new marketing and advertising language ? », http://www.influencia.net/fr/actualites1/you-speak-fluently-the-new-marketing-and-advertising-language,47,2072.html, 2 novembre 2011.
- Lévesque (Julie), « 11 septembre, psychologie des foules et propagande », http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=19008, 6 mai 2010.
Price (David H.), « Gregory Bateson et l'OSS : la Seconde Guerre mondiale et le jugement que portait Bateson sur l'anthropologie appliquée », Horizons et Débats n°35, 13 septembre 2010, disponible sur Mecanopolis.