
« Les mousquetaires étaient loin de cette image romancée et romantique. C’était avant tout une unité d’élite, une unité militaire directement rattachée au roi, pas du tout indépendante ».
source : YouTube/TV Libertés
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Les mousquetaires étaient loin de cette image romancée et romantique. C’était avant tout une unité d’élite, une unité militaire directement rattachée au roi, pas du tout indépendante ».
source : YouTube/TV Libertés

par Boris Egorov.
Une armée orientale incroyablement nombreuse, bien entraînée et cruelle a non seulement ruiné le pays, mais a également enchaîné pendant plusieurs siècles la conscience du peuple russe par la terreur.

« À cause de nos péchés, des peuples inconnus, Moabites impies, sont venus, dont personne ne sait exactement qui ils sont et d’où ils viennent, quelle est leur langue, de quelle tribu ils sont, et quelle est leur foi » : c’est ainsi qu’un chroniqueur a décrit la première apparition près des frontières russes des troupes mongoles, survenue en 1223. L’invasion de la Russie, cependant, n’était pas prévue par les Mongols à ce moment-là. La campagne des commandants Subotai et Djebé dans la plaine d’Europe de l’Est s’apparentait plus à une mission de reconnaissance qu’à une conquête.
Si vous avez aimé le règne de Macron I, vous consommerez, jusqu'à son terme, le règne de Macron II, et puisque la constitution ne permettra pas en tout état de cause, un Macron III, préparez-vous à adorer un nouveau superchampion de la technocratie. Nos ministres intègres s'y préparent.
Dans l'histoire contemporaine de la France, les exemples de ces bons élèves arrivés au sommet de la décision politique ne manquent pas. Leurs cursus républicains étaient supposés prolonger, de droit divin, leur [brillant] curriculum studiorum. De la sorte, l'on n'ose presque jamais se souvenir des méfaits que, concrètement, ils ont tous engendrés leur vie durant par leur gestion calamiteuse.
1/ Le retour de De Gaulle
En 1958, le Parlement rechigne ... il s'accroche. De Gaulle, lui, multiplie les déclarations, faisant appel (sans rire) à la « discipline de l'armée », assurant qu'il a « entamé le processus » pour revenir aux affaires.
Ne voyant rien venir il déclare à l'envoyé spécial du général Salan, le général Dulac, venu l'informer d'une possible opération aéroportée sur Paris : « Vous direz au général Salan que ce qu'il fait et ce qu'il fera c'est pour le bien de la France. »
Grâce à Alger, grâce à l'armée, grâce aux pieds-noirs, grâce au peuple de France le général De Gaulle revient au pouvoir et déclare aux Français d'Algérie, toutes religions confondues, qui l'acclament : « Je vous ai compris ... Il n'y a plus, ici, en Algérie que dix millions de Français à part entière ... » .
Dès cette minute, le drame commence, alors que tout peut être gagné en peu de temps. Aux frontières les «armées» rebelles se replient en catastrophe, croyant déjà voir l'armée française exercer le droit de suite ...
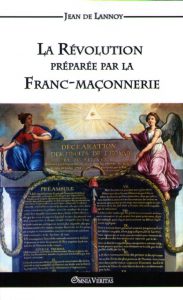
Ce livre parut pour la première fois en 1911. Son auteur, Jean de Lannoy, a voulu montrer la main de la secte maçonnique dans les crimes de la Terreur.
La Révolution française reste un « tabou » et rares sont les personnages politiques ou les journalistes qui ne s’inclinent pas respectueusement devant l’idole révolutionnaire. Pourtant, des écrivains et des historiens en ont démontré les horreurs et les rouages.

Jean-Marie BASTIEN-THIRY était Lorrain, Polytechnicien, Lieutenant-colonel dans l’Armée de l’air et l’inventeur de deux missiles antichars, les SS-10 et SS-11. Il avait 36 ans et laissait une veuve et trois petites orphelines.