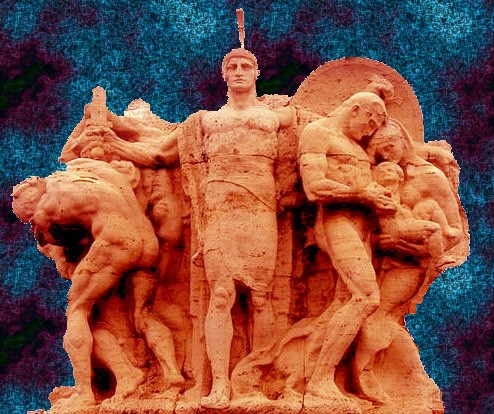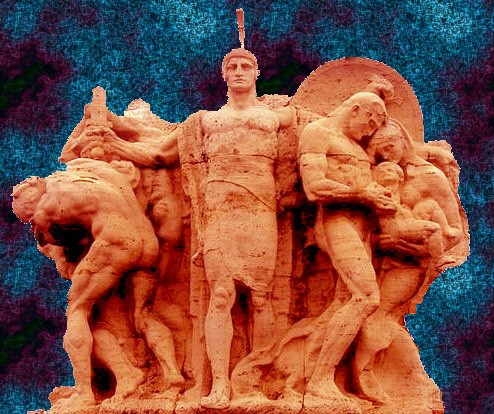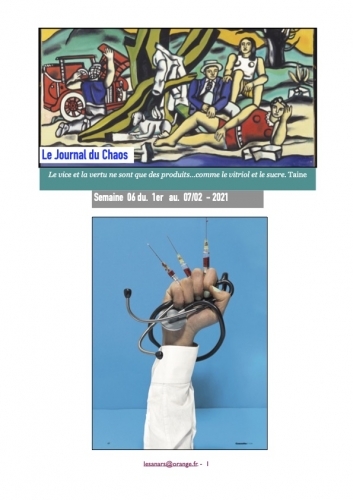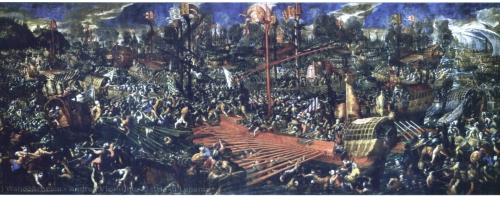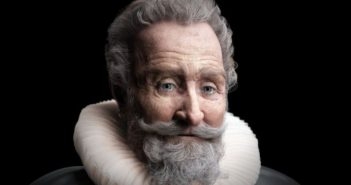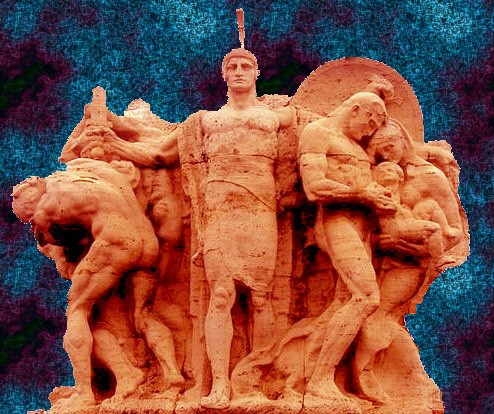
Le contre-modèle de l’Empire, auquel Evola a consacré quelques-unes de ses meilleures pages, est tout aussi parlant. L’empire romain-germanique a incontestablement mieux respecté l’organicité de la société que l’État-nation. Mais il l’a mieux respectée dans la mesure où son pouvoir était, non pas absolu et inconditionné, mais au contraire relativement faible, où la souveraineté y était partagée ou répartie, et où le pouvoir se souciait moins d’imposer sa « forme » aux différentes collectivités locales que de respecter le plus possible leur autonomie.