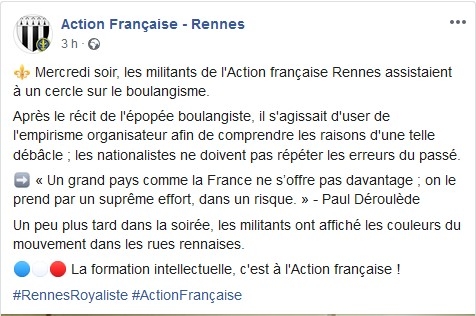Il s’agit d’un drame dont seuls parlaient jusqu’à présent les nationalistes italiens : le massacre ignoble de milliers de personnes par les communistes italiens et yougoslaves (« partisans ») à la fin de la 2e Guerre mondiale. Mais un film vient de sortir qui met sur le devant de la scène italienne cet épisode tu par la gauche culturelle…
La bande-annonce :
Lu chez la Tribune de Genève :
« Pendant des décennies, l’Italie a oublié les milliers de victimes des massacres commis à la frontière yougoslave à la fin de la Seconde Guerre mondiale. «Red Land – Rosso Istria», sorti la semaine dernière en Italie, veut leur rendre justice.
Évoquant des faits longtemps commémorés par les seuls néofascistes, le film tente de rendre compte de la complexité de ce drame. Il a provoqué de fortes réactions sur les réseaux sociaux.
Entre 1943 et 1947, 5000 à 10’000 Italiens – selon les estimations des historiens – ont été tués dans les territoires repris par les Yougoslaves autour de Trieste. Certains ont été jetés parfois vivants dans les «foibe», de profondes crevasses naturelles, tandis que plus de 250’000 autres ont dû fuir leur foyer.
Mais si ces opérations avaient dans les dernières années toute l’apparence d’un nettoyage ethnique de la part des partisans de Tito, elles ont d’abord commencé comme une épuration. Épuration qui visait les carabiniers ou fonctionnaires fascistes et qui se faisait avec la collaboration de partisans italiens.
L’histoire de Norma Cossetto
Aussi, dans l’après-guerre, soucieuse de tourner au plus vite la page du fascisme et des exactions commises dans les régions de Yougoslavie occupées par son armée, l’Italie a-t-elle oublié ces massacres, dont seuls les nostalgiques du «Duce» ont gardé le souvenir pendant des décennies. Ce n’est qu’en 2004, sous le gouvernement de Silvio Berlusconi, qu’une journée nationale du souvenir a été instaurée.
Dans ce cadre, une médaille du Mérite civil a été attribuée en 2005 à Norma Cossetto, une étudiante de 23 ans, fille d’un responsable fasciste local, violée, torturée et assassinée par des partisans yougoslaves et italiens en octobre 1943.
C’est son histoire, comme métaphore du sort de tous les autres, que «Red Land» raconte, de manière sombre et crue. Comme le mode d’exécution des victimes: les unes étaient abattues d’une balle dans la tête au bord d’une profonde «foiba», où elles entraînaient les autres, liées par les poignets. […] »
Le film est boycotté par les salles italiennes.