Pierre Hillard est auteur d'un Atlas du mondialisme aux Éditions le Retour aux Sources. Il donne la clé pour comprendre le monstre mondialiste.
RIVAROL : Vous avez mis en exergue, dans les années 2000, la volonté américaine de créer un « Nouveau Proche-Orient ». Ce projet est à l'origine de centaines de milliers de morts et d'un chaos durable dans toute la région. Pour vous, ce plan est-il encore d'actualité en Syrie ? Dans le même temps, Israël est un acteur non négligeable de la déstabilisation de la région. Comment l'entité sioniste prépare-t-elle sa survie dans un proche avenir ?
Pierre Hillard : Beaucoup d'éléments se télescopent dans cette affaire. Les néoconservateurs américains, dont beaucoup sont d'origines juives (Kristol père et fils, Perle, Wolfowitz…), ont estimé qu'il fallait introduire la démocratie en Irak avec la destitution de Saddam Hussein en 2003. Cette politique devait, selon eux, faire tache d'huile dans l'ensemble de la région. Bien entendu, ces prétentions étaient fallacieuses. D'abord, on peut rappeler les volontés anciennes de balkaniser ces pays musulmans. Dans mon livre Atlas du mondialisme, je cite de nombreux documents et cartes qui le prouvent. Par exemple, la couverture de la revue Time de 1979 présente l'arc de crise allant de la corne de l'Afrique jusqu'au Pakistan avec l'ours russe en arrière-fond. L'objectif était de créer un tel désordre au sein de ces pays que la déstabilisation devait se propager dans les républiques musulmanes soviétiques. On peut relever le plan Oded Yinon de la revue sioniste Kivunhn de 1982 dont les écrits en hébreu ont été traduits en anglais en 1982 par Israël Shahak, président de la ligue israélienne pour les droits humains et civils.
Ce rapport décrit une volonté de faire éclater ces pays en une multitude d'entités territoriales comme, par exemple, l'Irak subdivisé en trois blocs indépendants sunnite, chiite et kurde, mais aussi l'Arabie Séoudite, la Syrie, l’Égypte, etc. Les plans de partition du monde musulman ont été présentés aussi dans une revue militaire américaine, en 2006, avec un article au titre explicite, Frontières de sang, et des cartes sous la plume du lieutenant-colonel Ralph Peters, mais aussi par le New-York Times en 2013 présentant un "idéal" faisant passer ces pays balkanisés en 14 blocs territoriaux. Les guerres et les conflits en tout genre qui martyrisent ces pays ne sont que les conséquences d'ambitions anciennes, mais aussi le reflet d'un courant de pensée parfaitement défini par la Secrétaire d'État aux affaires étrangères sous la présidence de George Bush junior en 2006, Condoleezza Rice « Ce que nous voyons ici, d'une certaine manière, c'est le commencement, les contractions de la naissance d'un nouveau Moyen-Orient et quoi que nous fassions, nous devons être certains que nous poussons vers le nouveau Moyen-Orient et que nous ne retournerons pas à l'ancien. » Outre les aspects politiques, stratégiques et énergétiques, il ne faut surtout pas oublier un autre élément clef, l'affaire spirituelle, plus précisément les ambitions d'un « Grand Israël » des rives du Nil à l'Euphrate proclamées par le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, dans ses Carnets personnels (volume 2, page 711) en se référant à la Genèse 15-18 qui affiche le même programme. Cette politique ne peut aboutir que dans le chaos. Or, dans l'esprit de ces personnes, ce chaos permet aux contractions précédant une naissance de passer à une étape supérieure dans le cadre d'un messianisme triomphant.
Le grand spécialiste du judaïsme, Gershom Scholem, l’affirme clairement « Le messianisme prit alors dans la conscience juive un double aspect, qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes, où on les rencontre de façon plus ou moins explicite un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect utopique quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature - on ne saurait jamais assez y insister - l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire tors du passage du temps de l'histoire présente aux temps futurs messianiques […]. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve, en effet, dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique ; c'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des "souffrances de enfantement" du Messie ». Dans cette tournure d'esprit particulière, l'idéal rabbinique talmudo-sioniste doit s'achever par la reconstruction du Troisième Temple, prélude à l'arrivée de leur messie. La présence de la mosquée al-Aqsa, haut lieu de la spiritualité musulmane, gêne "légèrement" ces ambitions. Doit-on croire qu'un Argameddon peut régler le problème selon certains ?
R. : Quelle est selon vous l'origine de l'opposition entre l'Arabie Séoudite et le Qatar?
P. H. : Les causes sont multiples. On peut signaler des rivalités politiques et économiques entre ces États au sein du Conseil de coopération du Golfe regroupant la plupart des pays de la péninsule arabique. Il faut signaler que le Qatar exploite de vastes gisements de gaz sous-marin dans le Golfe persique (North Dome/South Pars) en liaison avec l'Iran chiite ennemi de l'Arabie Séoudite et d'Israël. Téhéran s'est rangé du côté de la Russie et de la Chine, puissances terrestres, opposées à la thalassocratie anglo-saxonne qui dispose d'une grande base militaire au Qatar (al-Oudeid). Ces deux mondes s'opposent en particulier concernant la politique de la « route de la soie » (ou OBOR : One Belt, One Road, « une ceinture, une route ») diligentée par Moscou et Pékin. Ces derniers rêvent de voir la zone géographique allant de la Turquie au Yémen basculer de leurs côtés verrouillant ainsi l’Eurasie et sécurisant la route de la soie.
Parallèlement à ces événements, il faut rappeler que ces rivalités entre pays musulmans s'allient à des frictions violentes entre factions juives concernant le « Grand Israël » en liaison avec l'Ukraine et la Crimée. Dans mon livre, j'ai apporté des documents montrant des politiques où certains groupes juifs voudraient favoriser un courant migratoire vers l'Ukraine et la Crimée considérées comme une « seconde Judée » en raison de l'histoire des Khazars. Ces peuples turcophones se sont convertis au judaïsme au début du 9è siècle sur un territoire s'étendant de la partie orientale de l'Ukraine (Crimée incluse) jusqu'à la Caspienne. La mer Noire constitue un axe autour duquel tournent des rivalités en tout genre. Nous avons donc des oppositions internes entre ces factions tirant à hue et dia avec en arrière-fond des bagarres politiques, stratégiques, énergétiques et spirituelles entre le monde occidental influencé par la faction liberalo-libertaire Rothschild (avec aussi des oppositions internes) opposée au clan Loubavitch de Berel Lazar soutenant Vladimir Poutine avec en toile de fond la Chine. Rappelons aussi que Vladimir Poutine s'est plu à réciter une prière au pied du Mur des Lamentations, en 2012, en lisant un psaume à partir d'un recueil russo-hébreu affirmant par la suite sa volonté de voir le Temple reconstruit (cf. https://www.breakingisraelnews.ccW78372/bin-exclusive-sanhedrin-asks-putin-trump-build-third-temple-jerusalem/#-sUGSURoTJvkOJb3.97)
R.:Il est particulièrement difficile de comprendre la ligne stratégique des Etats-Unis depuis la dernière élection présidentielle. Pour vous, quels sont les points forts de la diplomatie de Trump ? Renouvelle-t-elle dans votre thèse d'un processus, en cours partout sur la planète, de constitution de vastes blocs continentaux constituant l'architecture de la gouvernance mondiale ? Ce monde multipolaire est-il une menace ou une chance ?
P. H. : L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche correspond à l'arrivée au pouvoir d'une faction oligarchique aux dépens d'une autre incarnée par les employés du système comme Bush, Obama ou Hillary Clinton. D'abord, il faut que le lecteur sache différencier mondialisation et mondialisme.
Toutes les autres questions dépendent de cette clarification nécessaire. La mondialisation est un concept normal reposant sur les échanges des biens, des personnes et des idées en fonction du développement des techniques. C'est tout autre chose concernant le mondialisme qui est un messianisme reposant sur des référents religieux et philosophiques propres à la synagogue nouvelle née avec le Talmud, autour de l’an 100 ap. J-C avec le rabbin Akiba, et dont les objectifs sont d'abattre la maison rivale, c'est-à-dire le catholicisme trinitaire avec ses conséquences politiques. Tout repose sur cette opposition. Concernant Donald Trump, il faut savoir qu'il est protestant (presbytérien, christianisme judaïsé) lié au judaïsme orthodoxe via le mariage de sa fille à Jared Kushner. Par conséquent, sa tournure d'esprit n'appartient pas aux référents du catholicisme traditionnel. Il est donc dans le camp d'en face.
Ensuite, il faut définir deux types de mondialisation et trouver à quel groupe il appartient. On distingue deux types de mondialisation :
1) La mondialisation planétaire consistant à établir une gouvernance mondiale respectant, dans le cadre d'unions régionales, les intérêts des différentes factions oligarchiques. C'est ce que souhaite Vladimir Poutine dans son discours de Valdaï en 2014 appelant à un nouvel ordre mondial politique, économique et juridique privilégiant l'interdépendance sous les auspices d'une ONU modernisée.
2) Le mondialisme unilatéraliste qui promeut uniquement les intérêts d'une faction oligarchique anglo-saxonne (Bush, Obama, ...) liée à des intérêts d'une partie de la communauté juive aux dépens des autres pays et blocs continentaux à qui on laisse les miettes.
Fort de cette assise, on peut constater, tout en restant très prudent en raison des retournements de situation, que Donald Trump et la faction oligarchique derrière lui sembleraient se rapprocher des propositions de Poutine. Lors d'un entretien dans le Wall Street Journal, Trump s'est défini comme « nationaliste et globaliste » (http://wwwSntnewsjcom/article/ president-trump-im-a-nationalist-and-a-globalist). Il souhaite fortifier le bloc américain afin qu'il puisse peser assez lourd dans le cadre d'un monde régi par une gouvernance mondiale. Que cela soit l'OTAN, le Tafia, les rapports avec l'Union européenne, le Canada, la Chine et la Russie (en lien avec l'Union eurasienne) ou l'Allemagne et son levier de puissance qui est l'UE, il s'agit pour Donald Trump de tenter de s'entendre dans un réglage des intérêts américains en liaison avec ceux d'autres clans oligarchiques. Réglage et hiérarchisation des intérêts de chacun dans le cadre d'une interdépendance accrue constituent le point essentiel où se concentrent les problèmes actuels.
J'ai démontré dans mon livre Atlas du mondialisme qu'il y avait eu une bagarre à mort, durant la Première Guerre mondiale, entre les sionistes français, anglais et américains voulant la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine sous la direction de la City face aux sionistes allemands voulant la même chose mais sous la direction de Berlin en liaison avec le chemin de fer de Bagdad traversant les zones pétrolifères de Mésopotamie (Bagdad-Bahn). Nous assistons aux mêmes types de bagarre concernant la répartition des zones d'intérêts et d'influences entre certaines factions oligarchiques juives anglo-saxonnes s'opposant à la faction oligarchique loubavitch russe soutenant Poutine sur fond de messianisme désiré à différents degrés par les différents protagonistes. Ajoutons que les discussions en cours entre l’UE et le Royaume-Uni, concernant le Brexit, entrent dans la même catégorie. Il s'agit d'une tentative de réglage sur des sujets (financiers, hiérarchisation des rôles...) qui doivent permettre à la City de se repositionner par rapport aux blocs continentaux sans oublier le Commonwealth au sein d'une gouvernance mondiale en préparation. Toute la question est de savoir si les différents groupes arriveront à s'entendre et à aller au bout du projet messianique.
R. : Le gouvernement Macron apporte-t-il pour vous un changement au niveau de la diplomatie française ? L'Union européenne semble durcir son emprise sur les Etats membres. Pensez-vous que nous allons être prochainement libérés de cette « prison des peuples » ?
P. H. : Emmanuel Macron n'est que l'outil de l'oligarchie avec, en arrière-fond, Attali, Mine, Drahi et tant d'autres. Ancien de la Banque Rothschild comme l'était Georges Pompidou qui, dans les années 1960, était le trésorier de l'institut mondialiste, la Paneurope France, Macron est un « Young Leader » de la Fondation franco-américaine comme son Premier ministre Edouard Philippe de la même promotion 2012. Il succède au « Young Leader » François Hollande (promotion 1996). Il a pour mission de parachever la construction européenne (gouvernance de la zone euro...). D'une certaine manière, nous sommes dans la dernière ligne droite. L'UE serre la vis de plus en plus afin de favoriser l'enracinement du système. Cela passe ou cela casse. Nous rappelons que le Parlement européen a été construit selon les référents de l'architecture propre à la Tour de Babel. L'UE connaîtra le même sort. Cependant, nous paierons cher sa défaite.
R. : Le mondialisme est pour vous un projet messianique de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Quelles sont les racines occultes de ce grand projet ? Le catholicisme a-t-il un poids géopolitique face à ce monstre ?
P. H. : Dans la lutte engagée par la synagogue à l'égard du catholicisme depuis 2000 ans, il faut que le lecteur comprenne que deux éléments doivent être abattus l'Église catholique et la France née du baptême de Clovis. Dans le premier cas, l'Église offre un modèle spirituel avec des répercussions politiques (ne jamais l'oublier) que le judaïsme talmudique combat. la Sainte Trinité, l'Incarnation et le sacerdoce (conséquence de l'Incarnation). Le nouveau judaïsme qui s'est créé à partir de 100 ap. J-C s'est construit en opposition à cette abomination pour la synagogue qui attend son "vrai" messie.
Depuis 2000 ans, nous assistons à de multiples tentatives de désacralisation de l'Église au profit de la synagogue. En reprenant les idées du rabbin Benamozegh, l'objectif est de faire du peuple juif le peuple prêtre intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive (les gentils) encadrée par les lois noachides (religion anti-trinitaire issue du Talmud pour les gentils). Cette humanité doit se retrouver comme simple fidèle ou prosélyte de la porte au seuil d'un Temple restauré sous l'égide d'un messie juif universellement reconnu. L'Église, selon l'expression du rabbin Benamozegh, doit muter en un « catholicisme d'Israël ».
L'intermédiaire spirituel incarné par le prêtre et, à son sommet, par le pape (vicaire du Christ) a son corollaire politique avec le roi de France qui était le Lieutenant du Christ, principe qui a perduré de Clovis à Louis XVI. La Révolution de 1789 est la victoire de la Kabbale. Le Grand Architecte de l'univers ou l'Horloger, selon l'expression de Voltaire, est le Démiurge tandis que l'Être Suprême cher à Robespierre n'est que l’En-Sof, le Dieu infini. Après avoir abattu la France de l'Ancien Régime, l'Église doit suivre le même chemin. Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Dans mon livre Atlas du mondialisme, j'ai apporté un document officiel inédit prouvant l'action de groupes de pression juifs pour favoriser la bascule de l'Église du côté de la synagogue durant les travaux de Vatican II. Humainement, la situation est sans issue. Cependant, pour les croyants, la victoire apparente de nos ennemis n'aura qu'un temps.
Les Français doivent bien comprendre que le renouveau ne peut se faire véritablement que par la destruction jusqu'à la racine des principes de 1789 et de Vatican II avec la mise à l'honneur du baptême de Clovis dont les principes ont été rappelés par sainte Jeanne d'Arc lors de la Triple Donation le 21 juin 1429 « Christ, vrai Roi de France ».
Propos reccueillis par Monika BERCHVOK. Rivarol du 3 août au 5 septembre 2017
À lire Pierre Hillard, Atlas du Mondialisme, Editions le Retour aux Sources, 312 pages. 100 illustrations et cartes en couleurs , 45 euros franco. Disponible sur < https://wwwleretourauxsources.com >.

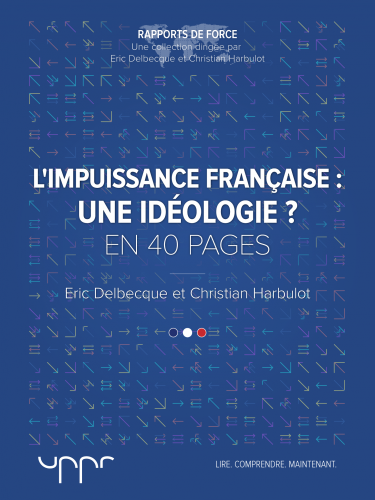 Eric Delbecque est président de l'Association pour la compétitivité et la sécurité économique (ACSE) et directeur du département intelligence stratégique de SIFARIS. Avec Christian Harbulot, il vient de publier
Eric Delbecque est président de l'Association pour la compétitivité et la sécurité économique (ACSE) et directeur du département intelligence stratégique de SIFARIS. Avec Christian Harbulot, il vient de publier  Le problème vient du fait que l'Union européenne jouent les intégristes du droit de la concurrence, alors que les autres nations pensent d'abord à maximiser leur prospérité, même si cela implique de fouler au pied les principes de base du libéralisme. D'une certaine manière, Donald Trump explicite la philosophie des Américains, y compris celle des Démocrates: «Acheter américain, embaucher américain».
Le problème vient du fait que l'Union européenne jouent les intégristes du droit de la concurrence, alors que les autres nations pensent d'abord à maximiser leur prospérité, même si cela implique de fouler au pied les principes de base du libéralisme. D'une certaine manière, Donald Trump explicite la philosophie des Américains, y compris celle des Démocrates: «Acheter américain, embaucher américain».


 Depuis plusieurs années, une poche islamiste s'était constituée dans la montagne libanaise appelée Antiliban, à cheval sur la frontière syrienne, à quelques kilomètres du beau site antique de Baalbek. De là, le Front al Nosra (rebaptisé depuis Fatah al Cham) se sentait suffisamment sûr de lui pour faire des incursions dans la Plaine de la Bekaa. Il y avait affronté l'armée libanaise, tuant et faisant prisonnier plusieurs de ses soldats. Il faut noter que des éléments de Daesh étaient venus lui prêter main forte ; il décapitera deux soldats libanais...
Depuis plusieurs années, une poche islamiste s'était constituée dans la montagne libanaise appelée Antiliban, à cheval sur la frontière syrienne, à quelques kilomètres du beau site antique de Baalbek. De là, le Front al Nosra (rebaptisé depuis Fatah al Cham) se sentait suffisamment sûr de lui pour faire des incursions dans la Plaine de la Bekaa. Il y avait affronté l'armée libanaise, tuant et faisant prisonnier plusieurs de ses soldats. Il faut noter que des éléments de Daesh étaient venus lui prêter main forte ; il décapitera deux soldats libanais...