tradition - Page 184
-
Près de 60 formation proposées cet été !
-
L’Église, gardienne de l'ordre
Prêchées aveuglément par la République, les valeurs de fraternité et d'amour engendrent la mort. Derrière « Liberté, Égalité, Fraternité », il faut savoir lire, ce que ne font pas conservateurs et libéraux, « Ni Dieu ni Maître ».
La politique n'est pas la religion, et tous les penseurs classiques ont bien marqué le distinguo, de saint Thomas qui ne bâtit pas une cité théocratique, à Bossuet qui fonde sa politique sur l'histoire sainte et non sur la Révélation. La sottise haineuse et subversive qu'ont suscitée en France, dans certains milieux républicains, les rappels du pape Benoît XVI de principes évidents de la morale du Décalogue, qui n'est que l'exposé de la morale naturelle, nous ont fait penser à certaines pages de Maurras. Illustrons donc ici l'actualité de réflexions générales.
Fraternité et mort
Dans l'introduction de son Dilemme de Marc Sangnier 1 Maurras rappelle que la théologie catholique ne s'est jamais abandonnée au vague des sentiments. Il rappelle que la fraternité et l'amour, quand ces vertus avaient été aveuglement prêchées hors du catholicisme, avaient le plus souvent produit « la fraternité et la mort ». Que fit l'Ordre catholique ?
« Par une opération comparable aux chefs d'oeuvre de la plus haute poésie, les sentiments furent pliés aux divisions et aux nombres de la pensée ; ce qui était aveugle en reçut des yeux vigilants ; le coeur humain, qui est aussi prompt aux artifices du sophisme qu'à la brutalité du simple état sauvage, se trouva redressé en même temps qu'éclairé.
Un pareil travail d'ennoblissement opéré sur l'âme sensible par l'âme raisonnable était une nécessité d'autant plus vive que la puissance de sentir semble avoir redoublé depuis l'ère moderne. "Dieu est tout amour", disait-on. Que serait devenu le monde si, retournant les termes de ce principe, on eût tiré de là que "tout amour est Dieu" ? Bien des âmes que la tendresse de l'Évangile touche, inclinent à la flatteuse erreur de ce panthéisme qui, égalisant tous les actes, confondant tous les êtres, légitime et avilit tout. S'il eût triomphé, un peu de temps aurait suffi pour détruire l'épargne des plus belles générations de l'humanité. Mais elle a été combattue par l'enseignement et l'éducation que donnait l'Eglise : – Tout amour n'est pas Dieu, tout amour est "de Dieu". Les croyants durent formuler, sous peine de retranchement, cette distinction vénérable qui sauve encore l'Occident de ceux que Macaulay appelle les barbares d'en-bas.
Aux plus beaux mouvements de l'âme, l'Église répéta comme un dogme de foi : Vous n'êtes pas des dieux. À la plus belle âme elle-même : Vous n'êtes pas un Dieu non plus. En rappelant le membre à la notion du corps, la partie à l'idée et à l'observance du tout, les avis de l'Église éloignèrent l'individu de l'autel qu'un fol amour-propre lui proposait tout bas de s'édifier à lui-même ; ils lui représentèrent combien d'êtres et d'hommes, existant près de lui, méritaient d'être considérés avec lui : – N'étant pas seul au monde, tu ne fais pas la loi du monde, ni seulement ta propre loi. Ce sage et dur rappel à la vue des choses réelles ne fut tant écouté que parce qu'il venait de l'Église même. La meilleure amie de chaque homme, la bienfaitrice commune du genre humain, sans cesse inclinée sur les âmes pour les cultiver, les polir et les perfectionner, pouvait leur interdire de se choisir pour centre. »
Quel magnifique éloge dans les dernières lignes, éloge de l'Église pour son bienfait social, mais aussi pour son bienfait moral. Si, dans un ordre qui ne nous regarde pas ici, elle prépare les hommes à mériter de vivre dans la Jérusalem céleste, elle est, au temporel, l'héritière de la Cité antique, de l'Ordre romain, elle est garante de la Civilisation.
Désordre mental
Que va dresser face à l'Ordre qui nous dit, comme le souligne Maurras, « Vous n'êtes pas des dieux », le désordre mental – moral et politique – qu'incarnent le romantisme et la Révolution ? « Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu... » 2 L'individualisme forcené, métaphysique, moral, esthétique et politique dans lequel est né l'esprit révolutionnaire. Derrière « Liberté, Égalité, Fraternité », il faut savoir lire, ce que ne font pas conservateurs et libéraux, « Ni Dieu ni Maître ».
Nous commenterons de plus près une prochaine fois ce texte fondamental de Charles Maurras.
Gérard Baudin L’ACTION FRANÇAISE 2000 du 12 au 15 avril 2009
1 - Le Dilemme de Marc Sangnier (1906) fait partie, avec La Politique religieuse (1912) et L'Action française et la Religion catholique (1913), de La Démocratie religieuse (1921). Rééditée en 1975 (Nouvelles Éditions latines).
2 - Jean-Jacques Rousseau : Emile, L. IV, Profession
-
« Chants de France XII » : le nouveau disque du Chœur Montjoie Saint Denis
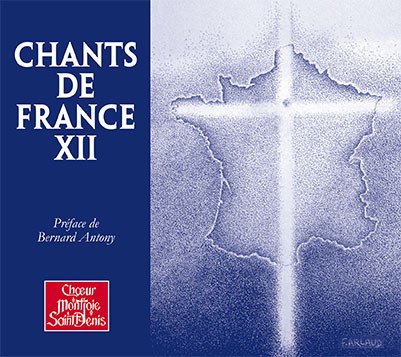 Travaillant à transmettre une part de notre patrimoine et poursuivant sa marche originale au pas cadencé, le fameux Choeur Montjoie Saint Denis publie ce nouvel opus de la collection de chants d’Europe et de France : 22 œuvres, dont onze anciennes, sauvées de l’oubli, et dix nouvelles compositions.
Travaillant à transmettre une part de notre patrimoine et poursuivant sa marche originale au pas cadencé, le fameux Choeur Montjoie Saint Denis publie ce nouvel opus de la collection de chants d’Europe et de France : 22 œuvres, dont onze anciennes, sauvées de l’oubli, et dix nouvelles compositions.Le disque est accompagné d’un livret de 32 pages (préfacé par Bernard Antony) comprenant les textes des chants, des notices historiques et de nombreuses illustrations. Il est disponible à la Librairie française (en ligne ici).
Liste des titres :
1. MARCHE DE NANTES – 2. NOUS MARCHONS ENSEMBLE- 3. PREMIER CHANT DU 1er REC – 4. LA COLONNE (CHANT DU 1er REC), DERNIER COUPLET – 5. DANS LES BOIS DE TOULOUSE – 6. ET MON PREMIER, C’EST UN MARIN – 7. À L’APÉRO – 8. BÉNIS SEIGNEUR – 9. ET SI QUELQU’UN SCANDALISAIT -10. JEANNE-MARIE, ANNE-LORRAINE – 11. QUE CESSENT LES DHIMMITUDES – 12. PSAUME DES BATAILLES – 13. PATRONNE DE PARIS ET DE LA GENDARMERIE – 14. SALUT À TOI, VIERGE LORRAINE – 15. FIERTÉ CHRÉTIENNE – 16. VA TE CONFESSER – 17. GLOIRE ÉTERNELLE – 18. VOLEZ, VOLEZ, ANGES DE LA PRIÈRE – 19. MON FRÈRE SCOUT, MON CAMARADE – 20. NOËL DE LA PAIX – 21. HYMNE DES CARMÉLITES DE COMPIÈGNE – 22. PRIÈRES À LA VIERGE MARIE POUR LA FRANCE.
-
Le Chevalier, la Mort et le Diable
Le 21 mai 2013, à 14 h 42, Dominique Venner offrait ce qui lui restait de vie dans un acte de "protestation et de fondation", devant le maître-autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, son Panthéon à lui.
Pierre Mylestin, Médecin
« Cette mort, nous lui devons d’en faire un point de non-retour. Qu’elle nous aide à nommer ce qui survient, pour commencer – à nommer vraiment : conquête, contre-colonisation, lutte pour le territoire, choc des civilisations, guerre de religion, changement de peuple. Puis à nous unir, malgré nos divisions, pour empêcher ce qui survient de survenir plus longtemps. »
C’est par ces mots que Renaud Camus prononçait, le 31 mai 2013, l’éloge funèbre de Dominique Venner, dénonçant le « Grand Remplacement, le changement de peuple et le changement de civilisation qu’il implique nécessairement, comme la raison principale de son geste, à la fois, et comme la plus grave, de très loin, des menaces qui pèsent sur nous et sur notre histoire ».
Son sacrifice est un « un hommage à la place immense que tiennent l’Église et la foi, le christianisme, dans notre culture et notre civilisation menacées, pour nous alerter, nous réveiller, nous tirer avant qu’il ne soit tout à fait trop tard de l’hébétude où nous gisons ».
Et le philosophe Alain de Benoist de poursuivre, ce même jour, « son geste dicté par le sens de l’honneur au-dessus de la vie ; cette façon de mourir est l’issue la plus honorable lorsque les mots deviennent impuissants à exprimer ce que l’on ressent, […] et les béotiens et les lilliputiens qui rédigent ces bulletins paroissiaux de la bien-pensance que sont devenus les grands médias ont été incapables de comprendre le sens même de ce geste. »
Il n’était ni un extrémiste, ni un nihiliste, ni un désespéré. Il s’est donné la mort dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour « réveiller les consciences assoupies, un appel à agir, à penser, à continuer; […] les peuples qui oublient leur passé, qui perdent la conscience même de leur passé se privent d’un avenir. »
Depuis lors, le peuple s’est mué en Charlie, il y eut les frères Kouachi, Coulibaly, le changement de peuple par les mers et les ventres des mères voilées, les églises profanées, les déséquilibrés, l’Ukraine, le racolage transatlantiste, la GPA fruit des entrailles de la République, le Grand Orient, la christianophobie institutionnalisée, l’amour, la tolérance et la paix, l’islam, la désinformation, le mensonge et la calomnie, Zemmour viré, Le Suicide français, les djihadistes avortés du ventre laïque de la République féconde, les zones de non-droit, les territoires perdus, si le FN passe je quitte la France, Robert Ménard, sa crèche, son « fichage », la bave et la meute, la loi sur le renseignement, Valls, la rage, l’amalgame, la stigmatisation, la cristallisation des discours, les valeurs de la République, la novlangue, le plug anal, la déconstruction de l’éducation, de l’Histoire, le genre, Belkacem, la haine, le doublement du nombre des mosquées, la destruction des églises, le changement, le remplacement, Taubira, le fiel, Les Républicains, la démagogie, les Femen, l’antiracisme, BHL, la propagande, la cinquième colonne…
Réveiller les consciences assoupies d’un peuple de zombies, de Charlie, un non-peuple de l’oubli, léthargique, de morts-vivants, avachis, titubant à peine étourdis vers l’abattoir du multiculturalisme. Plus belle la vie. Avant la mort.
Le 21 mai 2013, à 14 h 42, Dominique Venner offrait ce qui lui restait de vie dans un acte de « protestation et de fondation », devant le maître-autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, son Panthéon à lui.
« Il sera nécessairement toujours là aux côtés des cœurs rebelles et des esprits libres, confronté depuis toujours à l’éternelle coalition des Tartuffes, des Trissotins et des Torquemadas. »
Pierre Mylestin
-
Deux bougies pour les Sentinelles
Elles vous invitent à fêter leur anniversaire :
"« On » avait prédit un feu de paille. Pendant ces deux années écoulées, presque tous les jours, des sentinelles sont venues pour veiller, Place Vendôme ou ailleurs, qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil cogne.
« On » s’était ému en haut lieu de ce harcèlement continuel. Bien que cette protestation silencieuse ne gêne peut-être que des consciences trop rares.
« On » a fait donner la troupe qui a contrôlé, repoussé, réprimé, encagé, évacué ces personnes qui ne troublaient pas l’ordre public. Las, elles sont revenues, toujours aussi résolues.
Le 24 Juin 2015, ce sera le deuxième anniversaire des Sentinelles.
Elles se sont levées à Paris pour dire non à l’injustice faite à un jeune militant de la Manif pour Tous, embastillé parce que son opinion avait l’heur de déplaire.
Elles ont poursuivi leur lutte contre les lois dites sociétales, les décrets et circulaires absurdes et les voies détournées que tente d’imposer un pouvoir aveuglé par son idéologie destructrice de la famille : Mariage pour tous, bricolage de la filiation qu’il induit, éducation au genre sous prétexte de non-discrimination, euthanasie, grand n’importe-quoi procréatif et ses corollaires que sont la réduction en esclavage des mères porteuses, la marchandisation de l’enfant et l’éradication des repères sexués si nécessaires à leur éducation.
Elles continueront à se tenir debout, silencieuses, paisibles, bienveillantes et déterminées tant que ce sera nécessaire.Vous pouvez les rejoindre à tout moment, place Vendôme ou ailleurs en province.
Vous êtes aussi invités à fêter cette anniversaire lors d’une grande veille contre la GPA le 24 juin à 19:00 dans le pré-carré des Sentinelles, place Vendôme à Paris. Pas de faire-part, de réservation souhaitée ou de tenue exigée ! Vous pouvez, si vous en avez envie, vous inscrire surl’événement facebook qui est au bout du lien, mais ce n’est pas obligatoire. Si vous êtes novice, vous devinerez tout de suite le mode d’emploi : silencieux, espacés et sans signe distinctif.
Vous êtes les bienvenus pour ne rien lâcher. #2ansDebout, et ce n’est pas fini !
Des sentinelles parisiennes"Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, religion, tradition 0 commentaire -
Il est important de montrer qu’il existe des alternatives à l’avortement
Comme Le Salon Beige l'a indiqué, le député Jacques Bompard a déposé une proposition de loi mettant en avant des alternatives à l’avortement. Il explique à Présent :
"[...] Cette proposition de loi est cohérente avec celles que j’ai faites précédemment. Avec le mariage gay, les tentatives de légalisation de l’euthanasie, les attaques répétées contre la famille, il est clair que tous les fondamentaux de notre civilisation sont attaqués. Il nous a donc paru important de montrer qu’il existe des alternatives à l’avortement. Or aujourd’hui, l’avortement est présenté comme la seule solution possible face à des grossesses considérées comme gênantes.
Vos détracteurs insinuent qu’en proposant de faire entendre le cœur de l’enfant à la mère, avant qu’elle ne prenne la décision d’avorter, est une façon de culpabiliser les femmes…
Au contraire ! Cette loi n’est pas faite pour les culpabiliser mais pour les responsabiliser. Le système répète que l’avortement est un acte normal, bénin. Bientôt il le conseillera et il finira peut-être un jour par devenir obligatoire. Il est essentiel que les femmes se rendent compte de ce qu’elles vont faire si elles avortent : supprimer une vie.
[...] Le problème est que ceux qui sont d’accord avec moi n’osent pas le dire, tellement la pression est grande. Même Madame Veil, en son temps, avait dit qu’elle regrettait d’avoir fait voter la loi… Mais les médias ne se sont pas empressés de reprendre ses paroles. Ce qui était alors une exception est devenu la règle. Je dirais même plus qu’il s’agit d’une mode et que ceux qui n’en ont pas fait l’expérience sont regardés de travers.
Justement, vu le climat actuel, proposer une telle loi n’est-ce pas, quelque part, comme donner un coup d’épée dans l’eau ?
Je crois que cela établit clairement que nous ne sommes plus en démocratie. On a jeté l’anathème sur cette proposition, mais finalement tout s’est fait assez discrètement. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos adversaires se sentent sur un terrain glissant et n’ont pas le courage de nous affronter. Le prêt-à-penser interdit le débat.
Pourquoi la proposer alors, si elle ne doit pas être votée ?
Oui il est évident qu’elle ne sera pas votée, du moins avant longtemps. Mais cette proposition de loi, comme toutes celles que j’ai pu présenter, fait partie d’un tout. Chacune d’entre elles est une pierre destinée à bâtir une France du bon sens. [...]
Quelle est la prochaine étape pour votre loi ?
La première étape tout d’abord est de la faire connaître. Car un travail qui n’est pas connu est comme un travail qui n’est pas fait. La première arme du prêt-à-penser est le silence. Car le débat enrichit mais le silence tue."
-
Julius Evola : « Valeur éthique de l’autarcie »
A notre époque, il arrive souvent que la force des circonstances et des « causes positives », ces dernières étant tenues en si grand compte dans de nombreux milieux, finissent par provoquer des situations qui, en apparence, ne tirent leur sens que d’elles-mêmes, mais qui, pour un regard plus aigu, sont susceptibles d’incarner aussi une valeur plus haute et de s’élever ainsi au-dessus de l’ordre de la pure contingence.
C’est de manière tout à fait intentionnelle que nous avons utilisé le mot « susceptibles », car nous voulions indiquer par là le caractère de « possibilité », et non de nécessité, propre à cette signification supérieure. Les cas sont nombreux où le destin nous offre quelque chose, sans que nous nous en apercevions et sans que nous sachions en profiter. Et dans d’autres cas tout aussi nombreux, qu’il s’agisse de l’existence individuelle ou de la vie collective, la force des choses agit comme cet éleveur qui, tout en ayant une véritable affection pour un nouveau cheval, était contraint de le fouetter, mais s’arrêtant toujours devant le dernier obstacle, qu’il aurait pu aisément franchir, avec un petit effort, s’il avait compris. A une époque où le regard est hypnotiquement fixé sur le plan matériel, celui de la « réalité positive », des cas douloureux de ce genre se vérifient très fréquemment : on reçoit des « coups » de tous les côtés, sans réussir à comprendre et à suivre la juste orientation. Les « leçons de l’expérience » servent à accumuler laborieusement des faits, à les relier les uns aux autres de diverses façons en fonction de nos buts pratiques ; ils ne servent pas à nous faire saisir un sens, ils ne servent pas à nous réveiller et à nous mener, réveillés, vers la bonne direction.
La fameuse formule : « l’économie, c’est notre destin », n’est que le triste signe d’une époque, malheureusement non encore disparue entièrement. Fausseté évidente à toute époque normale de l’histoire et de la civilisation, ce principe est devenu vrai après que l’homme eut détruit, l’une après l’autre, toutes les valeurs traditionnelles et tous les points de référence supérieurs, qui présidaient auparavant à ses décisions et à ses actions. La toute-puissance de l’économie n’est que le signe d’une abdication, de même que, dans les phénomènes d’hypnose, la toute-puissance des automatismes psychophysiques a pour présupposé la suspension des facultés conscientes et, en général, de la personnalité.
Naturellement, ce principe, en tant que formule, a été surmonté de nos jours, du moins parmi les courants de droite. Selon le mot de Mussolini, « le fascisme croit encore et toujours aux actes où aucun motif économique, proche ou lointain, n’intervient », et elles seules, à l’exclusion de tous les autres facteurs, suffisent à expliquer toute l’histoire. Une autre formule connue dit que la reconnaissance du pouvoir de l’économie doit aller de pair avec ceci : l’homme n’est pas l’objet, mais le sujet de l’économie. Tout cela est évident, intuitif, naturel. C’est la vue opposée qui présente tous les caractères d’une véritable anomalie idéologique.
Cela, en théorie. En pratique, les choses malheureusement se passent autrement, car « les esprits évoqués, tu ne les éloigneras pas si facilement », comme nous en avertissait déjà Goethe. Ainsi, tandis que, d’un côté, nous ne pouvons que condamner les principes du renouveau idéaliste, de l’autre, nous sommes souvent contraints de prendre en compte des nécessités pratiques bien précises, et c’est là un engagement tout aussi sacré pour quiconque ne veut pas couper sa notion de la réalité et la mener, à brève échéance, à la ruine. L’aspect le plus tragique d’un tel dualisme, c’est qu’il peut dégénérer dans une véritable antinomie : on est parfois obligé de taire momentanément l’idée ou de la faire attendre, au nom de conjonctures de forces économiques, financières, commerciales exigées par les intérêts les plus fondamentaux de la notion. Idée et réalité ne cheminent donc pas toujours parallèlement dans la politique contemporaine ; chose indifférente, lorsque l’idée est pur simulacre, simple mythe, subordonné à Mammon ; chose grave, en revanche, lorsqu’elle est vraiment idée.
Quiconque examine le déroulement des toutes dernières années peut se convaincre que l’autarcie, plus qu’un principe, est la conséquence nécessaire d’une certaine situation générale politico-économique. Pour beaucoup, elle représente aujourd’hui encore un véritable scandale, ce qu’il put y avoir de plus irrationnel : la rationalité étant vue, par ces gens là, dans la « répartition du travail », dans un échange avec une marge de liberté suffisante, à partir d’une péréquation des douanes. C’est chose absurde, nous dit-on, de constituer dès le départ un système selon lequel certains peuples sont obligés d’imaginer toutes sortes de ressources et de se serrer la ceinture pour vivre « en autarcie », tandis que d’autres sont frappés par leur richesse même. Il s’ensuit qu’on voit dans l’autarcie une « créature de nécessité », déterminée par l’intervention violente et intentionnelle de la politique dans l’économie.
La facilité avec laquelle un tel point de vue, aux indubitables relents matérialistes, peut être renversé est, en vérité, étonnante. On peut en effet se demander si le système opposé à l’autarcie, celui réputé libre, serait « rationnel » et « sensé », lui qui ne serait autre que le système où le fait brut d’une certaine puissance économique supérieure de quelques peuples – puissance fondée, surtout, sur la possession de matières premières – enfermerait dans le filet insécable d’une dépendance passive d’autres peuples, à travers, précisément, la « fatalité » et la « rationalité » du processus économique « normal ». D’un point de vue supérieur, ce serait très exactement le plus répugnant des illogismes ; un assujettissement plus brutal que celui d’une quelconque tyrannie personnalisée.
Les peuples qui refusent aujourd’hui de se laisser prendre dans les rouages d’un tel engrenage et qui ont adopté l’autarcie comme principe, sont des peuples déjà éveillés à quelque chose de spirituel, des peuples qui font preuve de sensibilité pour des valeurs non purement réductibles à celles du ventre et de ce qui en dépend : et ceci est déjà le commencement d’une libération. Si c’est la nécessité qui les a conduits à cette situation (et nous devons faire rentrer aussi dans la nécessité tout ce qui se rapporte à la seule et réaliste politique), il faut reconnaître que la nécessité, dans ce cas, a rempli, précisément, cette fonction providentielle dont nous parlions au début, et qu’il suffit de faire un pas de plus pour s’élever, par une juste réaction, à une conscience effectivement spirituelle.
« Autarcie » signifie, étymologiquement, « avoir son propre principe en soi ». Seul est libre – disaient les Anciens – celui qui a en lui-même son propre principe. Toute la question converge sur le sens de cette liberté. Les interprétations courantes sont connues : elles reposent sur le domaine financier, d’un côté, sur le domaine militaire, de l’autre. L’autarcie économique nous garantit une marge de liberté envers la politique monétaire, nous permet de fixer et de défendre notre monnaie. Sans l’indépendance économique, la conduite d’une guerre moderne est gravement compromise, elle se ramène à quelque chose de semblable à un jeu de hasard qui réussit sur le coup (à brève échéance), ou qui mène à la ruine, l’équipement technico-militaire réclamé par une guerre moderne ne pouvant s’alimenter de lui-même, même si l’on fait abstraction d’un possible blocus.
Ce sont deux excellentes raisons. Mais l’on oublie la troisième, la plus importante, à notre avis. L’autarcie a la valeur d’un principe, au sens le plus élevé du terme, parce qu’elle est laconditio sine qua non d’une liberté des alliances et des inimitiés sur une base non matérialiste (réaliste), mais éthique. Il est en effet évident que plus une nation réussira à vivre en autarcie sur le plan économique, plus elle sera capable de suivre une idée, voire un idéal, dans toute sa politique étrangère ; autrement dit, plus grande sera sa faculté de désigner l’ami ou l’ennemi indépendamment de l’occasion la plus triviale et de la nécessité la plus brutale. Les raisons autarciques seraient donc les seules en mesure de former des fronts justifiés par de vrais principes, par des affinités idéales et spirituelles, plutôt que par une simple et changeante convergence d’intérêts. Une chose, certes, n’exclut pas l’autre, et la condition idéale serait incontestablement atteinte si une coïncidence des deux plans se vérifiait. Dans tous les cas de coïncidence imparfaite, contrairement à l’époque sournoise du matérialisme et de l’économisme, dont nous sommes en train de nous arracher, et qui était caractérisée par une subordination cynique, froide et immédiate de l’idée à l’intérêt, l’époque nouvelle, si elle ne se trahit pas elle-même et si elle doit vraiment mériter d’être appelée nouvelle, sera caractérisée par le principe opposé, c’est-à-dire par une décision active des nations, une décision venant d’en haut, sur la base des possibilités d’indépendance et de mobilité qui dérivent du degré maximal d’autarcie sensément réalisable dans chacune d’elles.
Le jour où l’on parviendra à cela, le côté positif de l’autarcie apparaîtra pleinement. Et si dans un premier temps ce principe nous a pratiquement été imposé de l’extérieur et a exigé de nous effort et discipline, la nouvelle attitude nous permettra de juger la chose d’un point de vue bien différent : la coercition exercée par l’« histoire » sera comprise comme le seul moyen qui était à disposition pour conférer à un instinct supérieur, encore inconscient de soi, un premier sens de la bonne direction.
Julius Evola
Essais politiques (recueils d’articles, 1938)
Deuxième partie : Économie et critique sociale
Article III : Valeur éthique de l’autarcie
Edition Pardès, 1988, p.189-194.
Source : Front de la Contre-Subversion
http://la-dissidence.org/2015/05/19/julius-evola-valeur-ethique-de-lautarcie/
-
TVL : Virginie Mercier : "la réalité que nous dénonçons est violente"
-
Figures animales dans la mythologie scandinave
Au∂umla, la vache primordiale
Au∂umla (ou Au∂humla ou Au∂umbla) est la désignation en vieux-norrois (cf. Snorra Edda, Gylfaginning 5) de la vache originelle, primordiale, née du dégel des frimas primordiaux. Snorri raconte que les quatre flots de lait coulant de son pis ont nourri le géant Ymir, tandis qu'Au∂umla libérait Buri, l'ancêtre de tous les dieux, en lêchant pendant trois jours la glace salée qui le retenait prisonnier. Au∂umla signifie «la vache sans cornes et riche en lait» (du vieux-norrois au∂r, signifiant «richesse», et humala, signifiant «sans cornes»). Tacite nous parle déjà des vaches sans cornes que possédaient les Germains dans Germania, 5. La figure de la vache sacrée est liée, dans de nombreuses religions non germaniques, à la figure de la Terre-Mère (à l'exception des anciens Egyptiens qui vénéraient Hathor, une déesse du ciel à tête de vache). Ainsi, chez les Grecs, Hera (dont on dit qu'elle a «des yeux de vache») et surtout Isis, présentent encore, dans leur culte, des restes du culte de la vache. Dans le domaine germanique, il faut citer le dieu Nerthus, comme lié au culte de la vache. D'après Tacite, son effigie est promenée lors des processions cultuelles dans un chariot tiré par des vaches. Lorsque Snorri nous parle des quatre flots de lait (ou fleuves de lait), il sort vraisemblablement du domaine religieux indo-européen et germanique: les pis d'Au∂umla sont vraisemblablement un calque du mythe proche-oriental des quatre fleuves du paradis, liés au culte de la Magna Mater. Rudolf Simek, le grand spécialiste allemand de la mythologie scandinave et germanique, pense que cette image du pis générateur de quatre fleuves de lait, indique très nettement la formation chrétienne de Snorri.
Sleipnir, le cheval d'Odin
Sleipnir (du vieux-norrois, «celui qui glisse derrière») est le cheval à huit jambes d'Odin. Il est né du coït de Loki (qui avait pris la forme d'une jument) et de l'étalon géant Sva∂ilfari; Snorri nous rapporte ce fait dans son histoire des géants bâtisseurs (Gylfaginning, 41; on comparera ce récit à celui de Hyndluljód, 40). Snorri raconte que Sleipnir est le meilleur de tous les chevaux des dieux (Gylfaginning, 14; cf. aussi Grímnismál, 44); Hermo∂r, en chevauchant Sleipnir pour se rendre dans le Hel (le séjour des morts), saute au-dessus de la palissade entourant Hel (Gylfaginning, 48). Odin chevauche également Sleipnir pour se rendre en Hel (Baldrs draumar, 2); Haddingus, pris par Odin en croupe, voit toute la mer sous lui (cf. Saxo, Gesta Danorum, I, 24). Le Sigrdrifumál, 15, évoque les runes qui seraient inscrites sur les dents de Sleipnir. Sleipnir est très souvent cité dans les chants de l'Edda, mais rarement dans la poésie des scaldes. Son nom semble donc assez récent et n'est sans doute apparu que vers la fin du Xième siècle, pour désigner la monture d'Odin. Quand à l'histoire racontant sa naissance, par Loki transformé en jument, elle ne date vraisemblablement que de Snorri.
Snorri est de robe grise et possède huit jambes. Plusieurs sources mentionnent ces caractéristiques (Snorri, Gylfaginning, 41; Hervarar Saga ok Hei∂reks, strophe 72). Odin est toutefois représenté monté sur son coursier à huit jambes sur des pierres sculptées du Gotland, datant du VIIIième siècle (Tjängvide; Ardre). Sur d'autres pierres, Odin est à cheval, mais le cheval a très normalement quatre jambes. Ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse que les anciens Scandinaves dessinaient huit jambes pour suggérer la vitesse. La représentation dessinée est ensuite passée dans le langage de la poésie et s'est généralisée.
Les images d'Odin représentent souvent le dieu à cheval. Bon nombres de ses surnoms indiquent le rapport d'Odin aux chevaux: Hrósshársgrani («celui qui a la barbe en crin de cheval») et Jálkr (le hongre). Les archéologues se demandent si Odin doit réellement être liée au culte du cheval. Il existe une interprétation mythologique naturaliste courante mais fausse, du mythe de Sleipnir: ses huit jambes représenteraient les huit directions du vent.
Le sculpteur norvégien Dagfinn Werenskiold a réalisé un bas-relief de bois représentant Odin monté sur Sleipnir. Sculptée entre 1945 et 1950, cette œuvre orne la cour de l'Hôtel de Ville d'Oslo. A l'époque contemporaine, Odin a été rarement représenté à cheval.
La légende veut que la crique d'Asbyrgi, dans le nord de l'Islande, soit l'empreinte du sabot de Sleipnir.
Sous le IIIième Reich, on avait l'habitude de donner le nom de Sleipnir aux bâteaux. En 1911, un navire de dépêche de la marine impériale allemande avait déjà reçu le nom de Sleipnir. En 1965, la marine norvégienne a donné le nom de Sleipnir à l'une de ses corvettes.
Depuis 1983/84, Sleipnir est également le nom d'un champ pétrolifère norvégien situé entre Stavanger et la côte septentrionale de l'Ecosse.
Hei∂run, la chèvre symbole d'abondance
Hei∂run est le nom d'une chèvre de la mythologie nordique. D'après le Grímnismál, 25, elle séjourne dans le Walhall et se nourrit des feuilles de l'arbre Læra∂r. De son pis jaillit un hydromel limpide qui coule directement dans les coupes des Einherier (les guerriers tombés au combat) (voir également Gylfaginning, 38). Dans le Hyndluljód, 46, 47, Hyndla reproche à Freya, outragée, qu'elle est aussi souvent «en rut» que Hei∂run. Le spécialiste néerlandais de la mythologie germanique, Jan De Vries, pense que les noms tels Hei∂vanr et Hei∂raupnir, dérive d'un mot cultuel, hei∂r, désignant l'hydromel des sacrifices. Sinon, la signification du mot reste obscure. Le mythe de la chèvre qui donne de l'hydromel doit être une interprétation typiquement nordique du vieux mythe de la vache originelle et nourrissière (Au∂umla). Chez les Grecs, nous avons la chèvre Amaltheia, donc les cornes sont des cornes d'abondance.
Ratatoskr, l'écureuil du frêne Yggdrasill
Ratatoskr, du vieux-norrois «dent qui fait des trous», est le nom de l'écureuil qui court le long du tronc du frêne Yggdrasill, l'arbre du monde, et va sans cesse de haut en bas et de bas en haut (Grímnismál, 30), pour aller rapporter au dragon Ní∂höggr, qui séjourne dans les racines, les paroles des aigles vivant dans les branches de l'arbre, afin, d'après Snorri (Gylfaginning, 15), de semer la zizanie. Les philologues n'ont pas encore pu prouver si ce récit est ou non un calque de la fable de Phèdre. En effet, le fait de semer la zizanie n'est pas une caractéristique originale de la mythologie nordique. L'écureuil Ratatoskr n'est vraisemblablement qu'un détail dans le mythe d'Yggdrasill, tel que nous le rapporte le Grímnismál.
Source: Rudolf Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, Kröner, Stuttgart, 1984. ISBN 3-520-36801-3.
-
Marion Maréchal Le Pen aux veilleurs : "Sommes-nous gouvernés par les juges ?"
Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, religion, tradition 0 commentaire