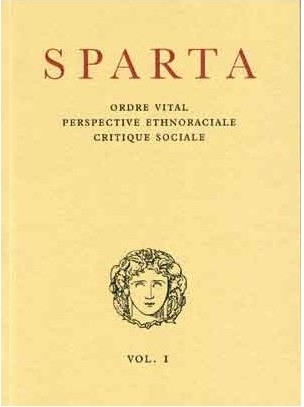David Foubert est vigneron bio. Comme il y a des vendanges tardives, il y a des vocations tardives : il s'est installé à 40 ans et vit son travail comme une passion. Il fait un vin qui est donc le fruit de sa passion : du fruit en barre, cette cuvé saumuroise de son domaine, La Folle Berthe… J'ai dégusté ! Et je dois dire que le bio, en vin, je suis conquise !
Entretien avec David Foubert, vigneron bio
Monde&Vie : On ne voit pas les vignerons manifester en ce moment : contrairement aux éleveurs de porcs ou aux producteurs de lait, vous êtes heureux ?
David Foubert : À titre personnel, oui ! Pour la filière viticole, c'est beaucoup plus mesuré. Elle subit en fait deux tendances contradictoires comme l'ensemble de l'agriculture. D'une part, une tendance à l'hyper-concentration des terres qui se termine par une dépossession complète : les exploitations deviennent tellement grandes que seuls des grands groupes financiers ou des investisseurs peuvent acheter la terre. En Anjou, des domaines avoisinent les 100 hectares. Multipliez par 20 ou 60 000 euros l'hectare, cela vous donne une idée de l'investissement nécessaire (hors chai, matériel, etc.). À Sauterne par exemple, la plupart des domaines appartiennent aux groupes du CAC 40 et c'est une tendance qui arrive également sur les bords de Loire. Autant dire que, dans cette perspective d'hyper-concentration, s'installer devient vraiment improbable pour un jeune.
Mais il y a aussi une deuxième tendance, à laquelle j'appartiens. Elle s'inscrit dans une approche contraire tout sauf la concentration. On vise plutôt une installation sur une petite surface qui permet de travailler sereinement et de faire de la qualité.
Justement, on parle beaucoup de la qualité française à l'occasion du Salon.
Certes. Là encore, la réalité recouvre des situations vraiment différentes voire contradictoires. Lorsque j'entends la FNSEA parler de qualité française en incluant certains céréaliers dont les blés ne sont plus capables de faire du pain, comme l'explique Claude Bourguignon(1), on se demande de quoi l'on parle. Si l'on accepte de regarder la situation en face, le plus souvent, les sols se sont appauvris quand ils ne sont pas morts les aliments que nous consommons ont une qualité nutritive qui peut être 70 % moindre qu'il y a quarante ans… Vous n'aurez aucun mal à relier cela à la malbouffe ou à l'explosion des cancers.
Lire la suite
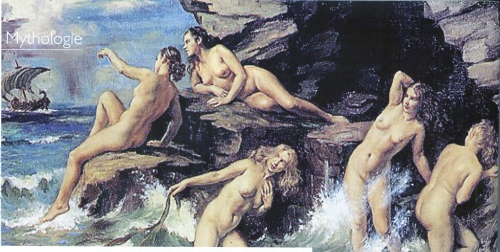
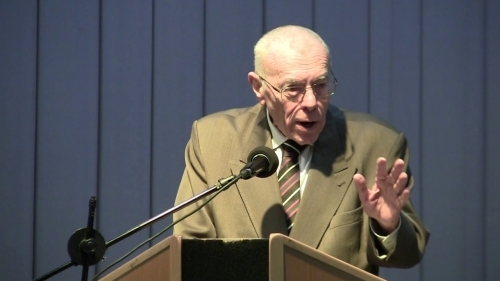

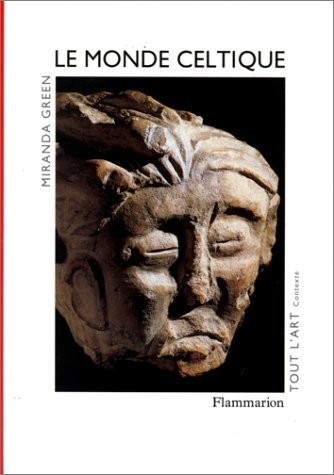 • Recension : Le monde celtique, Miranda Green, Flammarion, 1996.
• Recension : Le monde celtique, Miranda Green, Flammarion, 1996.