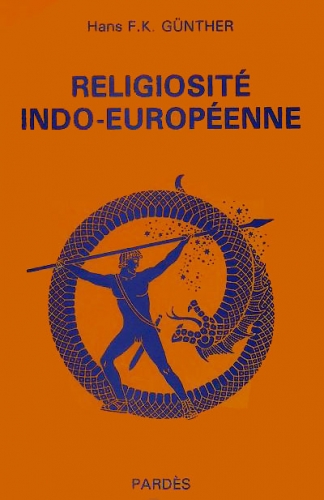 Un préjugé défavorable accompagnera ce livre de Günther. En effet, en France, Günther jouit d'une réputation détestable, celle d'être “l'anthropologue officiel” du Troisième Reich de Hitler. Cet étiquetage n'a que la valeur d'un slogan et il n'est pas étonnant que ce soit le présentateur de télévision Polac qui l'ait instrumentalisé, lors d'un débat à l'écran, tenu le 17 avril 1982 sur la “Nouvelle Droite” d'Alain de Benoist. Avec la complicité directe d'un avocat parisien, Maître Souchon, et la complicité indirecte d'un essayiste britannique, ayant comme qualification scientifique d'être un “militant anti-fasciste”, Michael Billig (1), Polac pouvait fabriquer, devant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, le bricolage médiatique d'un “Günther hyper-nazi”, maniaque de la race et dangereux antisémite. Comme aucun représentant de la “Nouvelle Droite”, aucun anthropologue sérieux, aucun connaisseur des idées allemandes des années 20 et 30, n'étaient présents sur le plateau, Polac, Souchon et leurs petits copains n'ont pas dû affronter la contradiction de spécialistes et le pauvre Günther, décédé depuis 14 ans, a fait les frais d'un show médiatique sans la moindre valeur scientifique, comme le démontre avec brio David Barney dans Éléments (n°42, été 1982) [cf. extrait en bas de page].
Un préjugé défavorable accompagnera ce livre de Günther. En effet, en France, Günther jouit d'une réputation détestable, celle d'être “l'anthropologue officiel” du Troisième Reich de Hitler. Cet étiquetage n'a que la valeur d'un slogan et il n'est pas étonnant que ce soit le présentateur de télévision Polac qui l'ait instrumentalisé, lors d'un débat à l'écran, tenu le 17 avril 1982 sur la “Nouvelle Droite” d'Alain de Benoist. Avec la complicité directe d'un avocat parisien, Maître Souchon, et la complicité indirecte d'un essayiste britannique, ayant comme qualification scientifique d'être un “militant anti-fasciste”, Michael Billig (1), Polac pouvait fabriquer, devant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, le bricolage médiatique d'un “Günther hyper-nazi”, maniaque de la race et dangereux antisémite. Comme aucun représentant de la “Nouvelle Droite”, aucun anthropologue sérieux, aucun connaisseur des idées allemandes des années 20 et 30, n'étaient présents sur le plateau, Polac, Souchon et leurs petits copains n'ont pas dû affronter la contradiction de spécialistes et le pauvre Günther, décédé depuis 14 ans, a fait les frais d'un show médiatique sans la moindre valeur scientifique, comme le démontre avec brio David Barney dans Éléments (n°42, été 1982) [cf. extrait en bas de page].
Lire la suite

 [Ci-contre : Le Vengeur, Arno Breker, 1940]
[Ci-contre : Le Vengeur, Arno Breker, 1940]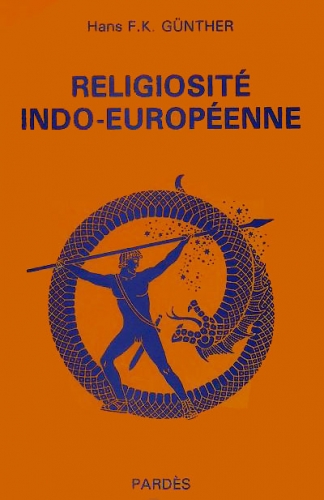 Un préjugé défavorable accompagnera ce livre de
Un préjugé défavorable accompagnera ce livre de 
