Plusieurs mois avant la parution presque simultanée de l’encyclique Laudato si’ du pape conciliaire Bergoglio et de la revue Limite (dont la recension du premier numéro fut mise en ligne le 1er novembre 2015 sur le présent site), la tendance la plus pertinente de cette vaste mouvance hétéroclite coagulée autour de « La Manif pour Tous » produisit un court et dense essai intitulé Nos limites, clin d’œil contraire auNo limit anglo-saxon, libéral et progressiste.
Co-écrit par trois responsables des Veilleurs qui témoignaient de leur opposition à la funeste loi Taubira par une protestation silencieuse et une lecture d’œuvres inactuelles – action hautement subversive à l’heure où regarder les écrans s’impose comme un préalable quasi-obligatoire au sordide vivre-ensemble républicain -, cet ouvrage concrétise l’émergence d’un « bioconservatisme » en France. Ainsi, les auteurs insistent-ils sur le fait que « ce petit livre n’est ni un programme ni un manifeste. C’est un essai, une ébauche pour tenter de comprendre comment et pourquoi le sens des limites est la condition de toute vie sociale durable (p. 9) ». Leurs réflexions se nourrissent du débat interne aux Verts opposant l’ancien élève de Jacques Ellul, le député européen et syndicaliste paysan José Bové, à la sénatrice trinationale franco-turco-israélienne Esther Benbassa. « D’un côté, ceux pour qui l’écologie est indissolublement sociale, naturelle et anthropologique; de l’autre, ceux pour qui l’éthique environnementale ne saurait s’embarrasser de considérations morales sans déroger au sacro-saint progrès (p. 68). » Et si cette discussion préfigurait de nouveaux rapports propres aux enjeux du XXIe siècle ? D’ailleurs, « la gauche et la droite, qui se disputent âprement face caméra, assurent les auteurs, s’opposent moins qu’elles ne se complètent et se prolongent, aucune d’entre elles deux ne remettent en cause le système économique productiviste fondé sur la croissance et la consommation maximales (p. 25) ».
Une écologie organique
Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam se réclament de l’« écologie intégrale » qui n’est ni la grotesque écologie de marché, ni l’écologie radicale. « Promouvoir une écologie intégrale, c’est défendre le droit de chacun à bénéficier d’un toit qui lui soit propre (p. 34). » Nos limites dresse par conséquent un sévère constat qu’on partage volontiers. Parce que, à la suite de Zigmunt Bauman, « la société liquide éclate en archipel (p. 17) », ils se prononcent pour la convivialité et encouragent les AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), les SEL (systèmes d’échanges locaux) et le « prix suspendu » (on offre par anticipation à un inconnu un café, un pain, une place de cinéma). Alors que « l’écologie intégrale implique moins l’indifférenciation (l’anonymat) que la complémentarité, la bureaucratie que la proximité, la croissance que le partage (p. 75) », les auteurs considèrent que « l’individu ne saurait être la mesure de toute chose sans compromettre la possibilité même de la vie sociale : dès lors que tout est individuellement permis, plus rien n’est collectivement possible (p. 18) ». Mieux encore, ils voient dans « l’individualisme hédoniste […] le principal vecteur de la lutte contre toute forme de retenue morale : lemarketing publicitaire nous fait croire que nous pourrions tout être, tout faire, tout prendre, ne rien manquer et ne manquer de rien (p. 66) ». Au nom du respect complet de la vie, de sa conception jusqu’à sa fin naturelle, ils refusent le mariage gay, la GPA, la PMA et l’euthanasie. En revanche, ils restent discrets sur l’avortement et évitent la question brûlante de la peine de mort. Les auteurs estiment qu’il existe une réelle et profonde continuité entre la protection des écosystèmes et la sauvegarde de l’intégrité humaine qu’ils résument par un slogan percutant : « Défense du mariage, défense du bocage, même combat ! (p. 109) ».
Ils envisagent « une authentique insurrection des consciences (p. 108) » d’autant que leur combat se veut plus qu’anthropologique, il devient organique. « Seule la reconstitution d’un tissu dense de solidarités concrètes nous permettra de vivre ensemble et non pas à côté. Or, pour être authentique, toute solidarité requiert une communauté de destin, c’est-à-dire la conscience d’appartenir à un même corps social, constitué de biens durables et vivants (p. 14). » Et puis, « la société n’est pas une somme d’individus quelconques à qui l’on pourrait accorder indifféremment un maximum de droits. C’est un organisme infiniment complexe et vulnérable qui ne saurait subsister sans respecter un certain nombre de conditions, de limites et de règles (p. 29) ». Leur anti-individualisme postule la reconnaissance « qu’on ne peut être libre hors-sol, c’est-à-dire hors-cadre, hors-norme, parce qu’il n’y a pas d’identité sans appartenance, pas d’existence sans référent commun. L’incarnation est en effet la condition de notre croissance intérieure (p. 39) ».
Cette sympathique vision organique pour laquelle l’homme « a besoin d’enracinement et de fidélité, de normes intelligibles et fermes, pour n’être pas fétu balayé par le vent (p. 13) » implique dès lors des limitations. En politique, c’est la frontière. Celle-ci, « barrière amovible, est nécessaire à l’harmonie du foyer, quelle que soit la taille (p. 83) ». A contrario du Comité invisible dans À nos amis, les auteurs avouent « préférer le local au global (p. 75) », car « la globalisation est un rouleau compresseur qui nivelle à défaut d’unifier (p. 78) ». La globalisation et non la mondialisation. Par globalisation, ils désignent l’expansion du Marché libéral à toutes les dimensions du Vivant et non plus au seul domaine marchand. Soumis à la logique libérale de la guerre de tous contre tous, « un monde ouvert peut vite devenir une jungle où s’exerce le droit du plus fort (p. 61) ». « Le mercantilisme contemporain, relèvent-ils, s’accommode parfaitement de l’effacement de toute frontière objective (notamment biologique) (p. 67). » Contre la fascination macabre de l’Androgyne et de ses déclinaisons actuelles (le gendérisme et le transsexualisme), l’altérité sexuelle demeure la première des différences essentielles.
Les auteurs soutiennent d’autres limitations. Par exemple, « l’extension rapide de l’Union européenne offre un exemple éloquent de gigantisme informe (p. 80) ». Mais Nos limites n’est pas un brûlot anti-européen. « Promouvoir une écologie fondée sur la limite, ce n’est pas rejeter l’unité européenne, c’est bien plutôt veiller à ce que la coopération ne détruise pas la cohérence. Tout étalement entraîne une dilution (p. 82). » Sans le savoir, les auteurs sont alter européens. Ont-ils naguère consulté le site Europæ Gentes de l’avocat Frédéric Pichon ? Ont-ils aussi lu l’essai collectif, Les Alter Européens, réalisé sous sa direction (1) ? Ces lecteurs attentifs de Hervé Juvin observent en outre que « la globalisation, loin d’éradiquer les frontières, ne fait en réalité que les déplacer (p. 84) ». En effet, « au sein des espaces ouverts comme Schengen s’érigent de nouvelles défenses, plus individuelles que collectives : digicodes, contrôles d’identité, alarmes, péages, télésurveillance, etc. L’insécurité croît dès lors que la communauté a perdu son ordre interne, parce que les références communes disparaissent, remplacées peu à peu par quelques slogans de propagande économique (p. 83) ». Les frontières produisent en permanence de l’altérité, et c’est heureux !
Contre la réification des rapports politiques et humain
Le déplacement des frontières cher aux thuriféraires de « la “ mondialisation heureuse ”, en fait de prospérité planétaire, entraîne une concurrence acharnée qui consiste de plus en plus à vendre à des chômeurs des gadgets produits par des esclaves (p. 29) ». Dorénavant, « traditions, écosystèmes, institutions, frontières, rien n’échappe au rouleau compresseur libéral-libertaire qui fustige comme fasciste tout obstacle à son expansion (p. 19) ». Le résultat fait que « si vivre, ce n’est plus que survivre, et si l’individu n’est plus qu’« un mort à crédit », déplaçable et remplaçable à l’envi, pourquoi donner encore la vie ? (p. 16) ». Cette interrogation ne concerne que le monde développé…
Leur diagnostic de la société française mérite une attention particulière. Ces chrétiens assumés, enfants de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François, condamnent la laïcité officielle, cette « valeur en soi, une idéologie positive apte à devenir une “ religion pour la République ” que tout un chacun devrait professer avec ferveur (p. 45) ». S’ils épinglent avec bonheur cette matrice du conformisme qu’est l’abject système scolaire hexagonale, ils se trompent toutefois de cible. En se référant à Ivan Illich et à son Deschooling Society (1971) au titre biaisé en français, ils oublient d’imputer la responsabilité de cette mise au pas de la pensée à la IIIe République et à ses « hussards noirs » génocidaires. Pour eux, l’alternative scolaire serait la méthode Montessori et non l’école à la maison ou la scolarité hors contrat. Cette pédagogie favoriserait « le civisme, cet autre nom de la fraternité républicaine, [qui] requiert la transmission vivante, c’est-à-dire critique, d’une culture commune, fondatrice et structurante, qui soit une boussole autant qu’un garde-fou dans les bouleversements du monde. Et le civisme […] ne commence-t-il pas avec le souci de répondre ensemble de l’avenir, d’enrichir notre héritage pour le transmettre aux générations futures ? (p. 19). » Et l’apprentissage sur le terrain à la mode scoute ou bündisch ?
Ces adversaires déterminés de « la tyrannie de la subjectivité (p. 46) » se gardent bien d’attaquer frontalement la sinistre idéologie des Lumières. Ils ne s’inscrivent pas non plus dans un activisme néo-luddite quelconque. Les auteurs veulent résister aux « assauts de la technique sans âme et du marché sans loi (p. 109) ». Mais la technique est-elle vraiment sans âme ? Ils semblent ignorer que l’âme européenne se structure depuis toujours autour de figures archétypales telles Prométhée, Dionysos, Apollon, Faust et Épithémée. Pourquoi leur méfiance envers la technique ne s’étend-elle pas au piercing, aux écouteurs et au téléphone portatif, ces premiers appendices de la machinisation consentante de l’être humain ?
« Faire l’éloge de la limite, ce n’est pas refuser les innovations techniques, c’est en interroger le sens pour les réorienter au service du bien commun (p. 93) ». Soit, mais pour quel bien commun ? Nos limites tonne contre le transhumanisme, l’antispécisme et la « pensée robotique » parce que, « loin d’être une délivrance cérébrale, l’Intelligence Artificielle n’est qu’une démission de la pensée, un renoncement, une soumission à la loi des machines (p. 40) ». Sans surprise aucune, les auteurs condamnent l’eugénisme accusé de favoriser le darwinisme social. Cet eugénisme correspond-il seulement à celui de Platon et du Dr Alexis Carrel ?
Ce livre avance par ailleurs que « l’humain et la nature peuvent faire bon ménage pourvu qu’on cesse de déraciner l’un(e) pour diviniser l’autre (p. 13) ». Or, l’humain et la nature co-appartiennent en fait au cosmos. Le monothéisme suppose une césure qu’ignoraient les anciens paganismes.
Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam n’arrivent pas ainsi à se départir du prisme d’une modernité certaine. « Le bonheur des générations futures est à ce prix (p. 109). » Mais qu’est-ce que le bonheur ? Pour Maurice Druon, « la condition première du bonheur est de convenir à son destin (2) ».
Toujours de notables équivoques
Ils utilisent les écrits de Thoreau, de Chantal Delsol, de Simone Weil, de Jean-Claude Michéa, de Michel Houellebecq, de Paul Valéry, de Hanna Arendt, de Günther Anders, son premier époux, de Bernard Charbonneau, etc. Leur approche n’est pas cependant nouvelle. Dans les années 1990, la sympathique revue animée par Laurent Ozon, Le recours aux forêts, traitait déjà de tous ces sujets avec les mêmes références. En revanche, relevons l’absence de mention du père de l’écologie conservatrice, Édouard Goldsmith, du grand penseur allemand de et contre la Technique, Martin Heidegger, et du philosophe catholique paysan, Gustave Thibon ! Pourquoi ? Parce qu’ils penseraient mal ?
En outre, « il est temps de repenser notre modèle de développement (p. 71) ». Le développement s’impose-t-il obligatoirement ? Ne faudrait-il pas plutôt poursuivre les travaux de François Partant et son anti-développementalisme ? Les auteurs célèbrent les communautés parce qu’elles établissent l’identité. Mais l’enchâssement interactif des identités et des communautés irait jusqu’à « l’unique famille humaine (p. 62) ». Une assertion bien aventureuse et très hypothétique qui se coule dans la doxa dominante. Si, pour eux, « le sans-frontiérisme global apparaît […] sous maints aspects comme un néo-colonialisme impitoyable au service des seuls intérêts du marché (pp. 85 – 86) », ils soutiennent que « comme tous ceux qui fuient la misère en quête d’un avenir meilleur, réfugiés politiques ou climatiques, loin d’être des envahisseurs, ils subissent de plein fouet la précarisation accélérée du monde (pp. 86 – 87) ». Le « bougisme » frappe où il veut. La preuve ! Bien sûr, « qui a une identité stable ne peut qu’accueillir sereinement l’altérité (p. 84, note 2) », mais pourquoi ne font-ils pas alors cause commune en faveur du port légitime du foulard musulman ?L’écologie est foncièrement différencialiste, sinon ce n’est plus de l’écologie !
Enfin, lire que « face aux défis formidables que nous présente l’avenir, prôner l’écologie humaine, c’est promouvoir une “ éthique de la non-puissance ” (Jacques Ellul) (pp. 107 – 108) », on atteint des sommets dans l’irénisme, à moins que cela soit une belle démonstration d’écolo-angélisme… Comme la quasi-totalité des écologistes véritables (à part le cas original, précurseur et radical du penseur finnois Pentti Linkola), Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam se détournent (volontairement ou non ?) les lois d’airain du politique. En oubliant, en écartant ou en récusant tout concept de puissance, leur projet de société conviviale se transforme en proie aisée pour les autres intervenants du Grand Jeu historique. Ils devraient méditer la réponse que fit Julien Freund le jour de sa soutenance de thèse, le 26 juin 1965, au membre du jury, le professeur socialiste, pacifiste et kantien, Jean Hyppolite : « Je crois que vous êtes en train de commettre une autre erreur, lui lance Julien Freund, car vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d’ennemis, nous n’en aurons pas, raisonnez-vous. Or c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitié. Du moment qu’il veut que vous soyez l’ennemi, vous l’êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin (3) ». Son directeur de thèse, Raymond Aron, expliquait pour sa part que « la puissance politique n’est pas un absolu mais une relation humaine (4) ». L’écologie, y compris intégrale, demeure cette science des relations entre les vivants.
Georges Feltin-Tracol
Notes
1 : Frédéric Pichon (présente), Les Alter Européens. Cette autre Europe de Paris à Berlin via Moscou, préface d’Alexis Arette, Dualpha, coll. « À nouveau siècle, nouveaux enjeux », 2009.
2 : Maurice Druon, Réformer la démocratie, Plon, 1982, p. 137.
3 : Julien Freund, L’Aventure du politique. Entretiens avec Charles Blanchet, Critérion, 1991, p. 45, souligné par l’auteur.
4 : Raymond Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Calmann-Lévy, 1962, p. 92.
• Gaultier Bès (avec Marianne Durano et Axel Nørgaard Rokvam), Nos limites. Pour une écologie intégrale, Le Centurion, 2014, 111 p., 3,95 €.
http://www.europemaxima.com/?p=4744
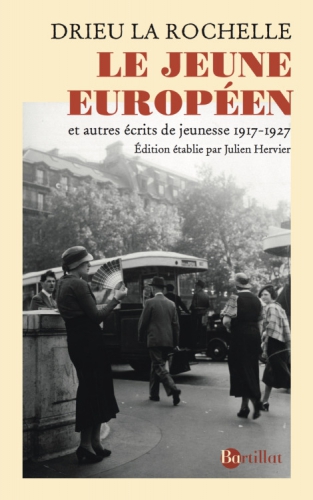 Juste avant la débâcle de 1940, à un moment dramatique où il se penche sur son passé, il éprouve le besoin de faire le point sur ses premières œuvres et de publier un recueil de ses Écrits de Jeunesse : deux recueils de poèmes de guerre, Interrogation (1917) et Fond de cantine (1920) ; et deux recueils d’essais et de textes divers, La Suite dans les idées (1927) et Le Jeune Européen (1927). Mais, toujours insatisfait de lui-même, il croit nécessaire d’en retravailler la formulation, perdant ainsi au passage la fraîcheur de ses premières sensations ; cela nuit particulièrement à la nouvelle version de ses poèmes.
Juste avant la débâcle de 1940, à un moment dramatique où il se penche sur son passé, il éprouve le besoin de faire le point sur ses premières œuvres et de publier un recueil de ses Écrits de Jeunesse : deux recueils de poèmes de guerre, Interrogation (1917) et Fond de cantine (1920) ; et deux recueils d’essais et de textes divers, La Suite dans les idées (1927) et Le Jeune Européen (1927). Mais, toujours insatisfait de lui-même, il croit nécessaire d’en retravailler la formulation, perdant ainsi au passage la fraîcheur de ses premières sensations ; cela nuit particulièrement à la nouvelle version de ses poèmes.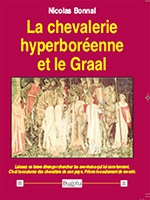
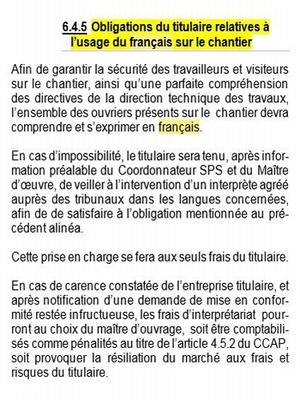
 "Aussi, un bon exemple vaudra mieux que de longs discours.
"Aussi, un bon exemple vaudra mieux que de longs discours.