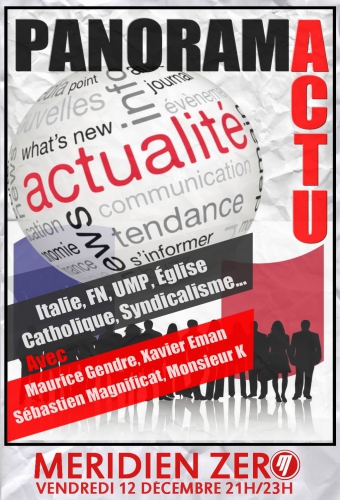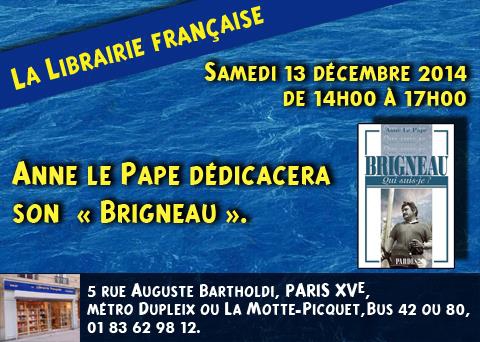Ces jours-ci, on conteste l’authenticité de la découverte récente, à Rome, d’une grotte où, prétend-on, l’on honorait les fondateurs de l’Urbs, Romulus et Remus. C’est un coup supplémentaire pour la Ville porteuse de tant de mythes, après que l’on ait nié l’authenticité de la Louve Capitoline, qui n’aurait pas d’origines dans l’Antiquité mais n’aurait été inventée qu’au cours de notre moyen âge. Quoi qu’il en soit, les enfants légendaires de la Louve sont tels qu’on les a toujours imaginés : paisibles sous le ventre du fauve, s’abreuvant à ses tétons.
Le choix de la Louve, comme mère de substitution, n’est nullement dû au hasard et s’explique en référence au père des jumeaux : Mars, le Dieu de la Guerre, qui se manifestait accompagné du Loup, emblème de son être intime, relevant de la même nature que l’animal totémique. Les Romains ont su exploiter ce lien Mars/Loup et utiliser le symbole du Loup dans leurs armées et sous de multiples variantes. Aux temps auroraux de la Ville, le Loup était l’emblème des légions et, jusqu’à l’ère impériale, les légions alignaient une partie de leurs effectifs, les vélites, légèrement armés, vêtus de peaux de loup et arborant des crânes de l’animal. Bon nombre de porte-drapeaux portaient également des peaux de loup. On peut aisément supposer qu’aux temps de Rome demeurait une réminiscence des très anciennes « compagnies du Loup », depuis longtemps oubliées, même au moment où Rome est sortie des ténèbres de la proto-histoire pour émerger dans la lumière des temps connus. Leur simple présence dans l’héritage romain rappelle l’existence de compagnies ou communautés similaires chez d’autres peuples indo-européens.
L’historien Georg Scheibelreiter nous signale, dans son œuvre, qu’aucun autre nom d’animal n’est aussi fréquent dans les noms ou prénoms personnels que celui du loup : du védique « vrka-deva », signifiant probablement « Dieu-Loup », en passant par le grec « Lykophron » (« Conseil de Loup ») ou le celtique « Cunobellinus » (« Chien ou Loup de Belenos »), jusqu’aux prénoms germaniques Wolf, Wulf, Wolfgang, Wolfram, Wolfhart. Lorsque l’on donnait un nom à un enfant, il n’y avait pas que la sympathie individuelle que l’on éprouvait à l’endroit de l’animal qui jouait, mais aussi le souhait de conférer à l’enfant ses qualités. Principalement, toutefois, jouaient des représentations religieuses, où l’on pensait obtenir une métamorphose rituelle en l’être vivant choisi pour le nom/prénom.
Jusqu’aux temps modernes, on a appelé « Werwolf » (loup-garou), les hommes qui avaient la capacité de se muer en loups ou étaient contraints de le faire. Ce mythème s’enracine vraisemblablement dans l’apparition d’individualités ou de communautés entrant en transe, vêtues de peaux, pour se transformer en bêtes échevelées. Les cultures préchrétiennes s’étaient déjà distanciées de tels phénomènes, même si les Romains avec Mars, ou les Grecs avec Zeus et Apollon honoraient des dieux accompagnés de loups. L’attitude dominante était un mélange de vénération et d’effroi, où ce dernier sentiment finissait toutefois par dominer : un loup, nommé Freki, suivait également le dieu germanique Wotan/Odin, mais les Germains croyaient aussi qu’au crépuscule des dieux, Odin lui-même allait être avalé par le loup Fenrir, aux dimensions monstrueuses. Dans l’Edda, l’Age du Loup correspond à l’Age sombre qui précède le Ragnarök.
Tous ces faits mythologiques expliquent pourquoi le loup, après la christianisation, ait perdu toute signification symbolique positive. Il était non seulement un indice de paganisme mais aussi et surtout la manifestation du mal en soi. Cette vision du loup s’est perpétuée dans nos contes. Le loup disparaît également des emblèmes guerriers de l’Europe ou n’y fait plus que de très rares apparitions.
En dehors de l’aire chrétienne, le loup n’a pas subi cet ostracisme. Il m’apparaît important de relever ici la vénération traditionnelle du loup chez les peuples de la steppe. Après l’effondrement de l’Union Soviétique, Tchétchènes et Gagaouzes se sont donné des drapeaux où figure le loup. Les Gagaouzes appartiennent à la grande famille des peuples turcs, qui ont, depuis des temps immémoriaux, considéré le loup comme leur totem. En Turquie, les Loups Gris, formation nationaliste, ont évidemment le loup comme symbole et saluent en imitant une tête de loup avec les cinq doigts de la main. Les Loups Gris professent l’idéologie pantouranienne qui entend rassembler tous les peuples turcs au sein d’un Empire uni.
Officiellement, l’organisation des Loups Gris a été interdite et dissoute en 1980, ce qui n’a diminué en rien la charge affective et l’attractivité du symbole du loup. Cette fascination pour le loup concerne également les Turcs émigrés en Europe, où personne n’est capable d’interpréter correctement cette symbolique. En Allemagne, personne ne comprend le sens réel de la chanson « Wolfszug » (= « Cortège du Loup ») du rappeur Siki Pa, frère de Muhabbet, qui a attiré récemment toutes les attentions sur lui :
« Fürchtet um euer Hab’ und Gut
Werdet brennen im Feuer…
Pakt der Wölfe zieht mit dem Wolfszug
Blutiger Horizont, der Tod friedlich ruht“.
(„ Craignez pour vos avoirs, pour vos biens,
Vous brûlerez dans le feu…
La meute de loups s’engage dans le cortège du Loup,
L’horizon est de sang et la mort repose en paix »).
Karlheinz Weissmann,
Traduction Française : Robert Steuckers
Source : VoxNR
http://la-dissidence.org/2014/12/11/la-symbolique-politique-du-loup/