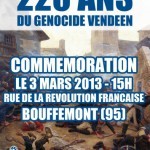Article rédigé en 1994 pour la Revue d'Europe Centrale.
Avec un décalage de près de quarante ans, cette fois non plus à cause du Canal, mais de l'ex-Yougoslavie, Paris a réussi un doublé inattendu : le "coup de Suez".
 C'est-à-dire faire les frais d'une expédition militaire et y souffrir des pertes pour constater qu'il revient à nouveau aux États-Unis et à la Russie de négocier le règlement d'une crise que l'on n'a pas su prévenir, encore moins conclure.
C'est-à-dire faire les frais d'une expédition militaire et y souffrir des pertes pour constater qu'il revient à nouveau aux États-Unis et à la Russie de négocier le règlement d'une crise que l'on n'a pas su prévenir, encore moins conclure.
Et, de surcroît, devoir admettre que les pourparlers aient lieu à Bonn, origine du drame yougoslave et à Vienne, par où transitaient les armes inondant les Balkans en dépit de l'embargo. Enfin, voir rejeter les plans d'organisation de la Bosnie qui avaient l'approbation des nations — dont la France au premier chef — qui contribuèrent activement à la sauvegarde des populations les plus meurtries par la guerre. Gribouille n'aurait pas fait pis.
Le 5 février 1994, au soir, le jour même où la destruction du marché de Markale causa la mort de 68 personnes et en blessa 197, le président de la République et le Premier ministre s'accordèrent sur la nécessité d'agir, d'en appeler aux principales nations concernées par le drame des Balkans afin que, par l'action, l'on réponde à l'attente de l'opinion publique. Il est vrai que mise en condition par une intense propagande — dont on évoquera plus loin les sources — profondément émue par cette tuerie, la population réclamait des mesures immédiates, y compris l'usage de la force. En démocratie, la règle est d'entendre l'électeur même, et surtout, s'il a été quelque peu abusé par la "désinformation". Mais si puissante et si convaincante qu'elle ait pu être, il n'en demeurait pas moins que Sarajevo était assiégée depuis des mois et que, chaque jour, on y mourrait par le fer et par le feu.
Solliciter l'ONU ? Les Résolutions précédemment votées permettaient le recours à la force (interprétation de la Résolution 836 de juin 1993). C'eût été risquer un veto russe. Et puis, régulièrement et consciencieusement informé de la situation locale par les chefs militaires de la FORPRONU, le Secrétaire général se serait montré réservé. ("Toutes ces gesticulations à propos de frappes aériennes ne riment à rien. Chaque fois qu'on approchait d'un accord, elles ont envenimé la situation", déclarait le général Francis Briquemont.) Que demander aux Douze qui n'ait déjà été fait. Assez paradoxale était la démarche française, la France ayant, à terre, en ex-Yougoslavie, le contingent le plus nombreux et l'un des plus exposés à d'éventuelles représailles, la retenue britannique paraissant mieux inspirée. Mais l'opinion publique réclamait que l'on mit un terme à l'inaction.
Aussi, le lendemain de la triste affaire de Markale, le ministre français des Affaires étrangères s'adressa-t-il à son collègue américain. Difficile requête pour Paris : on n'y avait cessé de revendiquer la reconnaissance de l’"identité de défense européenne", des pouvoirs et des moyens (?) de l'UEO, l'emprise militaire américaine sur l'Europe devant leur faire place. Et voici que pour une guerre spécifiquement européenne, ensanglantant une région dont M. Clinton avait dit qu'elle ne présentait pas d'intérêt stratégique pour les États-Unis, voici que Paris demandait à Washington de prendre l'initiative d'un ultimatum adressé aux Serbes, éventuellement suivi d'interventions aériennes. À Bruxelles, le ministre français de la Défense afficha la détermination de Paris. "On nous dit, déclara-t-il en substance, que la présence de la FORPRONU interdit que nous frappions en utilisant la force aérienne. Intenable position..." Sous-entendu il convient de passer outre et d'en venir à la menace d'emploi de la force si l'ultimatum n'est pas suivi d'effet. "On nous dit" ? C'est bien l'opinion qui le disait, lassée des souffrances indéfiniment tolérées de la population de Sarajevo.
À Washington l'appel fut entendu. Certes, aussi longtemps que seuls Serbes et Croates s'affrontaient, la Maison-Blanche demeura passive. Il y eut bien, de sa part, quelques velléités d'agiter la menace aérienne, mais devant les objections de Paris et de Londres, Washington sembla se désintéresser des événements des Balkans. Et cela jusqu'à ce que, gagnant la Bosnie, la guerre mobilise à nouveau le Département d'État. Les intérêts pétroliers américains sont assez puissants pour que l'allié musulman soit secouru. Pour les États-Unis, la démarche française présentait l'avantage de justifier l'Otan — en dépit de la disparition du Pacte de Varsovie. Elle répondait à l'attente de Bonn, l'Allemagne étant désireuse d'étendre la garantie américaine à ses voisins de l'est et du sud. La démonstration était faite que l'Amérique était bien la seule superpuissance et, qu'à ce titre, il lui revenait de contribuer à rétablir un "ordre international" convenable là où il était gravement menacé. L'intervention des États-Unis renforçait également l'allié turc et elle allait appuyer la présence en Macédoine du petit contingent qui y avait été dépêché. Bref, les Européens invitaient les États-Unis à jouer un rôle dans les Balkans mettant en évidence leur leadership en Europe. À l'initiative de la France.
Nous sommes directement concernés, affirma alors Bill Clinton, qui disait le contraire l'année précédente. Préparé depuis longtemps à intervenir en Yougoslavie — et déplorant de ne pas y avoir été invité l'état-major de l'Otan prit aussitôt sous sa coupe les formations maritimes et aériennes déployées en Adriatique et sur le littoral italien. Et, sous l'autorité de l'amiral Jeremy Boorda, commandant la 6e Flotte des États-Unis, "l'identité de défense européenne" devint "l'identité de défense américaine".
Chacun s'attendait à l'emploi de la force, le souhaitait ou le redoutait. C'était compter sans la manœuvre diplomatique et les avantages que Washington pouvait retirer de l'invitation qui lui avait été adressée. Alors que Moscou venait de réitérer son opposition aux attaques aériennes, y procéder eût placé Boris Eltsine dans une situation critique. Ni le peuple russe, ni la Chambre basse, la Douma, n'eussent admis que leur pays subisse une nouvelle humiliation. Bien que l'échec des réformes socio-économiques dont on attendait bien prématurément des résultats bénéfiques ait conduit à l'élimination de Galdar et d'une partie de ses conseillers économiques, Washington misait toujours sur Boris Eltsine de crainte que la Russie ne succombe aux sollicitations des extrêmes, unis dans un même nationalisme. Aussi fallait-il ménager Moscou, tenir compte des liens l'unissant à Belgrade et l'inviter à un tête-à-tête américano-russe qui devrait trouver un compromis acceptable par les trois belligérants.
C'est sans doute la raison pour laquelle, devenu le maître tout-puissant des forces alliées déployées face aux Balkans, l'amiral Boorda, à son tour et probablement sur ordre de son gouvernement, déclara "... qu'il ne lancerait aucune attaque aérienne sans l'ordre de l'ONU". Paris avait souhaité contourner l'Organisation des Nations Unies, mais l'amiral annonçait qu'il n'agirait que selon les instructions qu'il en recevrait.
Peut-être sans illusion, mais soucieux d'utiliser le prétexte bosniaque pour servir leurs intérêts nationaux, Américains et Russes ont pris à leur compte le puzzle balkanique devant lequel l'ONU et les Douze avaient échoué. Mais c'est aux Russes qu'il est revenu de jouer le rôle principal. Non seulement Washington les sollicitent et les placent en vedette sur la scène internationale mais, par les pressions qu'ils sont en mesure d'exercer sur les Serbes — et grâce aux garanties qu'en échange ils leur promettent — ils sont les seuls à pouvoir éviter l'extension du conflit de Bosnie. Moyennant les assurances qu'ils donneront à Belgrade sur l'issue des négociations auxquelles, désormais, ils participent, les Serbes replieront leur artillerie à distance de Sarajevo sans paraître obéir à l'ultimatum, mais à la demande de leur allié ; les Américains y gagnent d'éviter un engagement militaire qu'à juste titre ils redoutent et la FORPRONU ne risquera pas d'être la cible facile d'éventuelles représailles. Les "va-t-en-guerre" manifesteront leur satisfaction, la force ayant été brandie et les "pacifiques" également puisqu'elle ne sera pas utilisée, du moins comme sanction d'un ultimatum qui n'aurait pas eu d'effet. Enfin, et surtout, Sarajevo bénéficie d'une accalmie.
Pour Boris Eltsine ce fut là une occasion inespérée d'être à nouveau le principal interlocuteur de la superpuissance, de fournir un motif de satisfaction au peuple russe meurtri par toutes les manifestations d'une grandeur perdue et aussi atténuer la virulence des attaques des partis nationalistes. Peut-être sans l'avoir voulu, Eltsine fit mieux à propos des Balkans que Gorbatchev lors de la guerre du Golfe.
Avant d'étudier la proposition des nouveaux négociateurs, Américains et Russes s'étant substitués aux deux médiateurs représentant l'un l'ONU, l'autre les Douze, il faudrait revenir sur le très étrange comportement de la communauté internationale devant le drame yougoslave.
Il apparaîtrait que les Serbes ne furent pas les auteurs de la tragédie de Markale. Il est vraisemblable que les experts militaires qui étudièrent les traces de la détonation — ou des détonations — et qui évaluèrent les dégâts matériels qui en résultèrent, sans être assurés, s'étaient cependant formé une opinion. Adressée au Conseil des Ministres des Douze, deux jours après l'ultimatum, une lettre de la FORPRONU accuserait les Bosniaques musulmans. Fort courageusement, Bernard Volker l'avait révélé lors du "journal de TF1" le 18 février, mais allant à l'encontre de la thèse officielle, l'annonce avait été étouffée. Techniquement l'attentat suscitait l'interrogation. Les mortiers, fut-ce de 120 mm, identifiés lors des premières investigations, sont trop imprécis pour qu'un seul tir atteigne un objectif relativement réduit en dimensions (quelque 1200 mètres carrés). Ou alors, quel qu'ait été le camp des tireurs, le hasard est à incriminer et, seul, il dissiperait le mystère s'il s'agissait vraiment d'un projectile lancé par un mortier. L'autopsie des victimes aurait peut-être permis de préciser la nature de l'explosif et celle des projectiles ayant fait un tel carnage : les malheureux avaient été mis en terre précipitamment. Belgrade obtint la réunion d'une commission d'enquête. Mais, autre singularité, la tragédie fut attribuée aux Serbes et l'ultimatum lancé contre eux, avant que les experts aient déposé leurs conclusions. Enfin, il est pour le moins étrange qu'une association "TV carton jaune animé par des magistrats, des juristes et des journalistes" soit sortie de l'ombre pour porter plainte contre TF1 sous prétexte de "défendre l'honnêteté de l'information diffusée" alors que la scandaleuse désinformation subie par le téléspectateur lors de la guerre du Golfe, par exemple, n'avait pas heurté ses conceptions de la déontologie. C'est sans doute pourquoi, le 11 mars, M. Bernard Volker appuyait sa révélation du 18 février par la publication de la lettre officielle de la FORPRONU aux Douze. Lettre dont la teneur fut démentie par le Quai d'Orsay.
Tout s'est donc passé comme si n'ignorant rien du caractère équivoque de l'accusation dirigée contre les Serbes, les capitales occidentales avaient décidé de leur faire porter la responsabilité de l'attentat afin de légitimer l'ultimatum et, si nécessaire, l'attaque aérienne de leurs positions autour de Sarajevo. Peu importait le coupable du massacre. Il était assez révoltant pour que les opinions publiques approuvent toute action de guerre, quel que soit l'ennemi plus ou moins arbitrairement désigné.
Ce comportement, des plus discutables, est à rapprocher de celui qui fut adopté après l'attentat du 27 mai 1992 (20 morts, 70 blessés) également attribué à l'artillerie serbe. Le 22 août 1992, le journal britannique The Independent l'imputait à une machination bosniaque. Mais la grande presse se garda de reprendre la révélation. Elle fut confirmée plusieurs mois plus tard par le général MacKenzie, commandant en second de la FORPRONU, lors de la publication de son livre Peacemaker (1) : "... la rue (Vase Miskina où se trouvait la boulangerie de Sarajevo) a été bloquée à ses deux extrémités juste avant l'incident. Après que la foule ait été admise et que la queue se soit formée, les médias apparurent mais se tinrent à distance. L'attaque eut lieu et les médias se trouvèrent immédiatement sur place. La majorité des morts étaient des Serbes tenus pour être des 'modérés'. Qui peut savoir ? La seule chose certaine, c'est que des innocents furent tués..."
De même que l'attentat de Markale permit l'ultimatum et justifia d'éventuelles attaques aériennes, de même celui du 27 mai 1992 fut le prétexte de l'embargo imposé à la Serbie et au Monténégro. Bien qu'il ait été officiellement reconnu que les Serbes n'étaient pas impliqués dans le massacre dit de la boulangerie, l'embargo ne fut pas levé. Il a déjà fait des milliers de victimes parmi la population civile et atteint pour longtemps non seulement l'économie de la nouvelle République fédérale de Yougoslavie, mais aussi celle de ses voisins.
Pour celui qui se soucie de morale politique — l'un à côté de l'autre les deux mots surprennent — et, plus généralement, de la dignité des peuples dans les relations internationales, ces deux événements ne laissent pas d'être préoccupants. Ils provoquent au moins deux questions :
— Sommes-nous devant une nouvelle ruse de guerre ? L'Histoire n'en offre guère d'exemples malgré la malignité des hommes. L'on s'en prend à son propre parti, l'on massacre les siens et l'on accuse l'adversaire du forfait (2). Grâce à la toute-puissance des médias et, en particulier, de l'image télévisée, l'on bénéficie aussitôt de la commisération, puis de l'assistance internationale.
Celle-ci donne la victoire au coupable en croyant prendre parti pour la victime ou en feignant de le croire. Les succès du procédé invitent à la répétition. Les Bosniaques musulmans y eurent recours à la veille de chaque importante négociation où leur sort allait être évoqué. Et chaque fois à leur avantage. Devant l'émotion provoquée par la mort de civils en quête de pain ou faisant leur marché, les dirigeants musulmans furent en mesure de rompre les négociations lorsqu'elles leur étaient défavorables. Il suffisait d'évoquer les souffrances que l'adversaire infligeait à leur peuple.
Seconde question également suscitée par les guerres récentes, celle du Golfe et celle de l'ex-Yougoslavie : pour les démocraties également, la "désinformation" des populations est-elle devenue, officieusement, une des composantes de l'art de gouverner ? Afin de sataniser Saddam Hussein en mobilisant contre l'Irak une opinion publique indifférente, le président Bush reprit à son compte, dans ses discours officiels et au moins une demi-douzaine de fois, le récit mensonger de la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis qui prétendait avoir été témoin du pillage d'un hôpital pédiatrique à Koweït City. Amnesty International démontra le subterfuge, mais il avait atteint ses objectifs. En toute bonne conscience, les Alliés pouvaient déverser 90.000 tonnes de bombes sur l'Irak, puis lui imposer un embargo qui fit plus de 200.000 victimes parmi la population civile.
Mystérieuse serait également la partialité dont firent preuve les médias rendant compte par l'écrit et par l'image des événements de Yougoslavie. L'étrangeté de ce comportement ne s'explique que par la mise en œuvre de très puissants intérêts stratégiques et économiques, sans doute la force du mark et l'argent du pétrole lorsque la Bosnie fut en guerre.
Le véritable diktat allemand des 16 et 17 décembre 1991, une semaine après la signature du Traité de Maastricht d'où devait naître une "diplomatie et une défense communes", fut à peu près ignoré. Pourtant les ministres des Affaires étrangères des Douze réunis à Bruxelles, sous la houlette de M. H.D. Genscher, furent soumis à une rude épreuve et ce n'est qu'après des heures de débats que le 17, au petit matin, le ministre allemand obtint satisfaction. On reconnaîtrait l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie le 15 janvier suivant. Bonn et le Vatican, ce dernier manifestant son hostilité millénaire aux schismatiques orthodoxes, devancèrent l'engagement du 17 décembre et, le 23, reconnurent l'indépendance des Républiques sécessionnistes. Celle de la Bosnie suivra inéluctablement. C'était priver de citoyenneté près de trois millions de Serbes vivant en Slovénie, en Croatie et en Bosnie, en faire des minorités plus ou moins bien traitées. C'était également décider de l'éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, violer la Constitution yougoslave de 1974 en transformant des limites administratives en frontières internationales et faire bon marché de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris. Bref, les Douze piétinaient les textes qu'ils avaient eux-mêmes conçus, défendus et signés, s'inclinant devant la volonté de la déjà toute-puissante Allemagne. Il est vrai qu'elle était réunifiée, officiellement, depuis un an et qu'elle bénéficiait largement de son unité reconstituée sans avoir encore à en payer le prix. Mais, de ces manigances, les populations ne furent pas informées. Pas plus que, dès le début du conflit, on ne leur révéla la chasse aux Serbes de Croatie, leur fuite par centaines de milliers vers la mère-patrie, leurs villages rasés, leurs biens perdus à jamais : première phase de l'épuration ethnique pratiquée par les Croates et dont on ne s'émut que lorsque les Serbes, à leur tour, ripostèrent contre les exactions dont ils venaient d'être les premières victimes. Bien rares ont été les commentaires relatifs à la visite de M. Delors à Belgrade, réclamant du gouvernement fédéral, alors en fonction, qu'il maintienne l'unité du pays et subordonnant l'assistance de la CEE à la cohésion de la fédération yougoslave. Les Douze justifiaient ainsi les tentatives de l'armée fédérale cherchant à stopper les mouvements sécessionnistes. Ses unités furent encerclées dans leurs casernes et contraintes à la capitulation ou à un combat tenu alors par les Serbes eux-mêmes pour fratricide. Lorsque Sarajevo devint le symbole menacé d'une nouvelle construction politique fondée sur une confession et non sur la volonté des diverses nationalités de vivre ensemble, l'on s'est gardé de préciser que 30% de ses habitants étaient Serbes, tandis que près de 11% se déclaraient encore Yougoslaves, si bien qu'il était légitime que l'armée serbe ait pris position pour défendre ses concitoyens contre les 49% de Musulmans bosniaques. La dictature exercée en Croatie par M. Tudjman et son parti a été discrètement escamotée, de même que la profession de foi de M. Izetbegovic selon laquelle : "... il n'y a pas de paix, ni de coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales non islamiques. Ayant le droit de gouverner lui-même son monde, l'Islam exclut clairement le droit et la possibilité de la mise en œuvre d'une idéologie étrangère sur son territoire". Allez, ensuite, imposer aux 32 % de Serbes et aux 17% de Croates vivant en Bosnie- Herzégovine d'accepter la loi d'un gouvernement bosniaque musulman faisant de l'exclusion des autres confessions le fondement de sa politique ! Enfin, bien rares ont été seulement les allusions au rôle des Croates et des Musulmans aux côtés des forces du Reich, pas plus qu'il n'a été rappelé qu'à défendre la cause des Alliés contre l'empire wilhelminien, puis hitlérien, la Serbie a perdu 23% de sa population en 1914-1918 et encore 15% entre 1941 et 1945.
Les voix des nombreux experts en science politique et en relations internationales ne se sont guère fait entendre lorsque la Communauté européenne a repris à son compte l'héritage du maréchal Tito décidant qu'une religion donnait droit à former un État. On ne les a pas davantage entendus au moment où les pays occidentaux concernés par le drame yougoslave luttaient pour le maintien et le développement d'une République musulmane bosniaque.
Après la proposition de Lord Peel relative au partage de la Palestine (1937), dix ans de lutte et les terribles années d'extermination par les Nazis, les Juifs réussirent à s'installer en milieu musulman et, par leur vaillance guerrière, à s'y maintenir. Mais au prix d'un demi-siècle de guerres. Probablement plus encore. Aujourd'hui, les Occidentaux s'efforcent de créer et de renforcer une République musulmane (confession islamique minoritaire) en milieu chrétien. Sans doute en acceptant l'éventualité de conflits permanents. De surcroît, peut- être un jour membre d'une Union très grandement élargie, la Bosnie- Herzégovine en sera-t-elle à part entière pour être alors l'antichambre de l'Islam en Europe. Curieusement, les États-Unis s'en réjouissent : "Il serait important qu'il y ait en Europe un État où coexistent Musulmans et non- Musulmans", déclarait un haut fonctionnaire du gouvernement américain (3). En somme, il serait important de créer en Europe une "nouvelle Palestine". Afin, sans doute, que Washington y trouve prétexte à intervention.
Discutables certes, ces sombres perspectives sont bien rarement évoquées par des médias qui nous avaient habitués à plus de liberté. Les difficultés économiques dont souffrent plus particulièrement les pays industrialisés sont-elles à incriminer ? Privés des ressources normalement fournies par les diverses activités publicitaires des entreprises hier prospères, les médias deviennent-ils dépendants des soutiens gouvernementaux ? Il ne faudrait pas que, la crise aidant, les démocraties rejoignent les autocraties dans leurs méthodes d'information.
Mais la crise yougoslave a d'autres conséquences moins sujettes à l'interrogation. Elle a détruit les derniers vestiges de la victoire de 1945. Vainqueurs sur terre, les Russes font modeste figure devant l'Amérique, puissance de la mer. Tenants du statu quo balkanique, Français et Britanniques se sont inclinés devant les Allemands qui l'avaient mis à mal en 1941. La politique, la diplomatie et la défense communes dont les partisans du Traité de Maastricht nous ont rebattu les oreilles, s'évanouissent dans les brumes d'un très lointain et très incertain avenir. Et le "couple franco-allemand", mariage de raison, en a tous les défauts tant sont nombreuses et graves les infidélités.
Lors de son retour de Maastricht, le président de la République déclara que le texte qu'il venait de signer n'était pas négociable ; il fallait le prendre — ou le laisser — tel qu'il était. Chacun pensa qu'il en irait de même pour tous les autres pays signataires. Les mois qui suivirent démontrèrent que la plupart des grands partenaires de la France non seulement le négociaient mais, qu'unilatéralement, ils le modifiaient à leur convenance. Ce fut le cas de l'Allemagne, premier "pilier" du Traité. En effet, la Cour Constitutionnelle fédérale siégeant à Karlsruhe interpréta le traité de Maastricht de telle manière que s'il n'a pas été vidé de son contenu, il l'a été de sa finalité. Lors d'un entretien publié par la revue Politique Internationale (4), le chancelier Kohl avait clairement défini sa politique : "... le fédéralisme, la subsidiarité et l'intégration des intérêts des régions constituent, pour nous, les principes structurels essentiels de l'édification de l'Europe de demain". Mais la cour de Karlsruhe affirma que "l'Union européenne n'est pas un nouvel État fédéral, plus simplement un groupe d'États qui repose sur la volonté des États membres et respecte leur identité nationale" — Exit le fédéralisme. "L'appartenance à ce groupe d'États peut toujours cesser par un acte contraire.... l'Union européenne ne dispose ni de pouvoirs de commandement, ni d'une personnalité juridique propre... le passage à la troisième phase de l'Union monétaire n'est pas automatique..." La Cour rappelle les moyens dont disposent les autorités allemandes, et spécialement les tribunaux allemands qui ont le pouvoir de ne pas reconnaître la force juridique à des actes qui excéderaient manifestement les compétences des organes européens tels que prévues par le Traité. (Rappelons qu'en mai 1974 la Cour avait déclaré inapplicable en Allemagne un acte communautaire contraire au droit fondamental allemand.)
Manfred Brunner, président de la Fondation démocrate et avocat à Munich, réitérait à Jean-Paul Picaper (5) l'interprétation restrictive allemande du Traité : "... La Cour Constitutionnelle allemande agit, certes, en coopération avec la Cour de Justice européenne, mais elle a le dernier mot en cas de conflit". La légitimation démocratique de la CEE sera incarnée essentiellement par les parlements nationaux : le Parlement européen n'a qu'une fonction complémentaire (?) ... l'Union monétaire peut être résiliée... Pour toutes les questions dépassant le cadre du marché unique, il faudrait conserver dans le Conseil des Ministres la règle de l'unanimité... Mieux vaut ce type de démocratisation qu'une extension des compétences du Parlement européen parce qu'il ne peut y avoir de représentation populaire sans peuple..." Et J.P. Picaper ajoute : "... on comprend pourquoi le gouvernement s'est efforcé de passer sous silence ces conclusions de la Cour".
D'ailleurs, les efforts déployés par Bonn pour élargir l'Union vise deux objectifs : déplacer vers l'est, vers Berlin, le centre de gravité économique et politique de l'Union par l'adhésion de la Suède, de la Finlande, de l'Autriche et de la Norvège, pays formant une zone d'influence linguistique et économique allemande, et aussi interpréter le Traité selon les vœux de la Cour de Karlsruhe en diluant au maximum les responsabilités des institutions supranationales, toutes dispositions réalistes, mais contraires aux fantasmes européens français.
Les apparences, sinon peut-être la réalité, donneraient à croire que l'Allemagne réunifiée — ou plutôt, à peine réunifiée — a mis en œuvre deux diplomaties : l'une se manifeste à Bruxelles et lors des rencontres des chefs d'État, comme celles qui rassemblent périodiquement les dirigeants allemands et français. L'autre, discrète, consiste à "façonner" l'Europe conformément aux intérêts de la future nation allemande. Brunner le laissait entendre : "... l'Allemagne doit se défaire de sa peur de penser en contextes géopolitiques (à nous, Haushofer !). Le concept de la Mitteleuropa... nous a été légué par l'Histoire comme tâche particulière redevenue actuelle par la dépolarisation et le dégel qui a succédé à la guerre froide..." (6) Quoi de plus normal qu'un grand peuple, capable d'être le premier exportateur mondial et dont le commerce rayonne sur tous les continents, quoi de plus naturel qu'il pratique une politique ambitieuse, à la mesure de sa puissance démographique et économique. Seulement il faut dissiper les illusions entretenues par les fédéralistes français et, plus généralement, par les partisans du Traité de Maastricht. On ne peut prétendre que le diktat du 17 décembre 1991, une semaine à peine après la signature du Traité de Maastricht, ait été une manifestation d'entente entre les partenaires européens et l'amorce d'une diplomatie commune. La décision de M. Genscher, imposée à ses collègues, s'est révélée désastreuse. MM. R. Dumas et C. Warren en ont convenu. L'éléphant allemand entrait avec fracas dans le magasin de porcelaines que sont les Balkans. Le ministre des Affaires étrangères de Bonn a déclenché un processus infernal et malheureusement irréversible. Lord Carrington le confiait ainsi au Figaro (du 13 juillet 1993) : "... Alija Izetbegovic m'avait alerté : 'je dois demander l'indépendance de la Bosnie... Si je ne le fais pas, j'aurai la gorge tranchée. Mais je dois vous dire qu'une telle démarche aboutira à la guerre civile' ". Aussi, après de tels débuts, la politique étrangère allemande ne laisse-t-elle pas d'être inquiétante.
Elle l'est aussi vis-à-vis de l'Europe des Douze où Bonn ne se soucie guère de la "préférence communautaire" lorsque ses intérêts économiques sont en jeu : dès 1986, alors que la France cherchait à réunir les éléments d'une forte présence européenne dans l'espace, le gouvernement allemand s'opposa à deux des trois composantes essentielles de cette ambition : pas de station européenne sur orbite, mais un module amarré à celle des États-Unis, pas de "navette", mais peut-être un strapontin quémandé aux Américains et aux Soviétiques, si bien que le sort d' "Hermès" fut déjà compromis avant d'être réglé par l'abandon du projet. Ariane, par ses succès, échappa seule au naufrage. De même, convoitant le marché mondial, l'européen n'étant pas à sa mesure, Siemens choisit de s'allier à IBM américain et à Hitachi et Fujitsu japonais plutôt qu'aux firmes françaises et britanniques. Après avoir pris le contrôle de MBB (Messerschmidt, Bolkow, Blohm), Daimler-Benz s'est tourné vers Mitsubishi... Pourtant, les partenaires européens de l'Allemagne s'étaient montrés de bonne composition puisqu'ils se soumirent aux conséquences de la stratégie de la Bundesbank : taux d'intérêt élevés, afflux de devises en Allemagne, mais augmentation du chômage chez eux. "La politique monétaire de la Bundesbank est une véritable catastrophe pour toute l'Europe", dira Henri Martre, alors patron de l'Aérospatiale 0. Quant à la politique militaire, elle est pour le moins étrange : les forces armées d'outre- Rhin sont maintenant réparties entre quatre organisations : le futur corps d'armée franco-allemand, un groupe germano-hollandais, une participation à une force d'action rapide de l'Otan, enfin, une solide contribution à l'Otan, le tout, d'ailleurs, devant être placé sous le commandement américain en cas de crise grave. C'est là une curieuse façon de se préparer à une "défense commune" proprement européenne.
Chacun applaudit : l'intervention des États-Unis et celle, correspondante, de la Russie a décidé, en quelques heures, de la levée du siège de Sarajevo et du retour à la vie des citadins canonnés. Mais elle a mis en évidence l'incapacité des Douze à remédier à la catastrophe déclenchée par l'un des leurs. Il est vrai que le comportement de l'Allemagne dans les Balkans, fut-il vieux d'un demi- siècle, neutralisait la Communauté tout entière, accusée sous la pression de Bonn, puis de Washington, de partialité. L'entrée en scène de Moscou a rétabli l'équilibre entre des intérêts opposés. Celle des États-unis risque de se révéler périlleuse pour les pays européens dans la mesure où, pour plaire aux pays pétroliers arabes, c'est à l'instauration d'un État musulman en Europe qu'œuvre la Maison-Blanche. L'éveil de la Russie a été soudain et volontariste. Il n'est pas exclu que la destruction des quatre avions serbes ait été un avertissement : d'accord pour négocier à deux sur les décombres de l'ex-Yougoslavie, d'accord également pour substituer nos projets à ceux des médiateurs (c'est-à- dire à ceux de l'ONU et des Douze européens), mais qu'on ne s'y trompe pas, il n'existe toujours qu'une seule superpuissance et c'est l'Amérique.
Celle-ci a-t-elle un projet balkanique, comme l'intérêt subit qu'elle témoigne pour la Macédoine pourrait le laisser à croire ? Sinon à la Maison-Blanche où la politique intérieure accapare les esprits, mais dans de nombreux centres universitaires de recherche, des hommes de valeur étudient ces trois bouleversements qui transforment sur ce versant de l'Europe l'ordre international : l'effondrement du communisme, la réunification de l'Allemagne et la puissance croissante de l'intégrisme musulman. Vue d'outre-Atlantique, la péninsule occidentale de l'Eurasie — seconde en importance après l'Asie du Pacifique — prend un aspect nouveau. Deux forces la dominent : au nord les 80 millions d'Allemands, au sud les 80 millions que seront les Turcs dans un proche futur. C'est avec Bonn/Berlin d'une part, Ankara de l'autre, qu'il faut défendre les intérêts américains. À Bonn, l'on pardonnera la dangereuse précipitation de M. Genscher et, à Ankara, la répression des Kurdes. L'Allemagne aura toute liberté d'action dans cette Mitteleuropa "léguée par l'Histoire comme tâche particulière", selon M. Manfred Brunner avec, en prime immédiate, le rattachement économique de la Slovénie et de la Croatie. Quant à la Turquie, elle exercera son influence sur l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo musulman — au détriment des Serbes, affaiblis par l'embargo et désignés à la vindicte publique par une campagne de désinformation intense. Si l'Allemagne participera — avec mesure — à la réhabilitation de l'économie de la Russie, elle devra aussi demeurer la plaque tournante des forces de l'Otan si, par exemple, un néopanslavisme actif succédait un jour au messianisme marxiste. De surcroît, elle sera, en Europe, le champion du libre-échangisme si favorable à l'économie américaine — du moins à court et à moyen terme. L'Irak détruit, l'option laïque et socialiste du baassisme éliminée et l'option intégriste ralliant de plus en plus de fidèles, il reviendra à la Turquie, encore laïque, de former un môle de résistance tandis que son influence politique, et peut-être économique, s'exercerait sur les pays turcophones, hier membres de l'U.R.S.S, leur offrant une autre voie que le retour dans le giron de Moscou. Aussi l'intervention américaine dans la triste affaire des Balkans, aux côtés de l'Allemagne d'une part, des pays musulmans de l'autre, constitue-t-elle une bonne approche pour mettre en pratique, peu à peu, cette nouvelle — et élémentaire — stratégie.
Dans un délai qu'on ne saurait fixer, Moscou pourrait être en mesure d'altérer ces objectifs et de limiter les moyens nécessaires pour les atteindre. La crise yougoslave a stimulé une diplomatie paralysée par les difficultés internes. Mais, entre le comportement des Russes lors de la guerre du Golfe et le leur depuis que l'Amérique est diplomatiquement présente dans les Balkans, grande est la différence. Le Kremlin doit compter avec la nouvelle Douma d'autant qu'elle répond aux aspirations profondes de la population recrue d'humiliation. Après avoir tenu une place quasi dominante dans les affaires du monde, les Russes réclament une plus grande considération. Et les politiques comme les analystes devront se rendre à l'évidence : il faudra, à nouveau, s'accommoder des volontés de ce grand pays. D'ailleurs, si pour les hommes le pouvoir absolu conduit à l'arbitraire, de même l'omnipotence d'une seule nation l'amène à commettre des excès. Source d'équilibre, la bipolarité est aussi le gage de plus de mesure. C'est ainsi que l'attaque de Bagdad, le 23 juin 1993, pour punir l'Irak d'un attentat qui n'eut pas lieu (et qui ne fut même pas envisagé, selon la presse américaine), la partialité dont l'Occident a fait preuve tout au long du drame yougoslave n'ont été possibles que parce que la Russie avait pratiquement disparu de la scène internationale. Elle y entre et veut s'y faire entendre.
Dans un monde bipolaire, les forces antagonistes s'équilibrant à peu près, le complot antiserbe n'aurait pu prendre autant d'ampleur. On remarque, par exemple, que l'attentat du marché de Markale ayant eu lieu le 5 février en fin de matinée, le soir même, le gouvernement français s'apprêtait à réclamer un ultimatum aux Serbes et à l'accompagner de menaces d'attaques aériennes. Dans une démocratie, un suspect est présumé innocent jusqu'à ce qu'ait été prouvée sa culpabilité. Or, avant même que soit réunie la commission d'enquête et alors que les premières investigations des experts militaires concluaient à l'impossibilité de déterminer l'origine du tir (si tir il y avait eu), Paris décidaient que les Serbes étaient les coupables et qu'il convenait de les châtier. Étrange.
Étranges, également, les renvois successifs des chefs militaires de la FORPRONU. Sur le terrain et disant des vérités contraires à la tournure que les politiques voulaient faire prendre à cette guerre civile, ils furent, l'un après l'autre, contraints d'abandonner leur commandement. "La présidence bosniaque entretient là des combats qui n'ont, et ils le savent, aucune chance d'aboutir, mais qui ont le mérite d'attirer l'attention du monde", déclara le général Morillon. Il est rappelé à Paris. Le général MacKenzie révèle-t-il que l'attentat de la rue Vase Miskina a été préparé par les Bosniaques, qu'il est prié d'aller exercer ses talents au Canada, son pays d'origine. "Toutes ces gesticulations à propos des frappes aériennes ne riment à rien. Chaque fois qu'on approchait d'un accord militaire, elles ont envenimé la situation... Il faut en finir avec l'antiserbisme primaire véhiculé par quelques intellos en goguette", dira le général Briquemont aussitôt renvoyé en Belgique. Honnêtes et clairvoyants, ces militaires de haut rang dérangeaient les desseins des politiques qui entendaient que soit fardée la vérité.
Le "nouvel ordre international", conçu pour un monde unipolaire, en Irak comme en Yougoslavie, a cherché à atteindre ses objectifs par la "mise en condition" des opinions publiques, le recours aux cruautés des embargos et, si besoin était, les destructions massives. Ce sont maintenant les démocraties qui violent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se comportant comme les autocraties auxquelles, légitimement cette fois, elles eurent le mérite de longtemps s'opposer.
Pierre-Marie GALLOIS (1911-2010) http://www.theatrum-belli.com
Général de brigade aérienne et géopoliticien, artisan de la dissuasion nucléaire française.Article issu de la Revue d'Europe Centrale, du 1er semestre 1994
Notes :
(1) Lewis MacKenzie. Douglas and McIntyre. Vancouver/Toronto, 1993, p. 194.
(2) Le général MacKenzie, lors d'une conférence de presse : "... je ne suis pas en état d'empêcher les deux belligérants de tirer sur leurs propres positions pour satisfaire CNN"
(3) Alain Frachon, Washington veut amener les Serbes à la table des négociations, Le Monde. 16 mars 1994, p. 3
(4) N°52. Eté 1991.
(5) Une Europe des Etats souverains. Géopolitique, n° 44, p. 73
(6) Ibid., p. 75
(7) Henri Tricot : "Le patron de l'Aérospatiale accuse l'Allemagne de provoquer la récession". Le Quotidien, 14 janvier 1992, p. 7