Quelques bons mots de Mgr di Falco règlant ses comptes à la théorie du genre.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Quelques bons mots de Mgr di Falco règlant ses comptes à la théorie du genre.
Première partie. Aymeric Chauprade revient sur les grandes tendances géopolitiques du moment et se penche sur la place de la France dans le monde. Entretien réalisé avec Xavier Moreau pour Realpolitik, le 13 février 2013.
Aymeric Chauprade : les grandes tendances... par realpolitiktv
Cette fois, Frédéric Malaval se penche sur la Modernité. Il voit dans la période que nous vivons actuellement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale un nouvel Age d’or pour aboutir à la mondialisation, étape ultime de la colonisation américaine.
Polémia
Des trois étapes essentielles installant la Modernité nous éluderons le XIIIe siècle et le XVIe siècle en relevant toutefois que ces deux époques sont des Ages d’or succédant à des périodes troublées. Ainsi, le XVIe siècle conclut une période dominée par les grandes pestes qui décimèrent la population européenne. La période que nous vivons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est aussi un Age d’or. Aucune guerre, épidémie ou famine n’est venue dévaster l’Europe. Les hécatombes de la guerre de 1914-1945, les épidémies comme la grippe espagnole de 1919 ou la crise économique de 1929 relèvent de l’Histoire pour l’immense majorité d’entre nous qui n’a connu que la prospérité. Nous laisserons aux historiens le soin d’exposer pourquoi le XIIIe siècle et le XVIe siècle sont à ranger dans la catégorie des Ages d’or. Concentrons-nous sur la deuxième moitié du XXe siècle. Cette prospérité commence dans des conditions politiques où l’Europe est dominée par les deux porteurs de la Modernité : les USA capitalistes à l’ouest, l’URSS socialiste à l’est.
Le 14 juin 1940, le général allemand Rommel, à la tête de ses chars, faisait près de 260 km en une journée en Normandie. En face, il n’y avait plus rien. Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale à l’origine du Front populaire de 1936 confiait les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour gérer la débâcle. La classe dirigeante française fut ébranlée par ce séisme, elle qui avait participé à la régence du monde après 1918.
Le 6 juin 1944, le débarquement américain en Normandie eut comme conséquence de décapiter définitivement ce qui en restait après la débâcle de 1940. L’Epuration et la diffusion de listes d’infamie créèrent des vides au sommet de la hiérarchie sociale. Ceux-ci furent comblés à l’issue d’un processus méritocratique encadré par des protagonistes ayant fait allégeance au vainqueur. Puis, ce furent les Trente Glorieuses au cours desquelles le territoire français connut un bouleversement sans précédent. Géographique, avec la fin d’une France millénaire structurée par la paysannerie. L’exode rural vida les campagnes ; de rurale, la France devint urbaine. Social, avec un baby-boom entre 1945 et 1955. Ce sont ces enfants qui rompirent avec la France traditionnelle pour l’engager dans le matérialisme bourgeois. Le modèle politique qui s’impose repose sur la reconstruction, puis le développement. C’est au nom de ce développement que fut organisée l’arrivée massive de populations allogènes en Europe de l’Ouest, particulièrement en France et au Royaume-Uni dont les réservoirs issus de leurs empires éclatés ne cessaient de croître. Jusqu’alors les migrations ne concernaient que des peuples européens. L’américanisation est depuis irrépressible. Seule l’Europe de l’Est, dominée par l’URSS, échappa à cette politique. Depuis sa disparition, l’américanisation de l’Europe s’étend vers l’Est. Portée par toutes les institutions créées depuis, cette américanisation a assuré la paix et la prospérité dans un espace européen chroniquement affecté par la guerre et la misère. Chacun y succombe et accepte volontiers cette tutelle car, pour l’immense majorité, « on vit bien ».
Pour savoir où tout cela nous conduit et comment cela s’organise, regardons l’Amérique. Le déploiement de son modèle politique à l’ensemble du monde s’appelle désormais « la Mondialisation ». Le stade ultime de la Modernité, telle qu’elle est envisagée aujourd’hui, est une ploutocratie mondialisée garante de l’optimisation du bonheur collectif. La Mondialisation est le terme nuancé pour décrire l’américanisation de l’écosphère.
Alors que la crise financière de l’automne 2008 commençait, le président de la Banque centrale européenne, interrogé sur son origine, reconnaissait, sûr de lui, que le monde que lui et ses semblables cherchaient à édifier souffrait encore de quelques imperfections. Cette crise allait contribuer à les révéler et à les résoudre. Quel monde est-il donc envisagé ? Qui le construit ? Cette opacité sur la finalité du processus engendre rumeurs et fantasmes incessants, pourtant le but apparaît de plus en plus évident pour une multitude. Nous assistons à un processus d’américanisation du Monde uni par un même modèle politique, relayé par les bourgeoisies locales que les Etats-Unis ont promues. Le développement est le but et le moyen d’accéder au stade ultime.
Plusieurs références sont indiscutables. Deux ont déjà été évoquées : le Paradis, les USA. Se pose alors la question de l’identité et des motivations des protagonistes les plus actifs et de leur vision du monde. Une certitude s’impose alors : l’ambition ultime de la Modernité est d’artificialiser les écosystèmes, c’est-à-dire sortir l’Homme, conçu comme Unité, des contingences imposées par l’état naturel. La production de biens, matériels ou immatériels, est donc le but absolu. Cela s’appelle le Développement ; hier, la Civilisation. L’artificialisation de l’écosphère permet alors le découplage de l’Homme et de la Nature. Capitalistes et socialistes s’accordent sur la dissociation Homme/Nature, mais il y a divergence sur le mode d’appropriation des moyens de subsistance. Au nom de l’efficacité, pour les capitalistes, tout doit être fait pour favoriser le triomphe des intérêts privés ; pour les socialistes, ces moyens d’existence doivent être collectivisés. Les premiers ont gagné. Le pôle socialiste a implosé en 1991, les plus radicaux des capitalistes envisageant une Fin de l’Histoire (Fukuyama) par la réalisation d’un Nouvel Ordre mondial (George H.W. Bush). Tout ce qui s’oppose à cette promesse de l’Eden est alors éliminé. La certitude de participer à l’augmentation du bonheur collectif est ancrée dans leurs esprits. Les capitalistes se conçoivent, sous la protection armée des Etats-Unis, comme la classe dirigeante de nos sociétés ploutocratiques. Le triomphe du marché comme espace d’arbitrage des conflits est le but et le moyen de réaliser ce Paradis où les antagonismes de classes, de races, de nations, etc., auront disparu au profit du bien-être matériel garanti par cette élite capitaliste dans un monde unifié par une gouvernance mondiale. L’espérance du profit, donc l’enrichissement, est la ruse de l’Histoire pour amener des individus à réaliser cette entreprise collective. La Mondialisation est alors le but de toute politique. La combattre est un crime assimilable à ceux commis par les plus réactionnaires des ennemis du peuple. Tout ceci est fait et pensé au nom de la Modernité envisagée comme le paradigme inaliénable de la noosphère. Aussi, ce n’est plus le bonheur ou la prospérité de tel ou tel peuple qui importe, mais l’augmentation générale de la quantité de biens et de services accessibles au plus grand nombre. C’est l’esprit guidant une mondialisation heureuse, sacrifiant parfois un peu de confort chez les uns pour l’augmenter sensiblement chez les autres. (…). L’augmentation du bonheur collectif en est la justification.
Bien évidemment, les critiques fusent pour contester cette suprématie politique autoproclamée vertueuse. Ecologistes, philosophes, nationalistes, religieux, etc., sont en embuscade pour sortir du bois le jour où la fatuité de ces promesses s’imposera à tous. Déjà les premières failles ne cessent de s’agrandir. Tradition et PostModernité s’associent alors pour construire un discours alternatif. L’Ecologie comme science politique s’impose à l’interface de ces deux courants.
Frédéric Malaval http://www.polemia.com
22/02/2013
Ecoracialisme (5) - La réalisation politique de la Modernité en France
À lire :
Écoracialisme (1) / Introduction
Écoracialisme (2) / Un homme, une femme ; un homme/femme, une femme/homme
Écoracialisme (3) / L’Âge d’or
Écoracialisme (4) / L’insondabilité de l’origine des peuples
La science est la recherche de la connaissance exacte des phénomènes. En découvrant les liens entre les phénomènes, c’est-à-dire en observant les conditions de leur apparition, elle a l’impression qu’elle les a expliqués. Ce type de mentalité apparaît dans une Haute Culture après l’achèvement de la pensée religieuse créative, et le début de l’extériorisation. Dans notre Culture, ce type de pensée ne commença à s’affirmer qu’au milieu du XVIIe siècle, dans la Culture Antique, au Ve siècle avant J.C. La principale caractéristique de la première pensée scientifique, du point de vue historique, est qu’elle se dispense d’équipement théologique et philosophique, l’utilisant seulement pour remplir l’arrière-plan, auquel elle ne s’intéresse pas. Elle est donc matérialiste dans son essence, au sens où toute son attention est tournée vers les phénomènes et non vers les réalités ultimes. Pour une époque religieuse les phénomènes sont sans importance comparés aux grandes vérités spirituelles, pour une époque scientifique c’est l’opposé qui est vrai.
La technique est l’utilisation du macrocosme. Elle accompagne toujours une science en plein épanouissement, mais cela ne veut pas dire que toute science est accompagnée d’une activité technique, car les sciences de la Culture Antique et de la Culture Mexicaine n’avaient rien de ce que nous appelons compétence technique. Dans le premier stade de Civilisation, la Science prédomine et précède la technique dans toutes ses tentatives, mais au début du XXe siècle la pensée technique commença à s’émanciper de cette dépendance, et aujourd’hui la science sert la technique et non plus l’inverse.
Dans une Epoque de Matérialisme, c’est-à-dire une époque anti-métaphysique, il était tout naturel qu’un type de pensée anti-métaphysique comme la science devienne une religion populaire. La religion est une nécessité pour l’homme de Culture, et il bâtira sa religion sur l’économie, la biologie ou la nature si l’Esprit de l’Epoque exclut la vraie religion. La Science fut la religion dominante des XVIIIe et XIXe siècles. Si on était autorisé à douter des vérités des sectes chrétiennes, on n’était pas autorisé à douter de Newton, Leibniz et Descartes. Quand le grand Goethe contesta la théorie newtonienne de la lumière, il fut traité d’excentrique et d’hérétique.
La Science fut la religion suprême du XIXe siècle, et toutes les autres religions, comme le darwinisme et le marxisme, se référaient à ses grands dogmes-parents comme base de leurs propres vérités. « Non-scientifique » devint un terme de damnation.
Après ses débuts timides, la science franchit finalement le pas consistant à présenter ses résultats non comme un simple arrangement ou une simple classification mais comme les vraies explications de la Nature et de la Vie. Avec ce pas, elle devint une vision-du-monde, c’est-à-dire une philosophie complète avec une métaphysique, une logique et une éthique pour les croyants.
Toute science est une reformulation profane des dogmes précédents de la période religieuse. C’est la même âme culturelle qui avait formé les grandes religions qui refaçonne son monde à l’époque suivante, et cette continuité est donc absolument inévitable. La Science Occidentale en tant que vision-du-monde est simplement la religion occidentale sous une forme profane et non sacrée, naturelle et non surnaturelle, découvrable et non révélée.
Comme la religion occidentale, la science était clairement sacerdotale. Le savant est le prêtre, l’instructeur est le frère convers, et un grand systématiseur est canonisé, comme Newton ou Planck. Toute forme de pensée occidentale est ésotérique, et ses doctrines scientifiques ne firent pas exception. La populace était maintenue en contact avec « les progrès de la science » par l’intermédiaire d’une littérature populaire qui faisait sourire les grand-prêtres de la science.
Au XIXe siècle, la science accrédita l’idée de « Progrès », et lui donna sa marque particulière. Le contenu du « Progrès » devait être technique. Le « Progrès » devait consister en plus de vitesse, plus de bruit, plus d’exploitation du monde matériel ad infinitum. Cela montrait déjà la future domination de la technique sur la science. Le « Progrès » ne devait pas être d’abord plus de connaissance, mais plus de technique. Toute vision-du-monde occidentale lutte pour l’universalité, et celle-ci déclara donc que la solution des problèmes sociaux ne devait pas être cherchée dans la politique et dans l’économie, mais dans la science. Des inventions furent promises qui rendraient la guerre trop horrible pour que les hommes s’y engagent, et ils cesseraient donc de faire la guerre. Cette naïveté était un produit naturel d’une époque qui était forte en sciences naturelles, mais faible en psychologie. La solution du problème de la pauvreté était la machinerie, et encore la machinerie. Les horribles conditions qui étaient nées d’une Civilisation de la machine devaient être soulagées par plus de machines. Le problème de la vieillesse devait être surmonté par le « rajeunissement ». On décréta que la mort était seulement un problème de pathologie, non de sénilité. Si toutes les maladies étaient supprimées, on ne pourrait plus mourir de rien.
Les problèmes raciaux devaient être résolus par l’« eugénisme ». La naissance des individus ne devait plus être laissée au Destin. Les prêtres scientifiques décideraient des choses comme les parents et la naissance. Aucun événement extérieur ne serait permis dans la nouvelle théocratie, rien d’incontrôlé. Le temps devait être « maîtrisé », toutes les forces naturelles mises sous contrôle absolu. Il n’y aurait pas d’occasions de guerre, chacun tenterait de devenir un scientifique, pas de rechercher le pouvoir. Les problèmes internationaux disparaîtraient, puisque le monde deviendrait une immense unité scientifique.
Le tableau était complet, et pour le XIXe siècle matérialiste, imposant : toute la Vie, toute la Mort, toute la Nature, réduites à un ordre absolu, sous la garde de théocrates scientifiques. Tout se passerait sur cette planète tout comme dans l’image des cieux que les astronomes scientifiques avaient dessinée pour eux-mêmes ; une régularité sereine régnerait – mais cet ordre serait purement mécanique, totalement sans but. L’homme serait scientifique seulement pour être scientifique.
II
Quelque chose arriva, cependant, pour perturber le tableau, et pour montrer que lui aussi portait la marque de la Vie. Avant la Première Guerre Mondiale, la désintégration des fondements psychiques de la grande structure avait déjà commencé. La Guerre Mondiale marque, dans le domaine de la science comme dans tout autre domaine de la vie occidentale, une césure. Un monde nouveau surgit de cette guerre – l’esprit du XXe siècle se présenta comme successeur de toute la vision mécaniste de l’univers, et de tout le concept du sens de la Vie, comme étant l’acquisition de la richesse.
Avec une rapidité vraiment étonnante, étant donné les décennies de sa puissance et de sa suprématie, la vision mécaniste pâlit, et les principaux esprits, même dans ses disciplines, se détournèrent des vieux et évidents articles de la foi matérialiste.
Comme c’est habituellement le cas pour les mouvements historiques, les expressions d’une âme supra-personnelle, le point de la plus haute puissance, des plus grandes victoires, est aussi le début de sa chute rapide. Les personnes superficielles prennent toujours la fin d’un mouvement pour le début de sa domination absolue. Ainsi Wagner était regardé par beaucoup comme le début d’une musique nouvelle, alors que la génération suivante savait qu’il avait été le dernier musicien occidental. La disparition de toute expression de Culture est un processus graduel – néanmoins il y a des tournants, et le rapide déclin de la science en tant que vision-du-monde commença avec la Première Guerre Mondiale.
Le déclin de la science en tant que discipline mentale avait largement précédé la Guerre Mondiale. Avec la théorie de l’Entropie (1850) et l’introduction de l’idée d’irréversibilité dans son image, la science était sur la route qui devait culminer avec la relativité physique et la franche admission de la subjectivité des concepts physiques. De l’Entropie vint l’introduction des méthodes statistiques dans la science systématique, le début de l’abdication spirituelle. Les statistiques décrivaient la Vie et le vivant ; la stricte tradition de la science occidentale avait insisté sur l’exactitude dans la description mathématique de la réalité, et avait donc méprisé ce qui n’était pas susceptible d’une description exacte, comme la biologie. L’entrée des probabilités dans la science anciennement exacte est le signe que l’observateur commence à s’étudier lui-même, à étudier sa propre forme comme conditionnant l’ordre et la descriptibilité des phénomènes.
Le pas suivant fut la théorie de la radioactivité, qui contient aussi de forts éléments subjectifs et requiert le calcul de probabilités pour décrire ses résultats. L’image scientifique du monde devint encore plus raffinée, et encore plus subjective. Les disciplines anciennement séparées se rapprochèrent lentement – mathématiques, physique, chimie, épistémologie, logique. Les idées organiques s’imposèrent, montrant une fois de plus que l’observateur avait atteint le point où il étudiait la forme de sa propre Raison.
Un élément chimique avait maintenant une durée de vie, et les événements précis de sa vie sont imprévisibles, indéterminés. L’unité même de l’événement physique, l’« atome », qui était encore considéré comme une réalité au XIXe siècle, devint au XXe siècle un simple concept, dont la description des propriétés était constamment changée pour suivre et étayer les développements techniques. Autrefois, chaque expérience montrait simplement la « vérité » des théories dominantes. C’était aux jours de la suprématie de la science en tant que discipline au-dessus de la technique, son enfant adoptif. Mais avant le milieu du XXe siècle, chaque nouvelle expérience provoqua une nouvelle hypothèse de la « structure atomique ». Ce qui était important dans le processus, ce n’était pas l’hypothétique château de cartes qui était érigé par la suite, mais l’expérience qui avait eu lieu avant.
On n’avait aucun scrupule à avoir deux théories irréconciliables l’une avec l’autre, pour décrire la « structure » de l’« atome » ou la nature de la lumière. La matière-sujet de toutes les sciences séparées ne pouvait plus être gardée mathématiquement claire. Les vieux concepts comme la masse, l’énergie, l’électricité, la chaleur, la radiation, fusionnèrent en un seul autre, et il devint toujours plus clair que ce qui était étudié était en fait la raison humaine, dans son aspect épistémologique, et l’âme occidentale dans son aspect scientifique.
Les théories scientifiques atteignirent le point où elles ne signifiaient rien de moins que l’effondrement complet de la science en tant que discipline mentale. On projeta l’image que la Voie Lactée était formée de plus d’un million d’étoiles fixes, parmi lesquelles beaucoup ont un diamètre de plus de 93.000.000 miles ; cela à nouveau non pas comme un centre cosmique stationnaire, mais lui-même en mouvement vers Nulle Part à la vitesse de plus de 600 kilomètres par seconde. Le cosmos est fini, mais illimité ; sans limites, mais limité. Encore cette exigence du vrai croyant de la vieille foi médiévale : credo quia absurdum, mais l’indétermination mécanique ne peut pas susciter ce genre de foi, et les grand-prêtres ont apostasié. Dans l’autre direction, l’« atome » a des dimensions tout aussi fantastiques – un dix millionième de millimètre de diamètre, et la masse d’un atome d’hydrogène représente par rapport à un gramme d’eau ce que représente la masse d’une carte postale par rapport à la masse de la Terre. Mais cet atome est formé d’« électrons », le tout formant une sorte de système solaire, dans lequel les distances entre les planètes sont aussi grandes, en proportion de leur masse, que dans notre système solaire. Le diamètre d’un électron est d’un trois milliardième de millimètre. Mais plus il est étudié de près, plus il devient spirituel, car le noyau de l’atome est une simple charge d’électricité, n’ayant ni poids, ni volume, ni inertie ni aucune autre propriété classique de la matière.
Dans sa dernière grande saga, la science dissout ses propres fondements psychiques, et quitta le monde des sens pour passer dans le monde de l’âme. Le temps absolu fut dissout, et le temps devint fonction de la position. La masse se spiritualisa en énergie. L’idée de simultanéité fut rejetée, le mouvement devint relatif, les parallèles se coupèrent, deux distances ne purent plus être considérées comme absolument égales. Tout ce qui avait jadis été décrit, ou qui s’était décrit, par le mot Réalité, se dissout dans le dernier acte du drame de la science en tant que discipline mentale.
Les gardiens de la science en tant que discipline mentale, l’un après l’autre, abandonnèrent les vieilles positions matérialistes. Dans le dernier acte, ils finirent par voir que la science d’une Culture donnée a pour objet réel la description, en termes scientifiques, du monde de cette Culture, un monde qui est à nouveau la projection de l’âme de cette Culture. Par l’étude même de la matière, on parvint à la connaissance profonde que la matière est seulement l’enveloppe de l’âme. Décrire la matière c’est se décrire soi-même, même si les équations mathématiques drapent le processus d’une objectivité apparente. Les mathématiques elles-mêmes ont succombé en tant que description de la Réalité : leurs fières équations sont seulement des tautologies. Une équation est une identité, une répétition, et sa « vérité » est un reflet de la logique de papier du principe d’identité. Mais c’est seulement une forme de notre pensée.
La transition entre le matérialisme du XIXe siècle et la nouvelle spiritualité du XXe siècle ne fut donc pas une bataille, mais un développement inévitable. Cette vive et froide discipline mentale retourna le couteau contre elle-même à cause d’un impératif intérieur à penser d’une manière nouvelle, d’une manière anti-matérialiste. La matière ne peut pas être expliquée d’une manière matérialiste. Toute sa signification vient de l’âme.
III
De ce point de vue, le matérialisme apparaît comme un grand négatif. Il fut un grand effort spirituel pour nier l’esprit, et cette négation de l’esprit était en elle-même l’expression d’une crise de l’esprit. Il fut la crise de Civilisation, la négation de la Culture par la Culture.
Pour les animaux, ce qui apparaît – la matière – est la Réalité. Le monde des sensations est le monde. Mais pour l’homme primitif, et a fortiori pour l’homme de Culture, le monde se divise en Apparence et en Réalité. Tout ce qui est visible et tangible est perçu comme un symbole de quelque chose de supérieur et d’invisible. Cette activité symbolisante est ce qui distingue l’âme humaine des formes de Vie moins compliquées. L’homme possède un sens métaphysique comme marque de son humanité. Mais c’est précisément la réalité supérieure, le monde des symboles, du sens et du but, que le Matérialisme niait en totalité. Qu’était-ce donc, à part une grande tentative d’animaliser l’homme en identifiant le monde de la matière à la Réalité et en le fondant en lui ? Le matérialisme ne fut pas vaincu parce qu’il était erroné ; il mourut simplement de vieillesse. Il n’est pas erroné même maintenant – il s’adresse simplement à des sourds. Il est passé de mode, et est devenu la vision-du-monde de cousins de provinces.
Avec l’effondrement de sa Réalité, la science occidentale en tant que discipline mentale a accompli sa mission. Son sous-produit, la science en tant que vision-du-monde, appartient maintenant au passé. Mais l’un des résultats de la Seconde Guerre Mondiale fut qu’une nouvelle stupidité apparut : le culte de la technique en tant que philosophie de la Vie et du monde.
La technique dans son essence n’a rien à voir avec la science en tant que discipline mentale. Elle a un but : extraire de la puissance physique à partir du monde extérieur. Elle est, pour ainsi dire, une politique de la Nature, à distinguer de la politique humaine. Le fait que la technique procède à partir d’une hypothèse aujourd’hui et d’une autre demain montre que sa tâche n’est pas la formation d’un système de connaissance, mais la soumission du monde extérieur à la volonté de l’homme occidental. Les hypothèses à partir desquelles elle procède n’ont aucun lien réel avec ses résultats, mais fournissent simplement des points de départ pour que l’imagination des techniciens puisse réfléchir à des voies nouvelles pour de nouvelles expériences et pour extraire encore plus de puissance. Certaines hypothèses sont bien sûr nécessaires ; ce qu’elles sont précisément est secondaire.
La technique est donc encore moins capable que la science de satisfaire le besoin d’une vision-du-monde à cette époque. Puissance physique – pour quoi faire ?
L’époque elle-même fournit la réponse : la puissance physique pour des buts politiques. La science est passée dans le rôle de fournisseuse de terminologie et d’idées pour la technique. La technique est à son tour la servante de la politique. Déjà en 1911, l’idée d’« énergie atomique » était dans l’air, mais c’est l’esprit de la guerre qui donna pour la première fois à cette théorie une forme concrète, avec l’invention en 1945, par un Occidental inconnu, d’un nouvel et puissant explosif dont les effets dépendent de l’instabilité des « atomes ».
La technique est pratique ; la politique est sublimement pratique. Elle n’a pas le moindre intérêt à savoir si un nouvel explosif dépend des « atomes », des « électrons », des « rayons cosmiques », ou des saints et des démons. Le mode de pensée historique qui inspire le véritable homme d’Etat ne peut pas prendre trop au sérieux la terminologie d’aujourd’hui lorsqu’il se rappelle avec quelle rapidité celle d’hier fut abandonnée. Un projectile qui peut détruire une ville de 200.000 habitants en une seconde – c’est pourtant une réalité, et elle concerne le domaine des possibilités politiques.
C’est l’esprit de la politique qui détermine la forme de guerre, et la forme de guerre influence ensuite la conduite de la politique. Les armes, la tactique, la stratégie, l’exploitation de la victoire – toutes ces choses sont déterminées par l’impératif politique de l’époque. Chaque époque forme l’entièreté de ses expressions pour elle-même. Ainsi pour le XVIIIe siècle riche en formes, la guerre était aussi une forme stricte, une séquence de positions et de développements, comme la forme musicale contemporaine des variations sur un thème.
Une étrange aberration survint dans le monde occidental après le premier emploi d’un nouvel explosif en 1945. Elle était essentiellement attribuable aux vestiges de la pensée matérialiste, mais elle contenait aussi d’anciennes idées mythologiques. L’idée surgit que ce nouvel explosif risquait de faire exploser toute la planète. Au milieu du XIXe siècle, quand l’idée du chemin de fer fut mise à l’étude, les médecins dirent qu’un mouvement aussi rapide provoquerait des troubles cérébraux, et que même la vision d’un train passant à toute vitesse pourrait le faire ; en outre le soudain changement de pression de l’air dans les tunnels pourrait causer des attaques.
L’idée que la planète pourrait exploser était simplement une autre forme de la vieille idée, présente dans de nombreuses mythologies, occidentales et non-occidentales, de la Fin du Monde, du Ragnarök, du Götterdämmerung, du Cataclysme. La science s’empara aussi de cette idée, et l’enveloppa dans la Seconde Loi de la Thermodynamique. Les adorateurs de la technique imaginèrent beaucoup de choses concernant le nouvel explosif.
Ils ne comprirent pas que ce n’était pas la fin d’un processus, mais le commencement.
Nous nous trouvons au début de l’Epoque de la Politique Absolue, et l’une de ses demandes est naturellement celle d’armes puissantes. Par conséquent, la technique reçoit l’ordre de tout faire pour fournir des armes absolues. Elle n’y parviendra jamais, cependant, et le fait de croire qu’elle y parviendra trahit simplement un matérialiste, c’est-à-dire, au XXe siècle, un provincial.
Le culte de la technique est complètement inapproprié pour l’âme de l’Europe. L’impulsion formative de la Vie humaine ne vient pas plus de la matière aujourd’hui qu’elle n’en venait jadis. Au contraire, la manière même de faire des expériences avec la matière, et la manière de l’utiliser, sont des expressions de l’âme. La naïve croyance des adorateurs de la technique qu’un explosif pourrait détruire la Civilisation Occidentale jusqu’aux fondations est le dernier souffle du Matérialisme. Cette Civilisation a fait cet explosif, et elle en fera d’autres – ils ne l’ont pas faite, et ils ne feront ou déferons jamais la Civilisation Occidentale. La matière ne pourra jamais détruire la Civilisation Occidentale, pas plus qu’elle ne l’a créée.
C’est encore du matérialisme de confondre une civilisation avec des usines, des maisons, et l’ensemble des installations. La Civilisation est une réalité supérieure, se manifestant à travers les populations humaines, et à l’intérieur de celles-ci, à travers une certaine strate spirituelle, qui incarne au plus haut point l’Idée vivante de la Culture. Cette Culture crée des religions, des formes d’architecture, des arts, des Etats, des Nations, des Races, des Peuples, des armées, des poèmes, des philosophies, des sciences, des armes et des impératifs intérieurs. Tous sont de simples expressions de la Réalité supérieure, et aucun ne peut la détruire.
L’attitude du XXe siècle envers la science et la technique est claire. Elle ne leur demande pas de fournir une vision-du-monde – elle la trouve ailleurs – et elle rejette positivement toute tentative de faire une religion ou une philosophie à partir du matérialisme ou du culte de l’atome. Elle les utilise cependant, au service de sa volonté-de-puissance illimitée. L’Idée est primordiale, et pour la réaliser, la supériorité en armes est essentielle pour compenser l’immense supériorité numérique des ennemis de l’Occident.
Francis P. Yockey http://www.voxnr.com
Source : Extrait du livre de Francis P. Yockey, Imperium (1948)
Conférence donnée par Marion Sigaut le samedi 2 février 2013 dans l’agglomération toulonnaise et organisée par la section niçoise d’Egalité & Réconciliation.
Aida TOUIRI recoit José Garcia. Elle lui parle discrimination, il lui répond patriotisme et rêve français.
(1re partie) Intervention de Michel Geoffroy
Lors de la Troisième Journée d’étude de la réinformation, organisée par Polémia, le 16 octobre 2010, à Paris, Michel Geoffroy s’est attaché à analyser les failles du système mondialiste, condamné à disparaître comme a disparu le système communiste. Mais l’histoire est comme l’herbe, on ne la voit pas… pousser. Il faut donc apprendre à détecter les signaux faibles ce qui procède de la réinformation.
Par définition les signaux faibles ne figurent pas dans les gros titres des quotidiens et ne passent pas au « Journal de 20h ». Il faut donc apprendre à les découvrir car ils sont souvent cachés sous le fatras de « l’information » sidérante. En outre, les signes faibles ne bénéficient pas de l'effet d'orchestration, à la différence des faits politiquement corrects. Il faut donc une mise en perspective pour comprendre leur signification et leur dimension.
Pour une simplification de lecture, le texte de l’intervention de Michel Geoffroy sera présenté en cinq parties sous les titres suivants :
1. Les trois murs du système mondialiste
2. Les similitudes entre le système mondialiste et le système soviétique
3. L’ébranlement du mur médiatique : apprendre à détecter les signaux faibles
4. Les fissures du mur médiatique : la montée de nouvelles dissidences
5. Les fissures du mur médiatique : l’apparition de nouvelles lignes de fracture sociale
1er Partie : Les trois murs du système mondialiste
La première partie de l’intervention de Michel Geoffroy est consacrée à la description des « trois murs » sur lesquels s’appuie le système mondialiste : le mur des intérêts économiques, le mur du politiquement correct, le mur médiatique.
Le Système qui s'est imposé dans les pays occidentaux s'appuie donc sur trois murs :
- le mur des intérêts économiques : c'est à dire celui des entreprises transnationales et des banques qui sont les seules vraies bénéficiaires du libre – échangisme mondialiste ;
- le mur du politiquement correct ;
- le mur médiatique : c'est le plus nouveau par rapport aux anciennes tyrannies car il se présente sous les apparences de la liberté, de la transparence et d'un bien de consommation.
Ces trois murs se renforcent mutuellement: ainsi l'appareil médiatique occidental, principal vecteur du politiquement correct, est largement de nos jours dans les mains des puissances d’argent.
On s'attachera plus particulièrement au mur médiatique.
Le mur médiatique est idéologique : il se présente sous les dehors de l'objectivité (de « l'information ») mais il véhicule une vue du monde particulière qui est celle de la super-classe dirigeante et qui s'articule autour des principaux tabous suivants :
L'idéologie des droits de l'homme ;
La promotion du déracinement et du cosmopolitisme c'est à dire de l'homme réduit à un atome social et sans obligations vis à vis de sa communauté ;
L'égalitarisme et la négation des différences humaines ; Le libre échangisme mondialiste (et les bienfaits de la disparition des frontières et des Etats) ;
La culpabilisation des européens.
Le mur médiatique repose sur un décalage entre le monde réel et celui qui est construit et idéalisé par l'appareil des médias c’est à dire des écrans. Au début (années 1990), ce décalage était relativement limité, mais aujourd'hui il s’est accentué.
Le monde des médias comme celui de la publicité est différent du monde réel.
Le mur médiatique est enfin un filtre qui présente positivement la mise en œuvre de cette idéologie, qui ne donne la parole qu'à ses partisans, qui passe sous silence ses effets déplaisants et qui diabolise ceux qui la contestent.
Les failles du Système : les repérer, les analyser, les exploiter (2e partie) Intervention de Michel Geoffroy
Polémia poursuit la mise en ligne da la communication de Michel Geoffroy à la Troisième Journée d’étude de la réinformation, organisée par Polémia, le 16 octobre 2010, sur : « Les failles du système, les repérer, les analyser, les exploiter.» Michel Geoffroy souligne ici les similitudes avec le système soviétique.
2e Partie : Les similitudes entre le système mondialiste et le système soviétique
Bien qu’il ait été mis en place après la chute du communisme en Europe, le Système présente un certain nombre de similitudes avec le système soviétique :
1. une oligarchie dominante : la super classe mondiale ;
2. une concentration des pouvoirs : politiques, économiques, culturels et médiatiques ;
3. une idéologisation omniprésente de la réalité : au travers du filtre médiatique ;
4. un système qui repose sur la contrainte (mais non physique) :
- la censure politiquement correcte des opinions, la réduction de la souveraineté des Etats ;
- la peur de perdre son emploi pour un nombre croissant d'occidentaux, c'est à dire la menace de la mort économique ;
- le développement du contrôle social au nom de la sécurité (« lutte contre le terrorisme ») ;
- la menace économique et militaire (ex. le chantage des multinationales en cas de second vote négatif des Islandais, faire revoter quand le résultat ne convient pas).
Un système utopique
La principale similitude tient au fait que ce système repose sur l'utopie.
L'accent mis sur la rationalité économique ne doit pas faire oublier que ce Système repose sur l'utopie (hérésie) du gouvernement mondial et de l'unification du genre humain : c'est-à-dire sur une dérivée de l'utopie égalitaire et comme telle condamnée par le mouvement de la vie et par l'épreuve des faits. Il repose aussi sur l'utopie du contrôle total (par une petite minorité éclairée: la super classe mondiale).
Au surplus l'utopie du système est incohérente entre ses différentes composantes, à la différence du marxisme qui était un bloc.
Exemples :
– elle prône la négation des races mais veut le métissage et elle reconnaît l’identité noire ;
– elle diabolise la promotion de l’identité européenne sous le nom de racisme, mais elle favorise tous les autres communautarismes ;
– elle adopte une attitude incohérente vis à vis de l'Islam : elle l'instrumente dans l'immigration comme moyen d'affaiblir les Européens (après l'avoir instrumenté contre l'Union Soviétique). Mais elle prétend aussi le combattre sous le nom d'intégrisme (alors que beaucoup de musulmans perçoivent la mise en cause de l'intégrisme avant tout comme une atteinte contre leur religion).
Enfin cette utopie est d’autant plus fragile qu’à la différence de l'URSS le Système ne peut se fonder sur des succès visibles (comme la victoire sur l'Allemagne, l'industrialisation, la puissance militaire, la sécurité sociale ou la conquête spatiale pour l’URSS) qui contribueraient à le conforter dans le cœur de la population.
Son seul succès est négatif : il découle justement de l'échec du communisme comme alternative au capitalisme (c'est la fin de l'histoire selon Fukuyama : le libéralisme vainqueur par KO).
Mais en fait le Système a hérité de l'abondance matérielle qui a été construite antérieurement à sa mise en place et fondée sur des principes différents du sien. En outre il ne peut pas vraiment la garantir dans la durée pour les Européens.
Parce qu'il repose sur l'utopie comme l'Union soviétique, le Système est condamné, comme elle, à disparaître. Le Mur médiatique tombera comme est tombé le mur de Berlin et pour les mêmes raisons : les réalités viendront à bout de l'idéologie !
Un système contredit par les faits
Le Système est donc susceptible d'être contredit en permanence par les faits, comme le marxisme.
Nous vivons justement dans une période où les promesses et les mensonges du Système apparaissent de plus en plus sous leur vrai jour. Nous vivons en effet aujourd'hui à l'âge des conséquences : c'est à dire de la découverte par le plus grand nombre des conséquences fatales, et surtout de plus en plus désagréables, des politiques qui ont été mises en œuvre au cours du dernier quart du XXème siècle dans le monde occidental et qui ont justement donné naissance au Système dans lequel nous vivons et dont les effets pervers apparaissent de plus en plus. C'est ce qu'en langage médiatique on nomme une « crise ».
L'âge des conséquences est donc l'âge des crises, c'est à dire la découverte des différentes impasses dans lesquelles on nous a conduits et dont nous ne pourrons plus sortir que dans la douleur et sans doute aussi dans l’affrontement. L'âge des crises est donc aussi l'âge de La violence qui vient, (Eric Pougin de La Maisonneuve, Général de division, Arléa, 1997), c'est à dire celui de l'histoire dont les occidentaux avaient oublié un peu vite le côté tragique et conflictuel.
Cinq impasses majeures qui sont aussi cinq crises :
– l'impasse de la dénatalité européenne ;
– l'impasse de l'immigration africaine et musulmane de peuplement en Europe ;
– l'impasse de la supranationalité européenne et de la prétendue gouvernance mondiale ;
– l'impasse du libre–échangisme mondialiste ;
– l’impasse de l’idéologie compassionnelle des droits de l’homme ; mais il y en d'autres !
L’âge des conséquences L'âge des conséquences (des « crises ») contribue donc à ébranler de plus en plus le mur médiatique sur lequel repose le Système.
Il est très difficile de lutter contre les croyances idéologiques car elles ne reposent pas sur la raison.
Les faits historiques et sociaux sont rarement perceptibles au plus grand nombre (qui se préoccupe avant tout du court terme).
Des échecs n'affaiblissent pas enfin immédiatement une idéologie : ils peuvent au contraire conduire
– à sa radicalisation : exemple l'échec de la doctrine de « l'intégration » des immigrés débouche sur « la discrimination positive » c'est à dire encore plus d'intégration ;
– au phénomène de la NEP (Nouvelle politique économique, un système économique établi par Lénine en 1921, NDLR) : admettre provisoirement une entorse au dogme pour survivre politiquement et continuer de plus belle ensuite.
C'est en réalité l'expérience personnelle contraire qui conduit à remettre en cause une idéologie, qui est une croyance : comme circuler en Trabant sur les autoroutes allemandes et se faire dépasser par les BMW et les Mercedes, conduit à douter de la supériorité du socialisme !
L’information existentielle dément l’information mimétique
Le discours dominant pouvait avoir une certaine crédibilité tant que ses effets collatéraux restaient d'une ampleur limitée (les chiffres de l'immigration, du chômage et de l’insécurité en 1981 sont sans commune mesure avec ceux d'aujourd'hui), tant que ceux qui les subissaient restaient peu nombreux au regard de la population et tant qu'il était possible d'occulter certains faits.
Mais aujourd'hui ce n’est plus le cas : les commandements de l'idéologie dominante se trouvent contredits par l'expérience personnelle d'un nombre croissant de personnes.
Ainsi par exemple, la présentation compassionnelle de l’immigration, qui est le discours de l’oligarchie, est de plus en plus décalée par rapport à l’expérience personnelle des Européens de souche :
– il suffit de sortir dans les rues, de mener ses enfants à l'école publique, de fréquenter l'hôpital ou la sécurité sociale, d'aller dans une grande surface (produits hallal) ou de prendre les transports en commun pour mesurer la progression rapide de l'africanisation et de l'islamisation ;
– un nombre croissant de français ont donc le sentiment de ne plus vivre dans le même pays tout simplement parce que le nombre d'immigrés a cru très sensiblement (et bien au delà du discours officiel). Les violences et dégradation urbaines sont aussi plus visibles car tout simplement plus massives (ex émeutes du ramadan 2005). De même l'islam devient plus visible à mesure que la population musulmane augmente.
Ces expériences journalières frappent de contradiction l'idéologie compassionnelle de l'immigration ; elles montrent :
– qu'il y de plus en plus d'endroits où les « minorités » sont en majorité ; – que toutes les personnes d'origine immigrée ne sont pas animées d'un amour sans borne pour la France et les Français ;
– que des Noirs revendiquent dans l'espace public leur négritude (CRAN) et que les musulmans leur islam, au lieu de chercher à se fondre dans l'identité française.
Il s'agit là d’un phénomène de longue durée: il y a accumulation de perceptions qui finissent par créer une conviction contraire au dogme dominant.
Les failles du Système : les repérer, les analyser, les exploiter (3e partie) Intervention de Michel Geoffroy
Polémia poursuit la mise en ligne da la communication de Michel Geoffroy sur : « Les failles du système, les repérer, les analyser, les exploiter. ». Michel Geoffroy traite ici de l’ébranlement du mur médiatique. Et des signaux faibles qu’il convient de détecter.
3e Partie : L’ébranlement du mur médiatique : apprendre à détecter les signaux faibles
L’histoire est comme l’herbe, on ne la voit pas …pousser
L'ébranlement du mur médiatique produit pour le moment des « signaux faibles » Il s'agit encore de « signaux faibles », parce qu'ils sont soit
– dénaturés par le système médiatique quand ils ne sont pas purement et simplement censurés
– les prodromes d'un mouvement qui va s’amplifier. Ce n'est souvent que rétroactivement que l'on peut se rendre compte de leur existence et de leur importance. Car l’histoire est comme l’herbe : on ne la voit pas pousser…
Mais néanmoins ces signaux sont visibles et audibles pour peu qu'on s'efforce de les détecter. Tenter de repérer les signaux faibles procède de la réinformation.
Apprendre à détecter les signaux faibles :
Par définition les signaux faibles ne figurent pas dans les gros titres des quotidiens et ne passent pas au « journal de 20h ». Il faut donc apprendre à les découvrir car ils sont souvent cachés sous le fatras de « l’information » sidérante.
Quelques suggestions
a) Diversifier au maximum les sources d’information :
Comme ces faits sont en général occultés ou dénaturés dans les médias nationaux (qui suivent la ligne fixée par la dépêche de l’AFP et les journaux radiophoniques du matin, qui sont chargés de donner le ton chaque jour), on ne peut les trouver qu’en multipliant les sources.
Exemples :
– Internet : d’après le MRAP le site Fde souche est plus fréquenté que les sites du PS et de l’UMP (Le Monde du 10/3/2010). Voir aussi dans l’affaire Bettencourt le rôle joué par internet (Mediapart) dans la diffusion de certains documents mis en ligne ;
– Les médias étrangers, en général moins censurés qu’en France ;
– Les médias professionnels/ spécialisés, parfois plus prolixes sur certains faits occultés.
b) Apprendre à lire les entrefilets :
C’est généralement là que se trouvent les signaux faibles, puisque ceux ci ne figurent pas dans les gros titres.
Ils comportent souvent des informations intéressantes, en particulier quand elles sont l’écho d’informations étrangères (se reporter alors aux sources qui sont citées dans la dépêche).
On peut se hasarder d’ailleurs à une loi plus générale : la qualité de l’information écrite est inversement proportionnelle à sa longueur.
Souvent certains faits intéressants sont volontairement noyés en effet dans des commentaires longs et contradictoires (c’est d’ailleurs une technique de désinformation). Dans le domaine audio-visuel c’est plutôt la loi inverse qui s’applique : plus c’est court plus le risque de déformation est grand (images choc, interview coupées, petites phrases etc.)
c) Savoir utiliser la boussole à indiquer le sud :
Certaines informations doivent en effet être lues à l'envers pour trouver la vérité, comme en Union soviétique ! Cela implique de savoir décoder le langage médiatique ;
Exemples :
– un vocabulaire dévalorisant/inquiétant pour désigner un mouvement, une manifestation ou des idées (populiste, xénophobe, islamophobe, raciste, extrémiste, ultra nationaliste, dangereux, dérapage, tollé, etc...). Ce vocabulaire signifie au contraire que ces idées/mouvements/actions ne sont pas extrémistes mais populaires; c'est à dire qu'ils rencontrent un écho certain dans la population autochtone. Il s’agit de faits dénaturés par le système médiatique pour leur donner une autre signification plus conforme à l'idéologie dominante : en général leur polarité est donc inversée puisque le système repose sur le renversement des valeurs.
– a contrario, quand la tonalité est positive, c’est vraisemblablement qu’on est en présence de comportements ou d’idées politiquement corrects : ce sont donc des informations suspectes (mises en scène) ; Exemple : la façon très souvent positive dont les délits commis par des personnes d'origine immigrée ou de religion musulmane sont généralement traités dans les médias (pour qu'ils restent toujours dans le statut de victime) ; en fait ces informations respectent un code médiatique que l’on peut aisément décrypter ;
– idem quand les médias mettent en scène des informations sur un mode spectaculaire/émotionnel. Exemple : David Pujadas recommandant sur France 2 d’écarter les enfants lors de la diffusion d'un reportage censé représenter la répression en Iran par de… fausses images du Honduras en décembre 2009) ; c’est le signe d’un emballement médiatique, c’est à dire en général d’une manipulation
d) Savoir détecter les faits qui n’en sont pas
Dire que Nicolas Sarkozy « veut » ceci ou cela, c’est une intention qui n'est pas une action ; une action ne produit pas nécessairement le résultat escompté ou ne débouche pas nécessairement
Exemples :
– une loi peut ne pas être appliquée (s'il n'y a pas de décret, ou de circulaire) ;
– voir aussi la promotion bruyante des Etats généraux et Assises les plus divers qui, en général, ne conduisent à aucune révolution… ;
– la mise en scène de la volition gouvernementale doit se lire en creux : il y a donc bien une « crise » (que l'on ne parvient pas à résoudre) de l’insécurité, du chômage, de la précarité, de l’immigration etc.
e) Mettre les faits en perspective
Il suffit d’un papier et d’un crayon (ou d’un micro ordinateur !)
Le système médiatique repose sur la succession incessante des informations et l'orchestration du spectaculaire à court terme. C'est en faisant un arrêt sur image à chaque fois et des comparaisons temporelles que l'on voit apparaître des choses que le système veut cacher. Car le système use de la méthode de « la grenouille ébouillantée ». Les signes faibles ne bénéficient pas en outre de l'effet d'orchestration, à la différence des faits politiquement corrects : il faut donc une mise en perspective pour comprendre leur signification et leur dimension
Exemples :
– la mise en perspective des chiffres : les chiffres successifs des prévisions de croissance revus à la baisse montrent la dégradation de la conjoncture ou la succession des crises « maîtrisées », les bons résultats en matière de sécurité ou les chiffres d'expulsions… un mois donné ;
– la mise en perspective des mots ; voir, par exemple, la façon dont on rend compte du terrorisme islamique en Russie et en Occident ou, plus simplement les commentaires sur le chômage : « le chômage reculera dans les semaines ou les mois qui viennent » ( N.Sarkozy, les Echos du 26/1/10), « le chômage va continuer d’augmenter au moins jusqu’à mi-2010 » (F.Fillon le BQ du 26/2/10), « pas de baisse du chômage avant 2012 selon pôle emploi » (Les Echos du 24/3/10) ;
– la mise en perspective des données : c’est elle qui permet de se rendre compte du renforcement permanent de l’arsenal répressif en France depuis 20 ans.
Cette mise en perspective permet :
– de mettre en lumière des évolutions ;
– de faire apparaître des contradictions dans le discours dominant (c'est donc le signe d’un malaise au sein du Système).
Les failles du Système : les repérer, les analyser, les exploiter (4e partie) Intervention de Michel Geoffroy
Polémia poursuit la mise en ligne da la communication de Michel Geoffroy sur : « Les failles du système, les repérer, les analyser, les exploiter ». Michel Geoffroy traite ici des fissures du monde médiatique Et de l'apparition d'une dissidence politique et sociale croissante en Occident et notamment en Europe
4e Partie : Les fissures du mur médiatique : La montée de nouvelles dissidences
La dissidence « passive »
Il s'agit de signes « passifs », puisque ces manifestations de dissidence n'ont pas réussi à infléchir durablement le système pour le moment, même si elles traduisent une évolution en profondeur de l'opinion. C’était la plus ancienne forme de dissidence :
– le vote pour les mouvements et partis qualifiés de « populistes », d' « extrême-droite », donc de partis qui se posent en rupture avec le système : il concerne désormais la plupart des pays européens, avec des résultats tangibles au plan municipal ou provincial (exemple à Vienne avec 27% pour le FPÖ lors des élections du 10/10/10, soit plus 12 points par rapport à 2005) ;
– la progression de l'abstention aux élections (exemple les élections européennes où le taux d’abstention est passé de 39 à 57% en 30 ans)
– le décalage entre les opinions exprimées dans les sondages et les positions de la super-classe dirigeante (« majorité silencieuse) (2)
La dissidence « active »
Le fait nouveau est que la dissidence passive cède de plus en plus la place à des manifestations plus « actives » désormais.
D’abord les partis populistes finissent par exercer une influence politique directe au plan national: c’est par exemple le cas au Pays Bas, après l’Italie (intégration de la Ligue du nord et de l’alliance nationale dans Forza italia) ; au Danemark avec une participation au gouvernement libéral conservateur; en Suède où la présence de « l'extrême droite » empêche la droite institutionnelle de constituer une majorité sans elle (ou alors avec la gauche).
Ensuite, on assiste à les actes de révolte populaire directe contre l'établissement politique qui se multiplient :
Exemples :
– les manifestations pro-vie en France (censurées par les médias) ;
– les apéros saucisson en France (réprimés....) ;
– la révolte des habitants de Stuttgart contre les projets de reconstruction de la gare ou de modification de la durée de la scolarité dans le primaire ;
– la votation suisse contre les minarets de novembre 2009 ;
– la mobilisation contre la construction d'une mosquée au « ground zero » à New york (manifestations aussi contre la construction de mosquées en Allemagne) ;
– le mouvement des tea party aux Etats Unis qui bouscule autant les caciques du parti républicain que les démocrates
– la crise belge et le développement du discours séparatiste (concernait avant l'Europe du sud principalement)
– la montée des préoccupations écologistes traduit aussi en partie un phénomène de révolte populaire des primo-occupants contre le bouleversement de leur environnement : mais c'est d'ailleurs pourquoi elle a été récupérée en partie par le Système et instrumentée pour contrer le vote « populiste »
La revanche asymétrique des « petits » et des mal-pensants
Ce type de dissidence présente un certain nombre de caractères remarquables :
a) Auparavant ces phénomènes de dissidence étaient cantonnés à l'univers idéologique de la gauche et de l'extrême gauche (exemples: les appels en faveur des immigrés en situation irrégulière, mouvements contestataires divers, squats etc.…). Le fait nouveau est qu'il exprime désormais des préoccupations dites « de droite » : identitaires, conservatrices, chrétiennes ou reprises à la « gauche », régionalistes et localistes (en Italie la Ligue du Nord ou en Belgique les partisans de la partition) ;
b) Dans beaucoup de ces cas il s'agit d'une mobilisation des autochtones ;
c) Elle prend l’établissement à contrepied car elle ne s'effectue pas sur le registre institutionnel habituel (syndical par exemple). Elle utilise aussi des outils nouveaux de mobilisation (internet, réunions surprises). En outre elle aboutit souvent à faire reculer les pouvoirs établis (qui en général se sont prononcés, eux, favorablement pour les projets contestés). Des résultats sont obtenus, malgré une mobilisation hostile des médias et d’une façon générale des pouvoirs institués, c'est à dire de l'oligarchie dominante ;
d) Cette contestation contribue à dépasser les classifications politiques traditionnelles ;
e) Il s'agit de la revanche asymétrique des petits contre le Système, de la périphérie contre le centre. On ne reviendra pas sur le fait que la mobilisation via internet a permis plusieurs fois de contourner le carcan médiatique et de faire reculer le Système en France (exemple : la nomination de Jean Sarkozy à l'EPAD ou les révélations sur l'affaire Betancourt) : cet outil asymétrique redonne donc du pouvoir et de l'initiative aux "petits" , aux exclus du système médiatique, à ceux qui sont en bas (cf. A Touraine : « Les grands mouvements qui peuvent changer notre vie collective viennent d’en bas ». Le Monde des 5 et 6 septembre 2010)
Voir aussi l'effet de la « menace » du pasteur Terry Jones de « brûler le coran » comme moyen de faire pression sur le gouvernement américain contre le projet de Mosquée à « Ground Zero » Ce sont les réponses à la super classe mondiale qui voulait au contraire révolutionner la société par le haut, grâce à la concentration de tous les pouvoirs ;
f) Ces réponses sont souvent associées à un discours « de classe » visant spécifiquement la nouvelle classe dirigeante qui ne comprend pas les préoccupations de la population autochtone et qui vit dans un monde privilégié ;
Exemples en France : la contestation du bling-bling et la mise en lumière des liens entre politiciens et affairistes ;
g) Elles ont tendance à se multiplier. Le caractère assez général de ces manifestations donne à penser qu'elles peuvent déboucher un jour sur un bouleversement politique durable
L’usure rapide de l'image des équipes politiques mises en place par le Système :
– Le cas emblématique de Nicolas.Sarkozy : une dégradation très rapide (2 ans ) et pour la première fois le Premier ministre a eu une image plus favorable que celle du président. Phénomène inconnu jusqu'à présent.
– L'usure de l'image du messie Obama (selon un sondage Gallup les républicains bénéficieraient d'un avantage de 10 points devant les démocrates aux prochaines législatives : un écart jamais vu à mi-mandat depuis 1942, Bulletin quotidien du 2/9/10).
– Le dégonflement de l'image du libéral-démocrate Nick Klegg en Angleterre (12% de sympathies en aout soit la moitié par rapport à celles des élections du 6 mai 2010 : Bulletin quotidien du 2/8/10)
Ces phénomènes expriment le fait que l'hyper médiatisation ne suffit plus à assurer le soutien de la population : ce qui veut dire que le spectacle ne suffit plus à contenir la réalité ; l'opinion est de plus en plus sensible aux faits .
La libération de la parole à l'encontre des commandements de l'idéologie dominante
Ce phénomène est remarquable car il touche les fondements idéologiques du Système et alors que ce dernier a mis en place ces dernières années un appareil répressif très développé : mais manifestement cela ne suffit plus. Bien sûr il est encore limité : tous les tabous ne sont pas remis en cause mais ce qui frappe, c'est le fait qu'il touche aussi des membres de l'oligarchie et non pas seulement des « extrémistes » déjà diabolisés par le système:
Exemples :
– Les propos de Eric Zemmour sur la délinquance des personnes d'origine étrangère (non sanctionné mais a failli l'être) ; voir aussi les propos de l’avocat général de la cour d’appel de Paris Philippe BILGER – également rappelé à l’ordre – (Bulletin quotidien du 26/3/10) ;
– Les propos du Préfet Girod de Langlade sur l'africanisation de l'aéroport de Roissy (sanctionné) ;
– Les propos du ministre de l'Intérieur sur la délinquance des « roms » ;
– Les propos de Thilo Sarrazin (de la Bundesbank) sur l'islamisation en Allemagne (sanctionné). Il a reçu de nombreuses manifestations de soutien : 18% des allemands déclarent être prêts à voter pour un parti dont il serait le chef (Les Echos du 6/910). Ses propos ont été repris en partie par la CSU de Bavière (Horst Seehofer, Le Monde du 12/10/10) ;
– Les récentes publications de M.Triballat sur l'immigration ;
– Les travaux de Hugues Lagrange (Le déni des cultures, éditeur : Seuil 16 septembre 2010, 350p..) qui note la sur-représentation des jeunes issus de l’Afrique sahélienne dans les affaires de délinquance
– Les propos du cardinal Kasper (l’aéroport de Londres donne le sentiment que l’on arrive dans un pays du tiers monde)
Ces propos montrent qu'il est de plus en plus difficile de cacher certaines réalités (exemple : la progression de l'immigration africaine), même les privilégiés les constatent !
Les failles du Système : les repérer, les analyser, les exploiter (5e partie et conclusion) Intervention de Michel Geoffroy
Polémia met cette fois en ligne la 5e et dernière partie de l'importante communication de Michel Geoffroy sur : « Les failles du système, les repérer, les analyser, les exploiter », prononcée lors de la Troisième Journée d’étude de la réinformation organisée par Polémia le 16 octobre 2010. Michel Geoffroy traite ici de l’apparition de nouvelles lignes de fracture sociale : jeunes/seniors, jeunes autochtones et jeunes allogènes, paupérisation des classes moyennes salariées en Europe.
5e Partie et Conclusion Les fissures du mur médiatique : l’apparition de nouvelles lignes de fracture sociale
La fracture jeunes/seniors :
Entre la France qui travaille et celle qui profite des transferts sociaux :
* – les jeunes seront moins riches que leurs aînés du fait de la crise des systèmes de retraite et de la désindustrialisation ;
* – les adultes de 25/54 ans assurent en France 79% des emplois, alors qu’ils représentent 41% de la population.
On mesure cette fracture dans les sondages : les seniors ont par exemple une opinion beaucoup plus positive de Nicolas Sarkozy que le reste de la population (ex. sondage IFOP/Paris match : 49% des français reconnaissent l'action du président en matière de lutte contre l'insécurité , mais 69 % des seniors : le Bulletin Quotidien du 9/9/2010). Même si sa bonne image chez les seniors tend à diminuer.
La fracture entre jeunes autochtones et jeunes allogènes
Exemples :
– les phénomènes d'émeutes et de violences contre les jeunes blancs (ex manif du CPE de mars 2006) ;
– la fracture entre les bénéficiaires de la discrimination positive et ses victimes ;
– les jeunes issus de l’immigration ont un taux d'activité inférieur à celui des jeunes autochtones.
cf. les sondages :
– la majorité des jeunes Italiens se déclarent hostiles aux étrangers (étude de la Chambre des députés Les Echos du 19/2/10);
– 54% des Russes soutiennent le slogan « la Russie aux Russes » (Sondage Levada AFP du 25/2/10);
– 45,8% des jeunes français de 18 à 29 ans expriment une forme d’hostilité envers les étrangers selon l’institut SWG (AFP du 18/2/10);
– les 16/18 ans ont voté à plus de 50% pour les partis populistes en Autriche en 2008.
Cela traduit le fait que les Européens de souche découvrent qu'ils sont en réalité les victimes et non les bénéficiaires du Système.
Le Système se heurte aussi à l'Islam qui est une religion qui produit des effets comparables à ceux d'une idéologie, car elle ignore la distinction entre le temporel et le spirituel. C'est aussi une religion à vocation universaliste mais qui repose sur des principes différents de ceux du Système. Le développement de l'immigration musulmane contribue ainsi à accentuer les oppositions au Système en Europe, car l'islamisation renouvelle la question de l'immigration.
On notera que ce virage de la jeunesse européenne est occulté par le Système qui continue de véhiculer une image « soixante-huitarde » et « touche pas à mon pote » des jeunes.
La paupérisation des classes moyennes salariées en Europe :
Le déclassement de la classe moyenne autochtone (phénomène déjà rencontré dans les pays anglo-saxons, alors que les « minorités » bénéficient d'une attention privilégiée de la part des pouvoirs publics) est encore plus ressenti dans les jeunes générations.
Car les riches sont devenus plus riches du fait de la mondialisation (par exemple, de 2004 à 2007 le nombre de personnes gagnant plus de 500 000€ a augmenté de 70% (Les Echos du 2/4/2010) et les « défavorisés » ont changé de nature : soit ils se sont enfermés dans des trappes d'inactivité, soit ce sont avant tout des immigrés extra-européens bénéficiaires de prestations sociales qui ne sont donc pas dutout « défavorisés ».
Il y a de nombreux signaux faibles de la paupérisation : la multiplication des magasins discount, les « petits pleins » aux stations-service, le déclassement relatif des enfants par rapport à leurs parents, l’accession à la propriété plus difficile, la progression du surendettement (+ 20% en 2 ans), les fermetures de commerces autochtones.
A relever également que dans un certain nombre de pays touchés par la crise financière les manifestations – souvent violentes – des victimes autochtones, contre les représentants de l’oligarchie ; c’est le cas de la Grèce, de l’Islande… (pourtant traditionnellement tranquille).
C’est le grand retournement par rapport à ce qui s’est produit dans la seconde partie du XXème siècle où l’éventail des revenus s’est réduit.
C'est aussi un signe manifeste de l'échec de l'oligarchie dominante à assurer l'abondance matérielle pour tous (comme le communisme n'a pu assurer le règne de l'égalité et le dépérissement de l'Etat).
Cet échec atteint le cœur du Système.
Conclusion
Aujourd’hui l’expérience directe du plus grand nombre montre :
– que l'adhésion au Système et à son idéologie est loin d'être totale dans les pays occidentaux. Cela veut dire que ceux qui s’opposent au Système ne sont plus des marginaux, mais une majorité en formation ;
– que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être parfait Cela fait apparaître encore plus insupportable ou ridicule le « monde parallèle » du système médiatique ;
– que la super-lasse mondiale maîtrise de moins en moins la situation Cela veut dire qu’elle perd progressivement sa légitimité de classe super-compétente (son seul atout).
Ces différentes prises de conscience sont susceptibles d'avoir des effets politiques à long terme en Europe même s'il est difficile de prévoir quand le Système implosera ni quelle forme cela prendra.
Mais contrairement à ce que prétendent les historiens, les bouleversements politiques sont en général imprévisibles. Ce n'est qu'a posteriori que l'on reconstruit le caractère prétendument « inéluctable » des événements.
L’histoire est le lieu de l’imprévisible comme l’écrit Dominique Venner !
Michel Geoffroy Troisième Journée d'étude de la réinformation
Polémia 26/10/2010
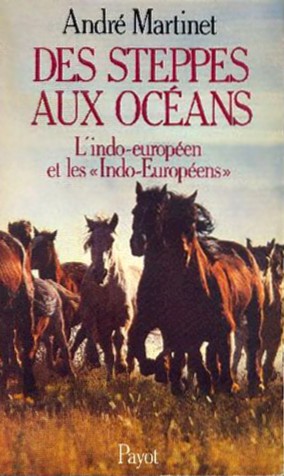 Des Steppes aux océans surprendra ceux qui ne connaissent l’auteur [André Martinet] que par ses travaux de linguistique pure. Mais les spécialistes ne seront pas surpris par son contenu que résume le sous‑titre L’indo‑européen et les “Indo‑Européens”. Déjà, son Économie des changements phonétiques (Berne, Francke, 1955) apportait à la reconstruction du système phonologique indo‑européen une importante contribution sur des points essentiels.
Des Steppes aux océans surprendra ceux qui ne connaissent l’auteur [André Martinet] que par ses travaux de linguistique pure. Mais les spécialistes ne seront pas surpris par son contenu que résume le sous‑titre L’indo‑européen et les “Indo‑Européens”. Déjà, son Économie des changements phonétiques (Berne, Francke, 1955) apportait à la reconstruction du système phonologique indo‑européen une importante contribution sur des points essentiels.
Parurent ensuite plusieurs études consacrées à la reconstruction morphosyntaxique ; les principales sont réunies, à côté des études de phonologie diachronique, dans son Évolution des langues et reconstruction (PUF, 1975). Les études indo‑européennes ne constituent pas une discipline autonome ; l’indo‑européen n’est que l’un des domaines de la linguistique. Assurément, les techniques de la reconstruction diffèrent considérablement de celles de la description, mais la base est commune. Quel que soit leur âge, les systèmes linguistiques, répondant aux mêmes nécessités, obéissent aux mêmes lois. C’est pourquoi, en l’absence de données nouvelles (rien d’essentiel ne s’est ajouté depuis le déchiffrement du hittite en 1917), la reconstruction de l’indo‑européen a pu progresser considérablement ces dernières décennies : ses progrès ont suivi ceux de la linguistique. Initiateur des études linguistiques modernes dans notre pays, A. Martinet était donc particulièrement bien placé pour contribuer au renouvellement de la reconstruction de l’indo‑européen.
Le spécialiste s’intéressera donc en priorité aux chapitres IX (Le système phonologique) et X (La grammaire) ; il y trouvera l’essentiel de l’apport “fonctionnaliste” à la grammaire comparée ; l’interprétation phonologique de la théorie laryngale (p. 141‑159), la question de la “voyelle unique” (p. 137‑140 et 159‑160), celle des séries d’occlusives (p.160-166). Rappelons à ce propos que la “théorie glottalique” des Soviétiques Ivanov et Gamkrelidze, qui substitue aux sonores simples (*d, *g, *gw) de la reconstruction traditionnelle les sourdes glottalisées correspondantes est sortie d’une observation d’A. Martinet dans son Économie des changements phonétiques, l’absence d’une labiale sonore *b. Inexplicable s’il s’agit du partenaire sonore de *p, cette absence est au contraire naturelle s’il s’agit d’une série glottalisée, où l’articulation labiale est rare. L’innovation la plus remarquable est l’hypothèse de l’existence en indo-européen de prénasalisées, *nt *mp, etc., expliquant des faits restés jusqu’à présent sans explication tels que la coexistence de désinences en *bh et en *m à certains cas obliques du pluriel et du duel, et jusqu’à l’alternance *r/*n.
Au chapitre de la grammaire, on relève notamment une approche nouvelle de la théorie de l'“ergatif indo-européen” qui sous‑tend l’ensemble ; une théorie sur l’origine du féminin (p. 188‑192) ; des observations sur les cas (p. 192‑200), les pronoms (p. 200‑204), les adjectifs (p. 203‑204), les numéraux (p. 204‑205), le verbe, considéré dans ses rapports avec le nom, dont il est issu (p. 205‑228) ; et, pour finir, l’auteur nous ramène à l’ergatif avec les neutres en *‑o‑m (p. 228‑229). Voilà un bref aperçu des pages qui retiendront le plus l’attention des spécialistes, et, naturellement, susciteront bien des discussions, tant elles ouvrent de perspectives nouvelles.
Mais ce ne sont pas ces 2 chapitres, inévitablement techniques et quelque peu austères, que le grand public goûtera le plus ; sagement, l’auteur les a rejetés vers la fin de l’ouvrage, les faisant suivre d’un chapitre sur le vocabulaire dans lequel il dévoile un aspect moins connu de son talent : celui de pédagogue et de vulgarisateur. Les principaux acquis de la “paléontologie linguistique” (les indications tirées du vocabulaire reconstruit pour la reconstruction des réalités) y sont présentés avec une grande clarté et accompagnés de parallèles familiers qui mettent le profane en pays de connaissance.
C’est ce même talent qui rend aisée, agréable, la lecture des premiers chapitres, consacrés au peuple indo‑européen, et en particulier aux hypothèses sur leur habitat primitif et leurs migrations. Ici, le linguiste sort de son domaine propre. Mais s’il le fait, c’est poussé par l’objet même de son étude. Les langues n’ont pas leur fin en elles-mêmes ; elles n’existent que par leurs locuteurs et pour eux. Or, plus leurs locuteurs diffèrent de l’Occidental contemporain, plus il nous est nécessaire de définir le cadre physique, social, spirituel, de sa vision du monde. Comme on le répète chaque année aux linguistes débutants, les langues ne sont pas des nomenclatures ; chaque langue représente une organisation spécifique de l’expérience humaine, qu’elle transmet aux générations successives. Ce faisant, le linguiste ne sort donc pas de son rôle, et ne se borne pas à enregistrer les indications fournies par d’autres disciplines. Comme l’indique excellemment l’auteur, « Les idées que les hommes se font du monde dans lequel ils vivent sont, dans une large mesure, dépendantes des structures linguistiques qu’ils utilisent pour communiquer leur expérience » (p. 229). Et c’est encore le linguiste qui, à partir de ses reconstructions dans le domaine du lexique notamment (désignations de plantes, d’animaux, etc.) détermine quels types de sites archéologiques sont susceptibles d’être retenus comme susceptibles de correspondre au dernier habitat commun des locuteurs dont il reconstruit la langue.
C’est alors qu’il doit sortir de son domaine propre, et donc redoubler de prudence. Ce que fait l’auteur, qui s’inspire de la conception la plus largement acceptée de nos jours, celle d’un habitat indo‑européen dans la région dite des Kourganes, en Ukraine. Cette conception, qui remonte à Otto Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 1883, a été reprise, étayée de nouveaux arguments, par Marija Gimbutas et son école. Assurément, ce n’est pas la seule possibilité ; Lothar Kilian a donné de bons arguments en faveur d’un habitat dans les régions baltiques et le nord de l’Allemagne, sur le territoire de la civilisation des gobelets en entonnoir dans Zum Ursprung der Indogermanen, Dr Rudolf Habelt GMBH, Bonn, 1983. Et il s’agit seulement du dernier habitat commun ; la formation de l’ethnie peut s’être effectuée ailleurs. Mais le témoignage de la paléontologie linguistique ne renseigne guère sur ce sujet. On sait d’autre part qu’en matière d’archéologie, et surtout d’archéologie préhistorique, nos certitudes sont toujours provisoires ; elles sont à la merci d’une fouille nouvelle, ou d’une découverte fortuite.
Tout au long de son livre, l’auteur présente les Indo-européens comme une réalité vivante et parfois comme une réalité actuelle : « La conquête du monde par les peuples de l’Occident a été longtemps ressentie comme étant dans la nature des choses. C’est au moment où elle rencontre des remises en question et des résistances efficaces que l’on commence à prendre conscience de la particularité du phénomène. En dépit de péripéties diverses de conflits internes qui culminent aujourd’hui avec l’opposition des 2 blocs, il s’agit bien d’une même expansion qui se poursuit depuis quelque six mille années » : ce texte reproduit en couverture résume l’essentiel, qui est la continuité entre ces migrations qui se sont succédé depuis le IVe millénaire et la situation actuelle du monde.
Que les Indo‑Européens aient — comme l’indique l’auteur dans la suite de ce texte — « mis leur supériorité technique au service de la violence pour subjuguer leurs voisins de proche en proche » n’a certes rien d’original. Plus que la raison, la violence est la chose du monde la mieux partagée. Mais ce qui, de fait, est propre aux peuples indo‑européens, c’est la supériorité technique. Non au départ : sur bien des points, en particulier dans le domaine agricole, leurs techniques étaient très primitives, et en retard sur celles de peuples contemporains. Mais à l’arrivée, puisque, à la seule exception du Japon, l’ensemble du monde industrialisé et développé parle aujourd’hui une langue indo‑européenne.
♦ André Martinet, Des Steppes aux océans, Payot, 1986.
Jean Haudry, La Quinzaine Littéraire n°478, janv. 1987. http://www.archiveseroe.eu