Le 10 novembre 1975, l'ONU votait une résolution qui fit scandale car elle "décrétait" que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ». À cette occasion, le grand écrivain et critique Pierre Gripari (1925-1990) nous donna une tribune libre qui fut publiée dans notre n° du 20 novembre 1975 mais qui, trente-cinq ans plus tard, mérite d'autant plus d'être méditée que cette résolution onusienne n° 3379 est restée lettre morte. Depuis 1975, l'Etat hébreu n'a cessé d'aggraver le sort des Palestiniens si bien que les problèmes qui se posaient alors sont plus aigus que jamais.
Il ne faut pas se leurrer : pour quiconque a la tripe historique, le racisme n'est pas une exception, ni un scandale, ni une monstruosité : il est la nature même, la plus ancienne religion du monde. La « religion naturelle » n'est pas, comme le croyait Rousseau, l'adoration d'un dieu unique et universel, commun à tous les hommes c'est au contraire un culte familial. Celui des dieux de la tribu, des grands ancêtres, du héros éponyme, du patriarche mythique.
C'est qu'en effet, quand les peuples commencent à se fixer au sol, les divinités, elles aussi, s'enracinent, deviennent locales, géographiques, propriétaires d'un site. Parallèlement, au lieu de sacrifier les prisonniers, on les fait travailler. C'est le début de l'esclavage, considérable adoucissement des mœurs.
Il se trouve que les Juifs, après avoir amorcé cette évolution, se sont trouvés victimes d'une sorte de blocage qui les a fait régresser au stade primitif. Leur littérature religieuse en témoigne et porte à cet égard une lourde responsabilité : elle est le premier manifeste écrit d'un racisme qui n'est plus le racisme naïf de nos pères les Pithécanthropes, mais un racisme en idéologie.
Ainsi, la loi juive (Deutéronome, chapitre 20) frappe d'interdit toutes les populations palestiniennes comme impures. Elles doivent être exterminées, sans distinction d'âge ni de sexe, leurs villes rasées, tout le bétail détruit. Interdiction pour les Hébreux de faire des prisonniers, de s'approprier du butin, d'emmener des esclaves. Et ce génocide rituel n'est pas présenté comme un effet de la barbarie des mœurs : c'est Dieu lui-même qui en donne l'ordre, et qui en revendique hautement la responsabilité ! Tout manquement est sanctionné par un retrait de la grâce divine. C'est ainsi que Saül perdra son trône pour avoir laissé vivre le roi d'Amalek et s'être adjugé les meilleures têtes de son bétail (I Samuel).
Le plus drôle de l'histoire, c'est que ces récits de massacres (Deutéronome, Josué, etc.) sont mensongers. Tous les archéologues sont d'accord là-dessus : il semble bien que la pénétration des Beni-Israël en Palestine se soit effectuée d'une façon relativement pacifique et, dès l'époque de Salomon, il n'y avait déjà plus de « race juive ». Bien plus, les dieux cananéens étaient adorés concurremment avec le Dieu de Moïse, au grand déplaisir des prophètes et des sacrificateurs du Temple... Enfin l'hébreu lui-même, la langue hébraïque, n'est pas autre chose qu'un dialecte cananéen. On pourrait bâtir une belle théorie en expliquant les malheurs du peuple juif par le fait que sa langue sacrée n'est pas la langue d'Abraham, mais, au contraire, un idiome emprunté à ces affreux Palestiniens frappés d'exécration, abominables aux yeux du Seigneur. La Kabbale, tradition magique fondée sur l'interprétation symbolique des lettres et des mots hébreux, n'aurait été qu'un piège contre le peuple élu !
Donc, les Juifs ne sont pas des Juifs, mais des Cananéens judaïsés, comme les Algériens sont des Kabyles arabisés. Que s'est-il passé depuis ?
Il s'est passé que, malgré les promesses de Moïse, le peuple hébreu ne s'est pas multiplié « comme les sables de la mer » et n'a pas « possédé la porte de ses ennemis ». Après une courte période de semi-indépendance correspondant aux règnes de David (allié des Philistins) et de Salomon (allié des Phéniciens, qui ne sont pas autre chose que les Cananéens de la côte), le royaume se morcelle, tombe en décadence et se trouve finalement annexé à l'empire babylonien.
Les dix tribus du nord perdent bientôt toute personnalité ethnique et leur destin se confond, dès lors, avec celui du peuple de la région. Mais les Juifs, c'est-à-dire les citoyens du royaume de Juda, maintiennent leurs traditions jusque dans l'exil, et c'est là qu'intervient la régression dont je parlais tout à l'heure : les cadres politiques n'existant plus, il ne reste aux prophètes qu'à miser sur le cadre familial, sur le sentiment de la communauté biologique.
Babylone une fois prise par les Perses, les Juifs obtiennent de Cyrus l'autorisation de rentrer à Jérusalem, d'en relever les murs et de reconstruire le Temple (Néhémie, Ezra). C'est alors que le sacrificateur Ezra n'hésite pas à falsifier les Écritures, fait récrire tous les textes - un peu à la manière dont les communistes récrivent l'histoire du Parti chaque fois que la ligne politique a changé - et fonde enfin le judaïsme moderne, avec son obsession de la pureté, sa phobie du mélange et du métissage, son interdiction des mariages interraciaux, sa théorie de l'honneur racial, enfin son apologie du génocide systématique des populations qui ont le mauvais goût d'habiter le Lebensraum du Herrenvolk (l'espace vital de la race des Seigneurs). On se demande bien pourquoi Hitler n'a pas cité l'Ancien Testament au premier rang de ses sources. La référence le gênait peut-être un peu...
Cela se passait il y a plus de trois mille ans. Depuis, nombre de Juifs se sont assimilés aux peuples qu'ils côtoyaient, et à chaque génération, il s'en assimile encore : nous sommes tous des Juifs allemands, et bien autre chose... Le malheur, c'est que le rabbinat, loin de mettre ce temps à profit pour évoluer normalement vers une conception de la divinité moins barbare, a toujours maintenu farouchement la discrimination raciale héritée du calamiteux sacrificateur Ezra.
Vers la fin de l'Antiquité, les Grecs se convertissent au judaïsme. C'est le début du christianisme, qui n'est encore qu'une secte juive. Mais, dès le premier siècle de la nouvelle ère, l'Eglise de Jérusalem, craignant d'être noyée dans la masse des nouveaux convertis, refuse de se mélanger à eux. C'est la querelle entre saint Pierre et saint Paul (Epître aux Galates), c'est la scission, c'est la rupture. Le monde occidental sera judaïsé, puisque christianisé, mais il sera aussi antisémite.
Au XVIIe siècle, Spinoza tente, à son tour, de sortir du ghetto. Sa philosophie est un panthéisme à la fois intellectuel et sentimental, d'un charme indéniable, et son intention avouée est de donner une interprétation universaliste de la religion judéo-chrétienne. Il est immédiatement excommunié par le rabbinat, décrété impur et frappé d'interdit comme un vulgaire Cananéen !
Au XVIIIe siècle en Pologne, en Russie et en Lituanie apparaît la secte des Hassidim, partisans d'une mystique et non sans analogie avec celle de Maître Eckhart : il s'agit pour chaque individu, de réaliser immédiatement, pour lui-même, en lui-même, la venue du Messie, en Esprit et en Vérité. Là encore, opposition rageuse de la Synagogue et disparition de la secte.
Enfin, dernière tentative d'universalisation, le communisme russe. Mais, une fois de plus, après avoir lancé le mouvement, les Juifs refusent de se laisser assimiler, entretiennent l'esprit du ghetto, de sorte qu'aujourd'hui l'URSS est antisémite. En outre, l'expérience marxiste ayant donné ce qu'on sait, les anticommunistes ne le sont pas moins !
Il n'est évidemment pas question de défendre Hitler sur ce chef. Il est parfaitement odieux de persécuter les gens pour une ascendance familiale à laquelle ils ne peuvent rien. Cependant si l'on veut être juste, il faut remarquer deux choses :
1° ) L'antisémitisme n'est pas un « crime gratuit ». C'est, en fait, un contre-racisme, un réflexe de colonisé. TOUT LE MONDE EST COUPABLE, à commencer par ceux qui, par bigoterie ou inconscience élèvent leurs enfants dans les idées de la Torah.
2°) La doctrine léniniste de la lutte des classes est aussi criminelle que la doctrine judéo-nazie de la lutte des races. Dans un cas comme dans l'autre, il y a certes des antagonismes. Mais les résoudre par la suppression physique des "bourgeois", des "koulaks" ou des Juifs n'est qu'une stupidité. Les génocides de classe pratiqués par la racaille léniniste n'ont pas eu d'autre résultat que de remplacer les patrons par le Parti-patron, ce qui n'a rien arrangé, au contraire ! Quant à la culture juive, elle est, qu'on le veuille ou non, une part inaliénable de la culture européenne. Nous vivons sur la Bible et Kafka aussi bien que sur Homère et sur Tolstoï.
Seulement, il faut sortir du cercle vicieux. Depuis trente siècles, racisme juif et antisémitisme se conditionnent l'un l'autre. Je rêve d'un Vatican Il de la Synagogue... Malheureusement, elle n'en prend pas le chemin !
Le véritable danger, c'est Israël.
Je me hâte de préciser que les Israéliens ne sont pas les plus coupables. Que les persécutions hitlériennes aient porté de l'eau au moulin des extrémistes juifs, c'était inévitable. L'aventure sioniste est un mouvement de masse, un mouvement passionnel, que l'on peut déplorer, mais qui est fort compréhensible.
Le malheur, c'est que la fondation de l'Etat juif était un crime et une folie. Et l'ONU, de l'époque (URSS comprise) a fait preuve, en cette occasion, de la même inconscience que Jéhovah lui-même, quand il fit don à son peuple d'une terre déjà occupée.
Après la condamnation du racisme, on fonde un Etat qui ne peut être que raciste, puisque Etat juif ayant sous sa juridiction une population qui n'est juive qu'en partie. Et, au moment où l'on s'apprête à imposer à l'Europe vaincue le largage de ses colonies, on crée un nouveau foyer de colonialisme en laissant s'installer en Palestine une population européenne, avec l'agrément de tout le monde, sauf justement des principaux intéressés : les Palestiniens !
Ceux-ci, comme il fallait s'y attendre, se révoltent, prennent le maquis, et ici intervient encore un troisième paradoxe : après avoir chanté les louanges de la Résistance (alors que, jusque-là, les francs-tireurs étaient considérés comme des criminels de guerre), après avoir flétri les militaires allemands qui luttaient contre elle, les Juifs se voient contraints d'adopter les méthodes nazies, de torturer des terroristes et de pratiquer la répression de masse contre les villages rebelles. Et la liste des Oradours palestiniens s'allonge tous les ans.
Pour bien moins que cela, notre intelligentsia juive n'a pas hésité à tirer dans le dos de nos frères, les Européens d'Algérie. Qu'espérait-elle donc ? Que les Arabes raisonneraient d'une façon à Alger et d'une autre façon, diamétralement opposée, à Jérusalem ? Les Arabes ne sont pas si bêtes ! Etait-ce mauvaise conscience, goût refoulé du suicide ?
Quoi qu'il en soit, le résultat est là : les Juifs ont soutenu le communisme, et le monde communiste est contre eux. Ils ont poussé à la décolonisation, et maintenant le Tiers-Monde est contre eux. Seuls, les dirigeants de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Amérique acceptent encore de leur servir de porte-glaive - je dis bien : les dirigeants, car, pour les peuples, c'est beaucoup moins sûr.
Je passe pour un obsédé parce que, depuis mon premier livre, je reviens sans cesse sur ce problème. Mais l'obsession n'est pas seulement en moi : c'est celle de notre époque. Personne ne le dit vraiment, mais au fond tout le monde le sait : s'il y a une troisième guerre mondiale, ce sera, comme la deuxième, avant tout une guerre juive. Ça vaut tout de même le coup d'y réfléchir...
Le récent vote de l'ONU a l'avantage de poser, pour une fois, la question clairement. Oui, la fondation de l'Etat d'Israël était une agression à caractère colonialiste, oui le sionisme est un racisme, et un racisme encore très modéré, si on le compare au judaïsme orthodoxe !
Je ne prétends pas résoudre la question qui n'est pas de mon ressort. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les protestations hypocrites, les indignations jouées, les mensonges impudents la résoudront encore moins. Si nous voulions sincèrement que tout le monde ait le « droit de vivre », commençons donc par accepter d'y voir clair.
par Pierre GRIPARI
LE STRABISME DU PARLEMENT ARABE
Organe de la Ligue arabe, le Parlement du même couscous qui s'est réuni trois jours au Caire a appelé le 29 décembre « le peuple suisse à reconsidérer sa décision erronée » d'interdire les minarets, ce qui « traduit les sentiments de haine et d'animosité envers l'islam et les musulmans qu'éprouvent les groupes de la droite extrémiste et raciste en Europe ».
Le Parlement arabe ne serait-il pas mieux inspiré de s'inquiéter des agissements de la « droite extrémiste et raciste » israélienne qui multiplie les empiétements à Jérusalem-Nord - où le gouvernement Netanyahou vient d'annoncer un nouveau plan de construction de logements réservés aux juifs - afin d'y éradiquer toute présence palestinienne ?
RIVAROL 15 JANVIER 2010
culture et histoire - Page 1933
-
Racisme et sionisme
-
La nostalgie suspecte de François Hollande…
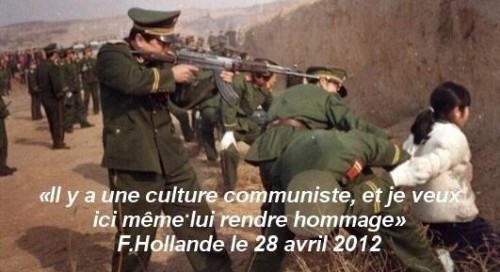
-
Vae Victis - Feux de la Saint Jean
-
Pour une nouvelle définition du nationalisme
♦ Conférence donnée par Robert Steuckers, le 16 avril 1997 à Bruxelles
“Nationalisme” signifie, au départ, selon une définition minimale, la défense de la “nation” sur les plans politique, culturel et économique. Par conséquent, toute définition du “nationalisme” dérive forcément d'une définition de la “nation”.
Qu'est-ce qu'une “nation” ? Le terme “nation” vient du latin natio, substantif dérivé du verbe nasci, naître. Donc, dans sa signification originelle, natio signifie naissance, origine, famille, clan (Sippe), la population d'un lieu précis (d'une ville, d'une province, d'un État ou, plus généralement, d'un territoire). Dans nos régions au Moyen-Âge, on appelait diets(ch) ou deutsch les locuteurs de langue thioise (= germanique), en précisant que ceux qui habitaient la rive gauche du Rhin étaient des Westerlingen, tandis que ceux qui habitaient à l'Est du grand fleuve se faisaient appeler Oosterlingen. Cette terminologie se retrouve encore dans les noms de famille Westerlinckx ou Oosterlinckx (ainsi que leurs variantes, orthographiées différemment).
À l'époque médiévale, Regino de Prüm, en évoquant les nationes populorum, indique que les “nations” sont des groupes de populations possédant tout à la fois des ancêtres communs, une langue commune et, surtout, ce que l'on a tendance à oublier quand on fait aujourd'hui du “nationalisme” comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, des systèmes communs de droit, voire des esquisses de constitutions. Dans la définition de Regino de Prüm, l'aspect juridique n'est pas exclu, le continuum du droit fait partie intégrante de sa définition de la nation, alors que certains nationalismes actuels ne réfléchissent pas à la nécessité de rétablir des formes traditionnelles de droit national et se contentent d'interpréter le droit en place, qui fait, par définition, abstraction de toutes les appartenances supra-individuelles de l'homme.
Ce droit en place n'a pas été voulu par les néo-nationalistes : il s'opposera toujours à eux. Ou alors, les néo-nationalistes se bornent à rejeter le droit et plaident pour des mesures d'exception ou pour un gouvernement par ukases ou par comités de salut public, ce qui n'est possible que dans des périodes troublées, notamment quand un ennemi extérieur menace l'intégrité du territoire ou quand des bandes de hors-la-loi troublent durablement la convivialité publique (attaques de forugons convoyant des fonds ou initiatives de réseaux de pédophiles en chasse de “chair fraîche”).
Dans le contexte belge, il conviendrait de rejeter toutes les formes de droit et toutes les institutions qui nous ont été léguées par la Révolution française et le code napoléonien, pour les remplacer par des formes modernisées du droit coutumier flamand, brabançon, liégeois, etc. La grande faiblesse des mouvements nationaux dans notre pays, y compris du mouvement flamand, a été de ne pas proposer un droit alternatif, inspiré du droit coutumier d'avant 1792 et de contester globalement et systématiquement les formes de “droit” (?) dominantes, non-démocratiques et héritées de la révolution française.
Dans quel contexte le terme de “nation” a-t-il été employé pour la première fois ? Dans les universités : une natio, dans la Sorbonne du Moyen-Âge, est une communauté d'étudiants issus d'une région particulière. Ainsi, la Sorbonne comptait une natio germanica ou teutonica regroupant les étudiants flamands, allemands et scandinaves, une natio scozia (ou scotia) regroupant les étudiants venus des îles britanniques, une natio franca, regroupant les étudiants d'Ile-de-France et de Picardie, une natio normanica, avec les Normands (que l'on distinguait des “Français”) et une natio provencialensis, pour les Provençaux, et, plus généralement, les locuteurs des parlers d'oc.
Mais, par ailleurs, au Moyen-Âge, les gens voyageaient peu, sauf pour se rendre à Compostelle ; ils n'avaient que rarement affaire à des étrangers. Ceux-ci étaient généralement bien accueillis, surtout s'ils avaient des choses originales, drôles, étranges à raconter. Le rôle de l'étranger est souvent celui du conteur d'histoires insolites. Certaines manières des étrangers étonnent, sont considérées comme bizarres, voire inquiètent ou suscitent l'animosité : très souvent, on est choqué quand ils parlent trop haut ou trop vite ; dans le Nord, on est rebuté par la manie méridionale de toucher autrui, dans le Sud, on est froisé par la distance corporelle qu'aiment afficher les gens du Septentrion. Les habitudes alimentaires sont généralement mal jugées. L'animosité à l'égard de l'étranger se limitait, au fond, à ces choses quotidiennes, ce qui est bien souvent le cas encore aujourd'hui.
La conscience d'une “nationalité” n'est pas perceptible dans les grandes masses au Moyen-Âge. Seuls les nobles, qui ont fait les croisades, les clercs qui sont davantage savants et connaissent l'existence d'autres peuples et d'autres mœurs, et les marchands, qui ont accompli de longs voyages, savent que les coutumes et les manières de vivre sont différentes ailleurs, et que ces différences peuvent être sources de conflictualités.
Le nationalisme ne devient une idéologie qu'avec la Révolution française. Celle-ci exalte la nation, mais dans une acception bien différente des nationes de la Sorbonne médiévale. La nation est la masse des citoyens, qui n'appartenaient pas auparavant à la noblesse ou au clergé. Cette masse est désormais politisée à outrance, pour des raisons d'abord militaires : les hommes du peuple, indistinctement de leurs origines régionales ou tribales, sont mobilisés de force dans des armées nombreuses, par la levée en masse. À Jemappes et à Valmy, en 1792, les beaux régiments classiques de la guerre en dentelles, qu'ils soient wallons, autrichiens, croates, hongrois ou prussiens, sont submergés par les masses compactes de conscrits français hâtivement vêtus et armés. Jemappes et Valmy annoncent l'ère de la “nationalisation des masses” (George Mosse). Celle-ci, dit Mosse, prend d'abord l'aspect d'une militarisation des corps et des gestes, par le truchement d'une gymnastique et d'exercices physiques à but guerrier : Hébert en France, Jahn en Prusse, drillent les jeunes gens pour en faire des soldats. Plus tard, les premiers nationalistes tchèques les imitent et créent les sokol, sociétés de gymnastique.
Après les guerres de la Révolution et de l'Empire, le nationalisme en Allemagne est révolutionnaire et se situe à gauche de l'échiquier politique. Puisque le peuple allemand s'est dressé contre Napoléon et a aidé le roi de Prusse, les princes locaux, la noblesse et le clergé à chasser les Français, il a le droit d'être représenté dans une assemblée, dont il choisit directement les députés, par élection. En 1815, dans l'Europe de Metternich, le peuple ne reçoit pas cette liberté, il est maintenu en dehors du fonctionnement réel des institutions. D'où une évidente frustration et un sentiment de profonde amertume : si le simple homme du peuple peut être ou doit être soldat, et mourir pour la patrie, alors il doit avoir aussi le droit de vote. Tel est le raisonnement, telle est la revendication première des gauches nationales sous la Restauration metternichienne en Europe centrale.
Dans l'Allemagne de l'ère Metternich, le nationalisme est un “nationalisme de culture” (Kulturnationalismus), où l'action politique doit viser la préservation, la défense et l'illustration d'un patrimoine culturel précis, né d'une histoire particulière dans un lieu donné. La culture ne doit pas être l'apanage d'une élite réduite en nombre mais être diffusée dans les masses. Le nationalisme de culture s'accompagne toujours d'une “pédagogie populaire” (Volkspedagogik) ou d'une “pédagogie nationale”. Concours de chants et de poésie, promotion du patrimoine musical national, inauguration de théâtres en langue populaire (Anvers, Prague), intérêt pour la littérature et l'histoire locale/nationale sont des manifestations importantes de ce nationalisme, jugées souvent plus importantes que l'action politique proprement dite, se jouant dans les élections, les assemblées ou les institutions. Le nationalisme de culture permet d'organiser et de capillariser dans la société un “front du refus”, dirigé contre les institutions nées d'idées abstraites ou détachées du continuum historique et culturel du peuple. Ce nationalisme de culture est toujours tout à la fois affirmateur d'un héritage et contestataire de tout ce qui fonctionne en dehors de cet héritage ou contre lui.
Le nationalisme selon Herder et le nationalisme selon Renan
De la volonté d'organiser une “pédagogie populaire” découlent 2 tendances, dans des contextes différents en Europe.
◘ 1) D'une part, il y a les pays où la nation est perçue comme une “communauté naturelle”, c'est-à-dire une communauté reposant sur des faits de nature, de culture, sur des faits anthropologiques ou linguistiques. Cette vision provient de la philosophie de Herder et elle structure le nationalisme allemand, le nationalisme des peuples slaves (Russes, Serbes, Bulgares, Croates ; en Pologne et chez les Tchèques, cet héritage herdérien s'est mêlé à d'autres éléments comme le catholicisme, le messianisme de Frank, un héritage hussite ou un anti-cléricalisme maçonnique), et, enfin, le nationalisme flamand qui est “herdérien” tant dans ses acceptions catholiques que dans ses acceptions laïques (souvenir de la révolte des Gueux contre l'Espagne).
◘ 2) D'autre part, nous trouvons dans l'histoire européenne une conception de la nation comme “communauté de volonté” (wilsgemeenschap) ; pour l'essentiel, elle est dérivée des écrits de Renan. Elle est la caractéristique principale d'un nationalisme français postérieur à l'ère révolutionnaire et jacobine. Le nationalisme français n'est pas un nationalisme de culture (et donc ne constitue nullement un nationalisme pour les Allemands, les Slaves et les Flamands) parce qu'il implique un refus des faits naturels, une négation du réel, c'est-à-dire des mille et unes particularités historiques des nations concrètes. Renan savait que la France de son temps n'était déjà plus un peuple homogène, mais un mixte complexe où intervenaient un fonds préhistorique cromagnonique-aurignacien (grottes de Lascaux, sites archéologiques périgourdins, etc.), un fonds gaulois-celtique ou basque-aquitain, un apport romain-latin et des adstrats francs-germaniques ou normands-scandinaves.
Aucune de ces composantes ne peut revendiquer de représenter la France seule : donc ces réalités, pourtant impassables, doivent être niées pour que fonctionne la machine-État coercitive, de Bodin, des monarques, de Richelieu et des jacobins. Pour que l'idéologie ne soit pas trop raide, schématique et abstraite, donc rébarbative, Renan table non pas sur les réalités concrètes, anthropologiques, ethniques ou linguisitiques, mais sur une émotion artificiellement entretenue pour des choses construites, relevant de l'“esprit de fabrication” (dixit le Savoisien Joseph de Maistre) ou sur des modes assez ridicules et des fantaisies sans profondeur (modes vestimentaires parisiennes, glamour féminin, produits culinaires ou cosmétiques à la réputation surfaite et toujours parfaitement inutiles, etc.). Le citoyen d'une telle nation adhère avec un enthousiasme artificiel à ces constructions abstraites ou à ces styles de vie mondains et citadins sans profondeur ni épaisseur, et, en même temps, nie ses patrimoines réels, ses traditions rurales, ses héritages, qu'il brocarde par une sorte de curieuse auto-flagellation, de concert avec les propagandistes politiques et les mercantiles qui diffusent ces modes ne correspondant à aucun substrat populaire réel.
Cette adhésion est une “volonté”, dans l'optique de Renan. Sa fameuse idée d'un “plébiscite quotidien” n'est jamais que l'exercice d'auto-flagellation des citoyens, le catéchisme qu'il doit apprendre pour être un “bon élève” ou un “bon citoyen”, pour oublier ce qu'il est en réalité, pour exorciser le “plouc” qui est en lui et l'empêche d'adhérer béatement à tous les parisianismes. Aujourd'hui, les modes vestimentaires, musicales, cinématographiques américaines, diffusées en Europe, jouent un rôle analogue à celui qu'avaient les modes françaises jusqu'en 1940. Les manifestations d'américanisme oblitèrent les traditions historiques et culturelles d'Europe comme les manifestations du parisianisme avaient oblitéré les traditions historiques et culturelles des provinces soumises aux rois de France, puis à la secte jacobine-fanatique.
Que signifie cette dualité dans les traditions nationalistes en Europe ? Pour Herder, le peuple, en tant qu'héritage et continuité pluriséculaire, prime toutes les structures, qu'elles soient étatiques, démocratiques, républicaines, monarchiques ou autres. Les structures passent, les peuples demeurent (Geen tronen blijven staan, maar een Volk zal nooit vergaan [Aucun trône ne reste debout, mais un peuple ne passe jamais]), dit l'hymne national flamand, contenant ainsi une magistrale profession de foi herdérienne dont les Flamands qui le chantent aujourd'hui ne sont plus guère conscients et dont la portée philosophique est pourtant universelle).
Pourquoi, chez Herder, cette primauté du donné brut et naturel qu'est le peuple par rapport aux institutions étatiques construites ? Parce qu'au moment où il écrit ses traités sur l'histoire, il n'y a pas un État allemand unitaire. Les Allemands du continent sont éparpillés sur une multitude d'État, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le contexte allemand du XVIIIe s., on ne peut donc pas parler de l'État comme d'une réalité concrète, puisque cet État n'existe pas. Ce qui existe en réalité, ce qui est vraiment là, sous les yeux de Herder, c'est une vaste population germanique, diversifiée dans ses façons de vivre et par ses dialectes, mais unie seulement par une langue littéraire et une culture générale permettant d'harmoniser ses différences régionales ou dialectales. Herder voit une nation germanique en devenir constant, un édifice non achevé. Les nationalismes qui dérivent de sa philosophie de l'histoire perçoivent leur objet privilégié, soit la nation-peuple, comme un phénomène mouvant, en évolution constante.
La primauté de la culture sur les institutions (jugées toujours éphémères et sur la voie de la caducité), du peuple sur l'État, conduit aisément à la pratique de défendre les Volksgenossen (“congénères”) contre les États étrangers qui les oppriment ou qui, plus simplement, ne permettent pas leur déploiement optimal. Tous les “congénères” doivent en théorie bénéficier d'institutions souples et protectrices, déduites de l'héritage juridique et historique national voire d'institutions partagées par la majorité nationale. Il apparaît intolérable que certains “congénères” soient sous la coupe d'institutions étrangères ou contraints de servir de chair à canon dans des armées non nationales. Le sentiment qui naît de voir des “congénères” subir des injustices conduit parfois à une volonté d'irrédentisme. Dans cette optique nationale-allemande et herdérienne, les Autrichiens, les Alsaciens, les Luxembourgeois, les habitants d'Eupen et de Saint-Vith, les Tyroliens du Sud, les ressortissants des disporas allemandes de la Vistule à la Volga et de Bessarabie au Turkestan sont des compatriotes allemands à part entière.
Pour les Flamands, les habitants du Westhoek ou les diasporas flamandes réparties jusqu'au pied des Pyrénées sont des compatriotes — indépendamment de leur “nationalité de papier” — qu'il faut protéger quand ils ont maille à partir avec l'État étranger qui les tient sous tutelle. Le conflit entre Serbes et Croates vient du fait que ni les uns ni les autres ne peuvent accepter de voir les leurs sous la coupe d'un État reposant sur des principes qui leur sont étrangers : orthodoxes-byzantins pour les uns, catholiques-romains pour les autres. Les Russes aussi se sentent les protecteurs de leurs compatriotes en Ukraine, en Estonie, au Kazakstan et dans toutes les républiques musulmanes de l'ex-URSS. Les Hongrois affirment aujourd'hui haut et fort qu'ils protègent leurs compatriotes des Tatras et de la Voïvodine et laissent sous-entendre, notamment à la Slovaquie et à la Serbie, qu'ils sont prêts à intervenir militairement si les droits des minorités hongroises sont bafoués.
Pour Renan, l'idée d'une “communauté de volonté” ou d'un “plébiscite quotidien” repose de fait sur une volonté d'oublier chaque jour ce que l'on est en substance, afin de correspondre à une idée abstraite (la citoyenneté républicaine et universelle dans la version rationaliste, délirante et fanatique) ou à une image idéale (dans la version édulcorée et modérée). Pour les tenants du nationalisme de culture, une telle démarche est une aberration. C'est ce que reprochent les nationalistes flamands ou les germanophiles alsaciens à leurs franskiljoens ou à leurs Französlinge. Rien de plus ridicule évidemment que le francophile brabançon ou strasbourgeois qui se pique de suivre les modes de Paris. Gauche et maladroit, il camoufle, derrière des propos grandiloquents et un catéchisme schématique, une honte et une haine pathologiques de soi, qu'il essaye fébrilement, de surcroît, d'inculquer à ses compatriotes. À Bruxelles, certaines nullités politiciennes de bas étage inféodées au FDF (Front des Francophones) jouent ce jeu avec une obstination inquiétante, avec un fanatisme comparable à celui qui s'est exercé sous la Terreur, et bénéficient du soutien à peine dissimulé de quelques services du Quai d'Orsay.
Pour Tilman Mayer (cf. Prinzip Nation : Dimensionen der nationalen Frage am Beispiel Deutschlands, 1986 ; B.. Estel/T. Mayer, Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften : Länderdiagnosen und theoretische Perspektiven, 1994), philosophe allemand qui s'est penché sur la question du nationalisme, il convient de distinguer dans cette problématique Herder/Renan, les notions d'ethnos et de demos.
L'ethnos est un groupe démographique humain, avec une base ethnique bien clairement profilée. Le demos est l'ensemble des électeurs (donc des habitants de toutes les circonscriptions électorales d'un pays donné), sans qu'il ne soit nécessairement tenu compte de leur profil ethnique/anthropologique ; ceux-ci peuvent certes exprimer leurs opinions sur le plan politique et institutionnel, mais ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte au fait naturel, au factum qu'est l'ethnos. Pour Mayer, comme jadis pour Herder, les peuples sont autant d'expressions spécifiques de cette humanité diversifiée voulue par Dieu (Herder est pasteur protestant), autant de façons de “l'être-homme” (het menszijn/Mensch-sein). Cette affirmation appelle d'autres réflexions d'ordre philosophique et anthropologique. À leur tour, ces réflexions conduisent à l'affirmation de principes politiques pratiques :
• Première réflexion : l'homme (l'humanité) est ontologiquement faible. Dans le donné naturel brut, dans sa déréliction, jeté au beau milieu d'un monde souvent hostile, l'homme nu, seul, est désarmé, ne pourrait survivre. Le “petit d'homme” n'a ni la fourrure de l'ours, ni les crocs du tigre, ni la fulgurante rapidité du guépard, ou l'agilité du dauphin ou les muscles puissants des grands singes anthropomorphes. Pour pallier à ces défauts, l'homme a besoin de la technique et de la culture.
• La technique, la fabrication d'outils, l'habilité manuelle lui procurent les instruments quotidiens (vêtements, armes, ustensiles divers, récipients, etc.) qui lui assurent sa survie biologique.
• La culture, en ce sens, est un ensemble de rites, de traditions, de règles ou d'institutions anthropologiques (mariage, famille, etc.) ou politiques (État, organisation militaire, judiciaire, etc.), qui permettent soit d'orienter les comportements vers le maximum d'efficacité soit de déployer autant de stratégies possibles pour répondre aux innombrables défis que lancent le monde et l'environnement.
Pluriversalité
L'humanité est répandue sur l'ensemble du globe, sous toutes les latitudes et dans tous les climats ou les biosphères ; cette répartition humaine est mouvante par l'effet des phénomènes migratoires, la pluralité des modes culturels/institutionnels est dès lors un postulat nécessaire, pour ne pas désorienter les hommes, pour leur conserver à tous un fil d'Ariane dans leurs pérégrinations à travers un monde labyrinthique. Les cultures doivent être maintenues et promues dans leur extrême diversité, de façon à ce que les stratégies de survie restent nombreuses pour affronter les innombrables situations ou contextes auxquels l'homme est sans cesse confronté.
Ce postulat de la diversité nécessaire induit un “pluriversalisme” et réfute les démarches universalistes. Le monde est un plurivers et non un univers. Un monde qui serait géré par une et une seule vision des choses serait un danger pour l'humanité, car cette vision unique, cette pensée unique, éliminerait la possibilité de déployer, ne fût-ce que par imitation, des stratégies multiples éprouvées avec succès dans d'autres Umwelten que le mien (les explorateurs polaires européens imitent les Esquimaux, les soldats européens imitent en Guyane, au Gabon ou en Birmanie les stratégies de survie des Pygmées dans les forêts vierges africaines, les explorateurs du désert calquent leurs comportement sur les Bédouins ou les Touaregs, etc.).
La pluriversalité est donc bel et bien une nécessité et un avantage pour l'homme, et la volonté perverse de certains cénacles, officines ou bureaux d'imposer une “political correctness”, niant cette luxuriante pluriversalité au profit d'une fade universalité, est une dangereuse aberration.
Si, en permanence, on peut tester au quotidien des stratégies vitales ethniquement ou biorégionalement profilées, on donne à l'humanité dans son ensemble plus de chances de survie. Dans une telle optique, l'Autre (l'Étranger) est toujours un enseignant, tout comme nous sommes pour lui aussi des enseignants. L'ennemi dans une telle optique est celui, compatriote ou étranger, qui refuse d'entendre et d'écouter l'Autre, d'enseigner ce qu'il sait, d'approfondir ce qu'il est, celui qui impose des modèles abstraits et inféconds par coercition ou par séduction perverse. Car dans un monde régi par le mono-modèle préconisé par les tenants de l'idéologie dominante et par leurs inquisiteurs, une réciprocité féconde et bienveillante, comme celle que nous souhaitons planétariser, ne serait pas possible.
Ces options pour la pluriversalité ou la pluralité doivent se répercuter au sein même de la nation. Au sein de sa nation, l'homme public ou politique, qui opte pour la vision herdérienne, plurielle et pluriverselle, doit, pour demeurer logique avec lui-même, respecter la pluralité qui constitue sa propre nation. Car la nation n'est jamais un monolithe, même quand elle est apparemment homogène ou plus homogène que ses voisines. La nation est une communauté complexe et multidimensionnelle, et non un groupe humain simple et unidimensionnel. La complexité et la multidimensionalité permettent de réaliser au sein de la nation ce qui se fait dans le monde : tester à chaque instant autant de stratégies vitales différentes que possible.
Le personnel politique pluriversaliste sélectionne alors les meilleures stratégies disponibles et les adapte à la situation et aux défis du moment : tel est le véritable pluralisme, et non pas cette pluralité d'options partisanes figées que l'on nous suggère aujourd'hui, en nous disant qu'elle est la panacée et l'unique forme de démocratie possible. Un État trop centralisé assèche ses potentialités : c'est le cas de la France qui tombe en quenouille sous le poids de ses contradictions mais c'est aussi le cas de la Wallonie ruinée où le PS francophile impose trop unilatéralement ses schémas et ce serait le cas d'une Flandre où seul le CVP aurait le dernier mot. Une vision organique de la nation implique la présence constante d'une pluralité de réseaux d'opinions ou une pluralité de projets, qui doivent avoir pour but, évidemment, de renforcer la cohésion de la nation, d'y introduire de l'harmonie, d'optimiser son déploiement.
La typologie des nationalismes chez John Breuilly
Dans Nationalism and the State (1993), John Breuilly nous offre une excellente classification de différents types de nationalismes qui se sont présentés sur la scène mondiale.
Première remarque de Breuilly : le nationalisme peut être porté par des strates très différentes de la société. Il peut être porté par la noblesse et la ruling class (comme en Angleterre), par la classe bourgeoise révolutionnaire (en France, de la Révolution à la Troisème République), par les paysans, par les ouvriers ou par les intellectuels. En Afrique du Sud, en Bulgarie, en Croatie, partiellement en Flandre (pendant la révolte paysanne contre la république française en 1796-99), en Irlande ou en Roumanie, les paysans sont porteurs de l'idée nationale. Avec James Connolly en Irlande et avec le péronisme en Argentine, les ouvriers et les syndicats (socialistes ou justicialistes) affirment la souveraineté nationale. Les intellectuels jouent un rôle moteur dans l'éclosion du nationalisme en Tchèquie, en Finlande, en Flandre, en Irlande, au Pays Basque et en Catalogne.
◘ 1. Dans un contexte où il n'existe pas d'États-nations, nous trouvons :
• des nationalismes d'unification, comme en Italie, en Allemagne ou en Pologne au XIXe siècle.
• des nationalismes de séparation, où les nations tentent de s'affranchir des empires dans lesquels elles sont incluses, comme la Hongrie, la Tchèquie, la Croatie dans l'empire austro-hongrois, ou la Roumanie, la Grèce et la Bulgarie dans l'empire ottoman.
La Serbie, par ex., est séparatiste contre les Ottomans, mais unificatrice dans le contexte yougoslave à partir de 1918, où elle est dominante. Les Arabes sont séparatistes contre les Turcs pendant la première guerre mondiale, mais unitaires dans leurs revendications nationales ultérieures. On peut également dire que le nationalisme flamand est tout à la fois séparatiste contre l'État belge mais vise l'unification pan-néerlandaise dans l'idée des Grands Pays-Bas, l'unification de Dunkerque à Memel dans l'idée hanséatique et “basse-allemande” (Aldietse Beweging) de C. J. Hansen (1833-1910), l'unification de tous les peuples germaniques chez quelques ultras de la collaboration entre 1940 et 1945 (De Vlag, etc.).
Pour les nations qui ne disposent pas d'une pleine souveraineté et sont incluses dans de vastes empires coloniaux, le nationalisme peut revêtir les aspects suivants :
♦ a. Être un nationalisme anti-colonialiste, comme en Inde jusqu'à l'indépendance en 1947 ou comme dans les nations africaines avant la grande vague de décolonisation des années 60 (où les soldats ghanéens revenus du front de Birmanie et travaillés par les miliants indiens et gandhistes, hostiles à la tutelle britannique, ont joué un rôle primordial).
♦ b. Être un sous-nationalisme dans des États issus des partages impérialistes décidés en Europe et/ou des administrations coloniales qui en ont résulté. Ce fut le cas du Pakistan en Inde, ce qui conduira à la partition du sous-continent indien. Ce fut également le cas au Katanga dans l'ex-Congo belge, mais cette sécession fut un échec.
♦ c. Être un nationalisme réformiste. Le nationalisme réformiste est un nationalisme qui se rend compte que la souveraineté formelle de la nation est insuffisante voire inutile, qu'elle ne peut faire valoir clairement ses prérogatives théoriques, vu le retard économique, industriel, institutionnel, militaire et technique que le pays a accumulé au cours de son histoire. Le nationalisme réformiste vise donc à accélérer le passage à un stade de développement optimal qui permet de faire face plus efficacement aux impérialismes qui tentent d'empiéter la souveraineté nationale. Les exemples historiques de nationalisme réformiste sont le Japon de l'ère Meiji, la Chine de Sun Ya-Tsen et la Turquie des Jeunes Turcs.
◘ 2. Dans un contexte où n'existent que des États-nations, où les impérialismes coloniaux ont théoriquement disparu et où les empires multinationaux tendent à disparaître, plusieurs types de nationalismes peuvent se manifester :
♦ a. Les nationalismes d'unification, qui prennent parfois le relais d'un nationalisme anti-colonialiste et sont, à ce titre, séparatistes. Ces nationalismes d'unification post-coloniaux sont le panafricanisme après la vague des indépendances dans les années 60. Ou le panarabisme, le nationalisme panarabe de Nasser.
♦ b. Le nationalisme de réforme en Europe. En Italie, par ex., le nationalisme démarre dans le giron du libéralisme italien qui est rigoureusement étatiste et centraliste. Il vise à créer en Italie un appareil industriel capable de concurrencer l'Angleterre, la France et l'Allemagne. L'obsession des libéraux italiens est de voir le pays basculer dans le sous-développement et devenir ainsi le jouet des puissances étrangères. Le fascisme prendra directement le relais de ce libéralisme national : sur le plan philosophique, la filiation libéralisme/fascisme prend son envol à partir de Hegel pour aboutir à l'interprétation italienne originale de Benedetto Croce et de celui-ci, qui reste libéral et s'oppose au fascisme, à l'actualisme hégélien/fasciste de Giovanni Gentile. À cette volonté permanente de modernisation de la société, de l'économie et des institutions italiennes, s'ajoute l'idéologie du futurisme qui proclame haut et clair ses intentions de balayer tous les archaïsmes qui frappent la société italienne d'incapacité. En Allemagne, à partir de Bismarck et de Guillaume II, la volonté de ne pas devenir le jouet de l'Angleterre ou de la France est clairement affichée : le programme d'industrialisation va bon train, couplé à une vision autarcique et contextuelle de l'économie (où les règles du jeu économique doivent favoriser un contexte politique et historique précis, sans prétendre à l'universel ; cf. les “écoles historiques” en économie et les pratiques préconisées par le “socialisme de la chaire”). Les historiens anglais reconnaissent volontiers que les Allemands les ont battus à la fin du XIXe siècle sur le plan des technologies chimiques et que la chimie a été le moteur d'un développement ultra-rapide de l'industrie allemande.
♦ c. Le nationalisme de séparation au sein d'États constitués, bi-ethniques ou multiethniques, bilingues ou multilingues, se manifeste dans des contextes de déséquilibres entre les composantes. Le nationalisme de séparation flamand prend actuellement de l'ampleur car le déséquilibre entre les 2 modèles d'économie en Belgique (le wallon et le flamand) ne sont pas compatibles au niveau fédéral, n'exigent pas les mêmes réponses et les mêmes modulations. En effet, une vieille structure économico-industrielle comme la Wallonie, qui correspond à la “première vague” de la société industrielle et a connu de graves difficultés à cause de l'effondrement des conjonctures en Europe, ne peut être gérée par les mêmes principes qu'une Flandre au tissu plus neuf, composé de PME, mais plus fragile face à la grande finance internationale. En Écosse, les problèmes sont également différents de ceux de l'Angleterre. En Italie du Nord, avec les ligues régionalistes, les clivages qui opposent les provinces septentrionales à l'État fédéral et aux structures sociales complexes (mafias incluses) des régions méridionales sont profonds, mais s'expriment davantage par un populisme séparatiste plutôt que par un nationalisme de culture ou d'État, d'ancienne mouture, avec son folklore et ses rituels.
Le besoin vital d'identité selon Kurt Hübner
Sur les plans psychologique, anthropologique et ontologique, l'homme a un besoin vital d'identité, tant au niveau personnel qu'aux niveaux communautaire et politique. Le philosophe allemand contemporain Kurt Hübner (in : Das Nationale : Verdrängtes, Unvermeidliches, Erstrebenswertes, 1991) résume brillamment en 8 points majeurs ce besoin vital d'identité :
◘ 1. L'identité d'une nation est un postulat anthropologique.
◘ 2. L'identité nationale repose sur un ensemble structuré de systèmes de règles, qui harmonisent les liens entre les individus et les groupes au sein de la nation.
◘ 3. Ces systèmes de règles fonctionnent comme des régulateurs et ne doivent pas être définis plus précisément, car toute définition serait ici un enfermement conceptuel infécond qui ferait fi des innombrables potentialités de la nation, en tant que fait de vie.
◘ 4. Ces systèmes nationaux sont instables et connaissent des hautes et des basses conjonctures.
◘ 5. Cette instabilité exige une adaptation constante, c'est-à-dire une attention constante aux transformations potentielles qui ne cessent de survenir. Dans un tel contexte, le nationaliste est celui qui demeure toujours en état d'alerte, parce qu'il souhaite que la conjoncture reste toujours haute pour le bénéfice de son peuple et est prêt à consacrer volontairement toutes ses énergies personnelles à ce travail quotidien de réception et d'adaptation des défis et des nouveautés.
◘ 6. Les transformations qu'une nation est appelée à subir ne sont jamais prévisibles. Dans l'appréhension du fait national (das Nationale), on ne peut donc pas faire appel à une grille de déchiffrement déterministe. Le nationalisme est toujours plutôt volontariste, il refuse d'accepter les basses conjonctures ou les dysfonctionnements de la machine étatique ou les imperfections génératrices de déclins et de crises : c'est là la grande différence entre le nationalisme et les autres grandes idéologies des XIXe et XXe siècles, comme le libéralisme, qui accepte les effets pervers de l'économie et les juge inéluctables, ou le marxisme (de moutures sociale-démocrate ou communiste), qui se réclame philosophiquement du déterminisme positiviste le plus plat et rejette toutes les formes et les manifestations de volontarisme comme des irrationalités dangereuses.
◘ 7. Le nationalisme ne parle donc jamais de déterminations mais de destin (lot, Schicksal, destiny). La notion de destin, à son tour, postule l'adhésion à la raison pratique (voire à des jeux diversifiés de raisons pratiques), plutôt qu'à la raison pure, toujours perçue comme unique en soi. La/les raison(s) pratique(s) appréhende(nt) les imperfections, les chutes de conjoncture, sans jamais chercher à les éluder mais, au contraire, visent à les travailler de multiples façons et à améliorer les situations dans la mesure du possible, tandis que la raison pure, en politique, dans le flux de l'histoire, tente de plaquer des principes irréels sur le réel, provoquant à terme des déphasages insurmontables. La manie de la “political correctness” est un avatar médiocre de cette raison pure de kantienne mémoire, appliquée maladroitement et déformée outrancièrement par des idéologues a-critiques. Dont les agitations frénétiques provoqueront bien évidemment des déphasages catastrophiques selon l'adage : qui veut faire l'ange, fait la bête.
◘ 8. La nation n'est donc pas une essence figée, comme l'affirment trop souvent les vieilles droites ou les romantismes nationaux étriqués, car tout caractère figé implique une sorte de déterminisme, induit une propension problématique à répéter des formes mortes, à proclamer des discours répétitifs, en porte-à-faux par rapport au réel mouvant et effervescent. Au contraire, la nation doit toujours être perçue comme un mouvement dynamique, comme une modulation localisée du destin auquel tous les hommes sont confrontés, comme un mouvement dynamique qu'il n'est jamais simple de définir ou d'enfermer dans une définition trop étroite. Cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter sans ménagement l'héritage romantique ou les formes anciennes de nationalisme. Un tel rejet se perçoit dans les gauches qui font toujours abstraction du temps et de l'espace (catégories auxquelles personne ne peut se soustraire) ou dans un parti ex-nationaliste comme la Volksunie flamande où l'on court d'un novisme sans épaisseur à l'autre, en se moquant méchamment et sottement des héritages que le nationalisme plus traditionnel aime à cultiver. Le travail des nationalistes romantiques constitue un héritage divers, où s'accumulent des trésors de découvertes culturelles, littéraires et archéologiques. Parmi tous ces éléments, on trouve des matériaux utiles pour promouvoir une dynamique nationale actuelle. La manie du rejet est donc une aberration supplémentaire du modernisme actuel.
Conclusion + remarques sur la “marche blanche”
En résumé, dans notre optique, tout nationalisme doit placer la concrétude “peuple” (Volk) avant l'abstraction “État”. Si l'État passe avant le peuple concret, et si cette pratique se proclame “nationaliste”, nous avons affaire à un paradoxe pervers. La priorité accordée à la population concrète dans un continuum historique concret signifie que, dans tous les cas de conflit ou de contestation violente, la vérité ou la solution est à rechercher dans la population elle-même. La “marche blanche” du 20 octobre 1996 à Bruxelles a montré que cette idée est ancrée dans le fond du subconscient populaire, tant en Flandre qu'en Wallonie, mais qu'elle ne peut pas s'exprimer dans les institutions étatiques belges, ce fatras d'abstractions dysfonctionnantes et sans avenir positif possible. La “marche blanche” a exprimé un mécontentement sans proposer un droit alternatif, clairement exprimé.
L'échec de cet étonnant mouvement populaire est dû à l'absence, dans la société belge, d'écoles (méta)politiques cohérentes, capables de vivifier constamment les legs du passé : seule l'Inde actuelle a donné l'exemple d'un mouvement parapolitique actif et efficace, vieux de près d'un siècle, le RSS, think tank bien drillé se profilant derrière la victoire récente du BJP. Les parents des enfants disparus ou assassinés ont eu tort de répondre à l'invitation du Premier Ministre à la fin de cette journée mémorable du 20 octobre 1996 : ils auraient dû refuser de le voir ce jour-là et réclamer, devant la foule innombrable venue les acclamer, la poursuite des grèves spontanées et des manifestations populaires contre les palais de justice et poser davantage de conditions :
• exiger au moins le retour inconditionnel du juge Connerotte, la démission de Stranard et Liekendael voire la dissolution de toute la Cour de Cassation,
• exiger l'incarcération des magistrats notoirement incompétents et leur jugement dans les 2 mois par une cour populaire spéciale,
• réclamer que les gendarmes fautifs et/ou négligeants soient traduits devant une cour martiale expéditive, composée de militaires de réserve, occupant tous une profession indépendante dans la société (médecins, chefs d'entreprise, avocats d'affaires, professeurs d'université, gestionnaires de grandes entreprises de pointe), expression d'une souveraineté populaire, d'une créativité professionnelle qui ont le droit de s'exprimer et de juger très sévèrement, avec une rigueur implacable, les fonctionnaires incompétents, auxquels on autorise de porter des armes et à qui on accorde des prérogatives ou des passe-droits et qui ne s'en servent pas à bon escient, qui sont assermentés dont parjures quand ils défaillent ; de telles négligences sont des crimes graves de trahison à l'encontre de notre peuple ;
• imposer le rétablissement de la peine de mort pour les crimes contre les enfants et, enfin,
• imposer la mise sur pied immédiate d'un comité de salut public composé d'officiers de réserve, de juristes indépendants et de citoyens n'étant ni fonctionnaires de l'État ou d'une région ni membres d'un parti (quel qu'il soit) ; ce comité de salut public aurait été commandé par un lieutenant-drossard (fonction prévue par le droit brabançon au XVIIIe s. pour lutter contre la grande criminalité, notamment les bandes de “chauffeurs” qu'étaient les bokkenrijders, avant l'adoption aberrante du droit révolutionnaire et napoléonien, véhicule d'abstractions perverses et de délires juridiques modernistes) ; ce comité de salut public et ce lieutenent-drossard auraient eu préséance sur toutes les autres institutions judiciaires et auraient pu agir à leur guise et procéder à des arrestations rapides, mais uniquement dans le cadre de l'enquête sur les agissements de Dutroux, menée par le juge Connerotte, légalement désigné au départ (Un comité de salut public ne saurait avoir la prétention de régenter tout le fonctionnement de la société au-delà des compétences concrètes des professionnels, mais seulement de gommer ponctuellement, au plus vite, par une bonne et diligente justice, les anomalies les plus dangereuses de la société).
La naïveté des parents et de la foule a été incommensurable et le cynisme abject du pouvoir en place — qui ne se soucie ni des dysfonctionnements ni de la vie des enfants et des humbles — a pu s'imposer rapidement, au bout de quelques semaines. Sur le plan philosophique et politique, le comité de salut public aurait eu pour fonction de prouver urbi et orbi la priorité de l'homme concret sur toutes les structures abstraites, assurant ainsi le triomphe d'une idée vivante mais étouffée qui traverse notre peuple. Devant le citoyen simple et honnête, meurtri dans ce qu'il a de plus cher, les autorités doivent toujours plier, que ces autorités soient la gendarmerie, la magistrature ou l'État.
Enfin, dernière remarque, le nationalisme, dans ce pays, ne doit pas se contenter de discours idéalistes, de grandiloquences sans objet, de lamentations interminables sur tout ce qui ne va plus, mais travailler à imposer au pouvoir corrompu — qui se revendique d'idéologies irréelles ne donnant jamais la priorité aux faits réels marqués par le temps et le lieu — les instruments juridiques qui sanctionneraient cette priorité : p. ex. le referendum et la multiplication des ombudsmen, dans tous les domaines de la fonction publique.
Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°32, 1997. http://vouloir.hautetfort.com
◘ Sources principales :
- John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester Univ. Press, Manchester-UK, 1993, 474 p.
- Bernd Estel / Tilman Mayer (Hrsg.), Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften. Länderdiagnosen und theoretische Perspektiven, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994, 325 p. Dans ce volume, cf. Wolfgang Lipp, « Regionen, Multikulturalismus und Europa : Jenseits der Nation ? », pp. 97-114 ; Tilman Mayer, « Kommunautarismus, Patriotismus und das nationale Projekt », pp. 115-130 ; Klaus Schubert, « Frankreich - von der Großen Nation zur ziellosen Nation ? », pp. 171-196.
- Kurt Hübner, Das Nationale : Verdrängtes, Unvermeidliches, Erstrebenswertes, Styria, Graz, 1991, 313 p.
- Tilman Mayer, Prinzip Nation : Dimension der nationalen Frage am Beispiel Deutschlands, Leske & Budrich, Leverkusen, 1986, 267 p. Sur cet ouvrage, cf. Luc Nannens, « Le principe “Nation” », in Vouloir n°40/42, 1987.
- Heinrich August Winckler (Hrsg.), Nationalismus, Verlagsgruppe Athenäum/ Hain/ Scriptor/ Hanstein, Königstein/Ts., 1978, 308 p. À propos de ce livre, cf. Robert Steuckers, « Pour une typologie opératoire des nationalismes », in Vouloir n°73-74-75, 1991, pp. 25-30.
◘ Sources secondaires :
- Colette Beaune, « La notion de nation en France au Moyen-Âge », in : Communications n°45/1987 « Éléments pour une théorie de la nation », pp. 101-116, Seuil, 1987.
- Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard Univ. Press, Cambridge-Massachussetts, 1994 (2nd ed.), 270 p. Ouvrage capital pour comprendre comment Français et Allemands conçoivent les notions de nationalité et de citoyenneté. Ces approches allemande et française sont fondamentalement différentes.
- Liah Greenfeld, Nationalism : Five Roads to Modernity, Harvard Univ. Press, 1993 (2nd pbk ed.). Les sources du nationalisme en Angleterre, en France, en Allemagne, en Russie et aux États-Unis.
- Georges Gusdorf, « Le cri de Valmy », in : Communications n°45/1987, op. cit., pp. 117-146.
- Stein Rokkan, « Un modèle géo-économique et géopolitique », in : Communications n°45/1987, op. cit., pp. 75-100.
- Heinrich August Winckler & Hartmut Kaelble, Nationalismus, nationalitäten, Supra-nationalität, Klett-Cotta, Stuttgart, 1993, 357 p. Dans ce volume, cf. Gilbert Ziebura, « Nationalstaat, Nationalismus, supranationale Integration : Der Fall Frankreich », pp. 34-55 ; Wolfgang Kaschuba, « Volk und Nation : Ethnozentrismus in Geschichte und Gegenwart », pp. 56-81.
- John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester Univ. Press, Manchester-UK, 1993, 474 p.
-
Méridien Zéro - A la rencontre de : Jean-Marie Le Pen
-
Qui a tué l'Université française ?
Que reste-t-il de l'université française, quand les meilleurs élèves du secondaire préfèrent aujourd'hui à ses diplômes un bon Brevet de Technicien Supérieur ? Réflexion sur un assassinat et ses mobiles.
La crise de 2007 au moment de l'adoption de la loi LRU aura eu entre autres choses un mérite : celui de manifester au grand jour le désarroi des chercheurs et des enseignants-chercheurs. C'est peu de dire que nombre d'entre eux éprouvent aujourd'hui un réel malaise par rapport à leur propre métier et aux conditions dans lesquelles on leur demande de l'exercer. Peu de dire aussi que nombre d'entre eux se sentent déconsidérés. Il existe en effet aujourd'hui chez les universitaires en poste un réel sentiment de déclassement.
Le drame de l'université française aujourd'hui tient à son explosion démographique et à son effondrement qualitatif. Il tient au fait que l'on a voulu multiplier à l'infini une élite qui, par essence, ne peut être qu'extrêmement rare et réduite.
La massification et la promesse faite à travers cette dernière de permettre à une quantité toujours plus grande d'étudiants d'accéder à des diplômes jusqu'alors réservés à une toute petite élite n'a pas seulement démonétisé la plupart de ces titres universitaires. Elle a surtout contribué à ruiner la qualité même de l'enseignement dispensé.
Un professeur à qui l'on n'offre l'occasion d'enseigner qu'à la condition expresse de ne jamais sanctionner ses élèves, de ne point pouvoir opérer de tri entre les meilleurs et les moins bons, de ne jamais sélectionner ses étudiants - le mot lui-même étant honni de l'institution - ne peut que se sentir inutile et au fil des années développer une sorte de sentiment d'impuissance que le sentiment de déclassement ne vient que renforcer encore.
La massification, de ce point de vue, n'a conduit qu'à des catastrophes. Elle a littéralement détruit l'université. Il est vain de prétendre amender le système en y introduisant mesures palliatives et systèmes d'accompagnement - tutorat, heures de soutien, individualisation des parcours. Le vice est au départ. Il réside dans la démocratisation de l'enseignement supérieur elle-même.
L'idée de démocratisation de l'enseignement supérieur est en effet une contradiction dans les termes. L'enseignement supérieur est élitiste où il n'est pas. Tout simplement parce que l'intelligence est élitiste - la nature l'a voulu ainsi.
La massification de l'enseignement supérieur a, de ce point de vue, constitué un véritable meurtre : celui d'une institution vieille de près de 800 ans, qui avait traversé sans sourciller les guerres civiles religieuses, les reprises en main par le pouvoir royal, les épisodes révolutionnaires, le contrôle impérial, les basculements successifs de régime du XIXe siècle, la guerre civile de 1870-1871, les deux guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945.
Après avoir tué l'Université, on a tué le professorat
Ce que six siècles de violence n'avaient point réussi à faire, deux décennies de démagogie à outrance l'ont obtenu. L'université française est morte et enterrée. Gauche et droite ont dans ce meurtre une responsabilité partagée. Toutes deux ont en effet communié de concert dans cette haine du savoir, de l'aristocratie universitaire, de l'élitisme fondé sur la connaissance, de la sélection, de la méritocratie, de la justice. Et gauche et droite se sont attachées dans un effort poursuivi sans relâche et avec un zèle obstiné à détruire l'un après l'autre ces piliers qui faisaient l'ossature du temple universitaire.
Par démagogie, on a fini par étendre le professorat à tous. Par démagogie, on a offert la titulature de chaire universitaire à tous - et surtout à ceux qui relevaient de la bonne obédience maçonnique ou du bon courant politique, à ceux qui avaient au moment opportun su choisir la bonne carte politique, ou à ceux qui avaient fait commerce de leurs charmes auprès du « bon » professeur - c'est-à-dire de celui qui était suffisamment puissant pour pouvoir garantir à celles (ou ceux) qui acceptaient de céder à ses caprices ou à ses propositions graveleuses une place de titulaire à l'université.
Ainsi, à force de lâchetés, de prévarications, de concussions, on a attribué le titre de professeur titulaire de chaire, avec tout ce qu'il comportait d'aristocratique et de noble, à des individus qui ne méritaient pas même d'avoir le baccalauréat.
On a fait du titre de professeur d'université une fonction flexible, malléable à l'envi, indéfiniment distribuable. On a distribué à l'envi les prébendes et les privilèges qui se trouvaient statutairement associés à ce titre - et qui étaient jadis réservés à une élite infiniment peu nombreuse - à une infinité d'incapables incompétents.
Et c'est ainsi qu'après avoir tué l'université, on a tué le professorat
La question dès lors se trouve posée de savoir s'il est encore possible de rétablir une véritable aristocratie du savoir. La réponse là encore est plus que décevante. A la faveur de l'autonomie des facultés, on pouvait espérer que certaines universités pilotes prendraient quelques longueurs d'avance sur les autres et que cette prééminence leur donnerait ainsi les moyens de créer une véritable élite enseignante.
Mais cela eût supposé que l'on leur laissât le libre choix des axes de recherche, du contenu des enseignements, de la pédagogie adaptée, de la nature des examens et de la forme du diplôme. Ce ne fut nullement le cas. Et ce ne l'est pas davantage aujourd'hui.
La raison en est simple : la cause principale de la dégradation de l'université n'a pas été la centralisation mais la massification et corrélativement la suppression de la sélection.
Il faudrait au contraire que l'institution soit confiée à quelques individus, à quelques maîtres dignes de ce nom qui organiseraient une sélection draconienne à l'entrée, et contribueraient ainsi à rehausser la qualité des maîtres de conférence et des professeurs d'université.
Daniel Aman monde & vie 27 août 2011 -
La subversion
« Le façonnement artificiel d'une population inhibée et détachée de la politique, grâce aux techniques psychologiques de la subversion ouvre en fait la porte à n'importe quel coup d’État. »
Attention ! Livre sur le rock et le NPA. Ha ha je plaisante... Quoique. Si le concept de subversion est aujourd'hui galvaudé et tient davantage de la fausse contestation pour narcissiques de tous poils, cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1970, au cours desquelles ce livre a été écrit, son sens restait entier. Décodage du comment-ça-marche. Histoire de comprendre comment notre système un tant soi peu stable bien qu'imparfait a été pourri de l'intérieur pour dégénérer en Sodome et Gomorrhe.
Selon Mucchielli (Roger, pas Laurent), l'idée de paix est illusoire. Elle masque une nouvelle forme de conflit : la guerre psychologique. Autrefois auxiliaire de la force, la subversion est désormais devenue l'arme principal du combat politique. Qu'est-ce que la subversion ?
Une « technique d'affaiblissement du pouvoir et de démoralisation des citoyens. » Plus insidieuse que séditieuse en raison d'une asymétrie des rapports de force, elle agit sur l'opinion par effet de pourrissement. Ses agents noyauteurs pratiquent l'entrisme dans les groupes-clés, l'observation-participation, l'influence. Son efficacité repose sur trois principes manipulatoires concomitants : paraître de bonne foi, parler au nom du bon sens, en appeler toujours à la justice et à la liberté. Une guerre de la com', ni plus ni moins. Son support privilégié est donc bien entendu la propagande noire, qui cherche à tromper l'adversaire sur l'origine ou l'appartenance de l'action de propagande. (1) Les mass media servent de tremplin au triple objectif de la subversion : démoraliser la nation visée et les groupes qui la composent ; discréditer l'autorité, ses défenseurs, ses fonctionnaires, ses notables ; neutraliser les masses pour empêcher toute intervention spontanée générale en faveur de l'ordre établi, au moment choisi pour la prise non-violente du pouvoir par une petite minorité. Par une « panique muette », les membres de la collectivité sont ainsi isolés et désolidarisés : Mucchielli nomme cela la neutralisation active.
La subversion met en œuvre diverses méthodes de pression au changement, de persuasion et de conversion des esprits. La propagande de recrutement et d'expression se double d'une propagande d'endoctrinement ou d'intégration, destinée à l'uniformisation idéologique. L'agitation, forme moderne de la propagande, a étendu le champ d'action de la subversion, avec l'organisation trinitaire parti / chef / doctrine d'exploitation des mécontentements. L'objectif est de détacher du pouvoir tous ceux qui lui resteraient loyaux.
Bref, le but de la guerre reste le même, seuls les moyens ont changé. Désormais, il faut s'appuyer sur 1) l'expansion des moyens de communication de masse (mass media), qui atteint à la fois individuellement et simultanément, avec le besoin de savoir qui expose à la suggestion et 2) le développement de la psychologie sociale. En complément, la maîtrise stratégique des logiques de réseaux assure la rapide propagation de l'information – près de quarante ans après l'écriture de ce livre, Internet est passé par là avec ses MSN, Facebook et autres Tweeter.
La révolution, expose Mucchielli, se fait à présent avec l'accord de un pour mille (rien de bien neuf en fait, à regarder 1789, 1917 ou encore la FED). La minorité active utilise les nouveaux moyens de communication pour créer chez le récepteur apathique la réalité qui sied à la subversion. L'ère de l'image permet d'en appeler à ses tripes et à son irrationalité. Le réel importe peu. Par la manipulation du langage, les subversifs utilisent les mots à forte charge émotionnelle, car les mythes, note Mucchielli, sont davantage mobilisateurs que les réalités objectives. D'où l'invocation fictive – mais galvanisante – du « peuple », l'invention de la notion de « majorité silencieuse » pour s'auto-légitimer, etc., en se proclamant bien entendu (à l'époque) socialiste – comme on se dirait aujourd'hui démocrate-humaniste-partisan des droits de l'homme contre les forces réactionnaires des zeuresléplussombres. Ce dernier point a son utilité : parer de « l'auréole de la justice sociale et de l'authenticité des idéaux révolutionnaires. » Et l'avantage de pouvoir cataloguer tout individu loyal comme réactionnaire pour le pousser à se détacher du pouvoir.
La subversion, une révolution ? Oui et non. Elle s'en distingue par trois aspects : pas besoin d'une condition objective de la révolte populaire ; la révolution veut un nouveau système, la subversion a pour objectif la destruction pure – elle est négative ; la subversion privilégie la violence verbale, froide, calculée, sur plusieurs années, en temps de « paix ». Mais en fin de compte, elle mène à l'émergence d'un nouveau paradigme, et a donc une portée révolutionnaire. Dans cette optique, la subversion révolutionnaire agit comme un ensemble de techniques au service d'une guerre révolutionnaire. Elle se déroule en deux phases : subversion (longue) et prise de pouvoir (courte). La violence constitue l'un de ses mécanismes opératoires privilégiés, car elle fournit les incidents exploitables et relayés par les mass media. Parmi ceux-ci, les relais issus du gauchisme ont pour leur part contribué à promouvoir l'immoralité et le pourrissement des mœurs (pour reprendre les mots de l'auteur) en présentant les barrières, notamment familiales, comme oppressives / répressives (on pensera aujourd'hui à Libé et aux Inrocks entre autres). Enfin, quand à l'agitation générale – relayée par l'intox de mass media complaisants – succède la répression, les mêmes media sont utilisés pour susciter l'indignation – présentée comme générale – de l'opinion publique et étendre la sympathie à l'égard des subversifs, qui gagnent donc progressivement du terrain. Actualisée, la subversion se trouve bien évidemment au sommet de l’État, avec opérations faux drapeaux, stratégie du choc, néolibéralisme macabre, déconstructivisme, déracinement, diabolisation, toujours la propagande grise ou noire, désinformation.
Hors du système électoral (ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien au contraire), l'agent subversif fait en sorte que toute critique à son égard soit diabolisée. Il exploite les idéaux et valeurs universels par l'indignation permanente. Le moindre fait divers est récupéré s'il sert un des trois buts de la subversion (utilisation psychologique de la répression, par exemple), mais le reste est passé sous silence. Le manichéisme moral, simplificateur, est avantageusement utilisé pour façonner l'opinion. L'inflation sémantique est généralisée – tous des fachos dirions-nous aujourd'huicontre-violence. Si l'ennemi est le mal, expose Mucchielli, la subversion prétend incarner le Bien. Conséquemment, les adversaires de ce Bien sont démoralisés, les individus neutralisés individuellement et les groupes dissociés. L'effet est notamment amplifié par l'absence de contre-propagande. L'appel à la psychologie entraîne le ralliement des belles âmes (des bonnes poires plutôt). L'exemple caractéristique de mai 68 nous est offert : dans la rue, les étudiants n'étaient que 5 à 6 000, pour un total de 140 000 inscrits...
L'absence de réaction assure l'impunité, et la révolte contamine de ce fait d'autres groupes et individus. Le contenu de l'idéologie développée importe peu, du moment que des réactions en chaîne se créent. Au bout du compte, l'effet d'entraînement crée un auto-engendrement des éléments subversifs, autonomisés de la sphère d'influence première.
Là encore, les media viennent jouer leur rôle d'idiots utiles en créant de toutes pièces le climat entretenu par la subversion. Qu'ils lui soient ou non favorables, ils lui confèrent davantage d'importance que ce qu'elle représente réellement, obéissant ainsi aux souhaits des agents subversifs... Par exemple, les journaux « neutres » surévaluent l'importance des groupes minoritaires ; les journaux « contre » les entreprises révolutionnaires accréditent les images des agents subversifs.
Enfin, exposons les techniques d'action de la subversion sur l'opinion publique. Nul ne s'en étonnera, celles-ci impliquent toutes la « culture de l'indignation ».
1. L'organisation du discrédit des autorités établies. Le pouvoir est présenté comme oppresseur, illégitime et oligarchique, en oubliant qu'il est issu du suffrage universel (c'était avant le vote électronique, et Mucchielli ne tient pas compte de la fabrication du consentement). Il est vu comme soumis à une puissance étrangère (en même temps hein... je dis ça je dis rien). La subversion façonne l'image du pouvoir policier et de la société répressive, et occulte que sans règles imposées, c'est la loi de la jungle. La subversion organise le discrédit sur le pouvoir par le discrédit sur ses piliers. Elle pratique l'attaque ad hominem, et applique les principes du montage d'une « affaire » dans une optique de subversion ;
2. L'utilisation des incidents fortuits, des fautes et erreurs de l'ennemi. La moindre erreur ou déclaration est exploitée, après un choix minutieux. Idem pour les droits et règlements, utilisés ou dénoncés en fonction de leur utilité. Enfin, toute contre-offensive est dénoncée comme une manœuvre de propagande ennemie ;
3. La situation de « tribunal populaire ». Si ce dernier point apparaît désuet, le fait qu'on accorde davantage d'importance à la mise en accusation qu'à la relaxe reste d'actualité – voir Dieudonné.
Au vu de cet exposé, comment, dès lors, lutter contre la subversion ? Mucchielli propose quelques pistes. Le contre-terrorisme, non institutionnel mais plutôt auto-défensif, serait contre-productif. Les contre-terroristes seraient considérés comme mutins, les terroristes comme simples délinquants. Mieux vaudrait donc privilégier des opérations de contre-subversion, afin de remobiliser l'opinion publique et isoler les groupes subversifs de la population. Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre : retournement de l'arme du ridicule contre l'ennemi ; l'opération-vérité (contre-campagne de dénigrement) ; le contre-appel au peuple (avec amplification par les mass media) ; la contre-information (démontage des mécanismes de l'action subversive) ; la mise sur pied de milices locales politiquement formées et encadrées, dont le succès tient à trois conditions : un fonctionnement comme groupes d'autodéfense institutionnels dans le milieu de vie de leurs membres ; un réseau et des moyens offensifs-défensifs suffisants ; être politiquement formées et moralement fortes. Encore faudrait-il, ce que ne mentionne pas Mucchielli, avoir des patriotes soucieux du Service Public à la tête de l’État, et non une bande de névropathes géomètres cosmopolites.
C'est d'ailleurs sur ce point que ce remarquable bouquin semble avoir pris un coup de vieux. Écrit par un militaire, ancien communiste, La subversion est à replacer dans son contexte. Qu'en est-il à notre époque post-moderne / néolibérale / liquide (Bauman) / Mètis (Amorim) ? A l'inverse de ce que note Mucchielli, la subversion n'est pas l’œuvre de groupuscules gauchistes, idiots utiles du mondialisme et alliés objectifs du grand patronat. Si la subversion est le renversement de l'ordre établi, c'est bien à la tête de l’État que nous en trouvons les meilleurs (les pires ?) agents : relativisme intégral, fausse neutralité axiologique, acceptation de toutes les idéologies (tant qu'elles ne remettent pas dangereusement en cause le N.O.M.), effacement du passé, désagrégation de la famille, anti-patriotisme, ingénierie sociale négative... Pour le coup, l'accusation d'un pouvoir oligarchique au service de l’Étranger et anti-démocratique (non au référendum européen de 2005 mais oui quand même, machines électroniques ayant transité par les États-Unis avant les résultats finaux des élections présidentielles de 2007) est manifeste. D'aucuns parleront de complotisme en lisant ces lignes. Il leur suffira donc de se reporter à trois ouvrages récents :
• Gouverner par le chaos, où toutes les sources livrées sont publiques.
• Choc et simulacre, présenté par l'ami Drac. Idem.
• La guerre cognitive, dirigé par Christian Harbulot & Didier Lucas de l’École de guerre économique. Où l'action réelle et subversive des États-Unis et de leurs hommes-liges hexagonaux secouera les plus sceptiques, et leur fera comprendre que ce qu'ils nommeront « complotisme » n'est rien d'autre ici que de la guerre psychologique et économique.
Rien de bien neuf au regard de l'Histoire donc.
Mais un décodage par cet ouvrage de Muchielli nous aidera à ne pas tomber dans le panneau en s'orientant vers de faux combats. La vraie subversion reste aujourd'hui celle des anti-mondialistes contre les barjots mondialistes adeptes de fin de l'humanité, de Rfidage généralisé, de post-humanisme et de nivellement populaire à la Idiocracy.
Dernière note en complément : Mucchielli est considéré comme l'un des héritiers de l'école de psychologie sociale de Palo Alto, dont les travaux ont été détournés à mauvais escient par le pouvoir oligarchique. Une bonne base pour connaître les mécanismes de manipulation hérités de la découverte de la cybernétique (notion de système ; feed-back (rétroaction) ; information codée) et de la communication et de mieux les décrypter pourrait donc passer par une lecture des quelques ouvrages suivants : L'invention de la réalité (dir. Paul Watzlawick) ; La nature et la pensée et Vers une écologie de l'esprit (deux tomes), de Gregory Bateson ; Communication et société, de Gregory Bateson & Jurgen Ruesch.
Roger Mucchielli http://www.scriptoblog.com
(1) Mucchielli note que la propagande noire « a pour support psychosocial l'étude des conditions dans lesquelles les défenses précédentes n'existent pas. » La propagande grise, quant à elle, se contente d'interposer un voile d'indétermination quant aux sources. La propagande blanche, enfin, s'avère peu efficace car elle ne convainc que les amis et les hésitants, selon l'auteur. -
Les batailles d’Iéna et d’Auerstedt (14 octobre 1806)

Napoléon passe en revue la Garde impériale à Iéna (Horace Vernet, 1836).En juillet 1806, Napoléon met un terme au Saint-Empire multi-séculaire pour créer la Confédération du Rhin avec les princes d’Allemagne de l’Ouest et du Sud. La Prusse mécontente se rapproche de la Russie et de Londres pour former la quatrième coalition (août). Elle adresse un ultimatum à la France demandant le retrait des troupes françaises stationnées à l’Est du Rhin. Reçu le 7 octobre, l’ultimatum est immédiatement rejeté par Napoléon Ier qui débute une campagne-éclair (il ne rentre que vingt jours plus tard à Berlin).
Le 8 octobre, Napoléon rassemble ses troupes (170.000 hommes) à l’Est de l’Allemagne, entre Cobourg et Baireuth (Bavière), et les répartit en trois importantes colonnes. Le 10 octobre à Saafeld survient la première bataille au cours de laquelle le maréchal Lannes met en déroute les forces du prince Louis de Prusse qui est tué au cours de l’affrontement.
Les armées prussiennes se dirigent vers le Sud-Ouest en trois colonnes : une de 44.000 hommes commandée par le prince de Hohenlohe, une autre comprenant 56.000 hommes menée par le duc de Brunswick (le vaincu de Valmy) et la dernière de 40.000 hommes aux ordres de Rüchel. A ces trois forces armées il faut rajouter une réserve de 20.000 hommes.I. La bataille d’Iéna
Le 14 octobre, Napoléon rencontre le prince de Hohenlohe au Nord d’Iéna. De gauche à droite, les corps armés d’Augereau, la Garde, le corps de Lannes, de Ney, de Soult et la cavalerie de Murat. Au total, 40.000 hommes sont du côté français, avec 173 canons et 12.000 cavaliers. En face, Hohenlohe et Rüchler disposent de 56.000 hommes et 120 canons.
Dans la nuit du 13 au 14, Napoléon fait occuper le plateau du Landgrafenberg, au nord d’Iéna et dominant la Saale. Passés par le Nord, Davout et Barnadotte doivent s’occuper de couper la retraite de l’ennemi. Le 14 octobre, vers 10h, alors que le brouillard couvre le champ de bataille, Napoléon lance Lannes et Ney à l’assaut des lignes prussiennes. Les combats acharnés coûtent cher à l’ennemi. Vers midi, à la gauche de Lannes et Ney, Augereau lance ses troupes contre les Prussiens et les enfoncent. A la droite, au même moment, Soult lance lui aussi l’offensive.
Peu après, à l’extrême droite du champ de bataille, la cavalerie de Murat achève d’écraser les troupes de Hohenlohe qui s’enfuient en direction d’Erfurt. Rüchel, n’étant pas arrivé à temps, est contraint de suivre Hohenlohe dans la débâcle. Les Français ont perdu 5000 hommes (tués ou blessés), les Prussiens 25.000 (dont prisonniers) et leurs canons.
Le lendemain de la victoire, dans sa lettre, Napoléon écrira à Joséphine : « Mon amie, j’ai fait de belles manœuvres contre les Prussiens. J’ai remporté hier une grande victoire. Ils étaient 150,000 hommes; fait 20,000 prisonniers, pris cent pièces de canon et des drapeaux. J’étais en présence et près du roi de Prusse; j’ai manqué de prendre ainsi que la reine. Je bivouaque depuis deux jours. Je me porte à merveille.
Adieu, mon amie, porte-toi bien et aime-moi. »II. La bataille d’Auerstedt

La mort de Brunswick à Auerstedt le 14 octobre 1806.Napoléon avait cru affronter le gros des troupes prussiennes, ce qui n’est pas le cas. Le même jour, Davout et ses 27.000 hommes et 2000 cavaliers mettent en déroute Brunswick et ses 56.000 hommes et 12.000 cavaliers. L’empereur ignore qu’une bataille a lieu même s’il entend des coups de canon au Nord.
Les Français rencontrent les Prussiens sur le plateau de Hassenhausen. Entre 8h et 8h30, Brunswick lance des assauts furieux contre des Français inférieurs en nombre. Sur la droite, les Français résistent héroïquement à la charge des cavaliers de Blücher. Vers 9 heures, Brunswick parvient néanmoins à faire reculer les Français hors du plateau de Hassenhausen. Au même moment, le chef de l’armée prussienne reçoit un coup de fusil mortel. Davout lance alors ses troupes sur le flanc droit prussien qui sont repoussés, permettant la reprise du plateau.
Brunswick hors du combat, le roi Frédéric-Guillaume III prend la tête des troupes mais se révèle être un piètre stratège. Pendant ce temps, les Français ayant enfoncé le flanc droit entreprennent un encerclement. Alors qu’à droite, les Français retiennent les assauts prussiens, à gauche, les Français débordent l’ennemi. En difficulté, le roi de Prusse décide de battre en retraite en milieu d’après-midi. Il compte sur les renforts de Hohenlohe pour reprendre le combat, mais contrairement à ses attentes, celui-ci a été battu un peu plus tôt à Iéna.
A Auerstedt, les Français ont perdu 7000 à 8000 hommes et les Prussiens 15.000 (prisonniers inclus) et 115 canons.
III. Les conséquences

Napoléon entre à Berlin par la porte de Brandebourg (Charles Meynier, 1810).Les batailles combinées d’Iéna et d’Auerstedt permettent d’écraser l’armée prussienne. Berlin n’étant plus protégée, Napoléon entre dans la capitale du royaume de Prusse le 27 octobre. Un armistice est signé le 30 novembre mais les combats reprennent peu après : Napoléon fait tomber les dernières places fortes (Magdebourg, Erfurt, Stettin, Graudenz, Danzig) et occupe les trois quart du pays.
Napoléon poursuit ensuite vers l’Est pour tenter de soumettre un autre grand ennemi continental : la Russie. L’empereur affronte victorieusement les Russes en Prusse orientale à Eylau (7 et 8 février 1807) puis à Friedland (14 juin). Le tsar Alexandre Ier est contraint de négocier. Le traité de Tilsit (7 juillet 1807) permet à l’empereur d’imposer le blocus continental à la Russie (qui ne sera néanmoins pas respecté) et de dépecer les territoires prussiens. Le royaume de Frédéric-Guillaume III est alors réduit de moitié en superficie et perd 5 millions d’habitants.
Bibliographie :
CHAUTARD, Sophie. Les grandes batailles de l’Histoire. Studyrama, 2005.
FACON, Patrick ; GRIMAUD, Renée ; PERNOT, François. Les plus belles victoires de Napoléon. Éditions Atlas, 2004. -
Un témoin de la Tradition : René Guénon
Il y a cinquante ans, le 7 janvier 1951, disparaissait au Caire, en Egypte, le Français René Guénon, l’un des principaux représentants de la pensée traditionnelle au XXème siècle.
DE L’OCCULTISME A L’ESOTERISME
Guénon est né à Blois, en 1899, dans une famille très catholique. En 1904, après un pélerinage à Lourdes, il vient poursuivre ses études supérieures à Paris. Musardant, il n’obtient sa licence qu’à 29 ans, puis est recalé à l’agrégation de philosophie à 32 ans, tandis que sa thèse de doctorat, consacrée à une «Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues», est refusée.
Parallèlement à ses études, Guénon fréquente, dès son arrivée dans la Capitale, les milieux occultistes, se lançant dans une course effrénée aux affiliations et initiations. Il entre à l’Ecole Hermétique, est reçu dans l’Ordre Martiniste, fréquente diverses organisations maçonniques occultistes, est initié dans la loge Tebah de la Grande Loge de France. En 1908, il est secrétaire du IIème Congrès spiritualiste et maçonnique, et devient Souverain Grand Commandeur de l’Ordre du Temple Rénové. L’année suivante, à 23 ans, il est consacré «évêque d’Alexandrie» de l’Eglise gnostique de France, sous le nom de Palingénius, et assure la direction de La Gnose, «revue mensuelle consacrée à l’étude des sciences ésotériques».
Après plusieurs expériences décevantes dans les milieux occultistes, il se tourne vers l’Orient pour trouver la juste voie, celle de la «Connaissance initiatique». Après s’être intéressé au Taoïsme, il est initié, en 1912, au Soufisme, un courant initiatique islamique, sans pour autant embrasser la religion musulmane, comme il le précisera plus tard à un correspondant. Ayant appris le chinois et l’arabe, lisant les textes originaux, il tente de travailler avec des initiés de chaque tradition.
Tout en donnant des leçons particulières et des cours de philosophie, René Guénon écrit de nombreux articles, dans des publications catholiques, comme la Revue universelle du Sacré-Cœur Regnabit, ou traditionalistes, comme Le Voile d’Isis, qui deviendra Etudes traditionnelles. Il publie également des livres.
LA TRADITION CONTRE LE MONDE MODERNE
Dans Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues (1921), et l’Homme et son devenir selon le Vedanta (1925), il définit les critères de la métaphysique traditionnelle universelle. Chez lui, la Tradition désigne l’ensemble de la connaissance d’ordre «métaphysique» : elle admet une variété de formes, tout en restant une dans son essence.
Il insiste sur l’idée, déjà formulée avant lui par Joseph de Maistre et Fabre d’Olivet, d’une Tradition primordiale, qui renvoie à un Centre suprême, détenteur de toutes les connaissances spirituelles, et qui les diffuse par le biais de «chaînes initiatiques» présentes dans les différentes voies religieuses. Dans Aperçus sur l’Initiation (1946), il défend la nécessité du rattachement à une «chaîne», à une «organisation régulière», mais n’offre guère d’alternative à ceux qui refusent de s’en remettre, comme lui, à des musulmans ou des Orientaux. Tout juste reconnaît-il que la franc-maçonnerie reste en principe, malgré sa dégénérescence, une organisation dispensatrice d’une réelle initiation.
L’aspect le plus intéressant de l’œuvre de René Guénon réside dans sa critique radicale du monde moderne, auquel il oppose une référence positive, le monde de la Tradition. Selon lui, la civilisation traditionnelle qui s’est réalisée en Orient comme en Occident -Inde, Moyen-Age catholique, Chine impériale, Khalifat islamique- repose sur des fondements métaphysiques. Elle est caractérisée par la reconnaissance d’un ordre supérieur à tout ce qui est humain, et l’autorité d’élites qui tirent de ce plan transcendant les principes nécessaires pour assoir une organisation sociale articulée.
Celle-ci repose sur la division de la société en quatre castes ou classes fonctionnelles : au sommet, les représentants de l’autorité spirituelle, puis l’aristocratie guerrière, la bourgeoisie des marchands et des artisans, enfin les masses laborieuses. Cette notion de caste fait bien évidemment référence au système hindou, indo-aryen, divisé entre brahmane, kshatriya, vaishyas et çudras. De même, l’Iran, la Grèce et la Rome antiques connurent en partie un type d’organisation sociale analogue, que l’on retrouve, d’ailleurs dans la doctrine politique de Platon. L’ultime reviviscence de ce système en Occident fut le Moyen-Age féodal, le clergé correspondant aux brahmanes, la noblesse aux kshatriyas, le tiers-Etat aux vaishyas et les serfs aux çudras.
Au pôle opposé du monde de la Tradition se tient la civilisation moderne, à laquelle sont propres la désacralisation, la méconnaissance de tout ce qui est supérieur à l’homme, le matérialisme, l’activisme forcené.
Deux livres majeurs, La Crise du monde moderne (1927) et Le règne de la quantité et les Signes des temps (1946) contiennent l’essentiel de cette critique, auxquels on peut ajouter Orient et Occident (1924), qui soutient que ne subsistent désormais de civilisations traditionnelles qu’en Orient. Ce qui conduit Guénon à s’établir au Caire, en 1930, où il prend l’identité du cheikh Abdel Wâhid Yahiâ.
LA REGRESSION DES CASTES
René Guénon n’eut jamais d’activité politique, bien qu’évoluant dans des milieux parisiens d’Action française, car il estimait qu’«il n’y a, à l’époque contemporaine, aucun mouvement méritant qu’on y adhère».
Pour lui, nous sommes à la fin d’un cycle, le Kalî-Yuga ou «Age sombre» prévu par les anciens textes hindous, mais aussi annoncé par d’autres traditions -que l’on songe à «l’Age de fer» d’Hésiode-. Son interprétation du cours de l’Histoire dans un sens involutif, résolument antimarxiste et antiprogressiste, repose sur l’idée de «régression des castes» : à une société gouvernée dans des temps quasi-mythiques, par des Rois sacrés de droit divin issus de la première caste, succède le règne de la caste guerrière, de monarques de type laïc, chefs militaires ou seigneurs de justice temporels, qui s’achève en Europe avec le déclin des grandes monarchies, puis vient le gouvernement du tiers-Etat, de la bourgeoisie, l’aristocratie cédant le pas à la ploutocratie, enfin, c’est l’émergence de la dernière caste, de la classe ouvrière, qui trouve sa conclusion logique dans le communisme et le soviétisme.
Cette idée de régression des castes sera reprise par Julius Evola dans son maître-livre Révolte contre le monde moderne, publié en 1934. Guénon consentira d’ailleurs à la publication de ses écrits dans la page culturelle dirigée par Evola, de 1934 à 1943, dans le quotidien Il Regime Fascista..
CONNAISSANCE ET ACTION
Redevable en bien des domaines à Guénon, Evola s’en sépare cependant sur un point : il s’agit des rapports de l’autorité spirituelle et du pouvoir temporel, c’est-à-dire du sacerdoce et de la royauté. Dans son livre Autorité spirituelle et pouvoir temporel publié en 1929, Guénon affirme la primauté du sacerdoce par rapport à la royauté. Pour lui, le Brahmane est supérieur au Kshatriya parce-que la connaissance est supérieure à l’action et le domaine «métaphysique» au domaine «physique». Même dans le cas où les membres de la caste sacerdotale ne paraissent plus dignes de leur fonction, le bien-fondé de leur supériorité de principe ne saurait être discuté, afin d’éviter le risque d’une désagrégation du système socio-politique. Au contraire, Evola, qui considère que la culture de l’Occident s’enracine dans une «tradition de guerriers», défend la thèse inverse, estimant qu’avec le raisonnement de Guénon l’on se trouve en présence du «point de vue brahmanico-sacerdotal d’un Oriental».
Fidèle à sa nature de brahmane, de sage, René Guénon fut plus un témoin de la Tradition qu’un acteur de son temps, à l’opposé du kshatriya, du guerrier Julius Evola, seul véritable révolté contre le monde moderne au XXème siècle.
Edouard Rix http://www.voxnr.com -
Vae Victis - Les Bars de Lorient