Au coeur de l’Histoire (Franck Ferrand), émission du 07/02/13.
Invités :
Jean-Christophe BUISSON, rédacteur en chef culture du Figaro Magazine
Michel PERNOT, agrégé d’histoire, maître de conférences honoraire des universités.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Au coeur de l’Histoire (Franck Ferrand), émission du 07/02/13.
Invités :
Jean-Christophe BUISSON, rédacteur en chef culture du Figaro Magazine
Michel PERNOT, agrégé d’histoire, maître de conférences honoraire des universités.
Jean-Yves Le Gallou poursuit son travail sur les manipulations des mots et des médias, et nous présente son nouveau livre, « La Tyrannie Médiatique », consacré aux mensonges médiatiques, à la pensée unique et à la désinformation.
Jean-Yves Le Gallou : "La Tyrannie Médiatique" par MrPierreLegrand
À la vision de l'homme cartésien « maître et possesseur de la nature », promoteur d'une science opératoire, cet article oppose un art conçu dans le prolongement de la nature, où il serait déjà présent de façon immanente, privilégiant l'approche contemplative.
L’écologie politique est l'enjeu majeur du XXIe siècle, entend-on souvent. Mais de quelle écologie parlons-nous ? Parce qu'elle utilise des moyens variés et parfois contradictoires, fait appel aux sentiments humains ou à la rationalité scientifique, défend les animaux ou bien l'homme, parce qu'elle est diverse et qu'il n'y a pas qu'une forme d'écologie mais des écologies, il convient de rappeler que celles-ci ne sont pas toutes bonnes et que si la finalité reste la même (« Sauvons notre planète ! ») les moyens mais surtout les principes qui les régissent s'opposent bien souvent.
Rivalité historique
Notre rapport à la nature n'a pas toujours été identique au cours de notre histoire. Pierre Hadot, dans Le Voile d'Isis - Essai sur l'histoire de l'idée de nature, met en évidence l'opposition entre l'attitude « prométhéenne » et l'attitude « orphique » vis-à-vis de la nature. « Si l'homme éprouve la nature comme une ennemie, hostile et jalouse, qui lui résiste en cachant ses secrets, il y aura alors opposition entre la nature et l'art humain, fondé sur la raison et la volonté humaines. L'homme cherchera, par la technique, à affirmer son pouvoir, sa domination, ses droits sur la nature. » C'est l'attitude prométhéenne. « Si, au contraire, l'homme se considère comme partie de la nature, parce que l'art est déjà présent, d'une manière immanente, dans la nature, il n'y aura plus opposition entre la nature et l'art, mais l'art humain [...] sera en quelque sorte le prolongement de la nature, et il n'y aura plus alors rapport de domination. » C'est l'attitude orphique.
Ce que nous appelons la vision anthropocentrique du monde, fondée en grande partie sur la philosophie aristotélicienne, était cette attitude orphique qui consistait à lier l'homme à la nature, à faire du microcosme humain une partie du macrocosme (du cosmos, de "l'univers"). À cette tradition "logothéorique" dans laquelle la science était contemplative et observait les phénomènes naturels pour les étudier, s'est substituée une autre tradition lors de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Des personnages comme Képler, Bacon, Galilée ou encore Descartes en sont représentatifs.
L'univers mis en équations
Le chancelier anglais Francis Bacon (1561-1626) propose ainsi un Novum Organum (1620) pour remplacer l'ouvrage majeur de la physique aristotélicienne, l'Organon : les méthodes scientifiques changent radicalement, partant des phénomènes particuliers et non plus des lois générales, supprimant toute idée de finalité, refusant les préjugés (« idoles ») qui occultent notre faculté d'observer. Si ces méthodes scientifiques se révèleront bien plus efficaces, elles s'accompagnent toutefois d'une philosophie qui sera le point de départ de nos problèmes écologiques contemporains : René Descartes (1596-1650) justifie en effet la promotion du mécanisme, c'est-à-dire la compréhension du monde à l'aide de la géométrie et des calculs arithmétiques. Le paradigme technoscientifique (la science opératoire) remplace alors le paradigme logothéorique (la science contemplative) : l'homme doit donc se rendre « comme maître et possesseur de la nature » (Discours de la méthode).
Dés cet instant, comme le dit le poète anglais John Donne au XVIIe siècle : « Tout est en morceaux, toute cohérence disparue ; plus de rapports justes, rien ne s'accorde plus. » Galilée fait du monde un grand livre dont le langage serait mathématique. La nature s'éloigne de notre perception intuitive, elle devient étrangère, énigmatique. Se développe un vocabulaire judiciaire pour faire parler cette nature si récalcitrante à nous livrer ses secrets : « Les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la torture des expériences que lorsqu'ils suivent leur cours naturel » (Francis Bacon, Novum Organum). Cuvier reprendra cette métaphore : « L'observateur écoute la nature, l'expérimentateur la soumet à un interrogatoire et la force à se dévoiler. » L'homme devient alors « le maître des oeuvres de Dieu » ( Johannes Kepler, De macula in sole observata).
Positivisme
La science se fait violente, toute puissante, et le XIXe siècle, avec ses nouveaux moyens scientifiques, va pousser plus loin encore cette vision du monde. Le positivisme, créé par Auguste Comte, tend à appliquer la méthode scientifique à tous les domaines (y compris à la morale ou à la société). L'idée de progrès humain ne fait qu'avantager cette perception d'une nature régie par la science, dont témoigne l'Exposition universelle de Paris en 1889 qui a pour symbole la tour Eiffel, qui signe l'âge de l'acier et de l'électricité. La science toute puissante a alors ses prophètes (Palissi, Papin, Lavoisier, Pasteur, Berthelot, etc.), ses temples (expositions universelles), ses idoles (tour Eiffel) ; ce XIXe siècle marque un changement dans notre rapport au monde, dans le prolongement du XVIIe siècle.
Si l'homme agit sur la nature comme un maître et comme un tortionnaire, alors il ne fait plus partie intégrante de la nature. La révolution darwinienne comme les nombreuses oppositions au positivisme ne semblent pas avoir véritablement porté dans le grand public. Nous assistons toujours au règne d'une science toute puissante qui serait la seule à pouvoir distinguer le vrai du faux : ne demande t'on pas toujours des "preuves scientifiques" ? Le terme même de "scientifique" ne s'identifie- t-il pas, de plus, en plus à "vérité" ?
Manichéisme
De fait, l'homme est plus que jamais coupé de la nature, considéré comme radicalement autre, et bien souvent l'écologie nous propose une vision moderne de cet homme cartésien « maître et possesseur de la nature ». En témoigne le vocabulaire utilisé couramment, les oppositions de langage que nous faisons entre "naturel" et "culturel", "biologique" et "chimique", alors que la culture est proprement un phénomène de nature chez l'homme et que la chimie est tout aussi présente dans la nature que dans les pratiques humaines. Ajoutons ce manichéisme réducteur, de plus en plus accentué, entre une nature belle et bonne (l'homme ne l'est-il jamais ?) et un homme destructeur et égoïste (la nature n'est-elle pas aussi souvent terrible et dangereuse ?).
Peut-être faut-il se réconcilier avec la nature et se comprendre à nouveau comme partie intégrante de ce monde. L'écologie politique, qui est bien dans sa terminaison même l'accord entre la nature et l'homme, commence sans doute par cette considération essentielle : l'homme est naturel, il est à la fois animal et politique ; sa spécificité tient donc dans la possibilité qu'il a d'harmoniser nature et culture.
Dimitri Julien L’ACTION FRANÇAISE 2000 4 au 17 novembre 2010
Il y a près d’un mois déjà ce dimanche 13 janvier 2013, journée digne des HLPSDNH de sinistre mémoire, une troupe de
« misérables factieux de la secte réactionnaire-bourgeoise, n’hésita pas à défier le gouvernement démocratique et populaire de West-Europa. Ce ramassis de séides de la réaction nationale-négationniste osa profaner le sol de notre capitale Delanoë-City pour dévaster les quartiers réservés à l’élite progressiste et à nos dirigeants bien-aimés ».
Enfin, crime des crimes,
« ces séditieux foulèrent de leurs pieds d’agitateurs malfaisants, la pelouse sacrée du Champ des Martyres LGBT, où se dresse illuminée de mille feux la Tour Taubira » !

C’est à peu de choses près la vision qu’auront eu les sectaires au pouvoir, de ces français manifestant pacifiquement une légitime inquiétude : se voir imposer une loi dénaturant le mariage traditionnel.
Le PS et ses compères ont en effet mis en ordre de marche une machine de guerre et de destruction du socle familial qui, associée à la GPA et autres PMA, mènera à terme à la marchandisation des enfants. Et ce n’est pas la dernière initiative de la garde des Sceaux autorisant la délivrance d’un certificat de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de mère porteuse, qui va nous rassurer quant à la bonne foi de ce gouvernement.
« Portant sur le front une mâle assurance, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort… »
Nous vîmes ce dimanche-là, la France profonde, le pays réel si cher Maurras, la France qui ne descend jamais dans la rue, exprimer des seules armes qui lui restent, puisqu’on lui a confisqué tout autre moyen d’expression, son opposition à cette criminelle loi dite du « mariage pour tous ». Nos pieds et nos slogans furent nos bulletins de vote (cela dit, voir autant de français dans la rue après huit mois de présidence, permet d’apprécier la performance des socialos. Chapeau bas !).
Quand à la polémique qui fit suite sur le nombre de participants à cette marche, elle aura vu les sots, la flicaille régimiste, les journalistes à la botte du pouvoir et les progressistes nuisibles, ne pas reconnaitre l’ampleur de la manifestation (800 000 au bas mot, selon le général Dary, conseiller du « comité de pilotage » de la manif). Les sites d’information honnêtes ont facilement démontré les tentatives de trucage des services officiels et des relais du pouvoir.
Il n’y a pas si longtemps encore, un déploiement de telle ampleur aurait « interpellé » n’importe quel gouvernement un tant soit peu responsable. Oh, rassurez-vous, pas pour reconnaitre de quelconques erreurs, mais uniquement pour préserver une certaine tranquillité sociale et ne pas trop compromettre les élections suivantes. Assurer un repli stratégique sur quelques sujets devenus brusquement « à problème », ne fait en principe pas tomber un gouvernement ; un ministre, tout au plus.
Aujourd’hui la donne a changé.
La populace contre l’Elite progressiste
Les socialistes, les progressistes et toute l’avant-garde de l’humanité éclairée, sont maintenant au pouvoir. Le droit est donc pour eux. Enfin surtout le droit d’avilir le peuple, ce conglomérat de crétins visiblement butés ayant trahi ses leaders naturels, en votant notamment pour cette peste « Bleue Marine » (couleur qui reste plus seyante tout de même que la peste brune de jadis). Ces abrutis en bleu de chauffe sont vraiment trop bas de plafond, pour n’avoir comme minable horizon que l’épaisseur de leur porte-monnaie et n’avoir pour soucis, que le remplissage du bol de soupe après le 15 du mois. Et trouver un travail pour les moins doués d’entre eux.
Non, les enjeux essentiels, cruciaux et primordiaux de ce 21ème siècle sont ailleurs, comme la socialo-kommandantur s’efforce de le démontrer, vainement visiblement : supprimer les voies sur berges à Paris, remplacer le terme de « maternelle » pour ne pas déstabiliser nos chères petites têtes (de moins en moins) blondes, ouvrir des supermarchés de la dope pour se piquer en toute légalité sous les yeux consternés de la maréchaussée, canoniser cette pseudo-naïve mais vraie pénible Florence Cassez et donc, objet de toutes les attentions du moment, permettre aux fofolles de convoler enfin en justes noces.
Tout bien réfléchi, les travailleurs ne méritent vraiment pas l’élite qui est aux commandes et qui elle, sait ce qui est bon pour le vulgum pecus. Le revers de la démocratie, sans doute…
Ce foutu peuple, manipulé par des religieux obscurantistes et des lepeno-sarkosistes, s’est une fois de plus fourvoyé dans l’ignorance des vrais enjeux de société. Il aura démontré son ignorance crasse du fléau de la discrimination homo et fait montre d’un égoïsme petit-bourgeois envers une population si cultivée, aux goûts si sûrs, mais ostracisée, proscrite, bannie et vilainement ghettoïsée dans les profondeurs sordides des 3ème et 4ème arrondissements de la capitale. Heureusement, le train du progrès sociétal est maintenant en marche et rien ne l’arrêtera, surtout pas une majorité des français rétrogrades !
La démocratie, c’est « cause toujours ! »
Eussions-nous été 2, 5 voire 10 millions de marcheurs, la si peu avenante tétèche1 Taubira serait restée inflexible, droite comme une canne à sucre sous son katoury2 créole !
Pourquoi donc demander l’avis du peuple sur des sujets que seule l’élite auto-proclamée du Marais parisien est légitime à traiter ? Certes, un candidat socialiste devenu brusquement autiste depuis son arrivée à l’Elysée, s’était engagé à consulter la Nation sur des sujets majeurs de société, mais ça, c’était avant, du temps des promesses des banquets de campagne.
Un référendum, exigiez-vous ? Quelle bonne blague ! MDR ! « Hors de question » nous aura martelé l’acariâtre mégère de la place Vendôme. « PAS CONS-TI-TU-TIO-NNEL » 3, parait-il. En somme, mettre un bulletin dans une urne n’est pas démocratique. Parfait, j’en prends bonne note.
Eh oui,
« bande de mécréants rétrogrades et ignorants, on a des députés de gauche pour voter les lois qui conviennent au populo, cela suffit bien. Toi y’en a comprendre ? Ta mauvaise foi fascistoïde devrait t’étouffer vu que le débat a déjà eu lieu il y a 5 mois de cela, abruti de francaoui hétéro ».
Fermez le ban et les urnes avec !
Quant au réac-catho version Cyrillus, forcément manipulé par les corbeaux noirs de l’épiscopat, eux-mêmes téléguidés par la Place Saint-Pierre de Rome, qui se poserait ingénument la question de savoir où ont bien pu se dérouler les fameux débats évoqués par la Gôche, il n’aura qu’à écrire au ministre en question pour de plus amples renseignements. Se voir confisquer derechef sa carte d’électeur pour outrage à la Démocratie Populaire de Métisse-Land, est un risque qu’il faudra assumer, mais après-tout, pour ce à quoi elle sert… (La bonne nouvelle, c’est que depuis le 13 janvier, ce pays compte donc au bas mot 1 000 000 d’antidémocrates. Bonne nouvelle pour le Centre Royaliste d’Action Française. Envoyez les cotises !).
Un peuple désespéré aujourd’hui, en colère demain ?
Il n’est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quand cette surdité gouvernementale s’accompagne du plus parfait terrorisme intellectuel sauce bolchévique, une protestation gentillette comme celle du 13 janvier restera sans effet et amusera follement des bobos invertis sûrs de leur victoire. Le Marais s’en amuse déjà.
Alors, un coup d’épée dans l’eau le crapahut du 13 janvier, alors que l’organisation d’une nouvelle marche de protestation semble pourtant se dessiner ? Et bien soit, marchons donc de nouveau. Mais enfin, pour atteindre quel objectif ? Pour un autre 13 janvier familial, propret, œcuménique et festif (et si possible moins froid et humide, merci) ?
Evidemment, trottiner en famille restera toujours utile pour nos silhouettes malmenées par les derniers réveillons et autres chandeleurs. Mais la multiplication des pieds sur le pavé parisien ne changera probablement pas la donne, sauf à courroucer de nouveau cette folledingue de Maire de Paris qui ne manquera pas d’envoyer une nouvelle facture pour dégradation de pelouse (porter atteinte aux pelouses, voilà qui doit bien traumatiser nos « amies » lesbiennes, tiens).
C’est pourquoi, à toi Ministresse de l’Injustice, à toi et à ton gouvernement de discorde, nous le peuple de France, nous te conseillons de porter une très vive attention à ce qui s’est passé ce 13 janvier. Votre hautaine et méprisante attitude envers les citoyens, ces autochtones que vous méprisez depuis vos lambris et vos dorures pourtant si peu populaires, heurte nos consciences et blessent nos cœurs.
Le peuple était dans la rue et vous, gouvernement de schizophrènes, vous ne vous en n’êtes pas rendu compte, préférant écouter la minorité d’inverti qui vous sert de cour. Môssieur le Président aura ainsi préféré se faire tirer le portrait avec deux représentants LGBT pleurnichards, sodomites au teint blafard et au regard de vipères sadiques, sinistres représentants d’une minorité de minorité. Mais notre Flamby-le-boutefeux lui, refusera d’écouter « son » peuple qui crie aujourd’hui son désespoir et son incompréhension. Tout juste condescendra-t-il à recevoir en catimini la madone Barjo. Que d’égards…
Hier le Champ de Mars, demain l’Elysée !
La gauche n’aime pas le peuple français, elle s’en sert. Terra Nova lui a d’ailleurs déjà expliqué comment s’en passer. Quant à la république, elle a souvent montré qu’elle n’aimait pas les français. Hier, elle tirait sur la foule (vendéens et chouans, canuts de Lyon, fusillés de Fourmies et de Draveil, anciens combattants et nationaux du 6 février, pieds noirs et harkis…), aujourd’hui elle se contente de l’ignorer et de la mépriser. Combien de temps encore se contentera-t-elle de cette passivité, avant de faire sortir ses gardes-mobiles ?
Le peuple de France a bien des défauts, mais il pourrait ne pas oublier votre morgue de corrupteurs de civilisation. Un roi et une reine, martyrs de 1793, n’avaient pas cette tare-là, surtout pas le millième de la perversité des mandarins actuels et pourtant, Samson fit tomber leur tête au pied de l’échafaud.
D’une façon ou d’une autre, le peuple de France vous fera payer votre cécité, votre entêtement criminel et votre dédain des vrais français et de leur civilisation.
Pour se faire entendre, il va donc falloir passer au stade supérieur et ne pas se contenter d’user nos croquenots sur le pavé dans l’espoir d’un revirement intellectuel des fripouilles au pouvoir, ou dans l’espoir qu’une hypothétique alternance UMPesque fasse machine arrière (ce qui semble assez improbable au vu du discours actuel de ce traitre de Jacob).
La voie du salut passera d’abord par la transformation des bisounours de paroisse en vrais insurgés et d’électeurs passifs en militants actifs de la cause nationale.
Et de faire de ces républicains, des royalistes.
Mais avant de décréter le premier jour de l’insurrection nationale qui chassera de ses palais l’élite auto-proclamée de la branchitude invertie, j’invite le Maréchal Flamby sauveur du Mali, probablement déjà Grand-Maître l'Ordre de la Médaille de l'Etoile d'Argent du Mérite National Malien, à s’occuper enfin des millions de chômeurs qui hantent le Pôle emploi, aux milliers d’artisans, commerçants et paysans étranglés par le fisc. Eux non plus ne vont pas tarder à descendre dans la rue, histoire de rappeler à la gauche ce qu’est le peuple, le vrai, le travailleur, le besogneux, celui qui par ses impôts, vous permet de dilapider les richesses de la France.
Que la gauche persévère dans cette fuite en avant, préférant donner satisfaction aux promoteurs des idées les plus folles et s’entêtant à répandre son idéologie destructrice (mariage pour tous, droit de vote des immigrés, police de la pensée et novlangue à foison), sans vouloir s’occuper des vrais problèmes de notre pays, elle trouvera de plus en plus de français dans la rue pour s’opposer à sa dictature molle.
Quant à dame Taubira, condescendante « Garde des Sots », qu’elle médite donc ce dicton de sa Guyane natale :
« Jwé bien ké makak mé pa pilé so latjo »
« Jouez tant que vous voulez avec le singe, mais ne lui marchez pas sur la queue »
Nantes, article écrit le jour anniversaire du 6 février 1934 http://soudarded.hautetfort.com
« La race du futur sera eurasienne négroïde, elle remplacera la diversité des peuples par une multitude de personnalités. L’homme du futur sera métissé. » Nicolas Coudenhove-Kalergi.
Le complot, cet objet de recherche de ceux que les media du Système appellent conspirationnistes, implique des acteurs bien précis, une histoire (un passé) tout à fait réelle, et bien sûr une « eschatologie » unique et précise aussi cachée, voire plus, que le véritable fonctionnement interne de la machinerie sociopolitique mise en œuvre par cette engeance implacable. Il est compréhensible que l’immense majorité de la population occidentale ne croit pas à ce Complot comme elle ne croit pas non plus aux milliers de conspirations mises en branle chaque jour à travers le monde pour neutraliser tel opposant, tel causeur, tel indiscret ou nous ne savons qui encore. Ou afin que l’Engeance s’accapare de nouvelles richesses, de nouveaux pouvoirs locaux, afin que les tentacules du poulpe sectaire enserrent plus sûrement encore les sociétés qu’il mène vers le plus parfait des esclavages. Comment le téléspectateur lambda shooté quotidiennement à ses flashes morphiniques, à ses émissions stupéfiantes, à ses séries propagandistes, à sa téléréalité de vie virtuelle addictive, pourrait-il parvenir à s’extraire de cette prison mentale dans laquelle l’enferme constamment le complexe médiatique d’aujourd’hui ? Comment le gentil petit électeur désinformé au jour le jour par les JT des grandes chaînes de télévision qu’il avale avec délectation croyant s’enrichir intellectuellement par ce biais et aiguiser son esprit critique, comment ce parfait abruti nourri de messages subliminaux, de rhétorique propagandiste savamment distillée parviendrait-il à observer objectivement (le pléonasme est ici nécessaire) le monde de pantomime jouée par des acteurs politiques de figuration ? Quelle gageure pour l’esprit se voulant libre de rompre d’avec le joug informatif officiel qui l’aiguillonne et le tient bien au chaud dans l’illusion du confort d’une sorte de cocon maternel de savoirs et d’autorité !
Dans son cocon anxiolytique, le télémane est aveugle
On le voit, on le sait, la télévision constitue une source sacrée d’informations pour toute sa clientèle ! Le politicien en mauvaise posture peut toujours mentir et « pratiquer la langue de bois », mais le journaliste de télévision cravaté, poli, souriant « qui est ton ami » ne pourrait trahir le spectateur selon ce dernier : L’éventualité de la trahison n’est même pas envisagée par le télémane. Le souriant de la télé aux yeux humides est ton ami. Et à l’instar de la présentatrice gourgandine de la météo, le lecteur du 20H du prompteur de Big Brother constitue en quelque sorte le garant de la vérité, le vulgarisateur de la complexité factuelle de ce monde, le tuteur quotidien du cerveau du télétox, le corset émotif de tous ces esprits bridés de naissance. Quiconque a tenté d’éclairer au moins une fois l’un de ces télémanes sur des questions politiques dissonantes a compris sur quel roc son discours circonstancié, même formidablement argumenté, imparable, s’écrasait-il… L’expérience impossible ! Tant le « vu à la télé » hypnotise-t-il l’abruti de la petite lucarne. Pas touche au Totem qui a bercé l’enfance du téléspectateur, car, en effet, l’écran de télévision représente pour tous les moins de cinquante ans voire pour les moins de soixante ans une véritable mère qui les a dorlotés par ses dessins animés, ses reportages animaliers, son sport et qui a toujours pris la défense du gentil souriant contre « tous ces névrosés faisant grise mine ». Comment cette mère chaleureuse, (la téloche est toujours visionnée dans des lieux de vie agréable, le télétox s’étant confectionné un petit espace lui permettant de baigner dans une sorte de liquide amniotique symbolique avec canapé douillet, nourriture à portée de main –souvent grasse et sucrée-, comme si notre néo-bébé était relié à un cordon ombilical qui le rassurait en permanence. La télé est le plus puissant des anxiolytiques modernes et ce n’est pas le malade télétox qui va entreprendre avec masochisme une entreprise de démythification de son remède miracle !), pourrait-elle nuire à ses enfants, comment pourrait-elle leur mentir alors qu’elle prône sans cesse le libre-arbitre et la liberté de jouir tout en leur conseillant d’être prudents en hiver sur le verglas nivéal des petites routes de campagne comme maman exhorte ses enfants à fuir le grand méchant loup ? Et le media présente aux spectateurs-« citoyens » le monde comme l’Engeance veut qu’il soit présenté, avec ses faux représentants politiques, ses faux moralistes, ses faux gardiens, ses faux sages, ses fausses religions, ses fausses disputes, ses fausses joutes électorales, ses faux débats créés ex nihilo, ses faux opposants et même ses faux diables. Dans cette configuration il est sûr que notre télévore (qui représente l’Hexagonal de base, il faut bien l’avouer) ne puisse imaginer sérieusement, une seule seconde, que la vérité est ailleurs, que l’élite ne lui veut pas forcément du bien, qu’il existe un énorme complot travaillant à sa parfaite soumission, et qu’une fraction de la population mondiale est vouée à disparaître. Un sentiment de confiance et de sérénité (objectivement complètement injustifié) alimenté intensément par le cinéma qui tourne systématiquement au ridicule la réalité du complot que l’ « on » présente toujours comme « les » théories du complot et donc comme une pure construction intellectuelle névrotique. Pour la masse, il ne saurait ainsi y avoir de conspiration intégrale. Cependant, le « citoyen » un peu plus curieux, un peu moins téléphage, se sentant davantage enraciné que ses malheureux congénères, ressentant quelque malaise en son for intérieur, éprouvant le besoin de connaître l’envers du décor par instinct de vie, se heurte d’emblée au cours de ses recherches balbutiantes aux postulats mensongers d’intellectuels qui ont infiltré diverses mouvances pour étouffer, freiner, saboter, toute renaissance nationaliste. De Taguieff à Alain de Benoist, du postmoderne Maffesoli aux prétendus fascistes du Troisième Millénaire, tous nient quasiment sans argumenter mais en postulant avec une effroyable violence, avec cette condescendance de petits profs ignares ou stipendiés qui devrait les rendre insupportable, que le complot n’existe pas, que la rationalité dit « non au complot » (!), que croire au complot impliquerait une façon imbécile de penser… Selon ces tristes sires, il n’y a pas complot parce qu’il n’existerait tout simplement pas de société secrète suffisamment puissante pour orchestrer cette gigantesque entreprise… Là aussi, il s’agit d’un postulat arbitrairement posé, de la posture d’agents systémiques qui camouflent l’objet de leur mission sous un vernis intellectuel de petite facture mais que personne au sein de la clique élitiste ne viendrait à discuter. Alors beaucoup de petits curieux, en majorité peu téméraires, abandonnent le paradigme complotiste qui « vous fait passer pour un doux dingue ou un fou furieux dans les dîners entre amis »… Et Dieu sait que les hommes « désespérément normaux » craignent plus que tout d’être marginalisés, stigmatisés, réputés négativement. Le tour est joué ! Et au sein même de la mouvance nationaliste… Il fallait le faire ! Ils l’ont fait !
Le Complot démasqué ?
Alors si je veux ici recenser l’ouvrage extraordinaire des Néerlandais Robin de Ruiter et Fritz Springmeier, le fameux Livre Jaune Numéro 7, intitulé Les 13 lignées sataniques, la cause de la misère et du mal sur Terre, quelques cerveaux programmés par les discours pavloviens de petits gourous de la Nouvelle Droite antinationaliste et maçonnique déchireront réflexivement mon papier, leur inconscient leur ordonnant d’agir ainsi pour rester dans le cadre conforme de la rationalité définie. Pendant des années, le lectorat nationaliste a été abreuvé de fausse logique sociologique et de ce que l’on appelle la théorie de l’individualisme méthodologique consistant à voir dans chaque fait social le fruit d’actions non concertés d’individus liés ou non entre eux par le travail, les intérêts ou quelques valeurs. Mais jamais, je dis bien jamais, dans cette mouvance nouvellement droitière un fait ou un phénomène social, politique ou sociétal n’a été analysé avec une entière honnêteté scientifique, et donc en prenant en considération le fait que l’évènement étudié puisse découler d’un complot ourdi par une engeance définie. L’explication est d’analyse marxiste, matérialiste, individualiste, purement et ouvertement axiologique mais jamais, jamais, d’origine complotiste. Comme si quelques centaines d’individus sur cette Terre n’avaient ni les moyens, ni l’envie, ni le loisir d’agir secrètement pour concrétiser leur rêve ou pour réifier dans ce monde des projets secto-religieux animant cette élite dont la puissance est inimaginable aux yeux du grand public. Cela a le don, certainement, de troubler la sérénité de ceux qui postulent qu’il ne faut pas « se ridiculiser » en lisant et en évoquant le complot mondial. Mais les auteurs du Livre Jaune ne postule pas arbitrairement, contrairement à tous ces censeurs anti-conspirationnistes, mais argumentent chaque assertion et illustrent par des documents consultables chaque point de leur démonstration. L’érudition est au rendez-vous, comme les sciences psychologique et sociologique, les saines intuitions, et la documentation historique, n’en déplaisent aux persifleurs maçons infiltrés au sein de la mouvance nationaliste. Pourtant, il suffit pour appréhender la queue visible de la Conspiration de se référer aux déclarations multiples de membres des plus grosses familles cosmopolites mondiales. Comme celle-ci de David Rockfeller dictée doctement en 1991 à quelques journalistes aux ordres : « Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New-York Times, Time Magazine et d’autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l’exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. » Le Complot s’établit étape après étape en fonction de la vitesse de désagrégation de l’esprit critique des populations occidentales. Nier cela relève d’une incroyable stupidité ou d’une profonde malveillance. D’autant plus que ces sorties mondialistes sont nombreuses et parfois, comme ici, sont des déclarations de membre de l’une des 13 familles « sataniques » qui sont depuis des décennies, voire des siècles, en relation étroite les unes avec les autres. Tout cela apparaîtrait peut-être farfelu si les prévisions, les « prophéties », les prédictions de tous ceux que nos auteurs néerlandais désignent comme étant des Illuminati, ne devenaient systématiquement choses réelles. Les familles incriminées sont toutes mises en exergue dans Le Livre Jaune. Leur enrichissement expliqué, leur réseau économique, politique et religieux mis en lumière. Avouons que l’on apprend beaucoup de choses à sa lecture !
Certains sujets agitant les gouvernements de toutes les nations (peut-on cependant encore parler de nations dignes de ce nom ?) industrialisées ont directement été introduits sur la scène politique mondiale par un Rothschild, un Russell, un Dupont, un Rockefeller, un Warburg, un Collins. En 1987, Edmund de Rothschild balançait pour la première fois lors du Quatrième Congrès Mondial sur les Milieux Sauvages l’idée saugrenue que le CO₂ était la cause d’un réchauffement mondial créé par l’homme. Et l’on remarquera, a posteriori s’il le faut, que toutes ces familles diaboliquement riches n’interviennent que lors de congrès mondiaux pour affirmer des solutions mondiales à des problèmes « évidemment » mondiaux… La solution est toujours mondiale puisque le problème est toujours mondial… Enfin sont mondiaux les « problèmes » choisis par l’Engeance ! Elle n’est pas bête la Bête ! La pollution est mondiale (quid des pollutions locales qui tuent des dizaines de milliers de personnes chaque année ?), la démographie est mondiale, le réchauffement est mondial, le sida est mondial, l’homosexualité est un phénomène mondial, les droits de l’homme doivent concerner le monde entier comme la démocratie, la tolérance, la liberté, l’éducation des petites filles, la chirurgie esthétique et tant de sujets que choisit en fonction de son agenda l’Engeance qui nous gouverne.
Des acteurs hétéroclites mais…
Si la plupart des Illuminati (car il s’agit bien ici d’un traitement des agissements de cette secte hyperpuissante à travers le monde) provient originellement d’Europe occidentale, nombre d’entre eux sont étrangement issus du Proche Orient, et émanent en particulier du peuple bigarré des Khazars et de cette population néo-juive assoiffée de conquête et disposée culturellement à imposer ses délires politico-ésotériques sur le reste du monde. Mais nous trouvons encore d’autres Illuminati à travers la planète. En Chine en particulier où la famille Li jouit d’une grande tradition en Chine… Pour les auteurs du Livre Jaune qui avancent les arguments, circonstanciés et explicités limpidement, « il ne fait aucun doute que la Chine communiste fait partie du complot pour le Nouvel Ordre Mondial, qu’elle collabore avec le système des Illuminati. »
Des méthodes radicales !
Robin de Ruiter et Fritz Springmeier s’intéressent également de près aux moyens utilisés par l’Engeance mondiale et mondialiste dans sa conquête effrénée du monde. Ils évoquent à ce propos le projet Monarque qui consiste, aujourd’hui plus que jamais, à contrôler un nombre défini de cerveaux (par le truchement de la torture, du viol, de l’éducation intégrale de petits nourrissons jusqu’à leur âge adulte…) qui sont autant d’armes télécommandées à distance qui meuvent les terroristes et les forcenés d’aujourd’hui et de demain. Il est toujours utile d’activer quand le besoin s’en fait sentir pour ces familles proprement lucifériennes de pauvres fous qui vont s’en aller abattre telle ou telle personnalité gênante, trop gênante. Nous étions sincèrement un peu sceptiques avant d’entreprendre la lecture des chapitres concernant ce thème. Mais encore une fois, il faut avouer que les descriptions et les documents avancés par nos chercheurs chamboulent quelque peu certaines idées reçues. Bref, ce numéro 7 doit être lu par tout nationaliste curieux. Car même si le lecteur sceptique de nature, insensible à la réalité du complot, balaie d’un revers de main les conjectures de nos audacieux auteurs, il ne pourra dénier l’énorme travail de ces derniers, et la mise en exergue de tous ces indices démontrant malgré tout l’effroyable « légèreté » de nos funestes dirigeants. Un ouvrage indispensable.
François-Xavier Rochette.
Livre Jaune Numéro 7, les 13 lignées sataniques, la cause de la misère et du mal sur Terre, Mayra Publications, commande à La Librairie Française (sur Internet), 318 pages, 30 euros (4 euros de port).
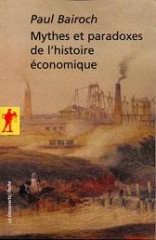 Les idées reçues contemporaines sont le fléau quotidien de tout chercheur de vérité. Combattre le lieu commun constitue un exercice délicat tant les cerveaux humains sont aujourd’hui, mais cela ne date pas d’hier, contaminés par l’opium de l’oligarchie dirigeante. Paul Bairoch, dans son livre Mythes et paradoxes de l’histoire économique, fait l’exégèse des lieux communs en matière d’histoire économique.
Les idées reçues contemporaines sont le fléau quotidien de tout chercheur de vérité. Combattre le lieu commun constitue un exercice délicat tant les cerveaux humains sont aujourd’hui, mais cela ne date pas d’hier, contaminés par l’opium de l’oligarchie dirigeante. Paul Bairoch, dans son livre Mythes et paradoxes de l’histoire économique, fait l’exégèse des lieux communs en matière d’histoire économique.
Selon lui, « l’histoire économique est un sourd qui répond à des questions que nul économiste ne lui a jamais posées ». Son premier objet d’étude est la crise économique de 1929. Selon la légende, elle serait due essentiellement à la montée du protectionnisme. Or, en 1928, la France a abaissé sensiblement ses tarifs douaniers. En outre, l’Europe et le Japon ont connu de 1920 à 1929 la plus forte croissance économique depuis cent trente ans, ce qui contredit l’idée selon laquelle les économies occidentales étaient dans un état catastrophique avant la crise.
Pour autant, les années trente furent plus prospères en Grande-Bretagne et en Allemagne que les années vingt. De 1934 à 1938, en raison de la politique de réarmement, le chômage allemand fut divisé par trois. Cependant, l’auteur relativise largement les performances des économies fascistes avant la guerre. De même, avant les guerres de 1914 et de 1870, les résultats économiques furent excellents.
L’auteur s’évertue à démontrer que le protectionnisme n’est pas un mal ou un quelconque projet de haine de l’autre. Toutes les politiques industrielles, à l’exception de celle du Royaume-Uni, se sont développées grâce à un haut taux de barrières tarifaires afin de se mettre à l’abri de la concurrence étrangère. À la fin du XIXème siècle, les Anglais se sont mis eux-aussi à augmenter les barrières douanières.
Les États-Unis, la Chine et le Japon n’échappent pas à cette règle. En 1914, les droits de douane étaient chez l’oncle Sam quatre fois supérieurs à ceux de la perfide Albion. Les Britanniques ont profité du libéralisme car ils avaient une avance technologique importante. Dans le reste des pays, l’abaissement des barrières tarifaires s’est systématiquement soldé par un ralentissement de l’activité économique.
Paul Bairoch s’intéresse aussi aux relations avec les pays du tiers monde. À la question de savoir si les matières premières du tiers monde ont été indispensables à l’industrialisation des pays occidentaux, il répond par la négative. À la veille de la Première Guerre mondiale, les pays européens étaient en suffisance énergétique. Le solde est devenu négatif à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique largement les guerres impérialistes des Américains et de leurs toutous de l’OTAN. Les matières premières ne représentaient qu’un quart des exportations des pays du tiers monde.
Les débouchés coloniaux jouèrent-ils un rôle important dans le développement des industries occidentales ? Là encore, Bairoch montre que les pays non ou peu colonialistes comme l’Allemagne, les États-Unis, la Suède, la Suisse, la Belgique ont eu une croissance plus rapide que les pays colonialistes comme la Grande-Bretagne ou la France. « Si l’Occident n’a guère gagné au colonialisme, cela ne signifie pas que le tiers monde n’y ait pas beaucoup perdu. »
L’auteur ose même s’attaquer au lieu commun voulant que seul l’Occident fût un grand colonisateur. Les Égyptiens, les Perses, les Romains, les Arabes et les Ottomans participèrent aussi à ce phénomène. Le trafic d’esclaves dans le monde musulman a duré plus longtemps et a touché un plus grand nombre d’esclaves, dont il reste peu de descendants car beaucoup étaient castrés. La problématique de la forte participation de la communauté juive au trafic d’esclaves occidental n’est pas traitée car elle n’a aucun rapport avec la question posée.
Contrairement au mythe répandu, c’est bien la croissance économique qui est à l’origine du commerce et non l’inverse. Les pays du tiers monde exportent énormément mais n’ont quasiment pas de croissance.
Paul Bairoch termine son livre en enfonçant une porte ouverte, mais l’évidence suivante mérite tout de même d’être rappelée : une politique de libre-échange absolu ou un protectionnisme absolu n’a évidemment aucun sens. Pourtant, les partisans du libre-échange vivent sur un modèle idéalisé et fantasmé où la « main invisible » réglerait tout. C’est pourquoi toute idée protectionniste est taxée par eux d’isolationnisme. Ceux qui réclament l’intervention de l’État quand leur arrogance et leurs multiples erreurs ont abouti à la catastrophe n’ont aucune leçon à donner. Comme l’écrit Léon Bloy, dans son Exégèse des lieux communs : « Le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. »
Haut fonctionnaire, intellectuel et homme politique français, Jean-Yves Le Gallou a fondé en 2003 la Fondation Polémia, très présente sur Internet. Au lendemain d'un colloque sur le coût de l'immigration auquel il a participé, nous l'avons notamment interrogé sur la liberté d'expression et les libertés politiques, sujets qui sont au coeur de son combat.
❏ L'Action Française 2000 – Pouvez- vous présenter la fondation Polémia à nos lecteurs qui ne la connaîtraient pas encore ?
❏ Jean-Yves Le Gallou – Polémia, c'est d'abord un cercle de pensée dissidente à l'opposé du système oligarchique dominant. Son rôle est d'être un incubateur d'idées nouvelles et un brise-glace idéologique du politiquement correct.
Polémia c'est également une encyclopédie numérique politiquement incorrecte. Les 4 500 textes mis en ligne sont rigoureusement sourcés et référencés. Polémia est une source précieuse de réflexion et de documentation que son moteur de recherche rend facilement accessible. Polémia, c'est aussi un site phare de la réinfosphère. Polémia contribue à faire entendre les points de vue de tous ceux qui sont attachés aux libertés, à l'identité et à la souveraineté, ce sont les valeurs du "LIS", ou du Lys si vous préférez. Polémia, c'est enfin un centre de décryptage des médias.
Les médias ne sont pas un contrepouvoir, ils sont le pouvoir. Le pouvoir sur les esprits. Polémia a consacré plusieurs publications à l'analyse des phénomènes médiatiques : La Tyrannie médiatique, le Dictionnaire de Novlangue, le Dictionnaire de la réinformation - 500 mots pour la dissidence et Les Médias en servitude. Polémia s'apprête à lancer l'Observatoire des journalistes et des médias pour placer sous le projecteur de la critique ceux qui fabriquent l'opinion. Polémia organise aussi chaque année une journée d'étude de la réinformation et la cérémonie - parodique - des Bobards d'or distingue les "meilleurs des journalistes", ceux qui n'hésitent pas à bobarder, c'est-à-dire à mentir délibérément pour servir le politiquement correct.
❏ L'immigration est, à vos yeux, un des enjeux majeurs de la décennie à venir. D'abord sur le plan économique bien sûr...
❏ En terme d'emploi, l'immigration est une absurdité dans un pays qui compte 10 % de chômeurs à temps plein (et 15 % à temps plein ou partiel). Un pays où le chômage des étrangers hors Union européenne est trois fois supérieur au taux moyen. Un pays où le taux de chômage des enfants d'immigrés (de quinze à vingt-quatre ans toujours hors Union européenne ) dépasse 35 %. Mais il est vrai que l'immigration est voulue par le Medef pour peser à la baisse sur le niveau des salaires. L'immigration joue ici le même rôle que les délocalisations ; l'immigration c'est la délocalisation à domicile dans le cadre d'un monde sans frontières 1.
En termes budgétaires, l'immigration est aussi une folie dans un pays surendetté. Yves-Marie Laulan, de l'Institut de géopolitique des populations, a chiffré le coût de l'immigration présente actuellement en France à 72 milliards d'euros. Il faut y ajouter le coût des investissements nécessaires pour accueillir les 200 000 étrangers qui entrent chaque année : 15 milliards pour construire les logements, les transports, les places d'école, d'université, d'hôpital et de prison. En tout, près de 100 milliards, l'équivalent du déficit public 2.
❏ Mais peut-être l'immigration constitue-t-elle un enjeu plus grave encore sur le plan de la cohésion sociale et celui de l'identité nationale. Considérez-vous que nous sommes à un tournant en la matière ?
❏ Vous avez raison, « l'économie n'est pas le destin ». Et l'immigration de masse que nous subissons pose un problème crucial en termes d'identité nationale. Certes, quelques individualités parviennent à s'assimiler, mais, globalement, l'intégration est un échec. Chaque année, le gouvernement donne la nationalité française à plus de 100 000 personnes. Malheureusement, beaucoup de ces Français administratifs ne sont pas des Français par la culture, par la civilisation, par le sentiment. C'est de la fausse monnaie nationale. Et des pans entiers du territoire se transforment par l'islamisation ou l'africanisation. Nous sommes en train d'importer le choc des civilisations en France.
❏ Plutôt que d'une islamisation rampante de la société, ne conviendrait-il pas de parler d'une communautarisation ?
❏ Bien sûr, il y a communautarisation quand le gouvernement et les médias déroulent le tapis rouge aux organisations communautaristes telles que le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), le Cran (Conseil représentatif des associations noires) et le CFCM (Conseil français du culte musulman).
Mais au-delà, il y une islamisation de la société, c’est-à-dire que la minorité musulmane (un peu moins de 10 % de la population) impose progressivement ses règles de vie à tout le monde : là où le voile islamique s'impose, la vie devient de plus en plus difficile pour les jeunes femmes qui ne le portent pas. Que les musulmans mangent halal (ou les israélites casher), c'est une chose. Que l'ensemble des Français se voient imposer ces pratiques, c'en est une autre. Et pourtant, aujourd'hui en France, 60 % des moutons et 30 % des bovins sont abattus selon les pratiques rituelles orientales. De même, il est anormal de financer des mosquées avec l'argent des contribuables et d'accorder des dérogations aux règles d'urbanisme pour permettre l'édification de minarets. Le pire est que, dans les écoles, la transmission de la mémoire française soit abandonnée pour complaire aux nouveaux arrivants.
❏ Un autre de vos combats est celui pour les libertés. Vous avez, dans un récent éditorial, souligné les dérives en la matière : Lopsi, Acta, persécutions policières et judiciaires contre ceux qui refusent le politiquement correct, censure à la télévision, sans oublier ces lois « scélérates » (dixit Anne Le Pourhiet) que sont, notamment, les lois communautaristes, mémorielles ou antidiscriminatoires adoptées successivement en France depuis 1972. Les historiens y sont de plus en plus opposés, mais le pays légal dans son ensemble est favorable à ces lois liberticides. Quel combat mener ? Comment ? Quel espoir avoir en la matière ?
❏ Cette formidable régression des libertés s'accompagne d'une régression civilisationnelle. À travers l'antiquité gréco-latine, la première Renaissance du XIIe et XIIe siècle, la grande Renaissance, la pensée européenne a toujours distingué deux ordres de vérité : les vérités religieuses, où le dogme s'impose comme article de foi ; les vérités scientifiques ou historiques, qui se déterminent par le libre débat. Dans ces domaines peut être dit vrai (ou faux) ce qui est librement réfutable. Philosophiquement, un fait, une opinion, un point de vue, une analyse qui ne peut être librement réfuté ne peut être dit ni vrai, ni faux (sauf dans l'ordre religieux). Ainsi les lois mémorielles transforment-elles des événements historiques en dogmes religieux. C'est une formidable régression. En retirant des pans entiers d'histoire au libre examen, les lois mémorielles (Gayssot, Taubira ou Boyer 3) ne sont pas seulement des atteintes à la liberté d'expression, ce sont aussi des fautes contre l'esprit. Que faire ? Ne pas se laisser intimider ; résister ; ne pas se laisser imposer l'historiquement correct ; ne pas "plier" ; continuer à réclamer l'abolition des lois scélérates. Grâce à internet, c'est possible.
❏ Vous avez enfin évoqué la tentative de truquage de l'élection présidentielle, visant à empêcher Marine Le Pen de se présenter. Que pensez-vous de la décision du Conseil constitutionnel sur la publicité des signatures des maires ?
❏ Il y a effectivement la volonté d'imposer une élection présidentielle croupion, comme il y a des parlements croupions. Un certains nombres de candidats ont déjà été sortis du jeu : Boutin, Nihous, Morin ou Lepage. Qu'on soit d'accord ou non avec eux, c'est regrettable. La tentation existe aussi d'éliminer Marine Le Pen, mais ce sera évidemment plus difficile. Mais déjà les médias manipulent l'opinion : sans attendre le premier tour, ils scénarisent le "duel" du deuxième tour qu'ils programment entre Hollande et Sarkozy, qui sont d'accord sur l'essentiel et feignent de s'opposer sur l'accessoire. Le parrainage des candidats à l'élection présidentielle par les maires a fait son temps. Mais le sujet le plus grave reste la tyrannie médiatique.
Propos recueillis par François Marcilhac L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 1er au 14 mars 2012
1 - « Immigration : l'illusion de l'intégration » ; http://www.polemia.com/article.php?id=1730
2 - Synthèse des travaux du colloque "Peut-on raisonnablement calculer le coût de l'immigration ?" ; http://www.polemia.com/article.php?id=4596
3 - « Loi sur le génocide arménien : une régression civilisationnelle »
 Parce que nous nous souvenons...Mar gheall ar cuimhin linn ...
Parce que nous nous souvenons...Mar gheall ar cuimhin linn ...
Parce qu'au sein de l'Europe était un pays en situation "d'apartheid" environné de barbelés. Que nos frères catholiques vivaient sous l'oppression protestante, descendante des planteurs anglais et écossais, unioniste ou loyaliste.
- "En Irlande du Nord, le droit de vote aux élections locales était limité aux propriétaires (qui bénéficiaient en outre d'un deuxième droit de vote s'ils possédaient une seconde maison autre que leur résidence) et aux locataires-bailleurs d'une habitation (tenants) et à leurs épouses, excluant donc les locataires de meublés (lodgers) ainsi que les enfants adultes vivant sous le toit parental. En 1961, plus du quart des électeurs qualifiés pour voter aux élections à la Chambre des communes étaient privés du droit de vote aux élections locales et régionales. L'abolition de cette discrimination en matière de droit de vote était une des revendications du Northern Ireland Civil Rights Association qui organisa des manifestations pour les droits civiques en 1968-1969, qui marquèrent le début de la guerre civile en Irlande du Nord. La législation nord-irlandaise sur le droit de vote aux élections locales fut par la suite alignée sur celle déjà en vigueur dans les autres parties du Royaume-Uni, et les premières élections locales au suffrage universel eurent lieu en mai 1973.
- Le chômage, jusqu'au Fair Employment Act de 1976 et 1989, touche plus durement la population catholique, parfois au double de la population protestante. La majorité des gros employeurs étant protestants, il existe une forte discrimination à l'embauche
- La distribution des logements sociaux étant confiée aux conseils locaux, la population protestante en profite plus La Royal Ulster Constabulary devait à l'origine être composé d'un tiers de catholiques, elle n'en contient que 10 %. L'Ulster Special Constabulary, force supplétive plus lourdement armée, est composée de 100 % de protestants. La police, en collusion avec des groupes paramilitaires loyalistes pendant le conflit nord-irlandais, multiplie les violences contre les catholiques.
- Cause principale du conflit nord-irlandais, la discrimination subit par les catholiques nord-irlandais provoque un exode de population. Entre 1937 et 1961, 90 000 catholiques émigrent. Un mouvement pour les droits civiques se lance au milieu des années 1960... Vingt-six manifestants et passants pacifistes des droits civils ont été pris pour cible par des soldats de l'armée britannique. 13 hommes, dont sept adolescents, sont morts immédiatement et un autre homme est décédé quatre mois et demi plus tard, à la suite des blessures reçues ce jour-là. Deux manifestants ont également été blessés quand ils ont été écrasés par les véhicules militaires. Cinq de ces blessés ont été touchés dans le dos. Le drame est survenu au cours de la marche de l'Association nord-irlandaise pour les droits civiques ; les soldats impliqués étaient du 1er Bataillon du Régiment de Parachutistes du Royaume-Uni."(Wikipédia)
Parce que nous Français n'oublions pas nos frères Irlandais, les "Oies Sauvages" qui participèrent à notre histoire.
- Parce que nous n'oublions pas que nous leur devons la grande victoire de Louis XV à Fontenoy.
- Que les Irlandais arrivés en masse sous Louis XIV, fondèrent la célèbre "Brigade Irlandaise" des Rois de France (dont nous avons reproduit les drapeaux en vente sur notre boutique et qui participent aux rassemblements des Camelots et Volontaires du Roi du GAR)
- Parce que les Irlandais seront toujours les premiers volontaires à partir en Amérique durant la guerre de Sept ans (1754-1761) et lors de la guerre d'indépendance sous Louis XVI, pour servir la France aux ordres du Roi contre les anglais.
- Parce que nous Français nous souvenons que de nombreux irlandais rejoindront l’armée des Princes, par fidélité au Roi et pour fuir les persécutions de la Révolution.
- Que le colonel Lord Rice, tenta même de sauver la reine.
- Le comte Arthur de Dillon, héros de la guerre d’indépendance américaine, mourra sur l’échafaud en avril 1794.
- C’est à un irlandais, l’abbé Edgeworth de Firmont, que revient l’honneur d’accompagner le roi Louis XVI à la mort en prononçant ces mots : « Fils de Saint Louis, montez au Ciel ! »
- Qu'une Irlandaise était à la tête de l'armée de Charette...
Cette fidélité se retrouvera plus tard, lors de la première IRA durant un voyage du Comte de Chambord, où de nombreux irlandais avec le leader indépendantiste Daniel O’Connell (député puis lord-maire,Dublin 1841) proposèrent au Prince : « Une brigade irlandaise au service d’Henri V pour reconquérir le trône de ses aïeux »
Fuarthas an fidelity níos déanaí, nuair a bheidh an IRA chéad uair le linn turas Comte de Chambord, áit go leor Gaeilge le separatist ceannaire Dónall Ó Conaill (MP agus Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath 1841) a bheartaítear an Prionsa: "An Briogáid Éireannach seirbhís Henry V agus faigh ar ais an ríchathaoir a sinsear "
Parce que nous n'oublions pas, nous sommes les fils de la mémoire...
Toisc nach bhfuil muid dearmad, táimid ag an mac an chuimhne ...
Tiocfaidh àr là - Notre Jour Viendra
SEMPER et UBIQUE FIDELIS -
Frédéric Winkler http://www.actionroyaliste.com
« « Déracinés de tous les pays, unissez-vous sous l’égide du marché mondial ! » ; tel pourrait donc être, en somme, le nouveau mot d’ordre de la gauche libérale. »
Le lecteur du nouvel essai de Michéa ne sera guère surpris. Le thème central en est à peu près toujours le même : démontage en règle du libéralisme, critique de la Gauche d’un point de vue authentiquement socialiste (donc réactionnaire), défense des gens ordinaires. Aucune surprise donc, mais seulement a priori, car en repartant d’Orwell anarchiste tory en 1995 jusqu’à son dernier bouquin intitulé La double pensée en 2008, on comprend tout de suite l’intérêt de ce nouvel opuscule.
Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un degré supplémentaire – et à mon avis son plus complet – dans la somme qu’il constitue depuis plus de quinze ans. Sociologie, histoire, philosophie, anthropologie, toutes les disciplines sont ici convoquées dans un substantiel bouillon de culture.
Au regard des sociétés humaines, du quotidien des gens ordinaires et de la socialité propre à chaque civilisation, une certitude apparaît : le mythe progressiste et libéral (pléonasme) est une aberration. Chacun en rirait s’il ne provoquait toutefois tant de souffrances et ne menaçait pas de toujours plus tout emporter sur son passage. Michéa s’inscrit en faux [contre] cette théologie.
Comme Maurras en son temps – mais sans être réactionnaire contre-révolutionnaire – il invite néanmoins à revenir sur nos pas pour corriger urgemment les ravages des malades du complexe d’Orphée : ceux qui par peur de perdre Eurydice se doivent de ne jamais regarder en arrière, vers un passé sombre, nauséabond et intrinsèquement fasciste, cela va de soi.
Seront ici privilégiés les éléments nouveaux de la réflexion de Michéa, bien que sa manière de démontrer l’alliance objective entre « sociologues de gauche et économistes de droite » soit toujours aussi brillante, tout comme la corrélation entre l’extrême-gauche libérale et le MEDEF (Schweitzer, ancien directeur de la HALDE, est président du MEDEF international et membre éminent du Siècle, apprend-on ; quant à Cordier et Hessel l’indigné citoyen sans-frontières, ils ont fourni avec leur club Jean Moulin plusieurs cadres à la Trilatérale) et la mise au pilori de la bêtise et de l’incompétence du « néo-journalisme ».
Historiquement, la Gauche n’est pas le socialisme. Le terme de Gauche désignait au contraire depuis le début du 19ème siècle le parti du Mouvement et du Progrès, inspiré par les Lumières. Fatalement, leurs adversaires tombaient sous la dénomination de Droite, laquelle était encore au 19ème siècle partisane de la Restauration. Le socialisme ouvrier, mouvement indépendant, entendait rester une force de troisième voie.
Ce n’est qu’avec l’affaire Dreyfus que notre « géométrie électorale » s’est polarisée de manière bipartite (1), lorsque les socialistes décidèrent de faire alliance avec la Gauche pour défendre le « front républicain ». A partir de là, le socialisme fut à tort assimilé au progressisme. Ce, malgré les dernières tentatives ouvrières pour rester autonomes : le syndicalisme révolutionnaire et la charte d’Amiens.
Les deux modèles civilisationnels, Socialisme et Gauche, sont profondément antinomiques. La Gauche entend édifier une société nouvelle, construite sur la ruine des enracinements et de l’expérience sensible, et fait l’apologie du bougisme (Michéa parle de gauche kérosène, « celle pour qui le déplacement perpétuel est devenu une fin en soi »). Le croyant de gauche récuse l’idée que les choses pouvaient être mieux avant, ce qui mène aujourd’hui à un véritable double bind : les « socialistes » critiquent la dégradation de la vie des classes populaires, mais refusent tout de même de reconnaître que les choses étaient mieux avant, sous peine d’hérésie au dogme.
Le progressisme est une Réaction inversée, adepte du « ce sera mieux demain » perpétuel, aidé par la surenchère mimétique des crétins de l’extrême-gauche. Rien ne saurait donc faire obstacle aux droits de l’homme, toute critique est perçue comme une discrimination. Michéa nous offre ici l’exemple récent de l’affaire Zemmour (voir annexe de la présente fiche [de lecture]) et des arguments illogiques au possible du système et de ses accusations de crime-pensée. La seule discrimination que tolère cependant le système reste bien entendu la discrimination de classe, que l’écart jusqu’alors jamais vu entre salaires vient confirmer tous les jours.
Résumé d’un mot, la défense du peuple est le populisme. L’antipopulisme de la Gauche est donc une démophobie. Michéa en conclut donc logiquement, par ce qu’il nomme le « théorème d’Orwell », que « quand l’extrême-droite progresse chez les gens ordinaires (classes moyennes incluses), c’est d’abord sur elle-même que la gauche devrait s’interroger. »
Car en fin de compte, quelles sont les valeurs propres aux gens ordinaires ? Pas que d’aujourd’hui, mais dans les diverses civilisations et à travers les âges ? La continuité historique, l’enracinement et la filiation. Bref, l’identité, ce minimum de valeurs partagées qui permettent d’établir les bases d’une société décente autour d’un fait social total qui fasse sens pour la collectivité. C’est-à-dire qu’une base anthropologique viable ne saurait passer outre certains éléments conservateurs, dont la permanence doit être assurée et reproduite sous peine de chaos.
La famille, l’effort physique comme « clé ultime de tout perfectionnement individuel et de toute estime de soi », l’attachement à une éthique défiant le pur technicisme du pragmatique contemporain, telles sont les valeurs indépassables d’une société qui entend jeter des bases saines et fécondes pour sa reproduction. Michéa reste toutefois lucide, et c’est pour cela qu’il parle de la décence comme base de départ. Une conscience morale et la bonne volonté des gens ordinaires ne suffit pas à faire fonctionner une société décente, il faut y adjoindre des connaissances techniques.
Politiquement, que choisir ? Le socialisme ouvrier est-il souhaitable ? Une fois de plus, Orwell représente pour Michéa une piste de réflexion privilégiée. On le sait, l’Anglais aimait provoquer en se qualifiant d’anarchiste tory (anarchiste conservateur) – un anarchisme par-delà droite et gauche, quand on le lit. Il serait une alternative face à « l’anarchisme de pouvoir » (le sadisme) dont parle Pasolini et que reprend Michéa. Cet anarchisme tory ne représente cependant pas de contenu distinct, mais peut proposer des éléments viables.
L’anarchisme suppose ici de mettre fin à la domination de classe, et non l’avènement d’une société sans classes. (2) La dimension conservatrice implique de ne pas confondre émancipation (socialisme ouvrier) et omni-modernisation (la Gauche) : savoir garder ce qui convient, tout en faisant preuve d’esprit critique sur les évolutions présentées comme des avancées. De plus, toute critique du capitalisme se doit de comporter des éléments conservateurs, qui seuls protègent les fondements de la vie en commun. Une fois de plus, il faut en revenir à l’originarité du cycle de don / contre-don, au fondement des sociétés humaines et qui suppose de savoir se fixer des limites.
L’individu socialisé doit donc devenir un sujet mature et apte à vivre de manière décente parmi ses semblables, loin de la soif de pouvoir de l’enfant gâté jouisseur et transgresseur : « C’est d’abord cette forme d’équilibre intuitif entre le « solitaire » et le « solidaire » qui constitue la marque la moins discutable d’un « anarchisme tory ». » Partant, ce que Michéa qualifie de moment « conservateur » de toute théorie radicale requiert de « restaurer des équilibres écologiques compromis par la « croissance » [...] préserver les conditions morales, culturelles et anthropologiques d’un monde décent. » En premier lieu, restaurer les face à face contre les « réseaux sociaux » virtuels à la Facebook et Twitter.
Il convient pour cela de mettre fin au règne de l’économie de marché et à l’impératif de croissance – et ses indicateurs bidon comme le PIB ou l’IDH. Mais une société socialiste n’est pas une société collectiviste. Le secteur privé doit rester présent et la logique marchande un tant soit peu conservée. Si les besoins et les désirs des individus étaient collectivisés, un des fondements de la vie privée serait aboli, et le terrain propice au totalitarisme. Une société socialiste se doit donc de conserver un secteur privé, mais il faudra toutefois que celui-ci ne s’érige pas en marché comme c’est maintenant le cas.
L’économie doit être « réenchassée » dans un tissu de relations, pour reprendre Polanyi qui reste une référence fréquente de Michéa – renouer ainsi avec l’éthique des sociétés traditionnelles. En pratique, deux pistes nous sont ici proposées, avec 1) une partie des revenus réinjectée dans les « circuits courts » pour favoriser l’économie de proximité, qui favorise le tissu social, de par ce caractère justement de proximité et 2) nationalement ou internationalement, la mise en place de la « monnaie fondante » proposée par Silvio Gesell : « Sous ce nom, Gesell désignait une « monnaie socialiste » dont la valeur « fondait » progressivement avec le temps lorsqu’elle n’avait été ni dépensée pour couvrir les besoins quotidiens des individus ni épargnée dans le but de parer aux aléas inévitables de la vie. »
Comme Alain de Benoist, loin du centralisme destructeur jacobin, Michéa précise toutefois qu’une société socialiste est plurielle. Ainsi, une communauté locale pourra si elle le décide refuser le système de l’échange marchand.
L’enracinement est nécessaire pour trois autres raisons. 1) Le principe de mobilité présente un risque énergétique majeur, 2) il entraîne une généralisation de l’emploi, interchangeable, au détriment du métier (3), savoir acquis par l’homme et qui lui confère une relative autonomie, 3) un tel monde monde serait « peu propice à l’exercice d’un pouvoir populaire. » Sans territorialisation, la démocratie communale deviendrait un concept vidé de sa substance car dénué d’expérience historique et culturelle partagée. Ceci encouragerait notamment la corruption, par l’absence de proximité avec ses compatriotes. Sans pour autant interdire les voyages, Michéa note qu’une société décente refusera l’obligation du nomadisme.
Pour lutter effectivement contre le marché mondial, la prise de conscience doit être internationale – au sens de la coopération entre nations, l’exact opposé du cosmopolitisme libéral-libertaire. Un socialisme international qui se respecte se doit de respecter à son tour les cultures enracinées, libérées de l’aliénation occidentale des droits de l’homme et de la fausse bonne conscience humanitaire. Des médiations doivent pour cela être créées afin que les peuples puissent s’appréhender dans leur universalité tout en restant fidèles à leurs culture et identité.
Pour paraphraser Michéa, il nous faut promouvoir un monde commun de la diversité des cultures enracinées, avec une coopération des peuples, contre un monde de l’uniformisation libérale par le règne bicéphale du marché et du droit.
Enfin, philosophiquement, une société décente « implique, entre autres, qu’on réhabilite les idées de lenteur, de simplicité volontaire, de fidélité à des lieux, des êtres ou des cultures et, avant tout, l’idée fondamentale selon laquelle il existe (contrairement au dogme libéral) un véritable art de vivre dont la convivialité, l’éducation du goût dans tous les domaines et le droit à la « paresse » (qui ne saurait être confondue avec la simple fainéantise) constituent des composantes fondamentales. »
On l’aura compris, Michéa a définitivement franchi le Rubicon et rejoint le camp de la Bête Immonde du populisme. Contrairement au think tank PS d’Olivier Ferrand, Terra Nova, Michéa entend encore défendre les gens ordinaires et les formes saines de la socialité, bases indépassables d’une société décente.
Et s’il nous rappelle qu’Orwell était considéré comme le « Chesterton de gauche », Michéa est quant à lui un « Imatz de gauche », tant la lecture – comparative et complémentaire – des deux sommes que sont Par-delà droite et gauche d’Arnaud Imatz et de ce Complexe d’Orphée s’avèrent indispensables pour construire une troisième voie digne de ce nom, celle des inter-nationalistes anti-mondialistes contre le totalitarisme mondialiste du marché global et de ses serviteurs liberticides, que ceux-ci se situent à l’une ou l’autre « des deux ailes du château libéral. »
Notes :
(1) Maurras faisait le même constat dès 1941, dans La seule France. Une entreprise qu’il nomma la « troisième révolution anglaise », faisant suite à 1789 et 1848.
(2) Michéa s’appuie très fréquemment sur Le Quai de Wigan de George Orwell, dont la lecture est recommandée afin de mieux cerner son socialisme et les reproches qu’il adressait déjà aux progressistes et professionnels de la révolution.
(3) Michéa opère la distinction suivante : le métier est le travail concret qui produit des valeurs utiles, tandis que l’emploi est le travail abstrait qui produit des valeurs d’échange.
Citations :
« Puisque tout essai se doit d’avoir un titre, j’ai donc choisi de désigner sous le nom de complexe d’Orphée ce faisceau de postures a priori et de commandements sacrificiels qui définit – depuis bientôt deux siècles – l’imaginaire de la gauche progressiste. Semblable au pauvre Orphée, l’homme de gauche est en effet condamné à gravir le sentier escarpé du « Progrès » (celui qui est censé nous éloigner, chaque jour un peu plus, du monde infernal de la tradition et de l’enracinement) sans jamais pouvoir s’autoriser ni le plus léger repos (un homme de gauche n’est jamais épicurien, quelles que soient ses nombreuses vantardises sur le sujet) ni le moindre regard en arrière. »
« C’est pourquoi il devait inévitablement venir un temps – et nous y sommes, de toute évidence, arrivés – où, derrière la conviction autrefois émancipatrice qu’on n’arrête pas le progrès, il deviendrait de plus en plus difficile d’entendre autre chose que l’idée, à présent dominante, selon laquelle on n’arrête pas le capitalisme et la mondialisation. Car tel est bien, en vérité, le lourd tribut à payer (dont l’abandon par la gauche moderne de toute critique socialiste du mode de vie capitaliste ne représente qu’un effet secondaire) pour tous ceux dont le « complexe d’Orphée » continue à organiser – consciemment ou non – la compréhension de l’histoire et de la politique. Que ce soit en raison de leur appartenance sociale (les nouvelles élites mobiles du marché global) ou de leur rapport psychologique personnel à l’univers familial et à l’idée de filiation. C’est donc d’ici qu’il va falloir repartir si nous tenons encore à vivre dans un autre monde que celui qui advient. »
« Aux yeux de l’intellectuel de gauche contemporain, il va nécessairement de soi que le respect du passé, la défense de particularismes culturels et le sens des limites ne sont que les trois têtes, également monstrueuses, de la même hydre réactionnaire. »
« La religion du progrès épargne, par définition, à ses nombreux fidèles ce que Tocqueville appelait le « trouble de penser ». Devant n’importe quel « problème de société » – déjà présent ou bientôt à nos portes (comme, par exemple, la légalisation de l’inceste ou l’abolition de toutes les formes de « discrimination » entre l’homme et l’animal) –, un esprit progressiste n’est, en effet, jamais tenu par les contraintes de la réflexion philosophique. Il lui suffit de répondre – avec l’aplomb caractéristique de ceux qui savent qu’ils naviguent dans le sens de l’histoire – que de toute façon la discussion n’a pas lieu d’être puisqu’un jour viendra inévitablement où l’humanité rira (c’est la formule habituellement employée par les progressistes lors des débats télévisés) de ce que l’on ait pu s’opposer à une évolution du droit aussi naturelle et évidente. Dans une société progressiste intégralement développée, la philosophie n’aurait donc plus la moindre place (ou alors seulement en tant que théorie de la « déconstruction » perpétuelle des préjugés « conservateurs » et des idées « nauséabondes »).
Annexe :
L’« affaire » Zemmour (pp.204-208)
« Lorsque le développement logique du libéralisme atteint le point où toute expression publique d’un jugement personnel ferme et précis (et l’existence des « nouvelles technologies » – à l’image du téléphone portable – permet aujourd’hui de rendre publique n’importe quelle conversation privée ou off) commence à être perçue comme une volonté perverse de nuire à tous ceux qui sont d’un avis différent, la société entre alors dans ce que j’ai appelé la « guerre de tous contre tous par avocats interposés ».
Les effets de cette guerre juridique moderne (qui, ne nous leurrons pas, n’en est encore qu’à ses débuts) apparaissent d’autant plus inquiétants que ceux qui se sont arbitrairement institués en gardiens officiels du temple libéral (mais le nom de policiers de la pensée leur conviendrait mieux) semblent à présent tenir la logique (et, avec elle, le vieux principe de contradiction) pour une fantaisie purement privée qui ne saurait, à aucun titre, peser le moindre poids dans un débat public (on reconnaît là l’une des conséquences extrêmes de cette curieuse épistémologie postmoderne pour laquelle la science elle-même ne serait, en fin de compte, qu’une simple « construction sociale » arbitraire).
De ce point de vue, la récente « affaire » Éric Zemmour est assurément emblématique. Ce journaliste (l’un des rares représentants du « néoconservatisme » à la française autorisé à officier sur la scène médiatique) ayant, en effet, déclaré, lors d’un débat télévisé, que les citoyens français originaires d’Afrique noire et du Maghreb étaient massivement surreprésentés dans l’univers de la délinquance (et notamment dans celui du trafic de drogue), la police de la pensée s’est aussitôt mobilisée pour exiger sa condamnation immédiate – voire, pour les plus intégristes, sa pure et simple interdiction professionnelle (Beruf verboten, disait-on naguère en Allemagne).
Je me garderai bien, ici, de me prononcer officiellement sur le bien-fondé de l’affirmation d’Éric Zemmour, et ce pour une raison dont l’évidence devrait sauter aux yeux de tous. Dans ce pays, l’absence de toute « statistique ethnique » (dont l’interdiction est paradoxalement soutenue par ces mêmes policiers de la pensée) rend, en effet, légalement impossible tout débat scientifique sur ces questions (un homme politique, un magistrat ou un sociologue qui prétendrait ainsi établir publiquement que l’affirmation de Zemmour est contraire aux faits – ou, à l’inverse, qu’elle exprime une vérité – ne pourrait le faire qu’en s’appuyant sur des documents illégaux).
Il n’est pas encore interdit, toutefois, d’essayer d’envisager toute cette étrange affaire sous l’angle de la pure logique (« en écartant tous les faits », comme disait Rousseau). Considérons, en effet, les deux propositions majeures qui structurent ordinairement le discours de la gauche sur ce sujet.
Première proposition : « la principale cause de la délinquance est le chômage – dont la misère sociale et les désordres familiaux ne sont qu’une conséquence indirecte » (comme on le sait, c’est précisément cette proposition – censée s’appuyer sur des études sociologiques scientifiques – qui autorise l’homme de gauche à considérer tout délinquant comme une victime de la crise économique – au même titre que toutes les autres – et donc à refuser logiquement toute politique dite « sécuritaire » ou « répressive »).
Seconde proposition : « les Français originaires d’Afrique noire et du Maghreb sont – du fait de l’existence d’un « racisme d’Etat » particulièrement odieux et impitoyable – les victimes privilégiées de l’exclusion scolaire et de la discrimination sur le marché du travail. C’est pourquoi ils sont infiniment plus exposés au chômage que les Français indigènes ou issus, par exemple, des différentes communautés asiatiques ». (Notons, au passage, que cette dénonciation des effets du « racisme d’Etat » soulève à nouveau le problème des statistiques ethniques mais, par respect pour le principe de charité de Donald Davidson, je laisserai de côté cette objection.)
Si, maintenant, nous demandons à n’importe quel élève de CM2 (du moins si ses instituteurs ont su rester sourds aux oukases pédagogiques de l’inspection libérale) de découvrir la seule conclusion logique qu’il est possible de tirer de ces deux propositions élémentaires, il est évident qu’il retrouvera spontanément l’affirmation qui a précisément valu à Zemmour d’être traîné en justice par les intégristes libéraux (« Le chômage est la principale cause de la délinquance. La communauté A est la principale victime du chômage. Donc, la communauté A est la plus exposée à sombrer dans la délinquance »).
Les choses sont donc parfaitement claires.
Ou bien la gauche a raison dans son analyse de la délinquance et du racisme d’État, mais nous devons alors admettre qu’Éric Zemmour n’a fait que reprendre publiquement ce qui devrait logiquement être le point de vue de cette dernière chaque fois qu’elle doit se prononcer sur la question.
Ou bien on estime que Zemmour a proféré une contrevérité abominable et qu’il doit être à la fois censuré et pénalement sanctionné (« pas de liberté pour les ennemis de la liberté » – pour reprendre la formule par laquelle Saint-Just légitimait l’usage quotidien de la guillotine), mais la logique voudrait cette fois (puisque ce sont justement les prémisses de « gauche » qui conduisent nécessairement à la conclusion de « droite ») que la police de la pensée exige simultanément la révocation immédiate de tous les universitaires chargés d’enseigner la sociologie politiquement correcte (ce qui reviendrait, un peu pour elle, à se tirer une balle dans le pied), ainsi que le licenciement de tous les travailleurs sociaux qui estimeraient encore que la misère sociale est la principale cause de la délinquance ou qu’il existerait un quelconque « racisme d’État » à l’endroit des Africains (au risque de découvrir l’une des bases militantes privilégiées de la pensée correcte).
Le fait qu’il ne se soit trouvé à peu près personne – aussi bien dans les rangs de la gauche que dans ceux des défenseurs de droite d’Éric Zemmour – pour relever ces entorses répétées à la logique la plus élémentaire en dit donc très long sur la misère intellectuelle de ces temps libéraux.
On en serait presque à regretter, en somme, la glorieuse époque de Staline et de Beria où chaque policier de la pensée disposait encore d’une formation intellectuelle minimale. Dans la long voyage idéologique qui conduit de l’ancienne Tcheka aux ligues de vertu « citoyennes » qui dominent à présent la scène politico-médiatique, il n’est pas sûr que, du point de vue de la stricte intelligence (ou même de celui de la simple moralité) le genre humain y ait vraiment beaucoup gagné. »
Scriptoblog via http://fortune.fdesouche.com