Il est de bon ton, y compris pour le président Sarkozy, de répéter que la période de la colonisation française fut une longue nuit pour l'Algérie qui, jusqu'à l'expédition française de 1830, aurait été un pays calme, heureux et florissant. Il est donc opportun d'exhumer quelques textes, extraits d'un fascicule (série culturelle n° 81) des Documents algériens publiés début 1958 par le service d'information du ministère de l'Algérie sous le titre : L'Algérie en 1830 vue à travers des témoignages de l'époque, ceux entre autres des Français Peyssonnel, Venture de Paradis, G.-T. Raynal, A. Nettement, H. de Grammont, de l'Anglais Shaw, de l'Italien Pananti, de l'Américain Shaler, etc. sur la Régence, « fléau de l'Europe » trois siècles durant.
E. de P.
LE DEY N'A D'AUTRE CHOIX QUE TUER OU ÊTRE TUÉ
« Le dey, qui n'a de comptes à rendre qu'à la Porte ottomane... et qui ne lui en rend guère, est élu par la milice turque composée ordinairement de "gens sans aveu, sans ressources et de mœurs dépravées, qui viennent du Levant d'où ils ont été obligés de s'enfuir pour se soustraire au châtiment dû à leurs crimes", note le Dr Shaw dans Voyage dans la région d'Alger. Mais, poursuit cet auteur, « il s'en faut bien que le choix d'un dey se fasse toujours paisiblement ; car, tous les Turcs de la milice étant également aptes à être élevés à cette fonction, il y en a toujours quelques uns de plus ambitieux que les autres et qui forment des conspirations dans le but de s'emparer du pouvoir en sacrifiant celui qui en est revêtu. Celui qui, dans ce cas, peut réunir le plus de partisans et tenir la chose secrète jusqu'à ce qu'ils parviennent conjointement à s'introduire dans le palais du dey est à peu près certain de le supplanter après l'avoir inhumainement massacré. Cela fait, il est aussitôt revêtu du caftan de la victime et proclamé de la manière suivante : prospérité à untel que Dieu a voulu élever au gouvernement de l'Etat et de la guerrière milice d'Alger ! Sans que les membres du divan qui sont présents osent proférer un seul mot, parce qu'ils savent qu'ils paieraient de leur vie la moindre opposition. Ils s'empressent au contraire de donner l'exemple de l'obéissance en baisant, les premiers, la main du nouveau dey. Il arrive assez souvent que celui-ci, afin de récompenser ses adhérents, fasse étrangler tous ceux qui étaient attachés à l'administration de son prédécesseur, principalement quand ils ne se soumettent pas de bonne grâce.
(...) Quelquefois, l'élection d'un dey est suivie immédiatement de plusieurs autres. On a vu par exemple dans le même jour six deys massacrés et sept élus. On ne fait pas plus de difficulté de reconnaître un Turc qui s'est fait dey par un assassinat que celui qui est légalement élu, parce que, disent les Mahométans, ce qui doit arriver est écrit de tout temps et n'arrive que par la volonté éternelle et immuable de Dieu.
(...) Quelquefois, c'est par hasard que l'élection se fait, comme il arriva en 1694, après la mort de Chaban-Dodja. On résolut d'élire le premier vieil officier que l'on rencontrerait en entrant dans la ville. Alachat-Amet se trouvait assis sur son tabouret de paille, faisant des souliers. On le prit et on le couronna roi malgré lui. Il régna trois ans et il mourut de maladie, craint et respecté des Turcs qu'il avait su dompter. D'autre fois, l'assassin même du roi a endossé le caftan du dey tout ensanglanté, s'est allé lui-même asseoir sur le trône ; ainsi fut reconnu Ibrahim-Dey qui avait assassiné Bactat en 1710. » (Peyssonnel et Desfontaines, Voyages dans les régions de Tunis et d'Alger, 1724-25 et 1783-86)
(...) « Le dey a la suprême justice sans appel, la disposition de l'argent et des troupes, la police, la nomination aux charges, les monnaies, l'autorité de déclarer la guerre ou de faire la paix et, qui plus est, l'autorité despotique de vie et de mort sur les sujets. » (Peyssonnel, op. cit.)
(...) « Ce pouvoir, si absolu en apparence, avait cependant des limites : il était contrôlé par la révolte et l'assassinat. Lui qui faisait tout trembler avait à trembler à son tour, et quand on étudie l'histoire des deys, on croit trouver la réalisation de cette dictature, votée dans nos assemblées révolutionnaires par un de leurs membres les plus violents qui demandait la nomination d'un dictateur condamné à gouverner, un boulet aux pieds et la tête sous le couperet.» (Alfred Nettement, Histoire de la conquête d'Alger, 1856)
UNE POPULATION PRESSURÉE COMME UNE EPONGE
Le gouvernement des provinces est confié à des beys que le dey nomme et révoque à volonté. Leur autorité est absolue là où ils commandent, mais elle cesse à leur arrivée à Alger où ils sont tenus de se rendre une fois l'an pour apporter au dey le produit des impôts et des tributs.
(...) « Le public juge de l'importance des revenus par le nombre des voitures chargées d'argent qu'amènent ces fonctionnaires et il en témoigne toujours sa joie par des cris bruyants. A leur arrivée au palais du dey, celui-ci les revêt aussitôt d'un caftan. C'est un honneur dont ils cherchent néanmoins à se dispenser quand ils le peuvent, incertains qu'ils sont de savoir quel est le sort qui les attend, s'ils seront traités gracieusement ou s'ils laisseront leur tête, malheur qui leur arrive fréquemment pour les punir de leurs prévarications et de leurs concussions, mais surtout pour les dépouiller des biens immenses qu'ils acquièrent généralement par toutes sortes de moyens illicites. » (Shaw, op. cit.)
(...) « Le dey laisse, avec la plus grande indifférence, les beys se conduire comme ils le font ; il semble même prendre plaisir à les voir s'imbiber du sang du peuple, parce qu'il se propose bien de presser un jour l'éponge. » (Pananti)
"DES PEUPLADES REBELLES PAR NATURE A TOUT SENTIMENT D'UNION ET DE NATIONALITÉ"
Tous les ans, quand il s'agissait de recouvrer l'impôt, le dey envoyait, pour prêter main-forte aux beys, des troupes recrutées parmi les tribus Makhezens :
(...) « C'est dans l'établissement des Makhesens, dans cette force tirée du pays pour le subjuguer, que résidait la véritable puissance des Turcs. En arrivant dans la région de Mogrob, ils virent combien il y avait peu d'homogénéité, de liaison, de nationalité parmi ces différentes populations entraînées sur le sol d'Afrique par les diverses invasions ou résidu des peuplades primitives. Il ne leur fut point nécessaire de diviser pour régner, ils n'eurent qu'à profiter des divisions existantes. » (Walsin-Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne Régence d'Alger)
(...) « Les Turcs ne semèrent pas la discorde dans le pays conquis, elle y existait avant eux et elle a régné de tout temps : l'esprit de faction est une des marques caractéristiques de la race ; il se fait sentir de tribu à tribu, dans la tribu-même et dans la moindre fraction de tribu ; les conquérants n'eurent donc qu'à l'utiliser à leur profit en favorisant tour à tour les partis opposés. » (H. de Grammont, Histoire d'Alger sous la domination turque, 1887)
(...) « Les Turcs ne durent la conservation de leur pouvoir qu'aux divisions incessantes de leurs sujets, complètement rebelles par nature à tout sentiment d'union ou de nationalité. » (Grammont, p. 410)
(...) « Les Maures, n'étant point unis entre eux, se trahissent volontiers les uns les autres. » (Shaw, op. cit.)
(...) « Les montagnes inaccessibles dans lesquelles les Zevawis vivent les mettent à l'abri des vexations des Turcs, mais entre eux il se font des guerres éternelles, et le plus faible se fait soutenir par le commandant turc le plus voisin, qui profite de ces divisions pour les dévorer. Leur haine est implacable et n'est assouvie que par le sang. » (Venture de Paradis, Alger au XVIIIe siècle, 1788-1789)
« Non seulement des redevances étaient exigées sur tout ce que la population pouvait posséder ou produire, mais la manière de percevoir ces redevances ajoutait encore à ce système d'exaction et de déprédation organisé. » (Walsin-Esterhazy)
MONOPOLE, VÉNALITÉ ET CONCUSSION
(...) « Ces charges, déjà si lourdes, se multipliaient par le mode de perception, en passant entre les mains du caïd, puis entre celles du chef lui-même, avant d'être remises au trésorier du bey, sorte de fermier général auquel il n'était demandé aucun compte des moyens employés, pourvu qu'il accomplit le versement annuel aux époques désignées. »
(...) « Le gouvernement est le seul vendeur de ce qu'il est permis d'emporter. À l'exclusion des navigateurs et des négociants, il s'approprie les grains de toutes les espèces au prix commun de la place et règle lui-même la valeur de la laine, des cuirs, de la cire qu'on est forcé de livrer à ses magasins, sans avoir eu la liberté de les exposer au marché. Ce qu'il a obtenu pour peu de chose, il le fait monter aussi haut qu'il veut, parce qu'il est possesseur de marchandises de premier besoin et qu'il n'est jamais pressé de s'en défaire. Un tel monopole, le plus destructeur que l'on connaisse, réduit à presque rien ce qu'une contrée si vaste et si fertile peut fournir aux besoins des nations. A peine les denrées qu'on en retire peuvent-elles occuper soixante à quatre-vingts petits navire. » (G.-T. Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans l'Afrique septentrionale, 1826)
(...) « La jouissance d'une place quelconque à Alger est soumise à des avaids en sa faveur et contre elle. Il n'y a pas jusqu'à la place d'un négociant qui ne soit tenue à présenter tous les ans des pommes, des châtaignes, des anchois, des olives, etc. aux grands et petits qui sont employés dans le gouvernement. Les actes de bienséance, de cérémonie, de politesse sont toujours suivis à Alger d'une donation en argent ou en effets. Tout est réglé : on ne connaît point les compliments qui ne sont pas accompagnés de présents. » (Venture de Paradis, op. cit.)
(...) « Les ministres du dey n'ont point de traitement régulier ; mais, comme ils ne servent pas pour l'honneur, il leur paraît tout simple de prendre d'autres moyens de lever des contributions sur le public. Aussi peut-on dire que tous les officiers du dey sont de véritables emblèmes de vénalité et de concussion. » (Pananti, op. cit.)
(...) « Des chefs sans principes, des tribunaux sans lumières, des prêtres sans mœurs, des marchands sans foi, des ouvriers sans émulation. Ce que cet État produit ? L'abrutissement entier des Maures, des Arabes, des Juifs, tous plongés dans la misère et dans l'opprobre, tous esclaves aussi rampants, aussi tremblants que s'ils avaient encore quelque chose à perdre. » (Raynal, op. cit.)
UN SEUL COMMERCE, LA GUERRE DE COURSE ET LE TRAFIC DES ESCLAVES
(...) « La politique extérieure des deys se trouvait, comme leur politique intérieure, dominée par la question financière. La Course étant leur principal revenu, ils ne pouvaient pas être question d'y renoncer et les premiers qui, sous l'influence de la terreur causée par les bombardements, essayèrent de le faire tombèrent sous les coups de la milice qu'ils ne purent pas solder régulièrement. » (Grammont, op. cit.)
(...) « Les raïs, ou capitaines de corsaires, forment un corps respecté et très considéré à cause des richesses que leurs courses procurent au pays dont ils sont les plus fermes appuis. » (Shaw, op. cit.)
(...) « Après avoir mouillé dans le port, le capitaine conduit tous les esclaves au palais du dey où les consuls des puissances étrangères sont aussitôt appelés et qui, en présence du dey, demandent à ces infortunés s'il s'en trouve parmi eux de leurs nations respectives. S'il s'en présente, les consuls s'informent par eux-mêmes s'ils étaient passagers ou s'ils faisaient partie de l'équipage du bâtiment pris. Dans le premier cas, ils sont remis à leurs consuls ; mais s'ils ont été pris les armes à la main, ils sont de droit esclaves. Le dey fait alors ranger tous ceux qui sont dans ce cas et en prend huit à son choix, lequel tombe ordinairement sur le capitaine, les officiers-mariniers, les ouvriers et surtout les charpentiers qu'il envoie conjointement au bagne du gouvernement ; les autres sont conduits au batistan ou marché aux esclaves où il s'en fait une première vente et où les delets ou courtiers les promènent l'un après l'autre, en faisant connaître à haute voix leurs bonnes qualités et le prix que l'on en offre. Mais ces ventes ne s'élèvent jamais bien haut parce qu'il s'en fait une seconde au palais du dey où l'esclave est remis entre les mains du plus offrant et dernier enchérisseur. L’État retire un bénéfice considérable, tant de la vente des esclaves que de leur rachat, qui est de 10 % du prix d'enchère. »
(...) Voici la description que le capitaine anglais Croker, envoyé à Alger en 1815, fait de la prison des chrétiens :
« Cet affreux séjour se trouve dans une des rues les plus étroites d'Alger. Une petite cour carrée à l'entrée sert aux captifs à prendre l'air. Leur nourriture journalière consiste en deux pains noirs d'une demi-livre chacun ; ceux qui travaillent ont de plus dix olives. Mais comme les travaux cessent le vendredi, qui est le jour de repos des Turcs, ces infortunés restent enfermés toute la journée et ne reçoivent autre chose du gouvernement algérien que de l'eau. Heureusement que la charité d'un aga turc y supplée. Cet homme humain, qui avait éprouvé dans sa jeunesse le malheur d'être esclave, a fait une fondation destinée à fournir le vendredi une livre de pain à chaque prisonnier. De cette cour, dit le capitaine Croker, je montai par un escalier de pierre dans une galerie autour de laquelle régnait un certain nombre de chambres humides et dont le plancher était en terre ; de fortes grilles de fer assuraient l'inviolabilité des portes et des fenêtres. Deux de ces pièces contenaient vingt-quatre espèces de cadres suspendus les uns au-dessus des autres et formés uniquement de quelques branches d'arbre entrelacées. Quelque pitoyables que fussent ces lits, il fallait encore payer pour s'y reposer ! L'odeur en était si infecte qu'une des personnes qui m'accompagnaient fut sur le point de se trouver mal. » (Shaw, op. cit.)
(...) « Le nombre des esclaves emprisonnés ne fut pas inférieur, pendant la durée de la Régence, à trente mille. Des soulèvements partiels furent impitoyablement réprimés en 1531, 1552, 1662, 1753, 1763. (...) Les Maures se cotisaient pour acheter un captif qu'ils destinaient au supplice. Le feu et la privation d'aliments délivraient de la vie de véritables martyrs. » (M. Martin, La vie et les conditions des esclaves chrétiens dans la Régence d'Alger.)
(...) Les Algériens avaient l'avantage de n'avoir pas de commerce, de sorte qu'on ne pouvait leur rendre le mal qu'ils faisaient — leur commerce était la guerre. » (Nettement, op. cit.)
PAS UN SEUL MÉDECIN !
(...) « Beaucoup d'obstacles se présentent à celui qui veut voyager dans l'intérieur. Il n'y a point de ponts sur les rivières ; et, pour les grandes routes, elles choqueraient la politique du gouvernement. Il les regarde comme pouvant faciliter la marche d'un ennemi et ouvrir des communications au peuple. Etrange paradoxe ! Le gouvernement pense qu'il est de son intérêt de prévenir ces communications. » (Pananti, op. cit.)
(...) « Les rues sont mal pavées, sales, obscures, non aérées. Nous n'aurions jamais pu avancer au milieu de ces masses si des gardes qui marchaient devant nous ne nous eussent ouvert le passage en distribuant des coups à droite et à gauche avec une dextérité et une prodigalité toute particulière à ce pays. » (Bianchi, Relation, 1675)
(...) « Excepté la principale rue d'Alger, toutes les autres sont étroites et d'une malpropreté extrême. Il n'y a ni places ni jardins dans la ville. Alger ne possède point non plus d'eau douce... L'eau qui se perd, soit en buvant, soit en la tirant dans les vases destinés à cet effet, se réunit et est conduite par d'autres tuyaux dans des égouts et des cloaques où se rendent les ordures des maisons et qui communiquent à une grande fosse située près de la Marine d'où toutes les immondices se jettent dans le port : ce qui produit une grande puanteur à la porte du môle durant les chaleurs. » (Shaw, op. cit.)
(...) « Considérant le petit nombre des villes commerciales et manufacturières, le despotisme barbare qui pèse sur le pays et la vie pastorale qui est encore celle d'un grand nombre de ses habitants, je pense que, malgré les avantages d'un beau climat et d'un sol fertile, la population de ce royaume, pour une surface d'environ trente mille mètres carrés, est plutôt au-dessous qu'au-dessus d'un million. » (William Shaler, consul général des États-Unis à Alger, Esquisse de l'Etat d'Alger, 1830)
(...) « Tous ceux qui nous ont donné des descriptions de cette ville (Alger) me semblent avoir mis bien de l'exagération dans l'évaluation du nombre de ses habitants. Pour moi, quand je compare Alger à d'autres villes dont la population est bien connue, je la réduirais à environ cinquante mille âmes. « (Shaler, op. cit.)
(...) « Les Algériens se sont toujours fait gloire de négliger toutes les précautions employées par les chrétiens pour prévenir la communication de la peste. C'est, à leur avis, s'opposer aux décrets éternels de la Providence et au cours de la prédestination absolue qui en est le résultat. » (Laugier de Tassy, Histoire des Etats bar-baresques qui exercent la piraterie, 1757)
(...) « On ne voit pas un seul médecin à Alger, ni dans le reste du royaume. Les bigots mahométans en censurent l'usage. Ils prétendent que c'est tenter Dieu que de prendre dans les maladies internes des remèdes prescrits par l'art de l'homme. J'ai vu le dey Baba Hali emporté par une fièvre violente sans qu'on pût l'engager à prendre aucun remède ; quoi qu'un habile chirurgien françois, qui était son esclave, lui promît guérison, il rejeta tout secours sous prétexte que le nombre de ses jours était fixé par les décrets éternels. » (Laugier de Tassy, op. cit.)
(...) « Il est facile de concevoir que la médecine n'est pas à Alger dans un état brillant. On donne aux docteurs le nom de thibid ; et toute leur science est tirée d'une traduction espagnole de Dioscoride. Leur étude favorite est celle de l'alchimie. Leur manière de traiter les malades paraîtrait singulière à un praticien d'Europe. Ils versent du beurre fondu sur les blessures nouvelles ; dans des cas de rhumatismes, ils font des piqûres avec la lancette sur les jointures les plus affectées ; ils appliquent le feu à un ulcère obstiné ; dans les inflammations, ils couvrent la tête du malade de feuilles de certaines plantes médicales ; et pour les morsures de scorpions ou de serpents, ils emploient de l'ail ou des oignons mâchés. En Barbarie, un professeur de médecine n'a de confiance qu'aux remèdes extérieurs. » (Pananti, op. cit.)
L'ESPAGNE, MESSAGÈRE DE CHARITÉ
(...) « Il n'y a que la charité de l'Espagne qui ait consacré un fonds pour l'établissement d'un petit hôpital où l'on reçoit les esclaves chrétiens. » (Raynal, op. cit.)
(...) « Cet hôpital (espagnol) était trop étroit encore, malgré tant d'agrandissements, pour le nombre de ceux qu'on y présentait ; de sorte que les lits des malades arrivaient jusqu'à l'autel où l'on célébrait les saints mystères de Dieu, leur hôte et leur protecteur. On y recevait les chrétiens libres comme les chrétiens esclaves, de toutes les nations sans distinction. (...) Ainsi la charité avait tout créé à Alger, le rachat des esclaves, l'hôpital, l'église, le cimetière. » (Nettement, op. cit.)
(...) « Le capitaine Croker visita aussi l'hôpital espagnol, ainsi nommé parce qu'il est entretenu aux frais de l'Espagne. Il y vit, étendus sur la terre, des vieillards, des femmes, des enfants. Tous avaient des jambes tellement enflées et ulcérées que leurs plaies paraissaient incurables. Il remarqua surtout, au milieu de plusieurs autres femmes, une pauvre Sicilienne qui fondit en larmes en lui disant qu'elle était mère de huit enfants en lui en montrant six qui étaient esclaves avec elle depuis treize ans ! La plupart de ces femmes avaient été enlevées dans des descentes faites par les Barbaresques sur les côtes de l'Italie. En quittant ce lieu d'horreur, le capitaine rencontra des esclaves mâles que l'on ramenait du travail au bagne, conduits par des infidèles armés d'énormes fouets ; plusieurs d'entre eux étaient pesamment chargés de chaînes. » (Shaw, op. cit.)
LES TROIS-QUARTS DES TERRES EN FRICHE
« Alors que les Romains avaient su admirablement mettre en valeur la terre africaine, celle-ci, après l'invasion arabe, était redevenue inculte et improductive.
Il appartenait à la France de rendre à la prospérité des régions telles que la plaine de la Mitidja — orgueil de notre Algérie — qui, avant l'œuvre splendide de nos colons (combien y moururent à la peine ?), était si insalubre qu'un Arabe tel que Hamdan-Ben-Othman Khodja traite de "chimérique" le projet d'assainissement élaboré dès la conquête par l'armée civilisatrice du maréchal Bugeaud.
L'histoire devait montrer ce dont étaient capables des Français héroïques à une époque où des intellectuels n'avaient pas inventé le « crime de colonisation ».
(...) « L'industrie est et doit être nulle chez des peuples plongés dans des ténèbres aussi épaisses. On n'y connaît aucun art agréable, et ceux de nécessité première y sont très imparfaits. Le plus important de tous, l'agriculture, est encore dans l'enfance. Les trois-quarts du terrain sont en friche et le peu qui est labouré l'est sans intelligence. » (Raynal, op. cit.)
(...) « Avec le sol le plus beau de la terre, il est impossible de trouver une contrée qui soit plus négligée que l'Etat d'Alger. Il est à peine besoin de dire que là où les trois-quarts du territoire ne sont pas cultivés, l'agriculture doit être dans le dernier état d'abandon. A peine le soc de la charrue laisse-t-il une trace sur les terres labourées. (...) Dans l'Etat d'Alger il se fait une grande quantité d'huile d'olives qui, en général, n'est pas d'une bonne qualité parce qu'on ne sait pas la bien préparer. On laisse croître l'olivier sans jamais le tailler, et son fruit en souffre beaucoup. Le vin qui est fait par des esclaves chrétiens est aussi bon que celui des Roses en Espagne ; mais il perd aisément son goût et se conserve peu. On fait le beurre en mettant le lait dans une peau de chèvre qui est suspendue et qu'on frappe de chaque côté avec des bâtons jusqu'à ce que le beurre puisse être foulé par la main.
Ces procédés donnent un mauvais goût au beurre, qui de plus se trouve rempli de poils. On moud le blé dans des moulins que trois chameaux font tourner. Les cultivateurs ne connaissent point les engrais des terres et se bornent à mettre le feu au chaume et aux herbes sauvages, usage qui produit quelquefois de graves accidents. » (Pananti, op. cit.)
(...) « La plaine de la Mitidja est coupée par la rivière d'Elarach qui a son embouchure dans la rade à une lieue d'Alger. C'est une superbe plaine de dix lieues de long sur deux lieues de large ; elle va aboutir aux montagnes de l'Atlas habitées par les Cabaïlis. Il s'en faut malheureusement beaucoup qu'elle soit toute cultivée ; elle est remplie de lacs et de terres en friche. Les gens d'Alger et le béiliky ont des métairies d'ici et de là, où on met une petite maison pour le maître et des cabanes de jonc pour les cultivateurs maures ; on appelle ces cabanes gourbis. Pour en défendre l'entrée au vent, on applique sur les côtés des bouses de vache. » (Venture de Paradis, op. cit.)
(...) « Si ce malheureux pays pouvait, par l'enchaînement des choses, jouir encore une fois des bienfaits de la civilisation, Alger, aidé des seules ressources de la plaine de Mitidja, deviendrait une des villes les plus opulentes des côtes de la Méditerranée. Mais l'action silencieuse du despotisme barbare de son gouvernement ne laisse à sa surface que le désert, la stérilité et la solitude. » (Shaler)
(...) « Je visite chaque année cette plaine au printemps —j e craindrais la fièvre dans toute autre saison ; et même à cette saison j'ai le soin de prendre avec moi de l'eau de Cologne et d'autres préservatifs contre le mauvais air ; je fais aussi une provision d'eau que j'apporte d'Alger pour ma boisson. Cette plaine est comme un marais durant l'hiver ; pendant l'été et l'automne, la fièvre y séjourne continuellement, au point qu'il est fort difficile de s'en préserver. » (Sidi Hamdan-Ben Othman Khodia, Aperçu historique et statistique sur la Régence d'Alger, 1833)
INSTRUCTION ET CONDITION FÉMININE
« Il n'y a rien de si misérable que la vie des gens qui habitent les campagnes et les montagnes d'Alger. Ils n'ont pour toute nourriture que du pain d'orge et du couscoussou fait avec de la mantague ; ils ne connaissent point la viande, ni les herbages, ni lesfruits. Si tous les gens de la campagne mangeaient du pain de froment, peut-être la récolte de blé ne suffirait pas. Les hommes et les femmes ne portent point de chemise : la même haïque qui leur sert le jour leur sert la nuit pour se couvrir. Leur lit, et c'est encore les plus aisés, est une simple natte de jonc sur laquelle ils s'étendent. Pendant l'hiver, ils sont obligés de recevoir dans leur tente leurs moutons, leurs vaches et leurs chevaux. La femme est occupée toute la journée à moudre son orge avec un petit moulin à bras. C'est elle qui a le soin d'aller chercher l'eau et le bois. Ils ne s'éclairent jamais pendant la nuit qu'à la lueur d'un peu de feu ; ils ne connaissent point l'huile. » (Venture de Paradis, op. cit.)
« Le maître punit les fautes de ses écoliers de la bastonnade ; assis comme ils sont sur des nattes avec les jambes croisées, pieds nus, il lui est aisé de leur lier ces derniers avec un insrument fait exprès, nommé falaca, qui les tient collés ensemble. Il les fait ensuite tenir par quelqu'un dans une situation presque perpendiculaire et y applique avec une règle ou un bâton autant de coups qu'en mérite la faute. » (Laugier de Tassy, op. cit.)
« Toute l'instruction qu'on donne aux enfants consiste à les envoyer à l'école, où ils apprennent à lire et à répéter cinquante ou soixante aphorismes du Coran. Quand un enfant est susceptible de ce gigantesque effort d'instruction et de science, son éducation est finie. » (...) « Les sectateurs de Mahomet trouvent plus convenable à leur politique barbare de couvrir les yeux du cheval condamné à moudre le blé. » (Pananti, op. cit.)
« Les gens de lettre, appelés alfagui et talbi, sont pour l'ordinaire des imposteurs qui font usage du peu de talents qu'ils possèdent avec la seule vue de maintenir la plus profonde ignorance dans la populace. Les Imams et les Musulmans, exclusivement dévoués à l'étude du Coran, forment une barrière impénétrable contre la connaissance » (Pananti)
« Leur ignorance en mathématiques est telle qu'ils n'ont pas les
premières notions de l'arithmétique et de l'algèbre. » (Shaw)
« Il n'y avait aucune librairie, aucun café où on lût les papiers-nouvelles, aucune société, aucun individu même dont on pût tirer une idée nouvelle. Comment en effet un peuple rempli de préjugés si barbares se livrerait-il à l'étude ? Et, avec son esclavage et son indolence, encouragerait-il des améliorations ? » (Pananti)
« Très peu de femmes ont ici quelque idée de religion. On regarde comme tout à fait indifférent qu'elles prient ou non ; qu'elles aillent à la mosquée ou qu'elles restent chez elles. Elles sont en conséquence élevées dans l'ignorance la plus grossière. Elles ne semblent faites que pour être les dupes des hommes. » (Laugier de Tassy, op. cit.)
JUSTICIERS (A VENDRE) ET BOURREAUX
« Le cadi ou juge est nommé par la Porte ottomane, approuvé du grand moufty ou patriarche ottoman de Constantin ople. Il juge et décide toutes les affaires qui regardent la loi ; mais comme ce juge achète indirectement son emploi à Constantinople et qu'il vient pour s'enrichir, il se laisse aisément corrompre. » (Peysonnel, op. cit.)
« Il n'y a point de code civil en Barbarie ; il est suppléé par le Coran, de manière que toute la doctrine de la jurisprudence algérienne repose sur l'interprétation du divin livre et de ses saints commentateurs » (Pananti)
« La justice, tant civile que criminelle, se rend ici d'une manière très sommaire, sans écriture, sans frais et sans appel, soit par le dey, le cadi ou le raïs de la marine. » (Shaw, op. cit.)
« Le châtiment réservé aux Juifs est le feu, le décollement, la pendaison et les crocs, et le dernier supplice pour les femmes est d'être noyées. Les Juifs qui méritent la mort sont toujours brûlés et c'est à Bab-el-Wad qu'on dresse le bûcher. C'est là aussi le lieu du supplice pour les chrétiens ; il est à Bab-Azoun pour les Maures. Ceux-ci, de même que les chrétiens, ont la tête coupée ou sont pendus ; les crocs ne sont que pour les Maures dans des cas très graves. Ils sont aux deux côtés de la porte de Bab-Azoun attachés aux remparts ; on y jette le coupable qui y reste accroché par un membre, et il y expire dans des supplices affreux. » (Venture de Paradis, op. cit.)
ACCORD EUROPÉEN SUR LA NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION
« Le lecteur s'étonnera qu'à une puissance aussi insignifiante, aussi méprisable, ait été si longtemps abandonné le privilège de gêner le commerce du monde et d'imposer des rançons qu'on ne pouvait discuter ; il s'étonnera que les grandes puissances de l'Europe soient allées, au prix de sacrifices immenses d'hommes et d'argent, établir des colonies aux dernières limites du monde, tandis qu'une poignée de misérables pirates conservait, sous leurs yeux, la jouissance paisible de la plus belle partie du globe et les soumettait à des conditions qui ressemblaient beaucoup à l'hommage d'un vassal. Les Algériens, dont le système politique a pour principe la piraterie, s'arrogent insolemment le droit de faire la guerre à tous les Etats chrétiens qui n'achètent pas leur bienviel-lance par des traités. » (Shaler, op. cit.)
« Toutes les grandes puissances, par une politique peu généreuse, ont longtemps cherché à se conserver la navigation libre de la Méditerranée aux dépens des petites. Cependant, toutes consentent aujourd'hui à être honteusement tributaires des forbans d'Alger sous différentes dénominations. (...) « On pourrait ici faire une observations très juste : c'est que les traités faits avec les Algériens lient les puissances européennes, mais ils ne les lient jamais eux-mêmes. Lorsqu'il y a quelque chose qui les embarrasse, ils s'en affranchissent, et lorsqu'on veut argumenter contre eux d'après les clauses du traité, ils répondent : — Celui qui a signé un pareil traité n'est pas un saint et on peut légitimement revenir du tort qu'il a fait au beilik par une stipulation irréfléchie. D'ailleurs, si cela vous déplaît, la porte est ouverte et vous pouvez vous embarquer. — Ce raisonnement péremptoire ferme ordinairement la bouche des consuls et coupe court à leurs réclamations. » (Venture de Paradis, op. cit.)
« Ou nous nous trompons, ou nous croyons avoir dit ce qu'il fallait pour démontrer que le repos, que la fortune, que la dignité de l'Europe chrétienne exigeaient la fin des brigandages que s'est permis durant trois siècles, que se permet encore l'Afrique septentrionale. Cette vérité frappe également l'aveugle multitude et les politiques raisonnables. » (Raynal, op. cit.)
« Une guerre semblable ayant le rare avantage d'être d'accord avec l'humanité et une saine politique ne pourrait manquer d'être populaire. » (Pananti, op. cit.)
« De petits intérêts de commerce ne peuvent balancer les grands intérêts de l'humanité : il est temps que les peuples civilisés s'affranchissent des honteux tributs qu'ils paient à une poignée de barbares. » (Intervention de M. de Chateaubriand à la Chambre des Pairs rapportée par Raynal)
« Pendant que l'on s'occupe des moyens d'abolir la traite des noirs et que l'Europe civilisée s'efforce d'étendre les bienfaits du commerce sur la côte occidentale de l'Afrique, ceux de la sécurité des personnes et des propriétés dans l'intérieur de ce vaste continent, il est étonnant qu'on ne fasse aucune attention à la côte septentrionale de cette même contrée, habitée par des pirates qui, non seulement oppriment les naturels de leur voisinage, mais les enlèvent et les achètent comme esclaves pour les employer dans les bâtiments armés en course. Ce honteux brigandage ne révolte pas seulement l'humanité mais il entrave le commerce de la manière la plus nuisible puisqu'un marin ne peut naviguer aujourd'hui dans la Méditerranée, ni même dans l'Atlantique, sur un bâtiment marchand sans éprouver la crainte d'être enlevé par ces pirates et conduit esclave en Afrique. » (Mémoire sur la nécessité et les mesures à prendre pour détruire les pirateries par Sir Sydney Smith, envoyé de l'Angleterre au Congrès de Vienne, daté de Londres, 30 août 1814, cité par Raynal, op. cit.)
« A quel peuple est-il réservé de dompter ces forbans qui glacent d'effroi nos paisibles navigateurs ? Aucune nation ne peut le tenter seule ; car si l'une d'elle l'osait, peut-être la jalousie de toutes les autres y mettrait-elle des obstacles secrets. Ce doit donc être l'ouvrage d'une ligue universelle. Il faut que toutes les puissances maritimes concourent à l'exécution d'un dessein qui les intéresse toutes également. Ces Etats, que tout invite à s'allier, à s'aimer, à se défendre, doivent être fatigués des malheurs qu'ils se causent réciproquement. Qu'après s'être si souvent unis pour leur destruction mutuelle, ils consentent donc à prendre les armes pour leur conservation : la guerre aura été du moins une fois utile et juste. » (Shaw, op. cit.)
« C'est surtout aux peuples subjugués que celle-là deviendrait utile ; ils recevraient de leurs vainqueurs des lois, les sciences, les arts et le commerce ; les mœurs de la civilisation remplaceraient la barbarie, les terres ne seraient plus sans culture et les productions du sol un fardeau pour leurs propriétaires. » (Pananti)
« Les conquêtes seraient d'autant plus sûres que le bonheur des vaincus en serait la suite. (...) Puisse un semblable projet se réaliser un jour ! » (Shaw, op. cit.)
Écrits de Paris février 2009
culture et histoire - Page 1952
-
Cette "radieuse Algérie" d'avant la conquête française
-
La pensée politique de Gramsci
Antonio Gramsci fut, dans l’Italie des années 20-30, le théoricien marxiste que l’Histoire avait chargé de tirer les enseignements d’un échec : celui de la révolution européenne, italienne en particulier. Echec d’autant plus cruellement ressenti par les militants européens que la victoire des Bolcheviks en Russie faisait contraste – et contraste, en l’occurrence, inexplicable dans le cadre de la théorie édifiée jusque là. Cette mission lui donna l’opportunité de formuler une théorie révolutionnaire nouvelle, et qui allait inspirer des générations d’activistes, de propagandistes et de tacticiens.
Pour Jean-Marc Piotte, la notion-pivot de cette théorie est « l’intellectuel ». Gramsci est en effet le premier disciple de Marx à avoir mis, au centre de sa pensée, une reprise réflexive de son propre positionnement, et du positionnement de ses homologues adverses. Gramsci a inventé les concepts d’intellectuel « organique », « traditionnel », « collectif », et il en a déduit ceux de « société civile » et de « société politique ».
Etudier Gramsci, c’est donc remonter à la source d’une bonne partie des « expressions toutes faites » que nous lisons presque quotidiennement, sans qu’elles soient clairement définies.
L’intellectuel organique est défini par la place qu’il occupe au sein d’une structure sociale. Il se distingue du travailleur manuel non par l’utilisation des connaissances (un manuel aussi a des connaissances), mais par la fonction qu’il occupe : construire la conscience de leur fonction par les divers groupes sociaux. L’intellectuel organique est donc, fondamentalement, celui qui construit, entretient ou anime un système de représentation socialement partagé. En règle générale, il émerge progressivement, au fur et à mesure qu’une classe s’élève jusqu’à acquérir une position dominante ou presque dominante, par spécialisation au sein de l’élite de la classe en question. Cette spécialisation résulte dans un premier temps de nécessités économiques : les premiers intellectuels de la bourgeoisie sont des organisateurs de la suprématie économique de cette classe.
Or, Gramsci pose une loi historique : quand les organisateurs ne se font pas théoriciens, l’ascension de la classe considérée est bloquée. Il explique, par exemple, l’incapacité politique de la bourgeoisie italienne pendant la période des Communes, par son inaptitude à secréter des intellectuels organiques théoriciens à partir des intellectuels organiques organisateurs. Il en déduit que l’intellectuel organique théoricien effectue une action qui est indispensable à la constitution d’une classe sociale dominante, ou en tout cas en situation de contester la dominance. Cette action, explique-t-il, c’est la construction de la fonction hégémonique de la classe sociale en question au sein de la société civile.
La fonction hégémonique est définie comme le travail de mise en conformité du discours véhiculé par la société civile (c'est-à-dire la Cité hors du champ proprement politique) – une mise en conformité avec les valeurs, les logiques et les prédicats qui correspondent aux intérêts de la classe sociale hégémonique. Cette fonction hégémonique prépare, facilite et accompagne le travail de coercition exercé par la classe dominante, y compris par ses intellectuels au sein de la société civile. En ce qui concerne l’activité spécifique de l’intellectuel supérieur, elle recouvre très largement un travail d’inclusion sélective des idéologies produites par les classes rivales (exemple : Marx a repris une partie de la pensée de Hegel, donc l’idéologie du Prolétariat inclut une partie de l’idéologie bourgeoise).
Pour que la fonction hégémonique soit assurée, il faut, d’abord, que la classe considérée possède une unité de représentation. Si elle n’est pas unifiée sous cet angle, elle ne peut promouvoir l’hégémonie de sa vision du monde, faute d’en avoir une. Bien entendu, il n’appartient pas aux intellectuels organiques de constituer une vision du monde autonome ; ils ne peuvent en pratique que formuler une vision induite par le positionnement de la classe à laquelle ils se rattachent. Mais sans cette formulation, la vision ne peut être, ensuite, propagée. En cela, l’intellectuel organique est plus que le simple reflet de sa classe sociale : le travail de formulation et de mise en cohérence qu’il opère peut aussi, à la marge, influer sur la définition exacte de la classe elle-même. C’est pourquoi, explique Gramsci, le « Parti » est indispensable à la constitution du Prolétariat comme classe consciente d’elle-même : quand le Parti se définit comme au service du Prolétariat, le « service » inclut la formation du Prolétariat en tant que classe consciente. Le Parti a raison de dire qu’il incarne la conscience de classe des prolétaires, mais la vérité, c’est qu’il ne se contente pas de l’incarner, il la crée.
En résumé, chez Gramsci, l’intellectuel est « organique » parce qu’il est, directement ou indirectement, inscrit dans une organisation (parfois aux marges d’une organisation), elle-même liée plus ou moins directement à un groupe social donné. Il existe deux types d’intellectuel organique : d’une part les intellectuels organiques spécialisés, capables d’assurer la fonction d’hégémonie de leur groupe dans un domaine précis, sans toutefois proposer et diffuser une vision du monde globale et cohérente conforme aux intérêts du groupe, et d’autre part les intellectuels organiques théoriciens, qui sont, eux, capables d’opérer une action générale sur la « société civile ». Ces deux types d’intellectuels organiques vont se rencontrer principalement d’une part dans la classe dominante, d’autre part dans la classe dominée capable de contester la domination. La présence, ou l’absence, d’intellectuels organiques théoriciens dans la classe contestataire décide généralement de son aptitude à opérer une révolution.
Un type particulier d’intellectuel organique intéresse plus particulièrement Gramsci : il s’agit de l’intellectuel « traditionnel », c'est-à-dire l’intellectuel organique théoricien d’une classe dominante en déclin. Ce type d’intellectuel est particulièrement intéressant aux yeux de Gramsci parce que, étant inscrit dans une structure sociale fragilisée, il peut, par sa décision de basculer (ou pas) au service des classes contestataires, jouer un rôle décisif dans l’évolution de la structure sociale.
L’intellectuel traditionnel est défini par la place qu’il occupe au sein d’un processus historique. Pour Gramsci, c’est l’axe qui permet le mieux de saisir les intellectuels inscrits dans une structure sociale en déclin. Par exemple, le clergé catholique d’Ancien Régime a toujours veillé à présenter sa fonction comme fondamentalement religieuse, extérieure à une société que son rôle religieux lui permettait de modeler, mais la réalité fut presque toujours autre : fondamentalement, le clergé catholique d’Ancien Régime était la classe des intellectuels traditionnels associée à la noblesse terrienne comme classe dominante. Il était donc modelé par le social autant qu’il pouvait en retour le modeler.
L’analyse du rôle du clergé lors de la phase d’ascension de la bourgeoisie (et de déclin de la noblesse) permet à Gramsci de mettre en évidence la fonction hégémonique lors d’une phase de mutation des structures sociales, et la façon dont l’intellectuel traditionnel l’assume. En Italie, à l’entrée dans l’époque moderne, ce clergé est très puissant, appuyé sur un domaine propre, autour de Rome, où il est à la fois la classe hégémonique intellectuellement et la classe dominante économiquement. Assujetti à la Papauté, il est de facto lié indissolublement au maintien d’un ordre transnational, donc étranger à la dynamique spécifique que la bourgeoisie impulse à chaque société nationale en voie de constitution. Ce clergé italien a donc particulièrement intérêt à défendre l’Ancien Régime en Italie, et est en outre particulièrement en situation de le faire, puisque son rayonnement international le place en quelque sorte en surplomb de l’évolution d’une bourgeoisie italienne qui ne le déborde jamais. C’est ainsi qu’usant du pouvoir d’influence et de coercition de l’Eglise, il parvient à intégrer systématiquement les intellectuels qu’il ne rejette pas au-delà des frontières (contribuant ainsi, indirectement, à fabriquer les élites intellectuelles des nouvelles nations françaises, allemandes et anglaises).
Toujours en analysant l’histoire de son pays, Gramsci montre comment l’intellectuel organique de la petite bourgeoisie rurale (médecins, avocats, notaires) est, par la suite, potentiellement à la fois l’intellectuel organique d’une classe désormais dominante (la bourgeoisie industrielle, dont il est proche par son éloignement des tâches d’exécution) et d’une classe dominée (le prolétariat rural et la petite paysannerie, dont il est proche géographiquement, et de par son éloignement des processus industriels). Et Gramsci remarque que la politique de la bourgeoisie d’affaires italienne, dès qu’elle eut saisi le pouvoir vers le milieu du XIX° siècle, consista, à l’égard de la petite bourgeoisie rurale, à se l’attacher pour l’empêcher de servir à l’incubation d’une conscience politique dans les zones rurales, largement étrangères à la domination des intellectuels organiques de la bourgeoisie industrielle. Gramsci en déduit que la lutte culturelle conduite en Italie, au XIX° siècle, par une bourgeoisie astucieuse, explique en grande partie que les choses ne se soient pas passées, dans la péninsule et en 1919, comme elle se déroulèrent en Russie et en 1917.
Ces constats vont l’amener à formuler une nouvelle théorie de l’action politique révolutionnaire : la Révolution culturelle.
Aux yeux de Gramsci, le parti communiste est l’intellectuel organique collectif du prolétariat. Son travail est de développer au sein du prolétariat une conscience de classe qui, sans lui, n’existerait que comme potentialité.
L’organisation d’un parti, compris comme intellectuel collectif d’une classe sociale, peut prendre diverses formes. Elle n’est pas nécessairement centraliste et unitaire. Par exemple, Gramsci relève que « l’ennemi » (les partis bourgeois italiens) s’est toujours organisé en incubant plusieurs partis, chargés de représenter des nuances, et dont la fédération constamment recomposée permet d’édifier un « parti unique de la bourgeoisie » qui ne dit jamais son nom. Cette configuration est utile lorsqu’il y a plusieurs classes associées (la bourgeoisie industrielle du Nord italien, les grands propriétaires terriens du Sud), et qu’il faut constamment renégocier entre leurs intérêts.
Gramsci est donc amené à distinguer le parti politique du parti idéologique. Le second est plus grand que le premier, et il inclut, en particulier, un réseau d’associations, parfois informelles, qui permettent l’action culturelle au-delà des cercles directement influencés par le Parti (politique), jusque dans les milieux constitutifs de partis distincts, mais potentiellement alliés.
La liaison entre Parti politique et Parti idéologique doit garantir une homogénéité idéologique, tout en permettant au Parti (politique) de la classe ouvrière de rayonner au-delà de cette classe. Une organisation générale du Parti idéologique a donc été progressivement esquissée par Gramsci, au fur et à mesure qu’il avançait dans son travail de théoricien.
Au centre se trouve une structure hiérarchisée, le Parti politique, qui constitue une pyramide à trois niveaux : les soldats (qui doivent comprendre les ordres, donc être formés idéologiquement et politiquement, et les exécuter, donc être disciplinés), les caporaux (qui doivent transmettre les ordres et, parfois, les interpréter), et les capitaines (qui doivent formuler les ordres en fonction de la situation tactique et au regard de la stratégie). Le Parti politique, colonne vertébrale de l’action, dispose donc d’une structure générale de type militaire. Sa force est que, tant qu’il existe un noyau de capitaines d’un bon niveau, il peut se reconstituer après chaque vague de répression, les capitaines recrutant les caporaux qui recrutent les soldats. D’une manière générale, le Parti politique est formé de haut en bas : on construit d’abord la doctrine, ensuite les cadres dirigeants sont formés, puis viennent les caporaux, et ensuite, enfin, les soldats. Ultérieurement, le Parti se refera de haut en bas en s’alimentant de bas en haut : on ira recruter les futurs caporaux chez les soldats, les futurs capitaines chez les caporaux, et ces capitaines « sortis du rang » viendront vivifier l’organisation, de haut en bas, en renvoyant à la base l’écho de sa propre expérience.
Autour de cette épine dorsale structurée par les liaisons verticales s’enroulent les métastases constitutives du Parti idéologique. Ici, les liaisons structurantes ne sont pas verticales, mais horizontales et obliques. Pour assurer son hégémonie sur la vie intellectuelle, le Parti, intellectuel collectif, forge la conscience de soi de la classe sociale qu’il représente, et, en retour, est forgé dans cette tâche. Ce que le prolétariat « sent », le Parti doit le comprendre et le faire comprendre. Ici, l’essentiel est la liaison horizontale, entre ce qui se trouve à la périphérie du Parti et ce qui se trouve dans son épine dorsale. C’est un flux d’information et un processus de construction du sens par itération, entre les initiatives et les sentiments des masses et la théorisation par les intellectuels.
Gramsci en déduira ce principe, plus tard reformulé par Mao, qu’un intellectuel doit travailler sur lui-même pour gommer sa propre sensibilité, et s’approprier celle des masses. On est là aux antipodes de la figure contemporaine du « grand écrivain », de l’artiste « de génie », à la sensibilité « unique ». Si loin en fait qu’à bien y réfléchir, on en arrive assez vite à la conclusion que cette figure contemporaine est précisément une stratégie visant à empêcher l’évolution des intellectuels traditionnels au rebours des intérêts des classes dominantes. Manifestement, les défenseurs de l’ordre contemporain ont lu Gramsci, et l’ont bien lu !
En somme, l’œuvre de Gramsci se résume à une méthode pour accomplir la révolution dans les pays européens, beaucoup plus développés que la Russie des Tsars, et où, par conséquent, il existe une société civile capable de résister au mouvement révolutionnaire par elle-même, avec ou sans le soutien de l’Etat. L’œuvre de Gramsci, c’est : pourquoi les communistes italiens n’ont pas réussi là où les bolcheviks russes ont réussi, et comment faire en sorte que cela change – c'est-à-dire : comment conquérir une société civile.
A la stratégie frontale de conquête du pouvoir par la force, Gramsci oppose une alternative, plus adaptée à la réalité des sociétés occidentales : la conquête des esprits, par la guerre culturelle, soit en retournant les intellectuels traditionnels, soit en les supplantant grâce à l’action énergique des intellectuels organiques du Parti. Alors seulement, dit-il, on peut faire passer une classe dominée de la soumission à l’ordre existant à une inscription dynamique dans cet ordre, puis de là, progressivement, à la constitution d’organisations, de relais, de réseaux indépendants de ceux de la classe dominante et potentiellement concurrents de ceux-ci – une démarche qui s’accomplit lorsqu’un nouveau monde émerge, à l’intérieur du monde ancien, un nouveau monde où les valeurs, la vision, le projet collectif sont structurés entièrement par des intellectuels organiques étrangers aux hiérarchies promues par la classe dominante.
On a coutume de présenter cette réflexion de Gramsci comme une grande originalité – la prise de conscience, par certains intellectuels marxistes, que la société civile appartient fondamentalement à la superstructure, pas à l’infrastructure, et que, par conséquent, si le Système dans son ensemble tient par la société civile, alors la lutte sur la superstructure doit accompagner et même souvent précéder celle conduite dans l’infrastructure. Et, de fait, dans l’univers des théoriciens marxistes de l’époque, il s’agissait là d’un renversement doctrinal de premier ordre. Le mérite de Jean-Marc Piotte est précisément de bien montrer en quoi Gramsci fut important, à une certaine époque et dans un certain contexte.
Pourtant, en même temps, on ne peut s’empêcher de sourire quand on lit certains commentaires de Piotte. Il y a, il faut bien le dire, un côté « les marxistes découvrent la Lune », chez Gramsci, et cela aussi fait partie du côté savoureux du travail de J.M. Piotte.
Car, après tout, s’agissant de Gramsci, son modèle révolutionnaire par conquête des « intellectuels traditionnels », qu’est-ce que c’est, sinon la Réforme luthérienne théorisée dans le cadre de la lutte des classes ? Et son modèle révolutionnaire par l’hégémonie des intellectuels organiques, triomphant d’intellectuels traditionnels dépassés, qu’est-ce que c’est, sinon le travail des Sociétés de Pensée avant la Révolution Française ?
Il est possible que tout cela passe pour original chez les léninistes purs et durs – mais du point de vue de l’Histoire longue de l’Europe, la « théorie révolutionnaire » de Gramsci n’est jamais qu’une analyse lucide et précise des stratégies qui permirent la victoire de la bourgeoisie, à l’époque de son ascension – et sa proposition tactique se borne donc, au fond, à proposer au prolétariat d’apprendre par son ennemi.
J.M. Piotte http://www.scriptoblog.com/ -
Identité (Z. Bauman)
« La notion d’identité est le produit d’une crise d’appartenance. »
La marotte de Bauman, c’est la modernité qu’il nomme « liquide », en rupture avec une modernité plus ancienne, « solide ».
Qu’est-ce à dire ?
Le « solide » comprend une fixité, des normes stables et étalées dans le temps, des repères clairement définis, bref la modernité conservant des vestiges de l’époque pré-moderne. Dans le « liquide », au contraire, rien n’est immuable, la mobilité est totalisante, les repères fixes abolis, les normes et valeurs supérieures régissant le vivre-ensemble sont, si ce n’est abolies, du moins en questionnement. D’où la nécessité de bâtir une analyse de l’identité sous son angle « liquide », où cadres et institutions sociales ont été « liquéfiés » et où l’imaginaire collectif de nos concitoyens serait empli d’un désir d’éphémère, de mobilité, loin d’une stabilité désormais honnie.
*
La question identitaire – aujourd’hui principalement nationale – surgit lorsque la réponse ne coule plus de source. Encore peu après la Deuxième Guerre Mondiale, la population rurale circonscrivait le « pays » au voisinage immédiat (environ vingt kilomètres), avant que la désagrégation de ces communautés ne transforme l’identité en problème à résoudre puis en devoir à accomplir, nous dit Bauman. Par contrainte, l’Etat-nation a étendu l’appartenance identitaire au champ national, autre que seulement locale, créant ainsi une cohésion et unité à plus vaste échelle. Par suite, l’Etat pouvait donc revendiquer un destin commun, et l’identité nationale primait sur toutes les autres (rappelons que la Constitution de la Vème République ne reconnaît pas les communautés autres).
Cependant, la mondialisation a provoqué un effondrement de la hiérarchie identitaire. Bien plus encore : l’économie étant transnationale, l’Etat n’a plus à en appeler au patriotisme, désormais « livré aux forces du marché et recyclé pour grossir les profits de l’industrie sportive, du divertissement et de la quincaillerie commémorative. » Corrélativement, les droits sont vidés de leur substance : droits économiques privés de souveraineté nationale, droits politiques soumis à la pensée unique néolibérale, droits sociaux progressivement remplacés par le chacun pour soi, l’Etat lui-même étant séparé de la nation.
Alors qu’auparavant, pour Simmel, l’identité était une expression des institutions – Famille, Eglise, Etat – elle est aujourd’hui pulvérisée par la société de masse moderne. D’après Bauman, dans nos sociétés modernes liquides, dites technologiques, c’est dans la mobilité que l’individu (que Bauman définit en reprenant Kracauer : « porteur de la culture et être spirituel mature, agissant et évoluant en pleine possession de ses facultés psychiques, allié à ses contemporains pour agir et ressentir ensemble ») cherche son identité, ou plutôt ses identités, substituables, cumulables, interchangeables, aujourd’hui même l’identité sexuelle (lundi Matthieu, mardi Mathilde, mercredi Matthias ? Table d’opération mon amour !).
« A défaut de qualité, on se rabat sur la quantité », nous dit Bauman. Le lieu de réalisation ? Les « groupes » (ou « totalités virtuelles »), éphémères, aussi faciles à intégrer qu’à quitter mais qui en réalité ne font que brouiller l’image de soi. A une époque où l’homme nomade (le nomadisme devenu devoir), vulgarisation de l’élite transnationale – privilégiée – est le « héros populaire », chercher une identité stable devient suspect.
La tradition n’étant plus sécurisante, on voit alors émerger des « communautés-patères », qui durent le temps d’un spectacle, d’un événement, d’une manifestation. Ephémère donc, l’engagement demandé pour y adhérer, et en profiter, est faible. A l’identité, on substitue donc le « réseau de connexions ». Réseau que l’on préfère toutefois textuel plus que visuel, le face-à-face devenu désormais intimidant et ne permettant pas le « zapping » ni la conversation différée, d’où le succès des SMS et tchats.
Seule la survie individuelle et ce qui peut la servir importent. Dans le monde du travail, loyauté et esprit d’équipe ne sont plus de rigueur : la tertiarisation a atomisé la solidarité ouvrière en la supplantant par un individualisme concurrentiel, comme le résume Bauman : « Ils préfèrent réclamer un meilleur présent pour chacun plutôt qu’un meilleur avenir pour tous. » La classe s’est effacée devant la race, le genre, la revendication postcoloniale, exaspérant les divisions, encore renforcées par des conflits multipolaires en rupture avec la « société bonne » (à rapprocher de la common decency orwellienne).
Le global s’est à présent fondu dans le catégoriel. Quant aux intellectuels, la génuflexion des chiens de garde arrivistes nous fait oublier qu’ils purent un temps se faire les porte-parole des faibles. Mais au-delà du monde professionnel, les relations amoureuses, cadre personnel, sont aussi victimes du « moderne liquide », car elles sont désormais envisagées sous un angle consumériste (ce dont se félicite Anthony Giddens), où jouissance immédiate, rupture et cumul de biens sont recherchés, au point que dans le couple, le conjoint est réifié.
Il en va de même pour le rapport au sacré, « ce qui transcende notre faculté de comprendre, de communiquer, d’agir » : radicalement évacué. Fait de scientisme et de technologie, le « liquide » bannit les idées éternelles, ce qui est « ancien » et « durable », pour se cantonner au strict présent et à la survie individuelle.
*
Une fois le constat posé vient alors la question : viable, l’identité liquide ? Que nenni, nous répond Bauman. L’identité, paradigme de l’ambivalence, est à double tranchant. Rêve, elle peut tout autant devenir cauchemar, car selon l’auteur l’homme a besoin de racines, de parenté, de camaraderie, d’amour, bref de stabilité et de relations continues dans le temps. Esseulé suite à la destruction de l’Etat-providence (Bauman préfère parler d’Etat social), c’est par dépit que l’individu se chercherait un cadre rassurant pluri-identitaire, face à une société torve et à un Etat ne proposant aucun modèle dominant ; de plus, la France ayant abandonné l’assimilation, le multiculturalisme se répand, les groupes étant en quête d’identité spécifique, chacun de son côté. Si la « communauté » est un carcan pour certains, elle s’avère donc libératrice pour d’autres.
Face à cela, existe-t-il une alternative politique ? L’altermondialisme, par exemple ? Bauman réfute cette idée, car alter signifie proposer une autre mondialisation, ce qui n’est pas souhaitable. De plus, le slogan de cette mouvance, « penser global, agir local », ferait le jeu du mondialisme en défendant un particularisme porteur de conflits multiples. L’altermondialisme aux oubliettes donc. Mais quid de « l’ère du multiculturalisme » ? Une feuille de vigne dissimulant la neutralité d’une élite « omnivore culturelle » nomade adepte du « supermarché multiculturel » qui a laissé tomber la mission collective en déshérence. Multiculturalisme entretenu par la télévision qui, par un effet d’extraterritorialité virtuelle synchronise les sujets de préoccupation, supercherie destinée à donner l’illusion de liberté de choix à des individus aliénés.
Dernière option donc : le nationalisme qui revient au galop ? Non plus. D’ailleurs, pour Bauman, celui-ci ne revient pas, il parle plutôt de revendications autonomistes et indépendantistes (il confond toutefois avec l’ethno-nationalisme, plus local), pour deux raisons : une volonté de protection face aux ravages de la mondialisation d’une part, la remise en question du lien entre Etat et nation d’autre part, ce qui renvoie pour lui « à l’érosion de la souveraineté de l’Etat. » Le nationalisme ne renaîtrait donc pas ? Il s’agirait de la recherche des « réponses ponctuelles à des problèmes générés à l’échelle mondiale », pour pallier les défaillances étatiques, face à une menace de balkanisation généralisée.
*
Quel est donc, en fin de compte, le souhait de Bauman ? Il postule que les luttes identitaires divisent plutôt que d’unir. Certes, mais n’est-ce pas un moyen de défendre sa culture autochtone (nationale par exemple) ?
Son idéal est, comme il l’expose, celui de l’humanité, d’une communauté véritablement universelle. Un zeste de Bourdieu, à première vue, tout comme lorsqu’il cite, en l’approuvant, Stuart Hall, lequel invite à relever le défi moderne de la diversité culturelle. Néanmoins – soyons optimistes – Bauman critique le multiculturalisme. C’est là qu’il semble flou, voire contradictoire.
Mais pour nous éclairer et conclure sur une note positive, nous le citerons au sujet des Etats-Unis, de l’Australie et du Canada, anciennes colonies, où il expose le caractère non viable d’un « patriotisme constitutionnel » (la seule condition posée aux nouveaux arrivants est de prêter allégeance aux lois du pays) préconisé par Habermas le mou. Il expose, et nous le rejoignons là-dessus, que « nombre d’immigrants ont choisi leur pays d’accueil en vue de préserver, de développer et de pratiquer à leur guise les particularismes religieux ou ethniques menacés dans leur pays d’origine ».
Pas forcément menacés, a-t-on tout de même envie d’ajouter…
Pourquoi une telle libéralité ? « Les immigrants n’ont pas rencontré de culture historique dominante et incontestée susceptible de servir de trame d’adaptation et d’assimilation pour tous les arrivants censés s’y soumettre. »
Il s’agit ici de sociétés à l’histoire jeune, mais la France en prend tout droit le chemin.
« Douce Frannnnnce-eu… »
Citations :
« Nous troquons quelques relations authentiques contre une multitude de contacts éphémères et superficiels. »
« L’identité prospère sur le champ de bataille, elle ne surgit que dans le tumulte ; sitôt que le bruit des armes s’éloigne, elle s’assoupit et reste silencieuse. On ne peut échapper à ce dilemme. »
« Les structures, si tant est qu’il y en a, ne tiendront plus longtemps. Elles finiront elles aussi par prendre l’eau, se liquéfier, suinter, et fuir. Les autorités aujourd’hui révérées seront demain tournées en dérision, méprisées et huées, les célébrités seront oubliées, les idoles à la mode ne survivront plus que dans les jeux télévisés, les nouveautés seront mises au rancart, les causes éternelles seront abandonnées pour d’autres causes tout aussi éternelles (peut-être finira-t-on, à force de parjure, par ne même plus y croire), les puissances indestructibles tomberont aux oubliettes, les palais et les banques seront engloutis par d’autres plus grands encore ou finiront tout simplement par disparaître, les actions à la hausse seront dévaluées, les brillantes carrières déboucheront sur une voie de garage. Dans un univers à la Escher, nul ne saura plus distinguer le haut du bas. »
Thibault Saint-Just http://www.scriptoblog.com -
Terrorisme à “visage humain” : l’histoire des escadrons de la mort des États-Unis
Le recrutement d’escadrons de la mort relève d’un programme bien établi de l’armée et des services de renseignement. L’histoire des assassinats ciblés ainsi que du financement et de l’appui clandestins à des brigades terroristes par les États-Unis est longue, macabre et remonte à la guerre du Vietnam.
Alors que les forces gouvernementales continuent à confronter l’« Armée syrienne libre » (ASL) autoproclamée, les racines historiques de la guerre clandestine occidentale en Syrie, laquelle a provoqué de nombreuses atrocités, doit être entièrement révélée.
Dès le début ,en mars 2011, les États-Unis et leurs alliés ont soigneusement planifié et soutenu la formation d’escadrons de la mort et l’incursion de brigades terroristes.
Le programme de recrutement et la formation de brigades terroristes à la fois en Irak et en Syrie ont été calqués sur « l’option Salvador », un « modèle terroriste » de massacres commis par des escadrons de la mort soutenus par les États-Unis en Amérique centrale. Cette option a d’abord été appliquée au Salvador, au plus fort de la résistance contre la dictature militaire, entraînant la mort d’environ 75 000 personnes.
La formation d’escadrons de la mort en Syrie s’inspire de l’histoire et de l’expérience des brigades terroristes en Irak appuyées par les États-Unis dans le cadre du programme de « contre-insurrection » du Pentagone.
La création d’escadrons de la mort en Irak
Les escadrons de la morts soutenus par les États-Unis on été recrutés en Irak en 2004-2005 dans le cadre d’une initiative lancée sous la direction de l’ambassadeur étasunien John Negroponte, envoyé à Bagdad par le département d’État en juin 2004.
Negroponte était « l’homme de la situation ». À titre d’ambassadeur au Honduras de 1981 à 1985, Negroponte a joué un rôle clé dans l’appui et la supervision des Contras du Nicaragua, établis au Honduras, et le contrôle des escadrons de la mort de l’armée hondurienne.
« Sous le règne du général Gustavo Alvarez Martinez, le gouvernement militaire du Honduras a été un proche allié du gouvernement Reagan tout en faisant « disparaître » des dizaines d’opposants politiques à la manière classique des escadrons de la mort.
En janvier 2005, le Pentagone, a confirmé qu’il envisageait :
De former des commandos de combattants kurdes et chiites pour cibler des chefs de l’insurrection irakienne [Résistance] dans un changement stratégique emprunté à la lutte des États-Unis contre les guérilleros gauchistes en Amérique centrale il y a 20 ans ».
En vertu de la soi-disant « option Salvador », les forces étasuniennes et irakiennes seraient envoyées pour tuer ou enlever des chefs de l’insurrection, même en Syrie, où l’on croit que certains se cachent [...]
Les commandos seraient controversés et demeureraient probablement secrets.
À l’heure actuelle, l’expérience des « escadrons de la morts » en Amérique centrale est toujours douloureuse pour bien des gens et a contribué à souiller l’image des États-Unis dans la région.
À l’époque, l’administration Reagan a financé et formé des équipes de forces nationalistes afin de neutraliser les chefs rebelles salvadoriens et leurs sympathisants […]
John Negroponte, l’ambassadeur étasunien à Bagdad, était alors à l’avant plan comme ambassadeur au Honduras de 1981 à 1985.
Les escadrons de la mort étaient une caractéristique brutale de la politique latino-américaine de l’époque [...]
Au début des années 1980 l’administration du président Reagan finançait et aidait à former les Contras nicaraguayen situés au Honduras dans le but de chasser le régime sandiniste du Nicaragua. L’équipement des Contras était acheté avec de l’argent provenant de la vente illégale d’armes étasuniennes à l’Iran, un scandale qui aurait pu renverser M. Reagan.
Le but de la proposition du Pentagone en Irak, […] est de suivre ce modèle […]
Il est difficile de dire si l’objectif principal des missions serait d’assassiner les rebelles ou de les enlever pour les interroger. Toute mission en Syrie serait probablement entreprise par des Forces spéciales étasuniennes.
On ignore également qui assumerait la responsabilité d’un tel programme – le Pentagone ou la Central Intelligence Agency (CIA). De telles opérations clandestines ont traditionnellement été dirigées par la CIA, indépendamment de l’administration, donnant la possibilité aux représentants officiels étasuniens de nier être au courant de leur existence. (El Salvador-style ‘death squads’ to be deployed by US against Iraq militants – Times Online, 10 janvier 2005, c’est l’auteur qui souligne.)
Alors que le but affiché de « l’option Salvador irakienne » était de « supprimer l’insurrection », les brigades terroristes parrainées par les États-Unis étaient impliquées en pratique dans des massacres successifs de civils en vue de fomenter de la violence interconfessionnelle. La CIA et le MI6 supervisaient pour leur part des unités d’« Al-Qaïda en Irak » impliquées dans des assassinats ciblés contre la population chiite. Fait significatif, les escadrons de la mort étaient intégrés et conseillés par des Forces spéciales étasuniennes.
Robert Stephen Ford, nommé ultérieurement ambassadeur des États-Unis en Syrie, était membre de l’équipe de Negroponte à Bagdad en 2004-2005. En janvier 2004, il a été envoyé à titre de représentant étasunien dans la ville chiite de Najaf, le bastion de l’armée du Mahdi avec laquelle il a pris contact.
En janvier 2005, Robert S. Ford a été nommé conseiller du ministre pour les affaires politiques à l’ambassade étasunienne, sous la direction de l’ambassadeur John Negroponte. Il ne faisait pas seulement partie du cercle restreint de Negroponte, il était aussi son partenaire dans la mise en œuvre de l’option Salvador. Une partie du travail de terrain avait été effectuée à Najaf avant le transfert de Ford à Bagdad.
John Negroponte et Robert Stephen Ford ont été chargés du recrutement des escadrons de la mort irakiens. Alors que Negroponte coordonnait l’opération à partir de son bureau à l’ambassade des États-Unis, Robert S. Ford, qui parle couramment l’arabe et le turc, avait la tâche d’établir des contacts stratégiques avec les milices chiites et kurdes à l’extérieur de la « zone verte ».
Deux autres représentants de l’ambassade, à savoir Henry Ensher (adjoint de Ford) ainsi qu’un représentant plus jeune de la section politique, Jeffrey Beals,ont joué un rôle important dans l’équipe Negroponte « en discutant avec un éventail d’Irakiens, incluant des extrémistes ». (Voir The New Yorker, 26 mars 2007) L’ancien ambassadeur étasunien en Albanie (2002-2004), James Franklin Jeffrey, est un autre individu clé de l’équipe Negroponte. En 2010, il a été nommé ambassadeur des États-Unis en Irak (2010-2012).
Negroponte a également amené dans l’équipe un de ses anciens collaborateurs du temps de son apogée au Honduras, le colonel James Steele (à la retraite) :
Dans le cadre de « l’option Salvador » Negroponte était assisté par son collègue des années 1980 en Amérique centrale, le colonel à la retraite James Steele. Steele, dont le titre à Bagdad était conseiller pour les Forces de sécurité irakiennes, supervisait la sélection et la formation de membres de l’organisation Badr et de l’armée de Mahdi, les deux plus grandes milices shiites en Irak, afin de cibler les dirigeants et d’appuyer des réseaux de résistance principalement sunnites. On ignore si cela a été planifié ou non, mais ces escadrons de la mort ont rapidement échappé à tout contrôle, et sont devenus la première cause de décès en Irak.
Que cela soit intentionnel ou non, la multitude de corps torturés et mutilés qui aboutissent dans les rues de Bagdad chaque jour est générée par les escadrons de la mort propulsés par John Negroponte. Et c’est cette violence interconfessionnelle soutenue par les États-Unis qui a mené à ce désastre infernal qu’est l’Irak aujourd’hui. (Dahr Jamail, Managing Escalation : Negroponte and Bush’s New Iraq Team,. Antiwar.com, 7 janvier 2007.)
Selon le député Dennis Kucinich, « le colonel Steele était responsable de la mise en œuvre d’un plan au Salvador dans le cadre duquel des milliers de Salvadoriens sont « disparus » ou ont été assassinés, dont l’archevêque Oscar Romero et quatre religieuses étasuniennes ».
Dès sa nomination à Bagdad, le colonel Steele a été assigné à une unité de contre-insurrection connue sous le nom de « Commando spécial de police » dirigée par le ministère irakien de l’Intérieur. (Voir ACN, La Havane, 14 juin 2006.)
Des reportages confirment que « l’armée étasunienne a transféré de nombreux prisonniers à la Brigade des loups(Wolf Brigade), le second bataillon redouté des commandos spéciaux du ministère de l’Intérieur », lequel était justement supervisé par le colonel Steele :
« Des soldats et des conseillers étasuniens se tenaient à l’écart et ne faisaient rien » pendant que des membres de la Brigade des loups battaient et torturaient les prisonniers. Les commandos du ministère de l’Intérieur ont pris le contrôle de la bibliothèque publique à Samarra et l’ont transformée en centre de détention, a-t-il affirmé. Une entrevue menée par Maass [du New York Times] en 2005 à la prison improvisée en compagnie du conseiller militaire étasunien de la Brigade des loups, le colonel James Steele avait été interrompue par les cris terrifiants d’un prisonnier à l’extérieur. Steele aurait été employé auparavant comme conseiller pour réprimer l’insurrection au Salvador. (Ibid. C’est l’auteur qui souligne.)
Une autre figure notoire ayant joué un rôle dans le programme de contre-insurrection en Irak est l’ancien commissaire de la police de New York Bernie Kerik. En 2007, il a fait face à 16 chefs d’accusation criminelles devant la Cour fédérale.
Kerik a été nommé par l’administration Bush au début de l’occupation en 2003 pour aider à organiser et former les Forces policières irakiennes. Durant son court passage en 2003, Bernie Kerik, qui a pris le poste de ministre de l’Intérieur par intérim, a œuvré à l’organisation d’unités terroristes au sein des Forces policières irakiennes :
Envoyé en Irak pour remettre les forces de sécurité irakiennes en ordre, Kerik se décrivait comme “ministre irakien de l’intérieur par intérim”. Les conseillers de la police britannique l’appelaient “le Terminator de Bagdad”. (Salon, 9 décembre 2004, C’est l’auteur qui souligne.)
Sous la direction de Negroponte à l’ambassade des États-Unis à Bagdad, une vague clandestine de meurtres de civils et d’assassinats ciblés a été déclenchée. Des ingénieurs, des médecins, des scientifiques et des intellectuels étaient également ciblés.
L’auteur et analyste géopolitique Max Fuller a documenté en détail les atrocités commises dans le cadre du programme de contre-insurrection financé par les États-Unis.
L’apparition des escadrons de la mort a d’abord été soulignée en mai cette année [2005], […] des dizaines de corps ont été trouvés, jetés nonchalamment […] dans des zones inhabitées autour de Bagdad. Toutes les victimes portaient des menottes, avaient les yeux bandés et avaient été tuées d’une balle dans la tête. Des signes indiquaient par ailleurs que de nombreuses victimes avaient été brutalement torturées […]
Les preuves étaient suffisamment concluantes pour que l’Association des chercheurs musulmans (AMS), une importante organisation sunnite, publie une déclaration dans laquelle elle accuse les forces de sécurité attachées au ministère de l’Intérieur et à la Brigade Badr, l’ancien bras armé du Conseil suprême de la révolution islamique en Irak (CSRII), d’être à l’origine des meurtres. L’Association a par ailleurs accusé le ministère de l’Intérieur de faire du terrorisme d’État. (Financial Times)
Les commandos de police et la Brigade des loups étaient supervisés par le programme de contre-insurrection étasunien du ministère irakien de l’Intérieur :
Les commandos de police ont été formés sous la tutelle expérimentée et la supervision d’anciens combattants étasuniens de la contre-insurrection et ont mené, dès le départ, des opérations conjointes avec les unités d’élite et extrêmement secrètes des forces spéciales étasuniennes. (Reuters,National Review Online)
[…] James Steele, un ancien agent des forces spéciales des États-Unis a joué un rôle clé dans la formation des Commandos spéciaux de la police. James Steele a fait ses premières armes au Vietnam avant d’aller diriger la mission des États-Unis au Salvador à l’apogée de la guerre civile.
Steven Casteel est un autre collaborateur étasunien, celui-là même qui, à titre de conseiller principal du ministère de l’Intérieur, a balayé du revers de la mains des accusations graves et bien fondées de violation consternantes des droits humains en les qualifiant de « rumeurs et insinuations ». À l’instar de Steele, il a acquis une expérience considérable en Amérique latine, en participant en ce qui le concerne à la chasse au baron de la cocaïne, Pablo Escobar, lors de la guerre contre la drogue en Colombie dans les années 1990 […]
La feuille de route de Casteel est significative car ce genre de rôle de soutien à la collecte de renseignement et la production de listes de décès sont caractéristiques de l’implication des États-Unis dans des programmes de contre-insurrection et constituent le fil conducteur sous-jacent à des folies meurtrières qui peuvent sembler aléatoires et désordonnées.
De tels génocides planifiés correspondent entièrement à ce qui se passe en Irak aujourd’hui [2005]. Ils correspondent également au peu d’information dont nous disposons à propos des Commandos spéciaux de la police, faits sur mesure pour fournir au ministère de l’Intérieur des forces spéciales ayant une capacité de frappe (Département de la défense des États-Unis). En conservant ce rôle, le quartier général du Commando de la police est devenu la plaque tournante nationale d’un centre de commandement, de contrôle, de communication, d’informatique et d’opérations de renseignement, gracieuseté des États-Unis. (Max Fuller, op. cit.)
Le travail préparatoire effectué sous Negroponte en 2005 a été mis en pratique sous son successeur, l’ambassadeur Zalmay Khalilzad. Robert Stephen Ford a assuré la continuité du projet avant d’être nommé ambassadeur en Algérie en 2006, ainsi qu’à son retour à Bagdad comme chef de mission adjoint en 2008.
Opération « Contras syriens » : Leçons de l’expérience irakienne
L’horrible version irakienne de l’« option Salvador » sous la direction de l’ambassadeur John Negroponte a servi de « modèle » à la mise sur pied des Contras de l’« Armée syrienne libre ». Robert Stephen Ford a été sans aucun doute impliqué dans l’implantation du projet des Contras syriens, à la suite de sa réaffectation à Bagdad comme chef de mission adjoint en 2008.
Le but en Syrie était de créer des divisions entre les factions sunnites, alaouites, chiites, kurdes, druzes et chrétiennes. Alors que le contexte syrien est complètement différent de celui de l’Irak, il existe des similitudes frappantes dans la manière dont les tueries et les atrocités sont commises.
Un reportage publié par Der Spiegel sur les atrocités commises dans la ville syrienne de Homs confirme l’existence d’un processus sectaire organisé de massacres et d’exécutions extrajudiciaires comparables à ceux menés par les escadrons de la mort soutenus par les États-Unis en Irak.
À Homs, les citoyens étaient régulièrement catégorisés comme « prisonniers » (chiites, alaouites) et « traitres ». Les « traitres » sont des civils sunnites situés dans les zones urbaines occupées par les rebelles et qui expriment leur désaccord ou leur opposition au règne de la terreur de l’ASL.
Depuis l’été dernier [2011], nous avons exécuté un peu moins de 150 hommes, ce qui représente environ 20 % de nos prisonnier », a déclaré Abu Rami […] Mais les traitres dans leurs propres rangs ont occupé les bourreaux de Homs plus que les prisonniers de guerre. « Si nous surprenons un sunnite en train d’espionner ou si un citoyen trahit la révolution,nous faisons ça rapidement », a dit le combattant. Selon Abu Rami, la brigade d’enterrement d’Hussein a mis à mort entre 200 et 250 traitres depuis le début du soulèvement. (Der Spiegel, 30 mars 2012)
Le projet nécessite un programme initial de recrutement et de formation de mercenaires. Des escadrons de la mort incluant des unités salafistes libanaises et jordaniennes sont entrés en Syrie par sa frontière méridionale avec la Jordanie à la mi-mars 2011. Une bonne partie du travail préparatoire était déjà effectué à l’arrivée de Robert Stephen Ford à Damas en janvier 2011.
La nomination de Ford comme ambassadeur en Syrie a été annoncée au début 2010. Les relations diplomatiques avaient été interrompues en 2005 à la suite de l’assassinat de Rafick Hariri et pour lequel Washington avait accusé la Syrie. Ford est arrivé à Damas à peine deux mois avant le début de l’insurrection.
L’Armée syrienne libre (ASL)
Washington et ses alliés ont répliqué en Syrie les caractéristiques essentielles de l’« option Salvador irakienne », menant à la création de l’Armée syrienne libre et ses diverses factions terroristes, dont les brigades Al-Nosra affiliées à Al-Qaïda.
Bien que la création de l’ASL ait été annoncée en juin 2011, le recrutement et la formation des mercenaires étrangers a débuté bien avant.
À bien des égards, l’ASL est un écran de fumée. Les médias occidentaux la présente comme une véritable entité militaire résultant des défections massives des forces gouvernementales. Le nombre de déserteurs n’était toutefois ni significatif ni suffisant pour établir une structure militaire cohérente avec des fonctions de commandement et de contrôles.
L’ASL ne constitue pas une entité militaire professionnelle. Il s’agit plutôt d’un réseau informel de brigades terroristes distinctes, composées de nombreuses cellules paramilitaires opérant dans différentes parties du pays.
Chacune de ces organisations opère indépendamment des autres. L’ASL n’exerce pas véritablement de fonctions de commandement et de contrôle, dont la liaison entre ces diverses entités paramilitaires. Ces dernières sont contrôlées par les forces spéciales et les agents du renseignement parrainés par les États-Unis et l’OTAN et intégrés aux rangs des formations terroristes sélectionnées.
Ces forces spéciales sur le terrain (bien entraînées et dont bon nombre sont des employés d’entreprises privées de sécurité) sont régulièrement en contact avec les unités de commandement de l’armée et du renseignement des États-Unis, de l’OTAN et leurs alliés (dont la Turquie). Il n’y a pas de doute que ces forces spéciales intégrées sont elles aussi impliquées dans les attaques soigneusement planifiées et dirigées contre des édifices gouvernementaux, des complexes militaires, etc.
Les escadrons de la mort sont des mercenaires entraînés et recrutés par les États-Unis, l’OTAN, leurs alliés du Conseil de coopération du Golfe et la Turquie. Ils sont supervisés par des forces spéciales alliées (dont les SAS britanniques et les parachutistes français) et des firmes de sécurité privées à contrat avec l’OTAN et le Pentagone. À cet égard, des reportages confirment l’arrestation par le gouvernement syrien de 200 à 300 employés d’entreprises privées de sécurité ayant intégré les rangs rebelles.
Le Front Jabhat Al-Nosra
Le Front Jabhat Al-Nosra, responsable de plusieurs attaques à la bombe très médiatisées et qui serait affilié à Al-Qaïda, est décrit comme le groupe de combattant le plus efficace de « l’opposition ». Les opérations d’Al-Nosra, considéré comme un ennemi des États-Unis (figurant sur la liste des organisations terroristes du département d’État), portent néanmoins les empreintes de la formation paramilitaire, des tactiques de terreur et des systèmes d’armes étasuniens. Les atrocités commises contre des civils par Al-Nosra (financé clandestinement par les États-Unis et l’OTAN) sont semblables à celles perpétrées par les escadrons de la mort soutenus par les États-Unis en Irak.
Pour citer le chef d’Al-Nosra à Alep, Abu Adnan : “Jabhat Al-Nosra compte dans ses rangs des vétérans syriens de la guerre en Irak, des hommes qui mettent de l’avant leur expérience en Syrie, particulièrement dans la fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI).
Comme en Irak, la violence entre factions et le nettoyage ethnique ont été fortement encouragés. En Syrie, les escadrons de la mort soutenus par les États-Unis et l’OTAN ont ciblé les communautés alaouites, shiite et chrétiennes. Les communautés alaouites et chrétiennes sont les principales cibles du programme d’assassinat et cela est confirmé par l’agence de nouvelles du Vatican.
Les chrétiens d’Alep sont victimes de la mort et de la destruction causées par les combats qui affectent la ville depuis des mois. Les quartiers chrétiens ont récemment été frappés par les forces rebelles qui luttent contre l’armée régulière, causant l’exode des civils.
Certains groupes de la brutale opposition, où se trouvent également des djihadistes « tirent sur des maisons et des édifices appartenant à des chrétiens pour forcer les occupants à fuir et en prendre possession [nettoyage ethnique] » (Agence Fides, 19 octobre 2012.)
« Les militants salafistes, a déclaré l’évêque, continuent à commettre des crimes contre les civils et à contraindre des gens à se battre. Les extrémistes sunnites fanatiques mènent fièrement une guerre sainte, particulièrement contre les alaouites. Lorsque des terroristes cherchent à vérifier l’identité religieuse d’un suspect, ils lui demandent de citer la généalogie en remontant jusqu’à Moïse et de réciter une prière que les alaouites ont abandonné. Les alaouites n’ont aucune chance de s’en sortir vivants. » (Agence Fides, 4 juin 2012.)
Des reportages confirment le flot d’escadrons de la mort salafistes et affiliés à Al-Qaïda entrant en Syrie sous les auspices des Frères musulmans dès le début de l’insurrection en mars 2011.
De plus, rappelant l’enrôlement des moudjahidines pour mener le djihad (guerre sainte) de la CIA à l’apogée de la guerre soviéto-afghane, l’OTAN et le haut commandement turc ont initié, selon des sources du renseignement israélien :
[U]ne campagne de recrutement de volontaires musulmans dans les pays du Moyen-Orient et du monde musulman pour se battre aux côtés des rebelles syriens. L’armée turque hébergerait et formerait ces volontaires et assurerait leur passage en Syrie. (DEBKAfile, NATO to give rebels anti-tank weapons, 14 août 2011.)
Les entreprises privées de sécurité et le recrutement de mercenaires
Selon les reportages, les entreprises privées de sécurité œuvrant dans les pays du Golfe sont impliquées dans le recrutement et la formation de mercenaires.
Bien qu’ils ne soient pas spécifiquement destinés au recrutement de mercenaires destinés à la Syrie, certains reportages indiquent la création de camps d’entraînement au Qatar et aux Émirats arabes unis. (EAU).
Dans la ville militaire de Zayed (EAU), « une armée secrète est en train de se former », dirigée par Xe Services, anciennement connu sous le nom de Blackwater. L’entente des EAU visant la création de camps militaires pour la formation des mercenaires a été signée en juillet 2010, neuf mois avant les offensives guerrières en Libye et en Syrie.
Selon des informations récentes, des firmes de sécurité à contrat avec l’OTAN et le Pentagone sont impliquées dans la formation des escadrons de la mort de l’« opposition » sur l’utilisation d’armes chimiques :
Les États-Unis et certains alliés européens utilisent des entrepreneurs à contrat avec la Défense pour apprendre aux rebelles syriens à sécuriser les stocks d’armes chimiques en Syrie, ont déclaré un représentant des États-Unis et plusieurs diplomates de haut rang dimanche à CNN. (CNN Report, 9 décembre 2012.)
Les noms des entreprises en question n’ont pas été révélés.
Derrière les portes closes du département d’État des États-Unis
Robert Stephen Ford faisait partie d’une petite équipe du département d’État supervisant le recrutement et la formation des brigades terroristes avec Derek Chollet et Frederic C. Hof, un ancien partenaire d’affaires de Richard Armitage, ayant agit à titre de « coordonateur spécial de Washington pour la Syrie ». Derek Chollet a récemment été nommé au poste de secrétaire adjoint à la Défense et coordonateur pour les Affaires de sécurité internationale (ASI).
Cette équipe agissait sous la direction de (l’ancien) secrétaire d’État adjoint aux Affaires du Proche-Orient Jeffrey Feltman.
L’équipe de Feltman était étroitement liée au processus de recrutement et de formation des mercenaires en provenance de la Turquie du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de la Libye (gracieuseté du régime post-Kadhafi qui a envoyé en Syrie six cent troupes du Groupe islamique combattant en Libye (GICL) en les faisant passer par la Turquie dans les mois ayant précédé l’effondrement du gouvernement de Kadhafi.)
Le secrétaire d’États adjoint Jeffrey Feltman était en contact avec les ministres saoudien et qatari des Affaires étrangères, le prince Saud al-Faisal et le cheik Hamad bin Jassim. Il était aussi en charge du bureau de Doha pour la « coordination spéciale de la sécurité » lié à la Syrie et qui incluait des représentants de la Libye et des agences de renseignement occidentales et du CCG. Le princeBandar bin Sultan, membre éminent et controversé du renseignement saoudien faisait également partie du groupe. (Voir Press Tv, 12 mai 2012.)
En juin 2012, Jeffrey Feltman a été nommé Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l’ONU, un poste stratégique consistant, en pratique, à établir le programme de l’ONU (pour le compte de Washington) relatif à la « résolution de conflit » dans divers « points chauds » à travers le monde (incluant la Somalie, le Liban, la Libye, la Syrie, le Yémen et le Mali). Ironiquement, les pays où l’ONU doit « résoudre des conflits » sont ceux ciblés par des opérations clandestines des États-Unis.
En liaison avec le département d’État étasunien, l’OTAN et ses commissionnaires du CCG à Doha et Ryad, Feltman est l’homme de Washington derrière le « plan de paix » de l’envoyé spécial de l’ONU Lakhdar Brahmi.
Entre-temps, en feignant d’accorder de l’importance à l’initiative de paix de l’ONU, les États-Unis et l’OTAN ont accéléré le processus de recrutement et la formation de mercenaires en réaction aux lourdes pertes essuyées par les forces rebelles de l’« opposition ».
La « phase finale » en Syrie proposée par les États-Unis n’est pas le changement de régime, mais la destruction de l’État-nation que constitue la Syrie.
Le déploiement des escadrons de la mort l’« opposition » ayant pour mandat de tuer des civils relève de cette entreprise criminelle.
« Le terrorisme à visage humain » est défendu par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui représente le porte-parole des « interventions humanitaires » de l’OTAN en vertu de la doctrine de la « responsabilité de protéger » (R2P).
Les atrocités commises par les escadrons de la mort des États-Unis et de l’OTAN sont imputées nonchalamment au gouvernement de Bachar Al-Assad. Selon la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Navi Pillay :
« Ces importantes pertes de vies auraient pu être évitées si le gouvernement syrien avait choisi un autre chemin que celui de la répression sans pitié de ce qui étaient au départ des manifestations pacifiques et légitimes de civils non armés. » (Cité dans Stephen Lendman, UN Human Rights Report on Syria : Camouflage of US-NATO Sponsored Massacres, Global Research, 3 janvier 2012.)
« L’indicible objectif » de Washington consiste à diviser l’État-nation syrien en plusieurs entités politiques « indépendantes » selon des frontières ethniques et religieuses.Michel Chossudovsky http://www.voxnr.com
Notes :
Traduction : Julie Lévesque pour Mondialisation.ca
Article original : Terrorism with a “Human Face” : The History of America’s Death Squads
Michel Chossudovsky est directeur du Centre de recherche sur la mondialisation et professeur émérite de sciences économiques à l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de Guerre et mondialisation, La vérité derrière le 11 septembre et de la Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial (best-seller international publié en plus de 20 langues).source :
Mondialisation.ca :: lien
-
Journée-Colloque: Bastien-Thiry, 50 ans après
Le thème de la journée est « Bastien-Thiry, 50 ans après » puisque Jean Bastien-Thiry a été fusillé au Fort d’Ivry le 11 mars 1963, à l’issue du procès de l’attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle.
Cette journée comprendra :
 Une exposition d’affaires personnelles de Jean Bastien-Thiry en particulier des uniformes (dont celui qu’il portait au procès), des livres et des objets qu’il avait dans sa cellule à la prison de la Santé, des lettres manuscrites.
Une exposition d’affaires personnelles de Jean Bastien-Thiry en particulier des uniformes (dont celui qu’il portait au procès), des livres et des objets qu’il avait dans sa cellule à la prison de la Santé, des lettres manuscrites.  2 séries d’interventions de personnes l’ayant connu ou étant liées à cette période de la fin de la guerre d’Algérie, une série le matin et une autre l’après-midi.
2 séries d’interventions de personnes l’ayant connu ou étant liées à cette période de la fin de la guerre d’Algérie, une série le matin et une autre l’après-midi.  Entre ces 2 séries, les participants pourront visionner des extraits de différentes vidéos en lien avec le souvenir de Jean Bastien-Thiry (émissions TV et films sur l’attentat et sur le drame vécu par les Pieds-Noirs et les Harkis).
Entre ces 2 séries, les participants pourront visionner des extraits de différentes vidéos en lien avec le souvenir de Jean Bastien-Thiry (émissions TV et films sur l’attentat et sur le drame vécu par les Pieds-Noirs et les Harkis).  Les personnes présentes pourront également participer à des ateliers-débats autour de différents thèmes en particulier celui de la Légitime Défense (La Légitime Défense a été évoquée au procès du Petit-Clamart), ou « la transmission du souvenir » concernant ces évènements douloureux.
Les personnes présentes pourront également participer à des ateliers-débats autour de différents thèmes en particulier celui de la Légitime Défense (La Légitime Défense a été évoquée au procès du Petit-Clamart), ou « la transmission du souvenir » concernant ces évènements douloureux.  A 17 heures, des jeunes représenteront la pièce « Bastien-Thiry, Vérité » écrite par son épouse Geneviève.
A 17 heures, des jeunes représenteront la pièce « Bastien-Thiry, Vérité » écrite par son épouse Geneviève. Pendant toute la journée, les participants pourront se procurer des ouvrages sur Jean Bastien-Thiry et se faire dédicacer des livres par les auteurs présents.
Pendant toute la journée, les participants pourront se procurer des ouvrages sur Jean Bastien-Thiry et se faire dédicacer des livres par les auteurs présents.Le droit d’entrée est de 5 Euros.
 Date : samedi 23 février 2013
Date : samedi 23 février 2013  Lieu : Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris
Lieu : Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris  Horaires : 9h30 – 18h30
Horaires : 9h30 – 18h30S’inscrire en écrivant au Cercle Jean Bastien-Thiry, BP 70, 78170 La Celle St Cloud ou par mail à l’adresse : basthiry@aol.com
DÉROULÉ DU COLLOQUE
 9h30 : Ouverture
9h30 : Ouverture  9h50 : Présentation de la journée
9h50 : Présentation de la journée  10h – 11h30 : Première série d’interventions : - Vie de JBT (Power-Point) - Contexte historique, expérience d’appelé en Algérie - Contexte historique, attentat, souvenir de JBT, prison - Aspect juridique et moral du procès, Déclaration de JBT
10h – 11h30 : Première série d’interventions : - Vie de JBT (Power-Point) - Contexte historique, expérience d’appelé en Algérie - Contexte historique, attentat, souvenir de JBT, prison - Aspect juridique et moral du procès, Déclaration de JBT  11h30 – 14h : Ateliers–Vidéos (Emissions TV, Films…) Ateliers–discussions (Tyrannicide, Difficulté de transmission du souvenir (Pieds-Noirs, Harkis,…) Exposition, vente d’ouvrages Restauration rapide
11h30 – 14h : Ateliers–Vidéos (Emissions TV, Films…) Ateliers–discussions (Tyrannicide, Difficulté de transmission du souvenir (Pieds-Noirs, Harkis,…) Exposition, vente d’ouvrages Restauration rapide  14h – 15h30 : Deuxième série d’interventions - Contexte historique de l’été 1962 (Pieds-Noirs, Harkis, Disparus) - Les attentats, la prison - Souvenirs du Procès et de JBT - Geneviève BT : sa vie (Power Point) (à confirmer) - Le souvenir de JBT depuis 50 ans
14h – 15h30 : Deuxième série d’interventions - Contexte historique de l’été 1962 (Pieds-Noirs, Harkis, Disparus) - Les attentats, la prison - Souvenirs du Procès et de JBT - Geneviève BT : sa vie (Power Point) (à confirmer) - Le souvenir de JBT depuis 50 ans  15h30 – 16h45 : Ateliers–Vidéos, Ateliers–discussions (Tyrannicide, Difficulté de transmission du souvenir (Pieds-Noirs Harkis,…) Exposition, vente d’ouvrages. Restauration rapide
15h30 – 16h45 : Ateliers–Vidéos, Ateliers–discussions (Tyrannicide, Difficulté de transmission du souvenir (Pieds-Noirs Harkis,…) Exposition, vente d’ouvrages. Restauration rapide  17h – 18h30 : Pièce VÉRITÉ
17h – 18h30 : Pièce VÉRITÉ  18h30 -19h : clôture du colloque
18h30 -19h : clôture du colloque -
DARWIN ETAIT·IL UN ÂNE ?
L'évolutionnisme ne serait-il qu'un « conte de fées pour grande personne » ? Telle est l'opinion développée ici par notre collaborateur Daniel Raffard de Brienne.
Nous vivons à une époque mirobolante : grâce à la liberté et à la démocratie, nous sommes informés de tout. La télévision ne nous laisse ignorer aucun éternuement de telle admirable vedette ou de tel dictateur antipodien. L'école nous fabrique 80 % de bacheliers sachant tout (sauf lire et écrire, mais personne n'est parfait).
Mais, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les abondantes informations se trouvent filtrées, canalisées, voire déformées pour alimenter une pensée officielle, juste ou fausse, mais seule autorisée. C'est vrai pour l'Histoire et la politique. Ce l'est tout autant pour les Sciences. Dans ce domaine, il existe une vérité obligatoire : l'évolutionnisme, cette théorie selon laquelle toutes les espèces vivantes, de la plus simple à la plus complexe, sortiraient les unes des autres et, à l'origine, de la matière inanimée. Or l'évolutionnisme a fait faillite au point de ne plus paraître que ce qu'en disait Jean Rostand : « un conte de fée pour grande personne ».
Ce conte de fée est enseigné comme un dogme infaillible dès l'école primaire. Il est assené sans discussion ni réserve par tous les médias, les dictionnaires, les Quid. Nous feuilletions dernièrement une nouvelle encyclopédie destinée aux enfants. Là, en pleine page, une rangée de personnages montrait la filiation du singe à l 'homme en passant par l'australopithèque et le pithécanthrope. Pour mieux marquer cette filiation, chaque sujet avait la même pilosité, la même couleur de peau et le même geste, toutes choses que ne conservent évidemment pas les seuls témoins : les fossiles. Or il faut savoir pour nous en tenir à deux exemples, que l'australopithèque n'était qu'un singe de prairie africain disparu sans descendance, et que le pithécanthrope a été entièrement inventé à partir d'une calotte crânienne de gibbon géant et d'un fémur humain, deux os trouvés à quinze mètres de distance l'un de l'autre à Java, dans une couche sédimentaire indatable qui contenait aussi des crânes d'homme. On avait bien imaginé en 1922 un autre ancêtre de l'homme, l'hespéropithèque, à partir d'une unique dent ... de cochon sauvage !
Pourquoi tant d'acharnement à maintenir en survie artificielle une théorie périmée ? Réponse : parce que le matérialisme et le progressisme, même chrétien, ne reposent que sur elle.
Dans ces conditions, l'opposition à l'évolutionnisme ne dispose que de bien rares moyens de s'exprimer. C'est pourquoi l'on accueillera avec plaisir la récente sortie d'une vidéo cassette consacrée à : Evolution, Science ou Croyance.
UN ARGUMENT CIRCULAIRE
Nous ne trouvons malheureusement pas le fond tout à fait à la hauteur de la forme. Certes, la conclusion de la cassette, due à un généticien polonais, Maciej Giertych, est excellente. Son auteur montre notamment que l'évolutionnisme n'est pas une hypothèse scientifique. En effet, on ne peut dire scientifique une hypothèse que si elle s'appuie sur des faits constatables, mesurables et, en principe, reproductibles en laboratoires, or personne n'a jamais constaté, mesuré ni reproduit un seul fait d'évolution. L'évolutionnisme se présente donc comme une théorie philosophique cherchant dans la Science, comme toute théorie de ce type, des motifs de crédibilité : c'est une véritable escroquerie intellectuelle de l'enseigner en classe de sciences naturelles .
Dans le corps de la cassette, les arguments les plus solides sont présentés par les professeurs italiens Roberto Fondi et Giuseppe Sermonti. Malheureusement le temps trop court qu'on leur a assigné ne leur a pas permis de développer suffisamment leurs affirmations ni de les illustrer par des exemples détaillés.
Les auteurs de la cassette semblent avoir eu pour souci principal de suggérer que tous les fossiles proviennent d'une unique catastrophe qui ne daterait que de quelques milliers d'années. Une hypothèse aussi surprenante éliminerait l'évolutionnisme à condition, bien entendu, de reposer sur des arguments au moins vraisemblables.
C'est pourquoi il est fait appel à un Américain, Edward Boudreaux, qui expose des réserves justifiées sur la fiabilité des méthodes radiométriques de datation. Mais il y a loin de ces réserves à la réduction de millions de siècles à quelques dizaines; les erreurs pourraient d'ailleurs se produire dans l'autre sens.
La cassette fait aussi état, longuement des travaux de Guy Berthault, selon qui les couches géologiques n'ont pas de signification chronologique. Certes Guy Berthault a sans doute raison dans des cas marginaux, pour que son hypothèse puisse être généralisée, il faudrait démontrer que toutes les couches sédimentaires et leurs fossiles résultent d'une unique catastrophe. Il faudrait donc éliminer, l'élément temps en ce qui concerne la sédimentation; et aussi en ce qui l'érosion, car il n'y a pas de sédimentation sans sédiments. Guy Berthault appuie son raisonnement sur une pétition de principe : sa théorie supposant une catastrophe unique, il y a eu une catastrophe unique, sa théorie se trouve ainsi fondée.
Quel savant pourrait accepter une telle méthode (que les évolutionnistes emploient de leur côté) ? Nous croyons pour notre part que l'on peut montrer la fausseté de l'évolutionnisme sans recourir à des voies aussi périlleuses. Dans un récent essai, nous avons accepté par hypothèse toutes les affirmations de la Science officielle et c'est en nous appuyant sur elles que nous avons démontré que l'évolutionnisme est insoutenable (2).
ARGUMENTS CONTRE L' ÉVOLUTIONNISMECertes, la faune et la flore varient fortement selon les ères géologiques, mais on n'a découvert aucun intermédiaire d'un groupe à l'autre, alors qu'on devrait en trouver à foison. En revanche, de nombreuses formes de vie, de nombreuses espèces traversent les milliers et les millions de siècles sans subir le moindre changement.
Il y a d' ailleurs là une étrange loterie où ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Prenons deux souches de poissons crossoptérygiens nageant tranquillement de conserve. L'une serait sortie de la mer et aurait donné naissance aussi bien au colibri qu'à l'éléphant, au serpent qu'à l'homme et à la grenouille. L'autre, celle du coelacanthe, continue à frétiller dans l'océan sans avoir changé la moindre de ses écailles en un million de siècles.
Et puis, il y a la loi du tout ou rien, Pour qu'une seule cellule vivante ait pu se former au hasard dans la matière brute, il aurait fallu qu'elle fût complète d'un seul coup, car aucun stade intermédiaire n'aurait permis sa conservation ni sa reproduction. Il aurait donc fallu que le hasard créât à la fois toutes les molécules organiques nécessaires et les assemblât pour former les machines de cette usine chimique qu'est la cellule, capable de synthétiser 10.000 produits différents, et lui donner son organe directeur composé de millions de gènes enchaînés dans un ordre rigoureux.
Les mathématiciens se refusent à l'admettre comme ils refusent d'envisager la possibilité de l'apparition subite d'un seul organe nouveau, tel que l' œil, car là aussi les probabilité seraient si fabuleusement faibles qu'on pourrait les estimer rigoureusement nulles. Notons que l'apparition par étapes d'un organe ne cadrerait pas avec la théorie évolutionniste, car une ébauche non fonctionnelle d' organe serait éliminée par la sélection naturelle. Le hasard ne peut pas préparer par des inconvénients immédiats des avantages futurs qu'il est incapable de prévoir.
Voilà, très brièvement résumé quelques arguments que la cassette ne présente pas suffisamment, me semble-t-il. Il nous reste à souhaiter une nouvelle édition améliorée.
• Daniel Raffard de Brienn
(2) De nous: Evolution: mythe ou réalité (Lecture et Tradition). chez DPF, 86190 Chiré-en-Montreuil.
Le Choc du Mois. Avril 1991 •
-
« Les Expulsés » de R. M. Douglas
C’est une véritable tragédie occultée. Aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, « les Alliés victorieux entreprirent le plus vaste transfert forcé de populations, peut-être la plus grande migration dans l’histoire de l’humanité» : au moins 12,6 millions d’Allemands d’Europe de l’Est – les Volksdeutsche –, « peut-être même 14 millions », furent déplacés et « des dizaines ou des centaines de milliers de civils trouvèrent la mort à cause des mauvais traitements, de la famine et de la maladie ». A l’heure où la justice allemande enquête officiellement sur les tristes événements d’Oradour-sur-Glane (642 victimes attribuées à la division SS Das Reich le 10 juin 1944), le gros livre de R. M. Douglas, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Colgate de New York, vient opportunément rompre l’omertà sur la gigantesque entreprise de purification ethnique menée – en temps de paix – par les vainqueurs de 1945. C.G.
Preuve irréfutable que les « Trois Grands » étaient bien décidés, avant même la chute du IIIe Reich, à bouleverser la géographie de l’Europe orientale en modifiant les frontières, c’est dès 1943, établit R. M. Douglas, qu’ils étudièrent les modalités pratiques d’une éviction massive des Allemands des Sudètes, de la Prusse orientale, de la Silésie et de la Hongrie, pour faire accepter à Prague, à Varsovie et à Budapest les amputations non moins massives de territoires auxquelles l’URSS comptait procéder sur ses confins occidentaux. Cet expéditif « Drang nach Westen » résultait d’une « carte de la Pologne corrigée par Staline en personne » et transmise au premier ministre Churchill, qui y souscrivit, par le Judéo-Tchèque Edvard Benes, franc-maçon devenu « petit télégraphiste du Kremlin », pour reprendre l’apostrophe assassine adressée en 1981 par François Mitterrand au président Giscard d’Estaing.
Solution finale

Un enfant allemand aux pieds nus fouille une poubelle à la recherche de nourriture, Hambourg 1945
Dans une Europe appauvrie et sinistrée après cinq ans de guerre, ce formidable transfert de populations posait des problèmes logistiques et sanitaires insolubles, qui ne pouvaient qu’aboutir à une effroyable mortalité parmi les millions de « rapatriés » dans une Allemagne elle-même exsangue et transformée en champ de ruines. Les futurs vainqueurs et surtout leurs obligés d’Europe centrale, auxquels reviendrait la responsabilité des opérations, ne l’ignoraient pas. D’autant moins que le Plan Morgenthau, du nom du secrétaire d’État au Trésor de Roosevelt (que, curieusement, Douglas ne cite jamais), avait préconisé entre autres le renoncement forcé par l’Allemagne aux Sudètes, à la Silésie et à la Prusse orientale ainsi que le déracinement des populations de souche germanique.
Les chefs de la « Croisade des démocraties » envisagèrent-ils l’inéluctable hécatombe comme une « solution finale » au problème allemand ? Bien qu’antinazi de conviction ainsi qu’il l’exprime presque à chaque page, l’historien américain n’exclut pas cette hypothèse, répondant clairement au vœu de nettoyage ethnique, accompagné de scandaleuses spoliations, des dirigeants tchèques, polonais et surtout yougoslaves. En effet, les Slovaques et les Hongrois se montrèrent beaucoup moins hostiles aux Volksdeutsche, souvent installés depuis plusieurs siècles à l’est de l’Elbe et de la Theiss qu’ils avaient mis en valeur, et si intégrés que beaucoup d’entre eux n’étaient même plus germanophones.
Trains de la mort et viols en série
Volonté délibérée de supprimer le plus d’indésirables possible ou gabegie et indescriptible pagaille ? En tout cas, les transferts – prévus lors de la conférence de Potsdam comme devant être « organisés et humains » – vers les zones britannique, américaine et soviétique de l’Allemagne désormais totalement occupée se firent dans les pires conditions, surtout à l’hiver 1945-46. D’abord interminablement internés dans des camps (dont Auschwitz) bientôt submergés et ravagés par diverses épidémies, typhus notamment, les déportés devaient ensuite subir, par des températures de -20°, quatre à cinq jours de trajet dans des trains de marchandises où, du fait du gel et de la famine (« un hareng pour vingt-cinq personnes » !) s’amoncelaient bientôt les cadavres de vieillards, de femmes et d’enfants. Dans un convoi de 650 expulsés, les représentants de la Croix-Rouge en Bavière trouvèrent ainsi « 94 passagers morts, dont de nombreux enfants ».
Car si Varsovie et Prague voulaient se débarrasser de leurs Volksdeutsche, elles déportaient en priorité « l’élément improductif de la population » et gardaient « les hommes sains pour le travail obligatoire », essentiellement dans les mines. Quant aux pères de famille qui voulaient absolument partir avec leur progéniture, ils étaient soumis à un implacable racket de la part des fonctionnaires locaux, souvent issus des maquis communistes.

Opération Swallow : une femme allemande expulsée des Territoires reconquis (image extraite de l’ouvrage)
Mais si nombre d’hommes furent transformés en main-d’œuvre servile, les femmes et même les gamines ne furent pas mieux traitées. Évoquant le premier convoi parti du camp de Szczecin (Stettin) vers Lübeck, R. M. Douglas écrit : « Le plus troublant était les marques des mauvais traitements systématiques et prolongés qu’ils [les déportés] portaient sur leur corps, les cicatrices laissées par les abus physiques et sexuels. Comme ont pu le remarquer les officiers médicaux britanniques, la plupart des femmes ont été violées, notamment une enfant de dix ans et une jeune fille de seize ans. » Et les mêmes constatations – « au camp de transit de Pöppendorf, un officier britannique découvrit que « la plupart des femmes [arrivées de camps polonais] avaient été victimes de viols multiples, de même que certains des enfants » – furent faites au fil des innombrables convois.
« Une caractéristique notable du système des camps d’après-guerre est l’importance des agressions sexuelles ainsi que des humiliations sexuelles ritualisées qui étaient infligées aux détenues », souligne ainsi R. M. Douglas en parlant de « supermarchés du sexe » réservés aux nouveaux maîtres des pays libérés et à leurs sbires, alors que, convient-il, dans les camps d’extermination nazis « le viol ou les mauvais traitements sexuels de la part des gardes étaient rarissimes et sévèrement punis par les autorités quand ils étaient découverts ».
Camps d’extermination
Peut-on parler de camps d’extermination à propos des Volksdeutsche bientôt rejoints par des Allemands antinazis à peine libérés des camps hitlériens, mais aussi (dans le cas de la Pologne et de la Yougoslavie) par des juifs, deux catégories dont le seul crime était leur origine ?
Ex-secrétaire de Churchill, John Colville fit savoir au Foreign Office qu’en Pologne et en Tchécoslovaquie « les camps de concentration et tout ce qu’ils représentent n’ont pas disparu avec la défaite de l’Allemagne ». En Yougoslavie, un observateur de la Croix-Rouge conclut que dans les quatre camps de Backi Jarak, de Filipovo, de Gakowa-Krusevlje et de Sekic, « où les autres établissements envoyaient les détenus incapables de travailler, la ration était si faible qu’elle avait manifestement pour seul but d’entraîner une mort “naturelle” ». De fait, à Krusevlje, « le taux de mortalité, surtout parmi les enfants, atteignait jusqu’à 200 décès par jour », selon l’ambassade britannique à Belgrade.
Dans le journal catholique tchèque Obzori, des lecteurs s’indignaient également du traitement réservé aux Sudetendeutsche : devant ces « scènes honteuses, nous nous taisons, comme la nation allemande se taisait », fulminait l’un d’eux, tandis qu’un survivant d’Auschwitz écrivait : « Face aux pires brutalités commises par les Allemands, nous nous consolions en nous disant “seuls les Allemands sont capables de faire des choses pareilles”. Pour rien au monde je ne voudrais qu’on pût parler ainsi de nous. »
De même Ignacy Cedrowski, médecin du camp polonais de Potulice et lui aussi « survivant d’Auschwitz où « toute sa famille avait succombé à la Shoah », fut « pourtant stupéfait par l’exploitation meurtrière dont les travailleurs allemands étaient victimes dans les fermes d’État de la voïvodie de Poméranie en 1946-47 ». Et les conditions ne devaient guère être meilleures pour les 40.000 Volksdeutsche qui, au lieu d’être expulsés vers l’Allemagne, « furent déportés de Pologne vers les camps de travail en URSS » au printemps 1945.
Crime contre l’humanité mais indulgence pour les bourreaux
Le « crime contre l’humanité » dénoncé par certains hauts fonctionnaires britanniques et dirigeants de la Croix-Rouge est donc avéré mais « une infime minorité de criminels furent poursuivis », et ils « ne passèrent guère de temps en prison ». Bourreau du camp tchèque de Linzervorstadt, Wenzel Hrnecek fut bien arrêté et accusé en 1948 de haute trahison mais… « pour collaboration avec les États-Unis d’Amérique » (1) ! Le Slovaque Karol Pazur, auteur du massacre de Pierov (où il avait fusillé des Volksdeutsche puis froidement éliminé leurs enfants dont il ne savait que faire) fut condamné à douze ans de prison mais amnistié et libéré trois ans plus tard, etc…
« En Pologne, les efforts visant à traîner les criminels devant les tribunaux furent encore moins couronnés de succès », déplore R. M. Douglas qui cite les cas emblématiques de Czezlaw Geborski qui, bien qu’« inculpé pour meurtre, torture et viol de prisonniers » en 2000 après la chute du communisme, mourut en 2006 sans avoir été jugé, et surtout de Salomon Morel. Ce chef du camp de Swietochlowice-Zgoda où, en cinq mois, avait péri le tiers des 5.000 prisonniers, en avait été récompensé par un rapide avancement mais, ayant pris sa retraite de colonel en 1968, il fut brièvement inquiété en 1990. Ce qui le poussa à émigrer en Israël où le gouvernement estima qu’il « n’y avait aucune raison d’accuser M. Morel de crimes sérieux ». D’ailleurs, trancha Edgar Bronfman, alors président du Congrès juif mondial, « son procès s’inscrivait dans le cadre d’un effort politique des révisionnistes et néo-nazis pour “relativiser” les crimes de l’Allemagne contre les juifs ».
Mauvaise conscience et loi du silence
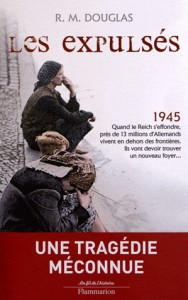 Autant que la mauvaise conscience des Occidentaux complices de cette tragédie – non pas « méconnue », comme l’affirme la jaquette du livre, mais délibérément occultée –, la crainte de « relativiser » les persécutions allemandes et de donner ainsi des armes aux révisionnistes explique sans doute le silence assourdissant sur l’expulsion-exécution des Volksdeutsche, notamment en France. Pourtant, celle-ci, absente de la conférence de Potsdam, était foncièrement hostile à l’opération, pour des raisons du reste moins morales que politiques : Paris ne voulait pas d’un accroissement de la population allemande et d’un éventuel revanchisme sur ses frontières.
Autant que la mauvaise conscience des Occidentaux complices de cette tragédie – non pas « méconnue », comme l’affirme la jaquette du livre, mais délibérément occultée –, la crainte de « relativiser » les persécutions allemandes et de donner ainsi des armes aux révisionnistes explique sans doute le silence assourdissant sur l’expulsion-exécution des Volksdeutsche, notamment en France. Pourtant, celle-ci, absente de la conférence de Potsdam, était foncièrement hostile à l’opération, pour des raisons du reste moins morales que politiques : Paris ne voulait pas d’un accroissement de la population allemande et d’un éventuel revanchisme sur ses frontières.N’ayant donc pris aucune part à ce qui demeurera comme l’une des pages les plus sombres de l’histoire européenne, pourquoi notre pays refuse-t-il de voir la réalité en face ? Car Les Expulsés n’est pas le premier livre consacré à la question. Or, les ouvrages publiés par la courageuse maison d’éditions Akribeia (2) ont été totalement boycottés et, bien que paru en 1997 à Londres, le livre majeur du Canadien James Bacque, Crimes and Mercies : The Fate of German Civilians under Allied Occupations, 1944-1950, n’a jamais eu chez nous l’honneur d’une traduction (3).
Si, malgré son aridité et son style parfois lourd que fait d’ailleurs oublier la richesse de sa documentation, Les Expulsés connaît un réel succès de librairie, peut-on espérer qu’il se trouvera un éditeur assez téméraire pour braver la Pensée unique en publiant le livre de James Bacque ?
Camille Galic
3/02/2013R.M. Douglas, Les Expulsés, éditions Flammarion, 2012, 510 pages avec photos, notes et copieuse bibliographie, Traduction de Laurent Bury.
Notes
(1) Parfaitement bilingue, il se réfugia en Bavière où il parvint à se faire inscrire comme Sudetendeutsche. Identifié, il fut simplement expulsé par la RFA.
(2) Tels Le Livre noir de l’expulsion par Heinz Nawratil, Martyre et héroïsme des femmes de l’Allemagne orientale par Johannes Kaps ou La Tragédie des Allemands des Sudètes, par Austin J. App. En vente à www.akribeia.fr qui diffuse aussi le livre de Douglas.
(3) Bacque (qui, lui, incrimine Henry Morgenthau) évalue le nombre de Volksdeutsche morts au cours de leur expulsion entre 2,1 et 6 millions. On trouvera un commentaire en français de son livre sur le site library.flawlesslogic.com/cmrev_fr.htmCorrespondance Polémia : 9/02/2013
-
La PMA fabrique des orphelins !
En plein débat sur la procréation médicalement assistée, la première génération d’enfants issus d’un don de gamète anonyme tente de s’exprimer et de faire entendre sa plainte : «Nous sommes une génération d’abandonnés, orphelins de nos origines», fait-elle savoir. L’association Procréation médicalement anonyme (PMA), qui militent pour l’accès de l’enfant à ses origines, apporte en effet des témoignages éclairants et bouleversants sur la détresse des jeunes issus de la technologie : «Nous avons à présent un recul de plus de 40 ans sur ces techniques. L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation implique au préalable le devoir impérieux de prendre en compte notre expérience, celle des parents et des donneurs», expliquent les membres de l’association.
Ce que le monde moderne refuse de comprendre, c’est que la technologie ne se substituera jamais à la morale. L’homme a peut-être su développer un pouvoir incroyable sur la matière, au point de savoir fabriquer un être humain, il reste que ces avancées scientifiques, si elles ne sont pas subordonnées à un progrès éthique, peuvent aussi bien devenir un facteur de destruction pour une humanité en perte de sens et de repère.
Ce que soulignent notamment ces appels de détresses des enfants issus de la PMA, c’est que la recherche du sens, inhérente à la conscience humaine, commence par la recherche de ses origines. D’où vient-on ? Car l’homme ne vient pas de nulle part, et il ne saurait savoir où il va sans savoir déjà d’où il vient. Une recherche qui suppose déjà celle de ses parents…
-
L'Iran à l'offensive contre l'Hollywoodisme
 La troisième conférence internationale de réflexion sur l'Hollywoodisme s'est tenue à Téhéran du 2 au 6 février, avec les interventions d'une cinquantaine d'invités, parmi lesquels les Américains constituaient pour la première fois un groupe nombreux.
La troisième conférence internationale de réflexion sur l'Hollywoodisme s'est tenue à Téhéran du 2 au 6 février, avec les interventions d'une cinquantaine d'invités, parmi lesquels les Américains constituaient pour la première fois un groupe nombreux.
Parmi eux, étaient présents Art Oliver, Jim Fetzer, Kevin James Barrett, Mike Gravel, William Engdahi, et l'anglais Rodney Shakespeare, hérauts de la contestation de la version officielle sur les attentats du 11 septembre, ainsi que le héros, le balayeur survivant devenu puissant militant William Rodriguez, Portoricain.
Star montante, était attendu le petit fils de Malcolm X, Hadj Malcolm Shabbaz: mais le FBI l'a empêché de monter dans l'avion. Le bloc des musulmans arabes, africains, européens et américains était fourni et véhément. Leurs positions rejoignaient complètement celles des chrétiens, dans leur diversité: chaldéen, catholique, presbytérien, orthodoxe. Samba Diagne a dénoncé l'homosexualisme comme nouvelle utopie. Michael Jones a fourni la formule choc qui résume les enjeux, autour de l'outrance sexuelle: c'est Jésus contre Dracula. Son exposé a montré que les Irlandais ont un temps (entre 1933 et 1965) contré les juifs à Hollywood, qui ont infesté d'obscénité le cinéma. La campagne contre le prophète Mohammed (qui sévit maintenant chez les Guignols de Canal +) est le nouveau chapitre pour réduire en esclavage mental les musulmans comme cela a se poursuit depuis longtemps pour les chrétiens (l'affaire des Pussy Riots constitue l'offensive contre le monde orthodoxe). Le Marquis de Sade, après l'expérience de la prison, avait parfaitement établi de lien entre dégradation par la débauche et tyrannie. Thierry Meyssan a souligné l'apparition de la justification de la torture dans les séries télévisées, et la désorientation du public, rongé par le conflit des références.
Des personnalités politiques, des partis républicain, démocrate, libertarien, des USA, mais aussi de Pologne et d'Angleterre, donnaient de la voix; des militaires témoignaient, tel Kenneth O'Keefe l'Irlandais qui était dans le Marmara attaqué par les Israéliens, Darnell Summers, vétéran du Viet Nam, et Monica Witt, ancienne combattante de la guerre d'Irak, convertie au chiisme.
Relations incestueuses mises en œuvre par Hollywood, entre sionisme et gestion politique de l'Amérique, cannibalisme, monstruosité, "Sin city" sont quelques raccourcis critiques à réutiliser, en opposition à la résistance spirituelle iranienne, saluée par tous. Mais Merlin Miller a souligné que Hollywood perd maintenant des parts de marché, la demande de vrais héros positifs et de pureté est bien là... et le contre-festival "Progies" en est à sa cinquième année.
Un groupe d'avocats s'est constitué pour attaquer en justice les films commandés par le Pentagone pour dénigrer l'Iran et préparer psychologiquement l'opinion publique au vaste projet de la "destruction nécessaire" (J. M. Vernochet) de l'Iran. Les films Argo (2012) , Zéro Dark 30 (2013), La lapidation de Soraya (2008), Les 300 (2007), Une nuit avec le roi (2006), Prince of Persia (Les sables du temps, 2010), Unthinkable (2010), et ceux qui ne manqueront pas de venir, ont pris la suite de Jamais sans ma fille (1991), mais la contre-offensive se prépare.
"L'hégémonie Hollywood, arme de destruction massive", la conjonction entre industrie du divertissement et Pentagone a été étudiée en profondeur. Le neveu de Freud, Edward Bernays, avait pour le compte de la famille Rockefeller, dès la première guerre mondiale, dessiné l'industrie de la propagande. Chaque nouveau film constitue maintenant une nouvelle phase de l'"opération terreur" contre les sentiments naturels, pour que chacun accepte une nouvelle attaque impériale contre un pays ou un autre, où se mêlent inextricablement attentats bien réels, effets spéciaux et scénarios ad hoc ayant précédé les massacres programmés,et la caricature infamante de chaque type national ou religieux, y compris les Français, avec, en amont et en aval, espionnage des réseaux sociaux pour bien saisir le degré de confusion du public.
La surprise est la convergence de spécialistes autour de la déconstruction des attentats du 11 septembre, chef d'oeuvre de l'ingénierie d'Hollywood, mais dont les failles sont désormais béantes. Nul doute que les organes israéliens se déchaînent, et donnent de fait le plus grand retentissement à ce qu'ils appelleront une provocation iranienne. Le président Ahmadinejad leur fait confiance! 2006, première invitation de Robert Faurisson, premier émoi israélien; 2011, 2012 et 2013, présence remarquée de Dieudonné, remise de distinctions par le président en personne aux représentants français du révisionnisme, Faurisson en tête.
L'accent mis cette fois-ci sur les mensonges du 11 septembre se situe dans le cadre d'une offensive diplomatique iranienne bien précise: le gouvernement argentin accepte désormais de siéger aux côtés des Iraniens pour l'enquête sur l'attentat de 1994 à Buenos Aires, contre le centre communautaire juif AMIA. Tous les spécialistes sont convaincus que l'Iran n'est pour rien dans l'affaire, et que c'est Israël qui cherche depuis les années 1990 à faire accuser l'Iran de terrorisme d'Etat, à travers le montage sous faux drapeau de cette opération. D'ailleurs, le dirigeant communautaire argentin Borger, ténor de l'indignation israélienne, vient de se trahir, en annonçant à l'Argentine un nouvel attentat, à quoi la présidente Cristina Fernandez a répondu sans se démonter: "Ah bon, et comment le savez-vous ?... et qui donc en seraient les commanditaires ?" [1] Comme l'affirment les Israéliens, l'Amérique latine est bel et bien en train de basculer du côté de l'Iran, et en tout cas ne se laisse absolument plus manipuler par les menaces et chantages sionistes. Merci les Iraniens, de ranimer le courage de tous !Maria Poumier http://www.voxnr.com
Notes :
1 - Lu sur yahoo.com.ar (la présidente s'est exprimé par twitter...)
"Ayer, Borger emitió su crítica más fuerte hasta el momento respecto del acuerdo. "Algunos dicen que es un paso adelante. Esto puede ser un paso adelante al precipicio. Porque si esto avanza estaríamos dando lugar a un tercer atentado muy lamentable", dijo.
Esta tarde, Cristina dijo que leyó "con preocupación" esas declaraciones. "Estremece", opinó, sobre la frase sobre la idea de "un tercer atentado".
"Considero a Borger una persona respetable. ¿Qué es lo que sabe para una afirmación tan terrible? Si hubiera un atentado por el acuerdo con Irán. ¿Quién sería el autor intelectual y material?", se preguntó en Twitter.
"Está claro que nunca podrían ser los países firmantes -continuó la mandataria-. ¿Serían quienes se oponen al acuerdo? ¿Países, personas, servicios de inteligencia? ¿Quiénes? Pero además, ¿quién o quiénes serían? ¿O seríamos los objetivos?"
"Me viene a la cabeza como un relámpago el dolor y las palabras de Zulema Yoma [la ex mujer del ex presidente Carlos Menem] afirmando que la muerte de su hijo fue el tercer atentado terrorista luego de la voladura de la Embajada de Israel y AMIA. Siento que se me hiela el alma", agregó.
Cristina cerró la docena de tuits de hoy con la conclusión: "Creo que el Pueblo Argentino en general y la Justicia en particular deben y merecen conocer lo que sabe Guillermo Borger, titular de AMIA".Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -
Un grand historien nous a quitté : Jacques Heers
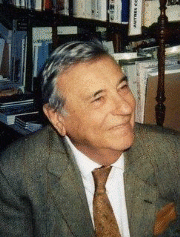 Les gros médias n’ont quasiment pas parlé de son décès, en dépit de sa renommée. C’est selon nous un hommage appréciable.
Les gros médias n’ont quasiment pas parlé de son décès, en dépit de sa renommée. C’est selon nous un hommage appréciable. Décédé il y a quelques semaines, à l’âge de 88 ans, Jacques Heers fut un historien français de grand talent et de grand renom.
Spécialiste de l’histoire du Moyen Âge, professeur à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris-Nanterre, puis directeur des études médiévales à Paris IV, ce catholique de conviction n’était pas soumis à l’historiquement correct.Vous pouvez retrouver ici ses ouvrages les plus connus (dont certains en poche), et en particulier son fameux et bienvenu Le Moyen-Âge, une imposture.
Jacques Heers avait participé au Manuel d’histoire scolaire que nous avions évoqué à diverses reprises.