Depuis plus de dix ans, le Forum catholique a ouvert ses colonnes virtuelles à tous ceux qui, sur Internet, veulent discuter de leur Église en temps réel. Une fois de plus les catholiques traditionalistes sont en avance sur le reste du troupeau. En avance pour la technique, peut-être, pour la liberté surtout, une liberté de parole et de jugement qui oblige l'Institution à de vraies réformes de comportement. Nous avons interrogé le premier protagoniste et le responsable de cette aventure spirituelle unique au monde.
Monde et Vie : Xavier Arnaud, vous animez depuis 12 ans le Forum catholique, institution internautique unique en son genre qui regroupe pour des discussions libres autour de l’Église et de la Foi tous ceux qui reconnaissent l'enseignement unanime des papes. Ce lieu de Foi et de camaraderie s'est tout récemment vu menacé dans son existence même. Panne, sabotage ? Que s'est-il passé ?
Xavier Arnaud : À l'heure qu'il est, nous n'avons pas pu identifier les raisons de cette défaillance technique. C'est la troisième fois en six mois que le forum connait une telle mésaventure. Autant les deux premières étaient manifestement la conséquence d'attaques, autant cette fois-ci notre hébergeur reste très évasif sur le sujet. Intervenue le 28 décembre, cette panne du serveur est tombée à un bien mauvais moment, ce qui a justifié une moindre réactivité des services.
Pour quelles raisons aujourd'hui fréquente-t-on le FC et qu'y trouve-t-on?
D'un liseur à l'autre, je crois que les motivations sont différentes. Certains viennent y chercher des réponses à des questions d'ordre liturgique ou catéchétique. D'autres font part de leurs
interrogations face à tels ou tels textes, documents, déclarations, articles. D'autres encore recherchent à échanger tout simplement dans un esprit de camaraderie, comme vous le disiez précédemment. Une chose est certaine : tous sont mus par un amour certain de l’Église, avec toutes les maladresses que peut commettre une âme transie...
Peut-on dire que vous êtes la mémoire virtuelle des catholiques traditionalistes, la banque de données, l'organe sensoriel mettant en alerte les catholiques français ?
Il serait orgueilleux de ma part de l'affirmer tel quel. Une chose est sûre : les archives du forum constituent une source d'informations très riche, pour peu que l'on prenne la peine de s'y pencher. On y retrouve l'histoire de la mouvance catholique traditionnelle depuis 2000, et Dieu sait que les événements ont été nombreux depuis lors. Peu d'informations échappent à la sagacité des liseurs, et le FC constitue à l'occasion une caisse de résonance inattendue, parfois gênante pour certains qui préféreraient agir discrètement.
À titre d'exemple, on se souviendra des événements de fin 2006 à Lyon, lorsque la Fraternité saint Pierre était quasiment mise à la porte du diocèse. La forte mobilisation des fidèles sur la toile a contrarié les projets d'alors qui n'avaient pas anticipé une telle médiatisation. On se souviendra aussi des événements de 2005 lors de l'exclusion de la Fraternité Saint-Pie X de plusieurs prêtres, dont les abbés Laguérie et de Tanoüarn. Les pressions d'alors étaient fortes pour tenter d'empêcher tout débat sur la question sur le forum. À chaque fois, l'argument est le même : il s'agit d'une question interne qui ne regarde que les clercs. Mais les fidèles ont tout de même « voix au chapitre », si vous me permettez ce jeu de mots. Car sans leur aide et leur soutien, telle ou telle Fraternité aurait bien du mal à développer ses apostolats. Peut-on légitimement les museler et exiger d'eux qu'ils se taisent et masquent leurs émotions ? Je ne le crois pas.
D'ailleurs, au sein de l’Église, les fidèles laïcs ont aussi pris part à son Histoire. On parle systématiquement du combat de Mgr Lefebvre pour la liturgie traditionnelle. Mais on ne saurait oublier les résistances d'un Jean Madiran, d'un Jean Ousset, d'un Marcel Clément ou d'un Michel de Saint Pierre qui ont largement contribué à la formation des laïcs et à cette défense de la messe grégorienne. Bref, les échanges du forum jouent aussi régulièrement, selon moi, ce rôle formateur grâce aux contributions de liseurs chevronnés, qui aident à mieux comprendre telle ou telle situation à un moment donné.
Quels sont vos projets ?
Ils sont nombreux, mais nous nous heurtons à des difficultés d'ordre technique, de même que nous manquons de moyens. La technique de mande du temps, dont nous ne disposons pas toujours suffisamment. Aujourd'hui, « l’équipe du forum » n'est constituée que de deux personnes : M. Tabudeux, pour la partie technique, qui fait un formidable travail au vu de ses disponibilités, et moi-même pour l'animation. Parmi les projets, je souhaite reprendre les Rendez-vous du forum, qui permettent le temps d'une soirée un échange avec telle ou telle personnalité, de Yann Moix à Jeanne Barbey en passant par Maurice Dantec ou l'abbé Ribeton et le Père de Blignières. Ce devrait être le cas dès le mois de février
J'aimerais également lancer un sous-forum consacré aux livres. Ce serait une façon pour lei liseurs de publier des critiques personnelles sui tel ou tel ouvrage et d'échanger autour de cette oeuvre. On pourrait imaginer d'ailleurs invita les auteurs sur le même format que les Rendez vous. Il faudra vraisemblablement plusieurs semaines avant que le projet n'aboutisse. Mais nous y travaillons.
Avant cela, il nous importe de réparer définitivement le forum, qui a beaucoup souffert de la dernière panne. On peut compter sur notre détermination et notre envie de poursuivre.
Propos recueilli: par Claire Thomas monde & vie 15 janvier 2013
Pour aider le FC, rendez-vous à la page www.leforumcatholique.org/soutienFC.php
culture et histoire - Page 1967
-
Forum catholique : la liberté est sur Internet
-
Alésia retrouvée
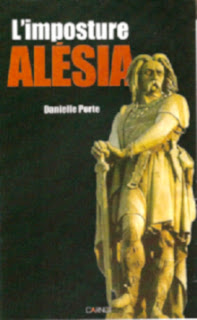 L'opinion répandue et même quasi officielle voudrait qu'Alésia se trouve à Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne. Mais des irréductibles chercheurs soutiennent depuis déjà longtemps qu'il n'en est rien. Danielle Porte, disciple enthousiaste d'André Berthier ; fait le point sur la question et démontre dans un livre passionnant que le site d'Alésia se trouve en Franche-Comté.
L'opinion répandue et même quasi officielle voudrait qu'Alésia se trouve à Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne. Mais des irréductibles chercheurs soutiennent depuis déjà longtemps qu'il n'en est rien. Danielle Porte, disciple enthousiaste d'André Berthier ; fait le point sur la question et démontre dans un livre passionnant que le site d'Alésia se trouve en Franche-Comté.Ce livre est à recommander à tous ceux qui ne s'intéressent ni à l'archéologie, ni à la guerre des Gaules. Ils se surprendront à se passionner pour une question à première vue secondaire : où Alésia se trouvait-elle ? «Je ne chais pas où ch'est, Alégia !» s'écrie un vieux Gaulois dans Le Bouclier arverne. Mme Porte, elle, croit le savoir, et nous fait partager avec fougue sa conviction.
Les Éduens ou les Séquanes ?
Question secondaire, l'emplacement du site de cette ultime bataille ? Non, car selon qu'on le place en Bourgogne (chez les Éduens) ou en Franche-Comté (chez les Séquanes), tout le sens de la guerre des Gaules en est changé.
Mme Porte n'est pas archéologue mais professeur d'histoire romaine à la Sorbonne. C'est avant tout au texte de La Guerre des Gaules qu'elle fait appel pour connaître le site et le déroulement de la bataille. Mais César n'aurait-il pas arrangé les choses à sa manière ? Non, affirme-t-elle, parce que nombre de ses adversaires politiques (et quelques-uns de ses futurs assassins) ont fait cette guerre avec lui et n'auraient pas manqué de relever à plaisir toute exagération. Ce qui ne fut pas le cas.
Le vrai site d'Alésia, disons-le tout de suite, c'est Chaux-des-Crotenay, en Franche-Comté ! Tout, dans le site identifié non par Mme Porte mais par son prédécesseur André Berthier à qui elle rend un vibrant hommage, correspond point par point à la description et au récit de Jules César.
L'histoire sur le terrain
Mais le plus passionnant (et surprenant) est de voir à quel point l'emplacement de la bataille change le sens même de cette guerre. À Alésia, ce n'est pas Vercingétorix qui est pris au piège, mais César lui-même ! C'est Vercingétorix qui avait longuement médité de le conduire à cet endroit pour l'y affronter et, espérait-il, l'y écraser.
Ce n'est pas le chef gaulois qui est poursuivi par César mais l'inverse. César, harcelé de toutes part et affamé par la politique de la terre brûlée que pratique son adversaire (et on comprend très bien pourquoi), cherche à regagner la Provence. S'il était passé par Alise-Sainte-Reine, jamais il n'aurait assiégé la ville : il aurait suivi le couloir rhodanien pour aller franchir les Alpes comme il en énonçait clairement l'intention.
Impossible à Chaux-des-Crotenay (Jura). César ne peut pas passer, mais Alésia, "très grande ville, libre et inexpugnable, foyer et métropole de toute la Gaule celtique", écrit-il, est imprenable de vive force. Il en fera donc le siège, tout en étant sous la menace de l'armée de secours gauloise. D'où la double enceinte qu'il édifie, l'une offensive, si l'on peut dire, l'autre défensive. Le piège tendu par Vercingétorix se serait refermé si... une partie de l'armée de secours n'avait trahi la cause et décampé sans livrer bataille.
Austerlix le Gaulois
Certes, dût l'orgueil gaulois, ou ce qu'il en reste après tant de siècles, en souffrir, la fin de l'histoire n'en demeure pas moins la même. Toutefois, la figure de Vercingétorix en sort bien changée, en même temps que le déroulement des opérations. On voit tout à coup un chef Gaulois parfaitement maître de la situation agir comme Napoléon avant Austerlitz : très longtemps à l'avance, il choisit le lieu de l'affrontement y conduit invinciblement son adversaire.
Soyons beaux joueurs : César reste César. Ses talents de général ne s'en trouvent pas diminués, bien au contraire : on lui restitue un adversaire à sa mesure. Et, du même coup, le récit de La Guerre des Gaules acquiert un relief et une véracité admirables. Sans cesser d'être l'œuvre littéraire que Cicéron, pourtant opposé à César, admirait, avec d'autant plus d'honnêteté que son propre style était tout différent.
Le livre de Mme Porte ne manque de rien pour passionner le lecteur. Il lui fait redécouvrir un épisode fondateur de l'histoire de France avec une puissance d'évocation rare. Mais elle y ajoute une réjouissante passion dans son acharnement à détruire une thèse officielle qui, devant ses arguments, résiste moins longtemps que les murailles d'Alésia.
On revit cette bataille qui mit aux prises pas moins de 95.000 Gaulois à l'intérieur de l'oppidum, 70.000 légionnaires romains plus la cavalerie, et les 150.000 hommes environ de l'armée de secours.
On s'emporte avec l'auteur quand elle expose tous les trucages qui ont permis aux savants du temps de Napoléon III de faire tenir debout, sur des béquilles branlantes, une construction qui avait pour seul mérite de complaire à l'Empereur (encore que celui-ci se soit montré à la longue quelque peu méfiant). Textes triturés, fouilles truquées pour alimenter en objets de l'époque de Néron (cent cinquante ans après l'affaire !) le musée des antiquités de Saint-Germain-en-Laye. Aussi passionnant que lorsque, dans un roman policier, le flic ripoux est enfin démasqué.
Alesia delenda est
Le plus passionnant est de se retrouver plongé dans cette bataille comme si on y était, car tout y est, même le gué que Vercingétorix franchit pour se rendre à César, et les raisons pour lesquelles l'emplacement du site d'Alésia devait être oublié. Et l'intérêt du lecteur est ravivé par cette rafraîchissante polémique et cette belle ardeur à ébranler et démolir les vérités qu'on aurait cru, en toute naïveté, les mieux établies.
On aurait pu croire un sujet pareil à l'abri de la pensée unique. Le livre de Mme Porte révèle que cette pensée unique voudrait régner même sur le site des batailles de l'an 52 av. J.-C. ! Ce n'est pas la moindre surprise de ce livre.
Danielle Porte, L'Imposture Alésia, éd. Carnot, 2004, 296 p., 20€. André Berthier, Alésia, Nouvelles Éditions latines, 1991, 335 p.
Source : Pierre de Laubier, Français d'Abord : décembre 2004
-
LA BIODIVERSITE : UNE CHIMERE EN FOLIE( 2011)
La biodiversité rentre par la grande porte avec le retour de Jean-Louis Borloo. Cet ancien ministre a fait un grand mal à l'économie française par le truchement des deux Grenelles de l'environnement. Ces parlottes, dont le coût ne sera jamais évalué, ont soumis par la voie légale d'immenses parties de la vie nationale au bon vouloir de la secte des écolos.
Le Grenelle de l'environnement est un ensemble de rencontres politiques organisées en septembre et octobre 2007 visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. En particulier, il fallait pour restaurer la biodiversité mettre en place une trame verte et bleue, ainsi que des schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l’efficience énergétique. Cette définition inextricable montre que la biodiversité est au carrefour de diverses autres chimères tout aussi destructrices.
L'émission Thalassa du 9 mars 2012, nous parlait d'un « drame » en Polynésie au sujet des tortues, espèce protégée. Les « vilains » habitants braconnent les tortues dont ils raffolent et qui font la fortune des restaurants ; cette pêche est une tradition séculaire. Six mois de prison menacent désormais les honnêtes pêcheurs dont le seul tort est de gagner leur vie en faisant la joie de leurs clients.
Le 17 mars, l'Islande est jugée « digne » d'entrer dans la CEE ; elle ne pourra que perdre son âme sans rien y gagner vraiment. Cette CEE exige que les Islandais renoncent à la chasse à la baleine, espèce protégée. Les Islandais plaident que c'est chez eux une coutume ancestrale et, qu’en plus, la chair de la baleine est délicieuse et se vend jusqu'au Japon. Attendons de voir comment se terminera le bras de fer. Si les Islandais capitulent, il faudra virer les pêcheurs à l'aide sociale.
Nous apprenons très récemment que les papillons sont menacés. Les écolos sont adroits. En attirant l'attention sur la disparition éventuelle de certaines espèces de papillons, ils touchent un point sensible : qui n'aime pas les papillons et leur charmant manège ?
La secte se prend pour Dieu et rien ne lui est impossible. En France et ailleurs il existe partout des personnes payées pour compter les oiseaux ; c'est un travail fort sympathique qui se passe dans la nature et évite de s'ennuyer dans un bureau ; ce dénombrement est très compliqué : pour compter l'impossible, il faut du matériel et des consultants qui travaillent à la méthode ; une fois le matériel créé et la méthode bâtie, des formateurs surviennent : que de marchés juteux !
L'INVENTAIRE IMPOSSIBLE
La liste des espèces protégées est impossible à faire, tant les textes sont nombreux, touffus et influencés par des accords internationaux. Cette liste augmente sans cesse, au hasard des appétits des uns et des autres.
L'arme de la terreur est manipulée sans vergogne. Les dauphins du Mékong meurent. En 2050 les requins auront disparu. Les albatros, splendides oiseaux océaniques dont l'envergure peut atteindre jusqu'à 3,50 mètres, sont très menacés. Tous les experts annoncent que la population mondiale du tigre a chuté de 95 %, seuls 4000 spécimens résistants vivent encore dans la nature.
Quel est l'objectif ? Faut-il reconstituer les espèces telles qu'elles étaient en 1900 ? C’est une histoire incertaine. Faut-il protéger les espèces telles qu’elles sont en mars 2012 ? Faut-il protéger la totalité des espèces ? Nous nous trouvons devant une tâche évidemment sans limite, car le Créateur a disposé des centaines de millions d'espèces dont une toute petite partie, simplement, est connue ; le début de l'exploration des abysses sous-marins nous découvre par exemple des horizons infinis.
En outre, des découvertes permanentes trompent les statistiques déjà fausses par nature. Il ne restait plus, paraît-il, que 50 000 à 60 000 orangs-outans vivant à l'état sauvage, 80 % en Indonésie et 20 % en Malaisie. Or une colonie de plusieurs milliers d'individus fut découverte à l'est de Bornéo.
LA RUINE POUR TOUS
Les immenses sommes d'argent dérobées par la force fiscale aux peuples bien conditionnés en vue de financer ce cirque mondialiste génèrent de la pauvreté par une succession de mécanismes bien connus.
S’y ajoutent des dégâts collatéraux pour faire plaisir à des membres de la secte plus actifs que d'autres. Le coût du TGV pour Marseille a été majoré à l’époque pour protéger un unique couple d’aigles de Bonnelli, dont, au demeurant, il n’est pas sûr que la trace ait été retrouvée. A cette fin, le trajet a été modifié et le chantier fut interrompu à plusieurs reprises. Il a fallu aussi complaire aux castors et, notons bien la précision, aux pélobates cultripèdes qui sont, comme tout le monde ne le sait sans doute pas, de rarissimes crapauds.
Puis arrive l'effet habituellement destructeur des réglementations publiques, telle Natura 2000. C'est une directive européenne qui depuis 1992 établit partout des zones rurales où aucune activité n’est autorisée, sauf accord des « boureaucrates » de Bruxelles. Le prétexte est de défendre précisément cette biodiversité. La France a proposé 800 zones représentant 5 % du territoire. A ce titre des camarades des chauves-souris ont voulu sévir dans une commune parce qu’un quart des chauves-souris prétendues rares avaient élu domicile dans une caverne se trouvant sur son territoire !
QUELLE EST L'ISSUE ?
Dans toutes les situations même les plus néfastes et les plus ridicules, il existe des solutions. La secte des écolos est, certes, forte et elle s'appuie sur d'immenses intérêts représentés par la collection de ministres de tous pays. Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), est au centre du dispositif et rêve de chiffrer la valeur des écosystèmes afin que les décisions étatiques les prennent en compte. Cela veut dire que la bataille engagée est rude.
Pour échapper à la ruine, il faudrait reconnaître et diffuser sans cesse que l'homme n’est pas capable de diriger les espèces et qu'il doit simplement dans le cadre de sa raison voisiner avec ces espèces telles qu'elles sont, tout en en tirant d’ailleurs le meilleur parti.
Le libre jeu du droit de propriété et son corollaire la liberté des contrats apportent une solution ; elle doit s'accompagner de la dénonciation de certains traités internationaux. Ceux qui aiment particulièrement les chauves-souris ou les tigres, ou les vipères peuvent très bien s'organiser à leur propre échelle dans le cadre du droit naturel et sans nuire aux autres. De même les plus grands et plus beaux animaux peuvent être exploités librement avec parfois la création de fonds d'investissement. Si ces animaux risquent de disparaître, leur valeur augmentera et les propriétaires légitimes prendront les mesures adéquates.
Il est important en terminant de constater que la quasi-totalité de la population aime la nature et peut fort bien s'en occuper dans la liberté et la variété des situations. Seuls les serviteurs de la chimère peuvent être considérés comme des ennemis objectifs de la nature puisqu'ils veulent l'asservir à leur propre pouvoir, tout en empêchant les autres de s’en occuper.
MICHEL DE PONCINS. http://libeco.net -
Pensées noires
 Le noir n’est pas une couleur, mais son absence. Penser est apprendre à mourir, c’est-à-dire à s’abstraire. Socrate est sans doute le père du nihilisme, car il instille la pensée critique dans le tissu resserré de l’existence, la dissolution dans le coagulé. La vie exige la foi, la certitude de régir les événements, ou du moins de les influencer. De l’adhésion sans recul à l’action résulte la force. La pensée peut réguler la force, non la produire. Elle est la carte, quand tout ce qui a lieu s’effectue sur le terrain. La trop grande lucidité peut faire perdre une bataille avant qu’elle ne soit engagée, car la raison géométrique peut persuader qu’elle sera vaine. Pensée et action ne se conjuguent qu’étroitement pour atteindre le sommet de l’être, là où, comme un dieu, on peut avoir l’impression de maîtriser la matière de l’Histoire. Tels furent par exemple les destins d’Alexandre, de César et de Napoléon. Mais, somme toute, ils ne firent qu’accompagner l’inévitable, et, se voulant maîtres et dieux, ils ne furent que les domestiques du Temps.
Le noir n’est pas une couleur, mais son absence. Penser est apprendre à mourir, c’est-à-dire à s’abstraire. Socrate est sans doute le père du nihilisme, car il instille la pensée critique dans le tissu resserré de l’existence, la dissolution dans le coagulé. La vie exige la foi, la certitude de régir les événements, ou du moins de les influencer. De l’adhésion sans recul à l’action résulte la force. La pensée peut réguler la force, non la produire. Elle est la carte, quand tout ce qui a lieu s’effectue sur le terrain. La trop grande lucidité peut faire perdre une bataille avant qu’elle ne soit engagée, car la raison géométrique peut persuader qu’elle sera vaine. Pensée et action ne se conjuguent qu’étroitement pour atteindre le sommet de l’être, là où, comme un dieu, on peut avoir l’impression de maîtriser la matière de l’Histoire. Tels furent par exemple les destins d’Alexandre, de César et de Napoléon. Mais, somme toute, ils ne firent qu’accompagner l’inévitable, et, se voulant maîtres et dieux, ils ne furent que les domestiques du Temps.
L’Histoire du monde ressemble à une vue aérienne : le plan panoramique révèle des lignes géologiques et le travail global des hommes, qui ont modelé le paysage sur une échelle universelle. Des champs, des prés, des forêts, des clairières, des villages, des villes, des voies se dessinent, s’étalent comme des taches, coupent, tranchent, s’évasent, se conjuguent aux blocs massifs des montagnes, aux effondrements des vallées et des gorges, aux linéaments des frontières naturelles, à la bigarrure des éléments minéraux et des végétations. Et si la vue se fait plus large et plus haute, et qu’elle emprunte le regard froid du satellite, l’apport humain se fait moins certain, les grandes logiques géographiques deviennent lisibles, les agencements géants du territoire continental et des évasements maritimes, les crispations et les relâchements titanesques de la planète apparaissent. Mais la vision se focalise-t-elle, en une sorte de travelling vertical descendant, sur les occupations microscopiques du vivant, l’agitation se fait plus fourmillante, le grouillement plus fébrile, et le temps semble s’accélérer, au grès des engagements particuliers, des rôles joués par des acteurs persuadés de tenir leur condition par l’action. La circulation se fait intense, chacun s’adonne à la tâche que sa vision implique, et si nous parvenons à cerner l’individu dans la circularité linéaire de son existence, qui est une spirale, c’est-à-dire une trajectoire répétitive du même dans le sillon d’une projection anticipative (ce que l’on appelle un destin, ou une vocation), nous avons presque la suggestion d’une liberté, d’une liberté néanmoins étranglée par la certitude de la mort.
Entre le regard des dieux et celui de la fourmi, il y a plus qu’une différence ontologique, il existe une distinction de perspectives, et c’est ce constat amer que l’on trouve avec force dans l’Iliade, cette école de l’esprit européen. Les guerriers s’agitent comme des insectes, sont pris de passion, s’entre-tuent en s’insultant, parfois quelque dieu prend parti, comme pour se divertir, souvent cruellement, dans ce jeu puéril, toujours sérieux, que les enfants entretiennent pour dompter un temps qui fuit, mais finalement, la famille des divinités se retrouve dans l’olympe, là-haut et loin, et, dans de grands rires, oubliant la dérisoire inquiétude des mortels.
Si Prométhée fut châtié d’avoir aidé les hommes, ce fut surtout parce qu’il leur donna l’illusion en leur octroyant un feu qu’il avait dérobé, un feu par conséquent illégitime. Toutes les sagesses anciennes présentent la conscience comme une faute ou une usurpation. Pensée, c’est souffrir, s’écarter de la condition naturelle du vivant, qui procrée et détruit comme une force qui va. Toutes les sagesses anciennes tenteront donc d’expliquer cette anomalie, ce fourvoiement du statut originel de l’être.
Le lourd fardeau de l’être pensant est une fatalité douloureuse, car il voit qu’il souffre, comprend sa douleur, et parfois les causes de celle-ci. Toute civilisation avancée a consisté à apprivoiser cette douleur, et à la travestir pour en faire la source de jouissances. La littérature, l’art, la philosophie, la musique sont des baumes sur nos plaies, et des vapeurs fantasmatiques qui nous permettent d’entrevoir quelque lueur d’une beauté enfuie, et peut-être enfouie. Toute civilisation aboutie formule au fond de sa conscience l’inanité de toute action. Toute la dialectique civilisationnelle, qui se nourrit du conflit constructif entre la barbarie et l’apprivoisement du sauvage, finit toujours par l’extinction de la vie dans le rêve.
Nous sommes à un moment décisif où le rêve, qui est parfois un cauchemar, s’est emparé de l’Histoire. La condition onirique supprime le temps et parodie le mythe dans l'utopie festive, la fixité d'un destin voué au plaisir. Le mythe est cette éternité originelle où tout pouvait commencer. L'éternité qui nous est promise est une agonie sans fin, un acharnement thérapeutique crépusculaire. Nous ne pouvons plus débuter car le terme, l’ultime et la finalité de notre être au monde historique a épuisé toutes ses potentialités de domestication de l’homme. Les insectes qui s’agitent ne le font plus que comme des robots téléguidés, car notre imperfection provient de notre perfection, notre faille de notre force, notre tare de notre vertu, notre stupidité animale de notre intelligence technique. C’est parce que nous avons atteint un degré de complexité incomparable que la matière vitale s’est absorbée dans la dimension mortifère du mécanique.
Peut-être qu’un effondrement géologique d’ampleur continentale nous rendrait à une sauvagerie revitalisante. Il n’est pas impossible qu’elle ne nous entraîne plus loin dans le labyrinthe de nos rêves suicidaires, cul de sac fabriqué par l'ingénieux Dédale, et il n’est pas dit que l’on trouve encore une Ariane et un Thésée, la pensée désirante et l'action tranchante, pour tuer le Minotaure.Claude Bourrinet http://www.voxnr.com -
Préférence nationale : pourquoi les Français ont raison de la solliciter…
Selon un sondage CSA, 66% des Français estiment que les réfugiés et demandeurs d’asile ne doivent pas bénéficier en priorité des aides et dispositifs sociaux publics.
En dehors de toutes considérations sur la portée d’un sondage dont les ressorts sont effectivement aux mains d’un système partisan, la question de la préférence nationale qu’il soulève est en revanche d’une actualité brûlante. Car de deux choses l’une : ou bien il y a en France suffisamment d’emplois pour tous ceux qui y résident, et dans ce cas la priorité à l’emploi pour les français, parce qu’elle n’est pas par définition une exclusivité, n’a aucune raison d’inquiéter les étrangers. Ou bien la France manque d’emplois, et dans ce cas il est bien normal que la solidarité nationale s’exerce prioritairement à l’adresse des ressortissants nationaux.
Qu’y a-t-il, en effet, de moralement suspect à vouloir enraciner l’amour du plus lointain dans l’amour du plus proche ? Celui-ci n’étant pas alors considéré comme un point d’arrivée dans l’exercice de la solidarité, mais bien comme un point de départ. Qu’y a-t-il de suspect à considérer que les Français sont héritiers chez eux, sur la terre de leurs ancêtres, et qu’ils possèdent alors davantage de privilèges que ceux à qui cet héritage, en tant que tel, ne s’adresse pas ? Après tout, seuls les enfants héritent de leurs parents, et non la terre entière.
Il faut donc introduire un ordre dans l’exercice de la solidarité, lorsqu’elle se déploie dans le cadre de la communauté politique : à quoi bon vouloir faire la charité à la terre entière lorsqu’on est incapable de l’exercer déjà à l’égard des siens ? Charité bien ordonnée commence par soi-même !
-
La déportation de la population basque par la Révolution française Un oubli du « devoir de mémoire »
Vous souvenez-vous de tous ces « Infâmes » ? Ceux de Sare, Itxassou, Ascain et d'autres encore ? Grande est la misère au royaume de France ! Au nom d'Itxassou, certains, gourmets à n'en pas douter me crient : « Ah ! Les bonnes confitures de cerises noires… » Le rouge ne devrait-il pas leur monter aux joues ? Itxassou, Espelette, Biriatou, Aïnhoa… Leurs habitants déportés. Tous ces morts au cœur et à l'âme suppliciés par la Révolution française…. A tous nos amis Basques, en ce mois d'avril nous disons « On dagizula » !
Et grâce à notre ami Alexandre de La Cerda nous entamons le devoir de mémoire que nous vous devons ! Terre de « fors » (libertés pour un bien commun), peuple fidèle à la foi de ses pères…
La Vendée, grande meurtrie parmi les « meurtries » est connue de tous… Mais le « Pays » Basque ne doit pas être oublié ! Un « Pays » qui sous la monarchie française avaient préservé ses traditions ancestrales. Devenu français en 1451, le Labourd pouvait se prévaloir, par exemple, du règlement des successions en tenant compte du droit d'aînesse, dont bénéficiait tant la fille aînée que le fils aîné, moyennant d'assurer une contrepartie aux autres frères et soeurs célibataires. Les Basques ne connaissaient pas la féodalité, et jouissaient d'une véritable constitution, sous la direction de leurs assemblées élues, veillant « jalousement » à leurs « fors », vivant fièrement leur langue et leur foi catholique…
Un grand merci à Alexandre de La Cerda.
Portemont, le 14 avril 2011
La déportation de la population basque par la Révolution française
Un oubli du « devoir de mémoire »
Le 22 février 1794, un arrêté des « représentants du peuple » Pinet et Cavaignac décrétait « infâmes » les communes de Sare, Itxassou et Ascain, et ordonnait l'éloignement de tous leurs habitants à plus de vingt lieues.
La mesure fut aussitôt exécutée : après avoir été entassés dans leur église, 2.400 habitants de Sare furent conduits dans 150 charrettes à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure où ils furent soumis aux quolibets, vexations et lapidations des membres de la « Société Révolutionnaire » de la commune rebaptisée « Chauvin-Dragon ».
Parqués dans les églises et d'autres bâtiments désaffectés, ils furent bientôt rejoints par des milliers d'autres compatriotes arrachés à leurs foyers de Saint-Pée, Itxassou, Espelette, Ascain, Cambo, Macaye, Mendionde, Louhossoa, Souraïde, Aïnhoa, Biriatou etc…
Saint-Jean-de-Luz et ses environs ne constituèrent qu'une première étape sur le chemin de croix des malheureux. Bientôt s’ébranla sur les routes le long cortège des déportés accompagné de charrettes où l'on avait jeté vieillards, enfants en bas-âge et grabataires. Des femmes accouchaient sur ces charrettes ou, en pleine nuit, sur la pierre nue, dans le froid !
L'itinéraire fut spécialement établi de manière à traverser des quartiers mal famés, notamment à Saint-Esprit, où une population trouble et famélique leur réserva le plus terrible des accueils… L'hiver 1794 fut particulièrement rigoureux, et les prisonniers mouraient en chemin comme des mouches, particulièrement les plus jeunes et les vieillards. On relève encore parmi les inscriptions tombales des cimetières jalonnant le parcours des suppliciés : Françoise Larregain, d’Ascain, 2 mois. Françoise Duhart, d’Ascain, 8 mois. Pierre Darhamboure, d’Ascain, 7 mois. Etienne Lissarade, d’Itxassou, 7 ans. Jean Garat, 3 ans. Michel Camino, de Sare, 11 ans. Michel Etchave, 9 ans. Martin Etcheverry, de Sare, 80 ans. Jean Delicetche, de Souraïde, 80 ans, etc. Les enfants qui réussissaient à survivre à ce cauchemar étaient livrés à eux-mêmes.
L'arrivée des survivants à destination églises et bâtiments désaffectés du Béarn, des Hautes-Pyrénées, des Landes, du Gers, du Lot-et-Garonne, jusque dans le Cantal et au-delà - ne signifia aucunement la fin de leurs tribulations, bien au contraire.
Un nouvel arrêté des autorités révolutionnaires, pris le 24 mai 1794, prévoyait l'organisation générale de la déportation : les détenus devaient être employés à des travaux publics et particuliers et ne pouvaient quitter la commune à laquelle ils étaient assignés, à peine de six ans de fer pour les hommes, six ans de prison pour les femmes, avec au préalable, une exposition d'une heure pendant trois jours « sur l'échafaud, au regard du peuple ».
II serait aujourd'hui difficile de s'imaginer les horribles conditions d'existence et de survie de ces malheureux entassés dans les églises (229 dans la seule église de Capbreton) dans le froid, sans nourriture, au milieu de populations étrangères, au moins par la langue, sous la surveillance d'autorités hostiles ; la liste des décès ne faisait que s'allonger…
Vers la fin du supplice
Il fallut attendre quelques huit mois pour qu'enfin le 28 septembre 1794, les « représentants » Baudot et Garrot mettent fin à l'internement des Basques et les autorisent à rentrer chez eux. La ruine était totale, les maisons dévastées, pillées et brûlées, la terre en friche ou les récoltes volées, les bourgs vidés de leur population. Pour le seul village d'Itxassou, une liste officielle dénombrait 271 déportés et 211 émigrés ; car nombreux étaient les Basques qui avaient cherché leur salut dans les provinces voisines de Navarre et de Guipuzkoa pour éviter la déportation. De timides mesures de répartition n'aboutirent pratiquement jamais, quelques responsables furent vaguement inquiétés. La colère des victimes s'exprime parfaitement dans le « Sarako iheslarien Kantua » ou chant des fugitifs de Sare ; quant à Salvat Monho, il regrette dans « Orhoitzapenak » (mémoires) que « ne soit pas permise la plus ancienne des lois (celle du talion, ndlr.), de rendre à chacun ce qu’il nous a fait ! »
Les prodromes de la tragédie
Comment expliquer les causes profondes de la déportation criminelle d’une population civile qui aurait sans doute valu à ses auteurs, en d’autres temps, un « procès de Nuremberg », bien que l’enlisement sans fin de celui des Khmers rouges au Cambodge et l’impunité générale des responsables communistes semblent accréditer sérieusement une systématisation, à notre époque, des « doubles standards » d’appréciation et de jugement ?
Tout d'abord un divorce profond des populations basques avec le pouvoir parisien révolutionnaire qui jugeait que les transformations souhaitées et l'élimination des anciennes forces vives ne s'accomplissaient pas assez rapidement.
Sans doute, l’accélération des événements intérieurs entraînant une nette radicalisation du pouvoir central avait-elle de quoi surprendre l’opinion publique « moyenne » - dans l’ensemble plutôt modérée - du département nouvellement créé des Basses-Pyrénées.
Une modération enrageante
La situation à Bayonne est parlante à cet égard.
Pôle marchand et libéral, les Protestants n’y furent par exemple guère inquiétés lors des guerres de religion qui avaient au XVIe siècle enflammé durablement toute la région alentour ; l’église de Saint-Jean-Pied-de-Port et celles de Chalosse, pour ne citer que celles-là, portent encore les séquelles des dévastations causés par Montgomery et ses troupes de Réformés.
Or, en ce XVIIIe siècle finissant, les nécessités du négoce et le voisinage de la frontière avaient conduit de nombreux étrangers à Bayonne dont les plus remuants étaient « utilisés » par les Girondins pour activer la propagande révolutionnaire dans leur pays d’origine.
Les Juifs de Saint-Esprit avaient déjà oublié que leur début d’émancipation était dû à la volonté de Louis XVI (et qu’ils avaient été plus d’une fois soutenus par les tribunaux royaux dans leurs querelles prolongés contre les marchands bayonnais, en particulier à propos du chocolat) : ils étaient donc disposés à servir la Révolution - tant qu’elle ne compromettrait pas leurs intérêts - et il feront durement sentir leur animosité envers les colonnes de déportés qui traverseront Saint-Esprit.
Quant aux députés représentant le nouveau département à la Convention, le procès du roi donna un aperçu de leur « modération » : Casenave, Conte, Meillan, Neveu, Pémartin et Sanadon se prononcèrent tous contre la peine de mort remplacée par la détention et le bannissement à la paix.
Cependant, les menaces européennes qui firent triompher en France la politique belliqueuse et l'extension de la guerre fit prendre de nouvelles mesures de « défense nationale », exaspéra les discordes politiques et porta le gouvernement central à déléguer des conventionnels aux frontières et à l'intérieur. Avant même la déclaration de guerre à l'Espagne en mars 1793 et surtout après cette date, ces commissaires aux armées organisèrent peu à peu, pièce par pièce, en appliquant et en complétant les décrets, le gouvernement révolutionnaire dans les Basses-Pyrénées.
Alexandre de La Cerda http://www.lesmanantsduroi.com/
-
Jean Giraudoux
Hippolyte Jean Giraudoux est né le 29 octobre 1882 à Bellac en Haute-Vienne. Fils cadet d'un père employé des Ponts-et-chaussées, puis percepteur, il manifestera toute sa vie son attachement à cette petite sous-préfecture de 2 400 habitants, disant : « Ma ville natale est Bellac. Je ne m'excuserai pas d'y être né ! » Il se révélera dès l'enfance un excellent élève, premier au certificat d'études dans son canton, avant d'obtenir le prix d'excellence au lycée de Châteauroux. Il ne gardera pas un excellent souvenir de l'« affreux Châteauroux, animé comme un cimetière ». Les habitants de cette ville ne lui en tiendront pas rigueur puisque le lycée de Châteauroux porte aujourd'hui le nom de Jean Giraudoux...
Il poursuit de brillantes études, termine sa seconde année de Khâgne avec le prix d'excellence et obtient le premier prix de version grecque, en 1902, au concours général. Entré à l'École normale supérieure de Paris, il se passionne pour la culture allemande. Plus tard, il définira la rue d'Ulm comme une école spirituelle. Giraudoux écrira : « Je ne dirai pas que tous ceux qui sortent d'elle ont de l'esprit, mais ils sont les serviteurs de l'esprit, c'est-à-dire les adversaires de la matière [...], ils n'acceptent pas le poids du monde. » Sa subite vocation de germaniste a notamment comme source l'irrépressible envie d'effectuer un séjour à l'étranger. Ce sera Munich où il fera la connaissance de Paul Morand qui entraînera son mentor et ami dans une « fête inimitable et joyeuse » qui contribuera à ce que Giraudoux se détourne de la perspective d'une carrière dans l'enseignement. Il va choisir, comme Morand la "Carrière". Il échouera en 1909 au prestigieux concours des ambassades mais se rattrapera l'année suivante au « petit concours » des consulats. C'est en 1909 que paraît son premier livre, Provinciales, remarqué par André Gide.
La Première Guerre mondiale éclate. Giraudoux aura une conduite héroïque. Insoucieux du danger, il est blessé dès septembre 1914 « à l'aine et sur l'Aisne ». À peine guéri, il fera des pieds et des mains pour retourner au front. Affecté au corps expéditionnaire d'Orient, sa brillante conduite au feu lui vaudra d'être deux fois blessé. Il sera promu sous-lieutenant et chevalier de la Légion d'honneur. Démobilisé en 1919, il revient à la diplomatie et à la littérature et sera enfin reçu au « Grand Concours ». Il écrit des livres, telle La guerre de Troie n 'aura pas lieu ayant pour thème le cynisme des politiciens et la différence entre l'histoire telle que les dirigeants la montrent au peuple et telle qu'elle se passe réellement. Il écrit Pleins pouvoirs en début 1939, qui lui vaudra sa nomination comme commissaire à l'Information dans le gouvernement Daladier.
Frappé par la décadence de la France, il apprenait aux Français que leur patrie n'était pas une idée abstraite mais une personne, un être de chair et de sang, avec une mission de « grandeur et de magnificence, de splendeur et d'imagination », qu'il ne fallait pas laisser dépérir. Il adjurait les Français de se reprendre, de ne pas se laisser glisser sur la pente molle du laisser-aller et de la décadence. Dans cet important essai politique, il demande notamment l'adoption d'une politique d'immigration, « afin de constituer, au besoin avec des apports étrangers, un type moral et culturel ». On devine que Giraudoux n'évoque pas dans ce texte une immigration venue du Tiers Monde... Sa préférence va vers une « immigration Scandinave éminemment souhaitable », à l'exclusion de « ces races primitives ou imperméables dont les civilisations, par leur médiocrité ou leur caractère exclusif, ne peuvent donner que des amalgames lamentables », symbolisées selon lui par les Arabes. Pendant la guerre, il se tiendra à distance des passions politiques et de toute forme d'engagement. Il refusera le poste de ministre de France à Athènes proposé par Vichy mais entretiendra des relations personnelles avec plusieurs membres du gouvernement. Son fils Jean-Pierre avait quant à lui rejoint Londres dès juillet 1940. En 1942, il affirmera « l'impossibilité d'une véritable rencontre entre les deux cultures (française et allemande) tant que durerait la guerre ». On lui proposera de quitter la France. Il refuse, arguant de la nécessité de livrer en France une « lutte d'influence avec l'Allemagne ». Jean Giraudoux meurt le 31 janvier 1944, à Paris. Évoquant « Giraudoux l'Athénien » dans son ouvrage Le défilé des réfractaires, Bruno de Cessole a cette formule : « Quel écrivain français peut se flatter d'avoir excellé à la fois dans la course à pied, la version grecque, le poker, la métaphore, la diplomatie et le théâtre ? » L'auteur répond : « Le seul merle blanc qui ait jamais assumé un tel éclectisme c'est, bien sûr, Giraudoux. »
R.S. Rivarol du 25 janvier 2013 -
Anne-Marie Delcambre démonte l’islam
Anne-Marie Delcambre n’est jamais invitée sur les plateaux Radios/TV en sa qualité de spécialiste de l’islam. Les médias préfèrent donner la parole à des dhimmis en puissance. Elle est pourtant :
Ø Docteur de 3ème cycle de l’Université Paris IVØ Docteur d’État en droit et agrégée d’arabe classiqueØ Professeur d’arabe littéraireØ Auteur de nombreux livres et articles sur Mahomet et l’islam -
Le grand bobard médiatique : plus il fait froid et plus ils nous menacent du réchauffement
La vague de froid qui s'abat sur l'ensemble de l'Europe doit être remise en son contexte. Pendant une semaine les média d'Occident ont été absolument indifférents à l'effondrement des températures survenu à l'Est et particulièrement en Russie, en Ukraine, en Bulgarie et en Roumanie faisant des dizaines de morts. Le même phénomène s'était produit l'année dernière et en 2007 avec un gel spectaculaire des rives de la Mer Noire, aussitôt occulté de peur que cela n'alimente la verve "conspirationniste" des "sceptiques".
Et pourtant les services de la météorologie avaient annoncé, confiants, que l'hiver 2012 et le printemps qui le suivrait seraient très doux. Rien en cela qui soit de nature à surprendre.
Les Anglais commencent à en avoir l'habitude pour lesquels c'est le troisième hiver enneigé et glacial, eux qui, certes familiarisés avec l'humidité, ne le sont qu'exceptionnellement avec les conditions actuelles.
Depuis des années, comme s'ils en avaient reçu des consignes expresses, les « météorologues de média », ceux qui, par leurs incessantes interventions sur les radios et les télévisions ont peu à peu façonné la vision du monde acceptée par la plupart des gens dociles, nous ont convaincus que nous allions vers un inéluctable réchauffement climatique. De surcroît provoqué par les activités humaines dont la production de CO₂ serait en train d'embraser la planète. Ainsi les océans ne cesseraient de monter, menaçant les îles Tuvalu, Cook, Marshall dans le Pacifique ou encore les Maldives dans l'Océan Indien. Ce même Réchauffement assécherait le Sahel africain, l'Est du continent ou l'Amazonie. Il aurait fait fondre les neiges du Kilimandjaro, des centaines de glaciers, les banquises nord et sud ainsi que le Groenland. Il serait responsable de la tempête de l'an 2000, des incendies australiens de 2009 et russes de 2010, du cyclone Katrina. Bref, s'il pleut trois jours sur le Poitou mais pas au printemps 2011 sur la Beauce, c'est encore lui. Et toujours lui si en septembre (... prochain !) le passage du Nord Ouest à travers l'archipel canadien sera ouvert - promis, juré - à la circum-navigation.
Or tout ceci est faux et cent fois démontré. Les océans n'ont pas crû d'un centimètre au cours du XXe siècle, les îlots menacés par les marées et les tempêtes, culminant à 1 mètre, 5 au-dessus du niveau des eaux, sont d'abord victimes d'une surpopulation qui force les villages à s'exposer au bord des plages. La Nouvelle-Orléans à été victime de l'effondrement de digues mal entretenues, pas de Katrina qui ne l'a pas touchée. L'Antarctique en sa partie orientale ne cesse de croître. Depuis deux ans l'Arctique retrouve ses marques habituelles et depuis la mi-novembre - dans l'indifférence des « météorologues de média » - l'Alaska est sous 4 mètres de neige. Fairbanks, la seconde ville de l'État avec 32 000 habitants, a battu à la mi-novembre tous ses records de froid, y compris le record absolu datant de 1911. Au cours des deux derniers mois le port de pêche de Cordova, 2 000 habitants, a reçu près de 6 mètres de neige. Certains toits sur lesquels 2 mètres de poudreuse s'étaient accumulés se sont effondrés. Une expédition russo-canadienne de grande ampleur a pu approvisionner en carburant la communauté inuit de Nome perdue dans le grand nord de l'Alaska, totalement isolée par un hiver précoce, brutal et glacial. Il a encore neigé au Mexique à Noël. On trouve sur Internet des photos spectaculaires de villes japonaises enfouies en décembre sous 3 à 4 mètres de neige. Début février tout le nord du pays était paralysé à son tour. Début janvier n'a-t-il pas neigé sur le Sahara ? Les murs ocre des oasis du Sud et des villages du Hoggard sous 5 centimètres on n'avait pas vu cela depuis 25 à 30 ans. Et pourtant le premier week-end de février de nouvelles et importantes chutes de neige sont tombées sur l'Algérie, le Maroc après que la Corse, la Sardaigne, la Sicile eurent connu leur pire enneigement depuis des décennies.
ILS TRUQUENT ET ILS MENTENT AUX ORDRES DE L'ONU
Mais ces événements s'opposent à l'idéologie véhiculée depuis des années par le, GIECC.
Le MET, office britannique de Météorologie, qui dépend du ministère anglais des Armées, et, à l'instar de Météo-France, est membre de l'Organisation Météorologique Mondiale, laquelle, comme le GIECC, est une agence des Nations Unies, faisait savoir le 29 septembre 2009 qu'à défaut, d'ici 2050, de réduire les émissions de CO₂, la température de la terre croîtra de 4e.
Le 8 décembre 2009, alors que s'ouvrait le sommet de Copenhague qui devait déboucher sur un fiasco complet pour le GIECC et ses partisans, le MET, en collaboration avec l'Université britannique de l'East Anglia, celle dont Internet révéla les tripatouillages en faveur du GIECC, publiait les résultats d'une étude destinée à confondre définitivement les sceptiques du réchauffement climatique anthropique. Et démontrant au-delà de toute contestation que selon des données fournies par 1 500 centres d'analyses dans le monde sur 5 000 consultés, les températures globales auraient augmenté au cours des 150 dernières années.
Le même MET, apportant encore plus de grain à moudre aux "chauffagistes" du GIECC, annonçait le 25 novembre 2010 que, du fait de mauvaises appréciations dans les relevés océaniques, en réalité la température avait augmenté depuis 1970 de 0,03° de plus par décennie que ce qui avait été annoncé. Le lendemain, à la veille de la conférence de Cancun sur le Climat, il confirmait que 2010 serait la première ou la seconde année la plus chaude depuis que la météo possédait des archives.
Le 26 novembre 2010, il publiait néanmoins cet incroyable communiqué : « Forget the cold, the world is warmer ». Ce qui commençait en ces termes : « En dépit de la neige de novembre et de l'hiver le plus froid que nous ayons connu depuis 30 ans, l'évidence d'une planète encore plus chaude, provoquée par les activités humaines, est devenue encore plus solide l'année dernière ». Suivait une oiseuse explication destinée à confondre définitivement les contradicteurs... qui n'existent pas !
On ne compte plus les interventions dans ce sens, qui correspondent aux vœux du GIECC, de l'Organisation Mondiale de la Météorologie et de l'ONU poussant à l'unification accélérée de la planète sous couvert de cataclysme universel.
Or, dans un rapport publié fin janvier, le MET et l'Université d'East Anglia reconnaissaient qu'il y aurait 92 chances sur 100 pour que l'actuel cycle solaire 25 ainsi que les suivants soient aussi faibles et peut-être plus faibles encore que ceux qui provoquèrent les Minimums de Maunder et de Dalton. En d'autres termes que nous pourrions entrer dans 75 années de périodes glaciales. À l'image de celles que connut l'Europe de 1545 à 1715, sous l'appellation de « Petit Âge Glaciaire », qui vit par exemple la Tamise geler plusieurs années de suite. Ou celles qui survinrent entre la fin des années 1780 et 1830 lorsque les températures en Europe chutèrent de 2°, avec pour conséquence l'effondrement des productions agricoles et la brutale augmentation des prix qui furent une des causes de la Révolution française.
Or le MET, tout en reconnaissant que cette situation pourrait entraîner une chute des températures de 0,08°, prétendit que cela serait contrebalancé par la quantité de dioxyde de carbone générée par les activités humaines. L'un des auteurs du rapport, Peter Stott, responsable du service du Changement Climatique au MET, n'hésitant pas à écrire : « Nos découvertes suggèrent une réduction de l'activité solaire à des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis des siècles mais qui ne seraient pas suffisants pour supprimer l'influence dominante des gaz à effets de serre ». D'où l'importance capitale de la contestation de ces gaz à effets de serre et de leur influence sur notre climat ainsi que l'opposition déterminée de milliers de scientifiques qui réfutent obstinément la vérité dogmatique dont l'ONU et ses factotums des services météorologiques et du GIECC continuent à proclamer qu'elle serait l'objet d'un consensus universel.
René BLANC. Rivarol du 3 février 2012 -
Retour au réel socialiste ou Jules l’imposteur
Après la fausse droite voilà la vraie gauche. Hollande ,en deux jours, proclame deux énormités : la première avant d’être élu : « il y a une culture communiste et je voudrais lui rendre hommage ». Les descendants des 100 millions de morts apprécieront.
2 ème énormité : la célébration de Jules Ferry. Jean Madiran nous conseillait hier matin dans Présent de lire Jules l’imposteur de François Brigneau ,publié dans Itinéraires. Aussitôt lu ce texte remarquable je vous en donne un aperçu.
Petit rappel historique: Sous la présidence de Jules Grévy, premier président franc maçon qui « abomine les prêtres et les rois » va être accompli une forfaiture.
Jules Ferry, ministre de l’instruction publique que l’on devrait nommer ministre de la propagande s’est donné pour tache de « changer le coeur de ce vieux peuple monarchiste et chrétien. » Pour parvenir à ce but son programme: dissolution des congrégations, laïcisation de l’enseignement et séparation de l’Eglise et de l’Etat. Le 15 Mars 1879 Ferry dépose plusieurs propositions visant toutes à républicaniser tout l’enseignement. Un article est particulièrement vicieux : l’article 7 : Nul n’est admis à diriger un établissement public ou privé, de quelque ordre qu’il soit ni à donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation non autorisée. Or et je cite François Brigneau : « L’enseignement privé (1.600.ooo élèves, un garçon sur cinq, une fille sur deux ) est essentiellement donné et dirigé par des congrégations non autorisées. C’est à dire des congrégations que la Révolution avaient mises hors la loi( liberté ,égalité, fraternité) et bannies, mais qui sont revenues depuis, tolérées sans avoir jamais été officiellement reconnues. » Ces bons républicains veulent donc faire appliquer des lois votés au début du siècle en pleine terreur révolutionnaire.
Après des débats houleux la loi n’est pas votée par le Sénat. Qu’importe le gouvernement publie un décret d’expulsion et ces dernières commencent le 29 Juin I88O par La Compagnie de Jésus rue de Sèvres.Puis se généralisent partout en France. Il faut lire le récit de François Brigneau évoquant tous ces vieux moines traînés hors de leurs murs. Il y a un mort ,le supérieur des Bénédictins de Solesmes , Dom Couturier, qui s’est épuisé le coeur à résister.
« Ce n’est pas le premier mort ,écrit Brigneau,mais c’est certainement celui qui doit lui faire le plus plaisir. Il symbolise et résume le combat engagé et son issue, la défaite du catholicisme. Le 31 Décembre Ferry peut mesurer l’étendue de sa victoire: 261 couvents crochetés et vidés. 5641 religieux expulsés. Le projet maçonnique est en bonne voie. »
Cette forfaiture de Jules Ferry qui ressurgit en 2012 est une magistrale leçon pour la droite, cette droite stupide qui danse sur une musique qui n’est pas la sienne et qu’on lui impose. Soit elle comprend où est l’ennemi ,et surement pas à sa droite comme elle le répète idiotement. Soit elle crèvera et notre beau pays avec. Sont à gauche tous ceux qui répètent comme des malades mentaux qu’il faut respecter les valeurs républicaines et la laïcité. Lesquelles valeurs ont pour seul but d’éradiquer les catholiques. Cela durent depuis deux siècles il serait temps de comprendre. Anticipons sur ce qui va se passer pour l’enseignement libre : au nom de la sécurité, c’est la nouvelle arme hypocrite à souhait, on imposera des accès pour handicapés,des toilettes spéciales, des escaliers de secours etc ,etc. Les établissements ne pourront pas ,n’auront pas de place ou pas d’argent et on les contraindra à fermer. Et bien sûr plus une pièce d’argent public pour cet enseignement libre.
Que les non chrétiens ne pensent pas se tirer d’affaire, ils seront obligés de se soumettre eux aussi dans tous les autres domaines ,les lois vont se durcir pour protéger tous les projets de la gauche, préparés par la droite inconsciente et molle : immigration, métissage,suppression de la famille, avortement, travestissement de l’histoire , indemnités à la nation algérienne et tutti quanti.
La devise Liberté, Egalité Fraternité est un leurre qui signifie en réalité Totalitarisme, discrimination et haine à tous les étages. . Il n’y a pas de droite molle ou dure, de droite républicaine ou lepéniste . Il y a ceux qui comprennent la manipulation gauchiste et les autres. Ceux qui préparent le lit de la gauche et ceux qui résistent. Ceux dits de droite qui ne veulent pas s’instruire sur le cas Ferry ,qu’ils cessent de faire de la politique, de faire semblant de nous représenter, de voter , qu’ils cessent de mépriser la vraie droite qui représente la France profonde, qui s’est abstenu ou a voté blanc , car ils raisonnent comme des caniches et les caniches se tiennent en laisse c’est bien connu.
Le seul régime libre, égalitaire et fraternel est un régime chrétien ou qui respecte le christianisme. Les autres mènent tôt ou tard au meilleur des mondes c’est à dire au pire. Aucun parti actuel ne prend cette idée en considération. Merci à Jules Ferry et à Hollande de remettre les pendules à l’heure.
Anne Brassié