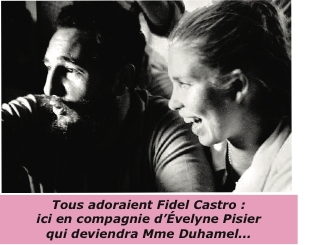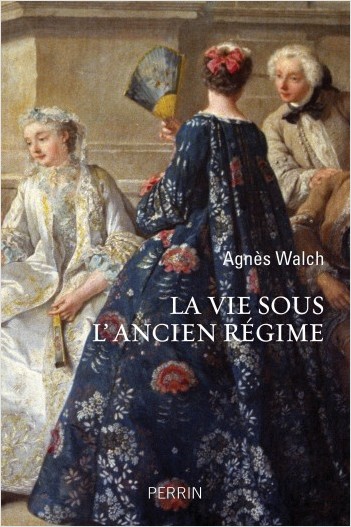Le magazine Reines & Rois m’a invité dans ses colonnes à présenter les arguments contemporains pour l’établissement d’une Monarchie en France, et ma tribune a été intégralement et fidèlement publiée dans le numéro de Mai-juin-juillet 2021, ce dont je remercie la rédaction et Olivier C. en particulier. En voici le texte ci-dessous…
Un récent sondage nous apprenait que 17 % des Français étaient favorables à l’établissement d’une Monarchie en France, et cela plus de deux siècles après la fracture révolutionnaire et plus d’un siècle et demi après le départ en exil du dernier roi ayant effectivement régné. Entretemps, cinq Républiques sont nées et quatre ont disparu, souvent dans des affres peu glorieuses, du coup d’État à la défaite militaire, sans oublier deux empires et un « État français » : deux siècles durant lesquels la question institutionnelle ne cesse d’être posée, et cela même si l’actuelle République, cinquième du nom, semble avoir réussi une certaine synthèse entre les différentes traditions politiques du pays, synthèse néanmoins remise en question aujourd’hui par les nostalgiques de la IIIe (ou de la IVe) République qui la trouvent « trop monarchique » quand les royalistes la trouvent, eux, trop républicaine ou « monocratique », trop jacobine ou laxiste…
Lire la suite