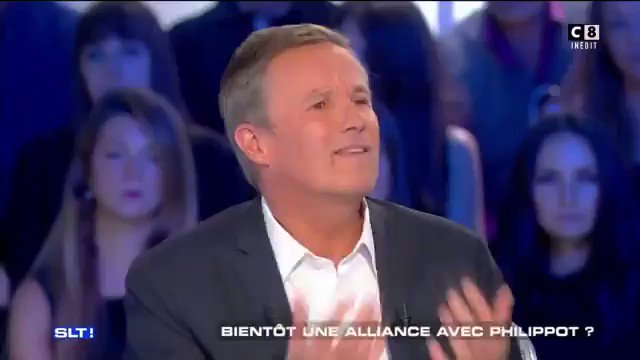Le bloc notes de Jean-Claude ROLINAT
Le pseudo référendum illégalement organisé le dimanche 1er octobre par le gouvernement régional de la Catalogne espagnole, s’est achevé dans la confusion et le ridicule. La Généralitat a, toutefois, gagné la bataille des images, et c’est important vis-à-vis de l’opinion publique locale et internationale. On connait, selon le slogan d’un célèbre magazine parisien, « le poids des mots, le choc des images ». Les photos et les films de policiers chargeant des manifestants, s’emparant d’urnes ou empêchant des électeurs « d’accomplir leur devoir » sans ménagement aucun, - mais connait-on une police qui agirait avec des « gants de velours ?-, ont tourné en boucle ce même dimanche 1/10 tant sur les réseaux sociaux que sur les chaines d’informations en continu. A noter que les membres des forces de l’ordre étaient surtout des Gardes civils ou des policiers nationaux rameutés de tout le pays,- pour la petite histoire logés sur des bateaux en rade de Barcelone, les hôtels étant complet ou refusant de les héberger !-, plutôt que des hommes appartenant à la police régionale, les Mossos d’Esquadra (1). Manque de confiance, risque de collusion, mauvaise volonté dans l’exécution des ordres ? Sans doute un peu tout cela mon général !
Madrid ne peut pas accepter un précédent qui ferait éclater l’Espagne !
Après la chute du régime franquiste par la disparition de son fondateur Francisco Franco Bahamonde, lequel avait assuré pendant presque quatre décennies la stabilité dans un pays ravagé par la guerre civile de 1936 à 1939, l’introduction d’un régime démocratique « à l’occidentale » qui se substituait à «celui de la « démocratie organique », permettait aux provinces espagnoles d’accéder à l’autonomie interne. Avec, toutefois, des statuts différents et un degré de compétences variable d’une région à l’autre, Galice, Catalogne et Pays Basque étant en pointe en raison, d’abord, de leur langue locale . Mais est-ce à dire que chaque peuple ayant un idiome, un dialecte, voire une langue spécifiques, aurait automatiquement le droit d’accéder à l’indépendance ? Dans ce cas ce n’est pas 194 pays membres que compterait l’Organisation des Nations Unies, mais mille, deux mille, trois mille et plus ! Rien que l’Inde et la Suisse, cette dernière n’étant qu’observateur à l’ONU, auraient respectivement droit, alors, à 18 et 4 sièges, un par « Etat linguistique » ! Et que dire de la Russie ou du continent africain ! Le morcellement des Etats-Nations en diverses entités politiques n’est pas sérieux, c’est même un facteur dangereux de divisions entre les peuples et un encouragement donné aux forces de la finance mondiale prêtes à s’emparer d’entités au format plus modeste, donc plus faibles à résister. Déjà, « on » nous dit que l’union des pays européens est une nécessité vitale pour pouvoir faire face à la concurrence des grands empires, Inde, Chine, Etats-Unis, Russie, alors que penser de micro Etats, même si, dans le cas catalan, nous avons à faire face à un « pays » de 7 millions d’âmes grand comme la Belgique ? L’Espagne est un vieux pays d’Europe, qui s’est un peu construit comme la France, autour d’un noyau central – Madrid et la Castille – par la volonté d’une dynastie. La volonté d’union du peuple espagnol ne fait aucun doute et même les résidents de Catalogne ne sont pas unanimes derrière la meute séparatiste du Président du gouvernement régional, Carles Puigdemont. Les sécessionnistes, regroupés au sein d’une coalition « Ensemble pour le Oui » » qui va des extrémistes de gauche d’Esquerra républicana aux « modérés » de la droite et du centre de Convergence et Union (CIU), totalisent 83 sièges sur 135 au Parlement de Catalogne, un vaste bâtiment à la façade rose ajourée d’arcades. L’opposition ou « unionistes » est composée de représentants des partis nationaux traditionnels, Parti populaire de Mariano Rajoy, Parti socialiste (PSOE) et les centristes libéraux/libertaires de Ciudadanos. Un sondage réalisé en novembre 2016 par l’institut CEO donnait 44,9 % de Oui, 45,1 % de Non et 10 % d’indécis. Un mois plus tard, l’écart se creusait encore un peu plus entre les « séparatistes » et les « unionistes ». La vérité nous oblige à reconnaitre que, juridiquement, le gouvernement de Madrid est dans son droit, la loi espagnole ne prévoyant pas de référendum « d’autodétermination » pour ses provinces. Les autorités catalanes, par ailleurs, n’ont pas facilité la publicité en faveur du Non, favorisant exclusivement la propagande pour le Oui. Elles ont même placardé des affiches représentant le général Franco disant « ne votez pas le 1eroctobre » ou « Non », pensant s’en servir comme d’un repoussoir. Il y eut même ici, en France, sur les ondes de la chaine « C News » le samedi matin 30 septembre, la curieuse prestation de l’ambassadeur d’Espagne présentant face aux caméras une photo du même général remettant un trophée au Barça, le club sportif catalan qui est, on le sait « mas un club », « plus qu’un club », une véritable institution à Barcelone. Pour « culpabiliser » les Barcelonais ? Les résultats, plus ou moins 90 % de votes positifs à l’heure où ces lignes sont écrites, ne sont absolument pas le reflet de l’opinion catalane, la consultation s’étant déroulée dans les conditions que l’on sait, et les partisans du Non l’ayant boycottée. Cette consultation ne peut avoir aucune valeur juridique. Si Madrid entrebâillait la porte pour ce type de « plébiscite », la péninsule risquerait de voler en éclat et la démocratie représentative avec l’armée, la Guardia civil et toutes les forces hispaniques centralisatrices ne l’accepteraient pas.
La Catalogne pourrait-elle vivre toute seule ?
On a soulevé l’hypothèse d’une déclaration unilatérale d’indépendance par le Parlement régional et, dans la foulée, celle de la « République ». D’abord cet Etat ne serait pas reconnu par ses voisins immédiats ni par les autres partenaires de l’Union européenne. Quant à l’économie catalane si florissante parait-il, n’oublions pas que ces 4 provinces du nord-est de l’Espagne ont une dette de 7,5 milliards d’Euros, soit 35,7 % du PIB, et que ce nouveau « pays » importerait plus qu’il n’exporterait. (Si ses frontières n’étaient pas bloquées par les pays voisins, comme celles du Kurdistan le sont et qui est un peu dans le même cas par exemple, par rapport au pouvoir central) .L’Eldorado catalan n’est pas aussi brillant que ses « thuriféraires » veulent bien le dire, le taux de chômage est tout de même de 14,85 %, et nombre de capitaines d’industrie songeraient à s’exiler en cas de séparation avec l’Espagne. Les indépendantistes démontrent leur indéniable force populaire avec la grève générale et la floraison de drapeaux rouges et jaune qui émaillent les cortèges. Mais la majorité – ou minorité ? – silencieuse ne descend pas forcément dans la rue, même si, ici ou là, des patriotes espagnols ont courageusement exprimés leur refus d’un divorce.
Un référendum peut en cacher d’autres
En Amérique du Nord, les Québécois se sont exprimés déjà deux fois sur leur « souveraineté-association ». La majorité des électeurs, dans les deux cas, ont dit non à la séparation d’avec le reste du Canada. En Ecosse aussi, le peuple s’est prononcé sur la sortie du Royaume-Uni, là aussi pour dire Non. Il y a une étonnante caractéristique qui réunit tous ces partis : ils sont, dans leur ensemble, de tendance social-démocrate et résolument immigrationnistes. Le Parti Québécois ne considère-t-il pas qu’est Québécois tout résident parlant le Français ? Madame Sturgeon à Edimbourg, leader du SNP et Premier ministre local, considère également qu’est Ecossais tout habitant de l’Ecosse et les « rebelles » catalans ne se félicitent-t-ils pas d’avoir 500 000 musulmans sur leur sol ? On est loin du sentiment identitaire qui devrait caractériser, logiquement, tous ces mouvements séparatistes. Toutes ces entités provinciales européennes, comme l’Ulster, la Flandre, la Wallonie ou les régions italiennes à statut spécial, bénéficient d’une large décentralisation et d’une capacité à se gouverner elles-mêmes dans de nombreux domaines. Tout peut être amélioré dans le sens d’une plus grande autonomie encore, mais il est une ligne rouge à ne pas franchir. C’est ce que les multiples partis ou organisations séparatistes refusent d’admettre, à commencer, chez nous, par les ultra-minoritaires partisans d’un Etat corse. Il existe au septentrion de l’Europe un archipel tranquille, qui flotte entre ciel et mer, qui aurait pu être au début du XIXème siècle le prétexte à une guerre terrible entre la Suède et la Finlande naissante. La sagesse et le pragmatisme l’ont emporté. Les populations suédoises de l’archipel des iles Åland ont été politiquement rattachées à la Finlande, mais les Alandais jouissent d’une autonomie totale dans TOUS les domaines, à l’exception de la monnaie, des affaires étrangères et de la défense. Dans les Caraïbes, le statut de Porto-Rico est également à méditer : l’ile a toujours refusé l’indépendance tout en souhaitant rester associée au grand frère américain. Bien plus loin encore, les iles Cook dans l’océan Pacifique sont heureuses de leur statut d’Etat associé à la Nouvelle-Zélande. Toute disposition permettant à un peuple de réaliser pleinement son d’identité tout en respectant l’intégrité d’un cadre national, est la bienvenue. Cela nous entraine bien loin de l’Espagne, certes, mais ne serait-ce pas une piste pour solder, par exemple, le dossier néo-calédonien ?
Note
(1) Force créée en juillet 1983 dont l’origine historique remonterait au XVIIIème siècle. Ses 17 à 18 000 hommes assurent les fonctions d’une police civile classique – circulation, enquêtes criminelles, protection. Elles ne se substituent pas, toutefois, à la police nationale ou à la garde civile qui restent les piliers policiers de l’Etat espagnol.
http://synthesenationale.hautetfort.com/