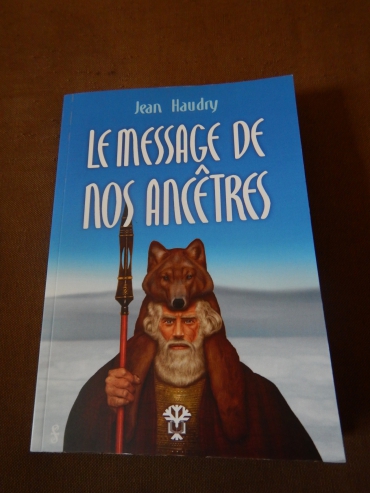Alors que les rixes se succèdent, la situation dans les camps de la région devient intenable, selon la police.
L'ambiance était tendue à Calais, elle devient explosive. Selon une note remise jeudi dernier au syndicat de police Alliance (majoritaire chez les gardés et gardiens), le nombre de migrants au camp de la Lande, baptisée la «jungle», «devrait atteindre les 10000 d'ici à début septembre». Les chiffres des associations humanitaires, qui évoquaient 9000 personnes (4500 en juin), sont maintenant dépassés par les propres estimations des forces de l'ordre.
Et encore ne s'agit-il que des migrants de Calais, car si l'on compte le camp de Grande-Synthe, près de Dunkerque, et les multiples implantations sauvages dans plusieurs agglomérations côtières, ce sont au moins 12000 déracinés qui se concentrent dans la région, dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne.
Pour le secrétaire général d'Alliance, Jean-Claude Delage, «il y aura bientôt tellement de gens dans la “jungle” que chaque jour qui passe rend plus périlleuse une évacuation en masse.» D'autant qu'il faudra reloger la plupart de ces personnes. Le gouvernement a annoncé cet été vouloir faire passer le nombre de places dans des «centres d'orientation» ailleurs en province de 2000 à 5000. Mais les 3000 places supplémentaires promises n'existent, pour l'heure, que sur le papier.
Expulser les indésirables? Ceux qui ne répondent pas aux critères de l'asile, les migrants économiques donc, sont une majorité dans les camps concernés. Ils ont, en principe, vocation à partir. Mais voilà: dans le Pas-de-Calais, alors que les arrivées n'ont jamais été aussi importantes, les éloignements exécutés par les services de la Police aux frontières (PAF) ont diminué. Entre le 1er janvier et le début du mois d'août, à peine plus de 1100 illégaux ont été expulsés, soit une baisse de 4% par rapport à la même période de l'année précédente. Dans le même temps, dans le Nord, pour un total de 450 expulsions environ, il n'y a que sept éloignements de plus… en sept mois.
Xavier Bertrand, le président les Républicains du conseil régional des Hauts-de-France, le regrette: «Le gouvernement n'a que trop tardé.» Lui assure ne «plus rien attendre» du trio exécutif Hollande-Valls-Cazeneuve. Car au-delà même de l'évacuation éventuelle du camp de la Lande et de ses ersatz, il convient, selon lui, de renégocier les accords du Touquet qui obligent la France à jouer les gardes-frontières pour le compte des Britanniques, moyennant quelques compensations financières. «Un marché de dupes !», proteste-t-il.
Selon la note du syndicat de police Alliance, dans l'urgence, pour faire face aux assauts répétés des migrants qui tentent de monter dans les camions sur les axes routiers comme l'A16, la Place Beauvau a fait passer à Calais le nombre de compagnies de CRS de 8,5 à 10,5, soit environ 150 hommes de plus. «La Sécurité publique est très souvent employée sur la problématique migrant et non pas sur son cœur de métier et cela se ressent sur le quotidien», estiment les auteurs de la synthèse d'Alliance qui affirment que «les chiffres de la délinquance sur Calais explosent.»
«Une zone de non-droit»
À les lire, «le camp n'est absolument pas contrôlé». Il «est devenu une zone de non-droit, aucun collègue ne peut y pénétrer la nuit. Seule une entrée est contrôlée par lecteur optique et identification, là où des mobil-homes sont implantés.» Une sécurité minimale pour «1500 migrants seulement», constatent-ils. L'idée d'un «couvre-feu» réclamé par Xavier Bertrand semble leur convenir. «Pourquoi pas?», écrivent-ils. Et d'ajouter: «Il est de notoriété publique que les migrants sont instrumentalisés par des activistes, tels les Black Blocs ou les No Borders, connus et identifiés par les collègues». La plupart, selon eux, sont «membres d'associations d'origine anglaise».
Depuis fin juillet, deux migrants sont morts lors de rixes. Les délégués d'Alliance le redoutent: «Il va y avoir d'autres morts.» Ainsi, «dans la nuit du 22 au 23 août, une rixe a éclaté entre 400 Afghans et 400 Soudanais, faisant un mort et six blessés graves.» Conclusion: «Le ras-le-bol des Calaisiens et des commerçants est palpable. L'économie, le tourisme s'en ressentent, les policiers ont l'impression de ne servir à rien.»
Cette inquiétude est partagée par tous les syndicats de policiers. L'Unsa-police, bien implantée chez les CRS, confirme qu'«en quelques semaines, le nombre de repas servis au camp de la Lande a augmenté de 30%». Or tous les migrants ne se signalent pas aux autorités.
Denis Hurt, le délégué zonal de cette organisation syndicale, révèle qu'«une vingtaine de migrants parvient à passer chaque jour en Angleterre». Et pourtant, selon lui, «ce n'est visiblement pas l'eldorado tant espéré, puisque certains reviennent.»
À Calais, la police se prend à rêver qu'une solution se dessine avant l'automne. Car c'est la nuit que les migrants les plus décidés passent à l'action. «Quelques usagers de la route ont déjà été pris à partie», confie Denis Hurt. Or, dans quelques semaines, la nuit sur le Calaisis tombera beaucoup plus tôt, aux heures de sortie de travail. Des confrontations plus fréquentes sont à craindre.