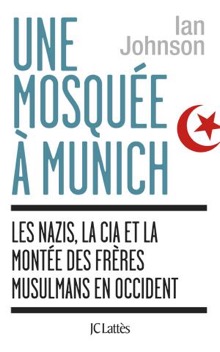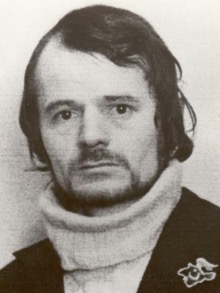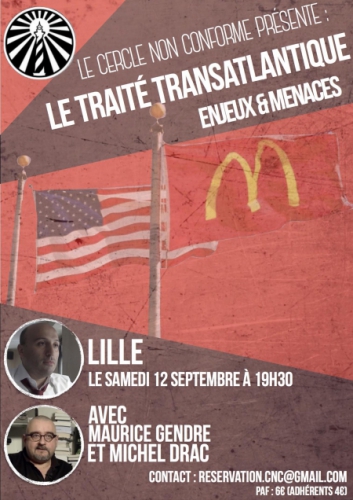En Europe, c’est l’été
L’été règne sur toute l’Europe, de la Grèce jusqu’à la Suède. Les vacances ont vidé les bureaux, et rempli les plages. Des fleurs partout, des fleuves de parfums. Des festivals sans fin, des performances et autres installations artistiques agrémentent les anciennes cités désuètes. Mais ça ne se passe pas comme d’habitude. Le vieux continent est malade. La vie est belle, mais pas pour vous. Les bonnes choses vous passent sous le nez, et le chômage est au plus haut.
L’austérité pour tous sauf les banquiers et les politiques corrompus, c’est le mot d’ordre. La protection sociale rétrécit, mais les budgets militaires grossissent, et l’Otan n’en finit pas de s’étendre. En dehors de l’Allemagne, les pays européens membres sont désindustrialisés, leurs travailleurs perdent leur savoir-faire et finissent dans les services. Un caddie de golf risque moins de créer des problèmes qu’un ouvrier de l’industrie, certes. La démocratie n’est jamais tombée aussi bas.
Après la débâcle Syriza, en Grèce, on ne fait plus guère confiance à la rhétorique gauchiste. De toute l’histoire moderne européenne, on n’avait jamais vu une reddition aussi honteuse, une telle trahison. « Alexis Tsipras » est une traduction grecque de « Vijkum Quisling », ou « Maréchal Pétain ». Il a reçu le plein soutien de son peuple, et il s’est dégonflé ! La première décision de Syriza après son fiasco a été d’entamer une coopération militaire avec Israël. Aube Dorée, le mouvement d’extrême-droite, n’est plus seul à clamer contre cet abaissement devant les banquiers, mais c’est un parti dans l’opposition, et il ne risque rien à pousser des coups de gueule.
Les partis de gauche et de droite sont maintenant bien semblables. L’Europe n’a plus ni vraie droite ni vraie gauche. La pseudo gauche soutient les guerres impérialistes et émascule l’homme. La pseudo droite soutient les guerres impérialistes et supprime les impôts pour les riches. C’était plus drôle avec les partis traditionnels, avec la droite qui haïssait les financiers et maintenait la tradition, l’Eglise et la famille, tandis que la gauche attaquait la bourgeoisie, se souciait des travailleurs, et se battait pour la justice sociale. Dans les termes de Douglas Adams, « les hommes étaient de vrais hommes et les femmes de vraies femmes, et les petites bestioles fourrées d’Alpha du Centaure de vraies petites bestioles fourrées d’Alpha du Centaure. » Maintenant tous poussent les femmes dans les conseils d’administration des multinationales, se disputent les donations juives et rivalisent de risettes pour se faire bien voir des gays.
Sur des questions importantes, c’est du pareil au même, comme disait, perspicace, ma logeuse chinoise. La gauche veut plus d’immigration, pour des raisons humanitaires et par antiracisme, tandis que la droite est d’accord, pour avoir une main d’œuvre moins chère et pour forcer les natifs à plus de docilité. Le résultat est le même.
Les gens qui se voient menacés par l’immigration votent souvent pour la droite, parce qu’ils pensent qu’une petite dose de racisme débouchera sur de réelles actions. Mais c’est en vain. Prenez Nicolas Sarkozy, ex-président français. Il flatte son électorat avec une ligne raciste, mais c’est lui qui a bombardé la Libye et envoyé plus d’immigrants en France qu’aucun gauchiste ne l’a jamais fait. A moins, bien sûr, que le président actuel François Hollande ne parvienne à le surpasser, puisque son soutien aux rebelles syriens a déjà envoyé un million de réfugiés en Europe.
Au Royaume Uni, Tony Blair a détruit le parti travailliste. Il a fait du vieux parti des ouvriers et des mineurs des éclaireurs des tories. Il a soutenu absolument toutes les campagnes militaires US et y a gagné le titre honorable de caniche britannique. Favori d’Israël et du lobby israélien, c’est un autre de ses titres de gloire. Il n’est plus au pouvoir, mais ceux qui le soutenaient dans son parti sont toujours là. Et ils continuent à perdre…
Les travaillistes voudraient que ce soit Jeremy Corbyn qui soit leur chef. Blair le déteste, ce qui est sûrement une excellente recommandation. On s’attend à ce qu’il soit un nouveau Michael Foot, qui était un grand homme à l’ère pré-thatcherienne. Il veut le désarmement nucléaire, il a parlé en termes positifs du Hamas et du Hezbollah, il a voté contre la Marche vers l’Est des guerres américaines. Littlewood l’a appelé « l’antidote à l’emprise sioniste ». Il pourrait changer la donne, s’il parvenait au pouvoir. Mais les autres vont le maintenir à l’écart, parce que les gens qui sont derrière les partis préfèrent des politiciens faibles et perméables.
Le parti d’extrême-droite BNP se veut l’héritier des vrais travaillistes. Ils disent que les ouvriers anglais votent pour le BNP. Ce qui ne manque pas d’un certain fondement. Car la vraie gauche, qu’il s’agisse de la variété chinoise, soviétique ou cubaine, était strictement anti-immigration. Mais l’immigration n’est qu’une question parmi d’autres, alors que le BNP a rétréci son horizon pour ne développer qu’une politique antimusulmane. Ils n’essayent même pas d’affronter le vrai problème, qui est la richesse démesurée de quelques uns, édifiée sur l’appauvrissement de vastes majorités.
Le Front national en France a des côtés plus reluisants, et plus de soutiens. En fait, le FN est probablement le seul parti bien vivant en France, les autres sont morts. Il veut sortir la France de l’Otan et de l’Union européenne, pour retrouver l’amitié avec la Russie et la souveraineté nationale. Leur arrivée à l’Elysée changerait bien des choses en Europe, mais cela arrivera-t-il un jour ? [L'auteur doit ignorer que la ligne politique de Marine le Pen n'est pas si différente, au sujet d'Israël notamment, des autres grands partis - Ndlr]
Le grand problème de l’Europe, c’est l’occupation américaine. Elle est là, la source des problèmes. En 1945, le continent a été partagé entre US et URSS. En 1991, les Russes se sont retirés, mais aucune liberté ne s’en est suivie : ce sont les US qui ont pris la place, occupant toute l’Europe, depuis Narva en Estonie jusqu’à Oeiras au Portugal, depuis la Baie de Souda en Crète jusqu’à Orland en Norvège. Sur ces fondements militaires, ils ont renforcé la pression politique. Et leur joug pèse sur les pierres grises de la vieille Europe. Les mesures qu’ils forcent les dirigeants européens à prendre nuisent au continent. Les dirigeants prennent les mauvaises décisions, et c’est le peuple qui trinque.
L’Europe avait un excellent client pour sa production. La Russie lui achetait machines-outils, fromages, vins et voitures, et fournissait du gaz et de pétrole à bon marché. Les US ont mis fin à ces échanges profitables. Et maintenant les Européens bradent leurs pommes et leurs fromages, dépensent plus en achats militaires, et importent du gaz américain cher.
L’Europe avait un ami quelque peu excentrique, Kadhafi le colonel à la retraite. Il vendait du pétrole bon marché, importait des marchandises européennes pour sa petite population prospère, et donnait du travail à des millions d’Africains. Sous la houlette US, l’Otan a bombardé la Libye, sodomisé le colonel avec un flingue, l’ont lynché, et ont anéanti son pays. Les Africains déferlent, depuis, en Europe, sur tout ce qui peut flotter sur mer.
L’Europe pouvait compter sur l’amitié de l’ex-ophtalmologiste de Londres, qui était à Damas. Il y ramenait des marchandises européennes, gardait son pays à flot, fréquentait Paris. Sous la direction US, cet homme aimable s’est vu traité de « génocideur », et ils ont armé ses ennemis, les takfiristes fanatiques. Son pays a été dévasté et des millions de réfugiés syriens ont fui en Europe.
Ils y ont retrouvé les irakiens, dont le pays a été ruiné par l’invasion US de 2003. Le pays le plus avancé du Proche Orient, avec un système d’éducation et de santé gratuites, avec les meilleurs ingénieurs et une armée solide, est devenu un nid de bagarres sectaires, tandis que des millions d’Irakiens rejoignaient l’Europe. Les Afghans, Palestiniens, Arabes, Africains se retrouvent en Europe, s’ils parviennent à échapper au poing d’acier qui écrase leurs pays.
Mon ami Roger van Zwanenberg, éditeur de la maison Pluto, estime que l’effroyable dévastation du Proche Orient du fait des guerres commandées par les US s’explique par l’influence sioniste et correspond au souhait israélien de voir la région fragmentée et soumise dans le cadre du paradigme d’un Grand Israël du Nil à l’Euphrate.
C’est tout à fait plausible, si on garde à l’esprit la scène récente de Netanyahu devenu objet de vénération au Congrès US. Les promoteurs des guerres étaient principalement les néocons archisionistes, Wolfowitz, Perle et consorts. Ils ont poussé à l’invasion de l’Irak et voulaient en faire autant en Iran. Mais pourquoi ces mégalomaniaques borneraient-ils leurs rêves de suprématie au Proche Orient ? Pourquoi ne pas viser la domination mondiale ? S’ils veulent mettre en pièces les vieilles sociétés orientales, ils peuvent le faire aussi en Europe, et y mettre le paquet. L’Europe est bel et bien une victime du conflit. Sans ces guerres, les vagues d’immigrants ne recouvriraient pas l’Europe comme le Proche Orient. Par conséquent, quels que soient les commanditaires de ces guerres, ils ont probablement essayé de démolir l’Europe comme le Proche orient, et l’Europe était la plus importante des victimes visées, parce qu’il fallait lui briser la nuque, la faire rentrer dans le droit chemin de la domination mondiale. Et le Proche Orient n’est pas la seule source de réfugiés et d’immigrants.
Jadis, l’Union européenne était une union des Etats issus de l’empire de Charlemagne, et peut-être une idée qui se tenait. Mais les US ont pris le contrôle de Bruxelles et les ont forcés à accepter les Etats de l’Est européen, sous la coupe de dévots de l’Amérique furieusement anticommunistes. A l’intérieur de l’UE, les pays développés de l’ancienne union ont dévoré les pays périphériques moins développés. Les Etats baltes ont perdu environ un tiers de leur population ; la Lettonie est passée de 2,7 millions d’habitants à la fin de l’époque soviétique à 1,9 millions aujourd’hui, la Lithuanie est passée de 3,7 millions à 2,9 millions. La Roumanie, alors que la poigne d’acier de Nicolas Ceausescu l’avait libérée de ses dettes, se retrouve maintenant à nouveau endettée jusqu’au cou. Et les citoyens appauvris de tous ces pays se précipitent en masse dans les villes de l’Ouest.
Prenez le cas de la Suède. C’est l’été le plus froid depuis plusieurs années, en Suède. Le mois de juillet a été aussi frais qu’un mois d’avril, mais cela n’a nullement arrêté l’afflux des réfugiés. Devant chaque supermarché, chaque station de train ou de métro en Suède, depuis Kiruna jusqu’à Luind, vous tombez sur un mendiant rom avec une soucoupe en plastique à la main. Ils sont venus de Roumanie et de Hongrie, les Etats qui font partie de l’UE, qui ont certes un niveau de vie assez bas, mais qui appartiennent à l’espace Schengen, ce qui les dispense de visa. Ils ne sont pas venus de leur plein gré, mais ont été expédiés par leurs barons qui se sont construit de grands châteaux dans le plus pur style tzigane tape-à-l’oeil, sur la redevance que les mendiants leur versent. Après trois mois à battre le pavé suédois, ils rentrent chez eux, remplacés par d’autres arrivages de mendiants.
La police suédoise n’interfère pas avec ces mendiants. Ils disent qu’il n’y a pas de loi pour chasser les gitans. Ils ont peur de se voir condamnés pour racisme s’ils le faisaient. Les romanichels sont hauts en couleur, hommes et femmes, âgés ou plus jeunes, et ne sont jamais plus que deux à chaque emplacement. La logistique ne peut pas être facile, avec tant de gens à répartir si uniformément, mais les barons roms savent s’y prendre : je n’ai jamais observé de bagarre, ou même d’altercation, entre les mendiants. Ils ont même été entraînés à sourire ; quelque chose que vous ne verrez jamais en Europe de l’Est, où les mendiants sont aussi sinistres que les immeubles des années 1950.
Les réfugiés de Somalie et du Soudan, victimes des interventions US précédentes, ne mendient pas. Ils se regroupent dans des villes suédoises plus petites ; l’Etat suédois paye pour leur hébergement et leur donne quelques subventions pour vivre. Ils ne sont pas autorisés à travailler, et de toute façon personne n’a besoin d’eux comme ouvriers. Ils restent là, simplement, en attendant que leurs demandes d’asile aboutissent, généralement sur un refus. Après quoi ils disparaissent des radars.
Mais ne versez pas trop de larmes sur les Suédois. Les tauliers se font beaucoup d’argent dans ce système de même que les fonctionnaires. L’Etat suédois paye 500 couronnes (50 euros) par nuit et par chambre. C’est une excellente affaire dans les petites villes reculées. Habituellement, l’Etat préfère des hôtels avec beaucoup de chambres à offrir, et ils renvoient l’ascenseur au fonctionnaire chargé de l’hébergement. Curieusement, un individu considéré comme le plus ouvertement raciste de toute la Suède, qui se bat contre l’immigration, a fait des profits rondelets avec l’hébergement des Somaliens ; il s’appelle Bert Karlsson.
Outre les réfugiés et immigrants fournis par les guerres US et l’élargissement de l’UE dicté par les US, la Suède et les autres pays de l’Ouest se trouvent minés par la campagne, en provenance aussi des US pour réorganiser la vie en termes de gender. Il y a peu d’enfants ; des écoles ont été fermées, les gays ont absolument tous les droits ; les femmes sont prioritaires pour les emplois. Les garçons ont moins d’opportunités : depuis les chaînes publiques de télé jusqu’aux coiffeurs, les emplois sont pris par les femmes. Les prêtres de l’église suédoise sont principalement femmes ; l’Etat choisit et rémunère les évêques connus pour leur soutien au sacerdoce féminin.
« La Suède est l’Arabie saoudite du féminisme », a conclu Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, bouclé pour la troisième année consécutive à l’ambassade d’Equateur à Londres ; C’est un expert en la matière : deux petites Suédoises avaient porté plainte pour viol, simplement parce que dans le cadre d’une relation pleinement consentie, elles avaient eu un rapport sexuel non protégé. La procureuse Marianne Ny a dit qu’en de tels cas, l’homme doit faire de la prison, même s’il s’avère qu’il était innocent. La Suède a le taux de plaintes pour viol le plus élevé au monde, et le taux le plus élevé de plaintes fallacieuses pour viol rejetées. Ce qui ne fait pas la promotion de l’amour entre personnes de sexe opposé.
L’éducation fait tout ce qu’elle peut pour émasculer les hommes, et les splendides Suédoises préfèrent souvent des mâles étrangers plus masculins (je le sais, étant précisément un mâle étranger basané et moustachu qui plus est, j’avais épousé une ravissante Suédoise il y a bien longtemps). Les Suédois se marient de moins en moins, et ont de moins en moins d’enfants, malgré les aides gouvernementales très généreuses.
Bien des observateurs conservateurs accusent les féministes. Même si les hommes ont certainement perdu la guerre, la victoire des femmes ne résiste pas à l’examen. Jadis les femmes avaient le choix : rejoindre le monde des gens très occupés ou rester à la maison avec les enfants. Jadis, les femmes pouvaient élever une famille sans se sentir coupables. Jadis les femmes pouvaient aimer être courtisées. Tout ça c’est fini, la dévirilisation des hommes a rapidement entraîné la déféminisation des femmes.
Il y a un sous-entendu commun aux tenants du pouvoir : c’est que les hommes féminisés sont plus faciles à contrôler, et c’est pour cela qu’ils encouragent l’homosexualité. Déviriliser l’homme est un pivot dans la reprogrammation de l’humanité pour qu’elle devienne horde obéissante, parce que les hommes entiers sont imprévisibles. Ils sont prompts à la rébellion, prêts au sacrifice et à l’action. Ce n’est pas une coïncidence si les ennemis de l’empire sont tous des mâles très virils, qu’il s’agisse de Kadhafi, de Castro, de Chavez, de Loukachenko, de Poutine, ou de Julian Assange. Tout devient clair : les hommes sont ciblés pour l’élimination, et les fourmis au travail n’ont pas besoin de sexe.
Les Suédois ont le culte des « blacks », qui vient aussi des Usa, à en croire Rachel Dolezal, la militante blanche pour les droits des noirs qui se faisait passer pour noire. Les noirs sont censés être meilleurs et plus beaux que les blancs. Dans le film Terminator, c’est un savant noir qui invente le truc merveilleux ; il se bat aux côtés de la guerrière blanche contre les méchants hommes blancs. Morpheus, noir, dans Matrix, est un opérateur de Zion, et il sauve la race humaine. Il y avait un président noir dans Le Cinquième Elément, avant Obama. Bien des Suédois en manque d’enfants ont importé des enfants noirs et asiatiques, autre ligne culturelle instaurée par Angelina Jolie. Ce racisme à l’envers n’est pas différent de la variété ordinaire. Les noirs sont des gens très bien, mais nullement meilleurs que les Suédois roses.
Les Suédois ordinaires sont malheureux. Dans une petite ville avec un haut pourcentage de réfugiés et d’immigrants, ils sont 40% à voter pour le parti d’extrême droite, les Démocrates suédois. Ils sont 12% à l’échelle du pays malgré une campagne féroce contre eux dans les médias.
La gauche a obtenu une majorité relative des sièges au Parlement, après des années de droite au pouvoir. Après l’élection, les gauche et droite officielles ont uni leurs forces sur un programme commun dans le seul but de maintenir les Démocrates suédois en marge, ostensiblement. Les électeurs de gauche se sont sentis bernés. Pourquoi s’en faire et pourquoi voter, si le résultat, c’est un arrangement entre les partis ?
Ne versez pas une larme sur le sort des Démocrates suédois non plus. Il y a un timide parti pro-sioniste dont l’action la mieux connue en matière politique a été d’installer une parade gay dans un quartier musulman. Ils s’extasient devant l’Etat juif, comme leurs frères dans les autres pays d’Europe. Ils acceptent l’emprise de l’idéologie gender, qui est le programme du nouvel ordre mondial. Ils sont contre les immigrants et les réfugiés, mais jamais contre ceux qui envoient les vagues déferler sur la Suède. Au contraire, ils soutiennent le régime de Kiev, bande de bâtards à la botte des néocons, et détestent la Russie comme se doit de le faire tout défenseur du Nouvel Ordre Mondial.
Voilà pourquoi il est bien difficile de voir d’où pourra venir la libération du continent, et si même il en est encore question.
Israël Adam Shamir
Article initialement publié dans Unz Review.
Traduit par Maria Poumier le 17/08/2015
Lire également: http://arretsurinfo.ch/chaos-au-moyen-orient-objectif-voulu-ou-erreur-politique/
Arrêt sur info n’est pas tenu pour responsable des déclarations inexactes ou incorrectes contenues dans les articles publiés
Source: http://plumenclume.org/blog/30-en-europe-c-est-l-ete-par-israel-adam-shamir
http://euro-synergies.hautetfort.com/