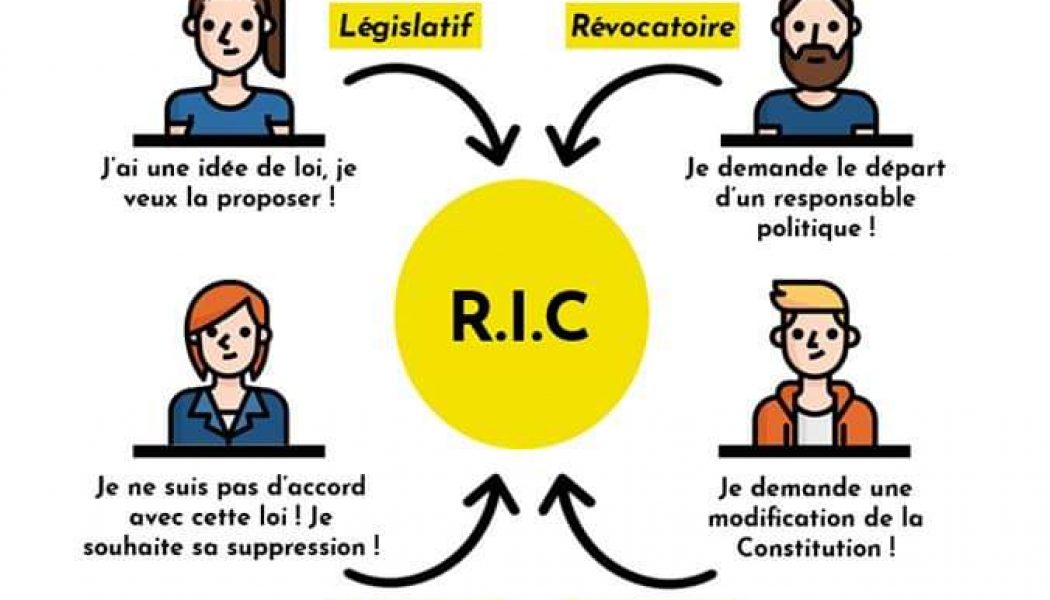Courte mais spectaculaire, la révolte des gueux vêtus de jaune a été clairement récupérée par les discours d'extrême gauche. Autant dire qu'elle a été détournée par les pires ennemis de la cause initiale, celle-ci étant au départ dirigée contre le fiscalisme et la technocratie.
Courte mais spectaculaire, la révolte des gueux vêtus de jaune a été clairement récupérée par les discours d'extrême gauche. Autant dire qu'elle a été détournée par les pires ennemis de la cause initiale, celle-ci étant au départ dirigée contre le fiscalisme et la technocratie.
Reste qu'elle a manifestement ébranlé le pouvoir de Jupiter. En ce 20 décembre, même Le Monde et Le Figaro, usant de rhétoriques fort distinctes, tombaient d'accord pour souligner aussi le déphasage entre le chef de l'État et le Premier ministre[1]. Ce dernier n'en finit plus de paraître vivre ses derniers jours en l'Hôtel Matignon.
Chacun perçoit en effet l'éloignement des discours tenus par les deux hommes, leur différence de comportement et parfois même, en moins de 24 heures, le renversement de leurs annonces de décision.
Or, ceci souligne aussi les contradictions entre le texte et la pratique de la Constitution de 1958.
On ne doit pas trop s'en étonner. La plus interminable de nos républiques, la Troisième, avait duré quelque 70 ans[2], dominée par un personnage, le président du Conseil qui n'était même pas cité dans les trois lois constitutionnelles adoptées en 1875.
Depuis 60 ans, la Cinquième république fonctionne, de ce point de vue, comme un patchwork d'additions peu cohérentes au gré de réformes accidentelles.
On doit donc rappeler les circonstances, largement oubliées, dans lesquelles le projet fut écrit.
En juin 1958, le général De Gaulle avait reçu, de la chambre des députés, par 322 voix contre 232, les pleins pouvoirs pour une durée de 6 mois. Il s'agissait d'élaborer un texte respectant les prérogatives du parlement. Le général présida donc quelque temps le dernier gouvernement de la Quatrième république. Celle-ci avait été démonétisée, certes de façon cruciale par les événements d'Algérie[3]. Ce drame national avait pris le relais des humiliations de Dien Bien Phu et de Suez. Mais le régime se trouvait également paralysé par les conséquences de la représentation proportionnelle. Les partisans du retour à un tel mode de scrutin ont perdu de vue les conséquences funestes qu'il engendra en termes de règne des partis, d'instabilité gouvernementale et d'abaissement du pays.
La rédaction du projet fut confiée à Michel Debré. Et la nouvelle constitution permit à son idole de gouverner, pendant 11 ans. Mais De Gaulle aurait pu la France sans ce texte et même sans la réforme de 1962 organisant l'élection du chef de l'État au suffrage universel.
L’écartèlement du texte constitutionnel s’exprime d’abord par ses articles 20 et 21 : ils caractérisent, sur le papier, un régime parlementaire, conformément aux pleins pouvoirs votés en juin 1958. Fictivement, le Premier ministre dirige. Et en contrepartie une foule de dispositions renforcent le rôle pratique du président. Tant que Michel Debré siégea à Matignon, les apparences furent ménagées. Il n'hésitait pas, en sa qualité de chef du gouvernement, à se faire donner de la Marche Consulaire de Marengo, tout en restant religieusement fidèle au chef de l'État. Mais à partir de 1962, hormis la parenthèse du gouvernement Chaban-Delmas (1969-1972) le pouvoir fut toujours dominé par l'Élysée. La théorie de la cohabitation définie en 1985 par Balladur correspond précisément à cette contradiction.
Les successeurs du gaullisme, chacun à sa manière, ont déformé le texte hybride de 1958, toujours théoriquement parlementaire. Ils ajoutèrent une foule de dispositions aggravantes, y compris le quinquennat. Ils superposèrent les féodalités régionales, à partir de la loi Defferre de 1982, au mille-feuilles territorial. Ils multiplièrent par deux le périmètre de l'étatisme en lui adjoignant en 1996, du fait du plan Juppé, celui de la sécurité sociale. Ils ont réduit les collectivités territoriales à l'assistanat, faisant remonter toutes les décisions au pouvoir central. Le non-cumul des mandats imposé en 2014, acheva de couper les élus nationaux de leurs racines, de leurs responsabilités locales et donc de l'essentiel de leur représentativité.
Parallèlement toutes les dispositions vertueuses de 1959, qui avaient permis de rendre au franc son caractère de monnaie forte avaient été, une à une, balayées.
Le découplage entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne doit donc pas être vu comme l'opposition de deux personnalités mais comme la radicalisation de la crise dégénérescente d'une certaine conception du pouvoir exécutif.
JG Malliarakis
Apostilles
[1] cf. "Entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, la tension monte"
[2] Les dates posent curieusement problème : on peut faire remonter le caractère républicain du régime à la loi Rivet de 1873, adoptant le septennat, bien qu'elle fût votée par une assemblée majoritairement monarchiste. Les trois lois constitutionnelles datent de 1875. On n'est passé juridiquement de la Troisième à la Quatrième qu'en 1946, mais il est clair que le régime était historiquement mort en juillet 1940.
[3] Les historiens, et les polémistes, se sont longtemps passionnés quant aux intentions du général proclamant, le 4 juin sur le Forum d'Alger son fameux Je vous ai compris. Cette équivoque engendra bien des drames, bien des engagements de notre jeunesse y compris ceux du rédacteur de ces lignes.