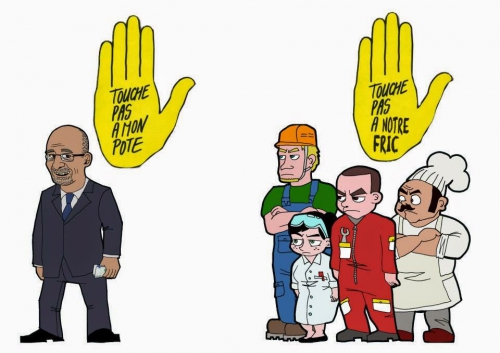Collaborateur régulier aux sites dissidents Europe Maxima, Euro-Synergies et Synthèse nationale, Claude Bourrinet est un penseur impertinent. C’est aussi un remarquable biographe. Vient de paraître sous sa signature un excellent Stendhal dans la collection « Qui suis-je ? ».
Henri Beyle (1783 – 1842) choisit le nom de plume de Stendhal. Il « n’était pas antimoderne, […], mais plutôt contre moderne. Fils de la Révolution, donc de la rupture, de l’arrachement, d’un certain déracinement, il prenait ce que la nouvelle ère proposait de mieux pour accroître sa puissance d’exister, sans en partager la vulgarité et la bassesse (p. 110) ». Toute son œuvre en témoigne comme nous le démontre avec brio Claude Bourrinet. Politiquement jacobin (républicain de salut public), Stendhal est surtout un admirateur de Napoléon. « Il voue à l’empereur un véritable culte, car il l’identifie à une France qui était encore grande. Napoléon “ fut notre seule religion ”, le plus grand conquérant après Alexandre et César, la restauration de l’Antiquité, un tyran italien chu dans un monde contemporain si minable, un aigle qui survole son temps par la pensée. Napoléon, c’est l’Italie, le bonheur (p. 42). »
Cette admiration envers le vainqueur d’Austerlitz se comprend aisément. « L’existence, pour Stendhal, est une dynamique, une énergétique. Quelle que soit la source de la puissance, l’excès et la surabondance affirment la sensation de vivre (p. 22). » Si « le beylisme est un vitalisme (p. 56) », c’est en outre « un aristocratisme, un “ espagnolisme ”, ennemi irréductible de la société de masse et de la modernité dévorante. Le courage froid de ne pas mendier la reconnaissance collective est plus précieux que celui, furieux, du champ de bataille (p. 55) ». On est très proche du Napoléon, « professeur d’énergie », dans Les déracinés de Maurice Barrès. Quelle aurait été l’influence de Stendhal sur Barrès, en particulier à l’époque du « culte du Moi » ? Une belle et riche étude en vue. Stendhal estime que « l’Empire, continuation de la Révolution offre la vision d’une communauté humaine centrée autour des vertus de sacrifice, d’émulation, de combat, de force, de patrie (pp. 42 – 43) ». Voilà pourquoi il est para-moderne puisqu’il tente une improbable conciliation entre les vertusenfantées par Napoléon et les valeurs sociales d’Ancien Régime.
Napoléon pour modèle d’être
« Stendhal a bien conscience, après la chute de l’Empire, que le temps n’est plus aux lauriers, mais aux travaux utiles, à l’économie, au commerce, au “ libéralisme ”, aux chambres des représentants, à la médiocrité bourgeoise, à l’égoïsme réducteur, à l’ennui. C’est la fin de l’honneur militaire, le temps du producteur, le règne de l’opinion (p. 42). » Il est évident que, pour lui, « la politique, d’abord, doit dominer l’économique. Avec Bonaparte, un Rothschild n’aurait pas été possible. Les lois institutionnelles sont indépendantes des exigences du commerce et de la bourse. En outre, ce qui présente véritablement une valeur humaine, sociale et politique, c’est justement ce qui échappe à la loi d’airain du travail et du besoin (pp. 81 – 82) ». Par conséquent, il considère que « le seul critère moral susceptible de souder la société autour de valeurs transcendantes est l’héroïsme, militaire, intellectuel, humain. En bon héritier de l’Empire, Stendhal choisit le rouge du dépassement de soi, de l’abnégation et du panache gratuit, contre le noir de l’argent, de la tartuferie et du moralisme (p. 82) ». Fuyant une société française d’après-guerre vile, il part pour l’Italie qu’il connaît bien et qu’il aime afin de retrouver un idéal d’humanité martiale. « L’Italie est le Sud fécondé par la sauvagerie barbare. L’idéal politique de Stendhal est la cité à dimension humaine, autogérée, libre et guerrière, adonnée aux arts et à l’esprit, audacieux, héroïque (p. 65). » Mais toujours garde-t-il à l’esprit l’exemple de Napoléon. D’ailleurs, « devenir napoléonien. S’étourdir quand il est nécessaire, se contraindre quand c’est utile, être toujours soi. Une bonne conduite suppose que l’on soit en même temps modeste et exigeant. Il s’agit de “ chevaucher le tigre ”. Les autres sont des objets, des cibles de mon intention, ou de mon attention, ou tout simplement des êtres indifférents. Le besoin existe de se lier avec eux, mais il faut pouvoir s’en défaire. Emprunter un lieu, une place, en visiteur, voilà la vraie politique. La tactique est une nécessité vitale (p. 47) ». Dans cette perspective, la vie italienne se révèle un parfait adjuvant. « La politique moderne était le jeu des opinions communes, donc une tendance à l’égalitarisme chloroformant par le consensus arithmétique, tandis que l’italianité est l’affirmation du Moi par la volonté, l’énergie et la force (p. 67). » Cependant, Stendhal « cherchera à se libérer de la politisation des rapports humains, qui infeste tout, y compris la vie privée. Cela étant, qu’est-ce que la modernité, sinon le sérieux et le ressentiment qui s’infiltrent partout ? (p. 25) ».
Contre l’industrialisme
Claude Bourrinet a le grand mérite de nous rappeler que Stendhal rédigea en 1825 un pamphlet de 24 pages contre l’« industrialisme » intitulé D’un nouveau complot contre les industriels. Il se montre aussi un très virulent contempteur de l’« Amérique, hyperAngleterre (p. 101) ». Il observe là-bas que « l’individualisme inquiet, qui doit sans cesse prouver sa légitimité, est la clé de voûte de cette société asociale de pionniers (p. 102) ». Bref, « le Nouveau Monde est devenu pour lui le danger le plus redoutable de l’homme différencié, c’est-à-dire de l’homme civilisé (p. 99) ». L’auteur de La Chartreuse de Parme remarque qu’il n’y a « aucun attachement à un terroir. Tout doit être converti en dollars. Il n’y a pas de paysan en Amérique, partant, pas de pays (p. 102) ». C’est au fond le choc frontal de deux visions antagonistes du monde. « Une modernité industrielle, conformiste, uniformatrice, morose, contre une autre modernité, romantique, subtile, passionnée, émancipée. La société américaine, dans son radicalisme utilitariste, essentialise les tares de l’industrialisme britannique par le biblisme (p. 100). » Stendhal paya chère cette altière attitude, lui qui juge qu’« être dissemblable, quitte à être dissonant, est un art, une culture, une ascèse, un abandon, un je-ne-sais-quoi. C’est être un homme (p. 85) », un homme appelé Stendhal ! Nul doute que le fin lettré que fut Maurice Bardèche aurait aimé ce livre.
Georges Feltin-Tracol
http://www.europemaxima.com/
"À la « une » de Charlie, feuille grassement subventionnée avec l’impôt de tous et largement publicitée médiatiquement, Marine Le Pen, Sarkozy et le pape sont débilement mais grossièrement insultés par un dessin les caricaturant en animaux canins.