
Le Conseil d’État a affirmé ne pas avoir eu le temps de «garantir au mieux la sécurité juridique» de la réforme des retraites, selon un avis publié le 24 janvier. L’institution déplore aussi les «projections financières lacunaires» du gouvernement et un recours aux ordonnances qui «fait perdre la visibilité d’ensemble».
Saisi le 3 janvier 2020, le Conseil n’a eu que trois semaines pour rendre son avis sur les deux projets de loi (organique et ordinaire), que le gouvernement a en outre modifiés à six reprises durant cette période, ce qui «ne l’a pas mis à même de mener sa mission avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique de l’examen auquel il a procédé», estime-t-il.
Une «situation d’autant plus regrettable» qu’il s’agit d’une réforme «inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir […] l’une des composantes majeures du contrat social», ajoute la plus haute juridiction administrative française, dans ce document.
Un avis sévère qui n’épargne pas l’étude d’impact accompagnant les deux textes. La première mouture était «insuffisante», et même une fois complétée, «les projections financières restent lacunaires», en particulier sur la hausse de l’âge de départ à la retraite, le taux d’emploi des seniors, les dépenses d’assurance-chômage et celles liées aux minima sociaux.
(…) RT

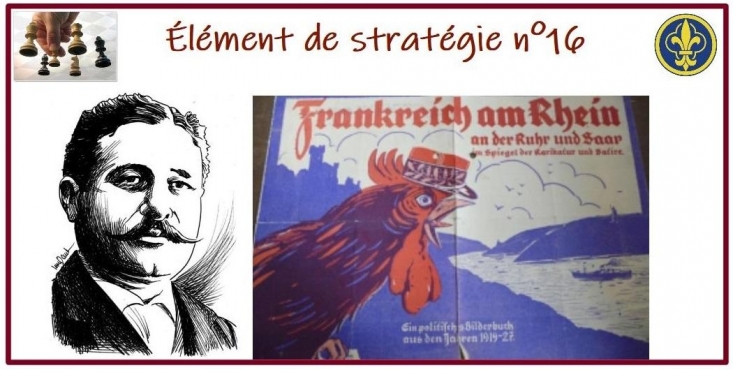
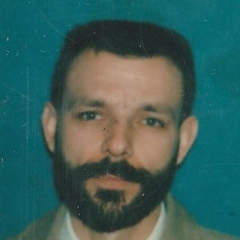 Depuis 1924 le duc de Guise était devenu dauphin suite au décès de Montpensier, frère de Philippe VIII. Considérant problématique la restauration de la monarchie, il s’est tout de même concentré sur l’éducation politique de son fils Henri, qu’il considère amené à succéder à son cousin Philippe VIII, sans postérité. Il est donc surpris en 1926 lorsque le duc d’Orléans meurt du choléra au retour d’un voyage. Longtemps simple cadet de la famille d’Orléans et non préparé a cette charge, Guise déclare pourtant assumer ses devoirs de chef de la Maison de France pour une prétendance qui va durer 14 ans. Jean III hérite alors d’un « capital » royaliste puissant car l’Action française de 1925 a atteint trois objectifs stratégiques fondamentaux
Depuis 1924 le duc de Guise était devenu dauphin suite au décès de Montpensier, frère de Philippe VIII. Considérant problématique la restauration de la monarchie, il s’est tout de même concentré sur l’éducation politique de son fils Henri, qu’il considère amené à succéder à son cousin Philippe VIII, sans postérité. Il est donc surpris en 1926 lorsque le duc d’Orléans meurt du choléra au retour d’un voyage. Longtemps simple cadet de la famille d’Orléans et non préparé a cette charge, Guise déclare pourtant assumer ses devoirs de chef de la Maison de France pour une prétendance qui va durer 14 ans. Jean III hérite alors d’un « capital » royaliste puissant car l’Action française de 1925 a atteint trois objectifs stratégiques fondamentaux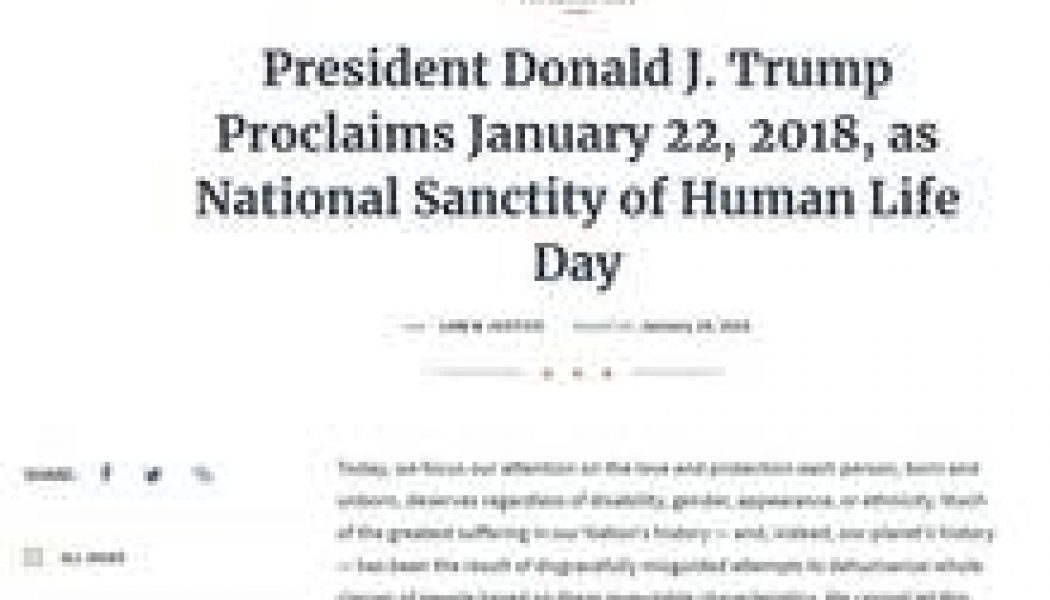




 Notre pays collectionne les contradictions mortelles. Parmi celles-ci, il y a l’incroyable rencontre du multiculturalisme et de la pensée unique. La tradition cohérente de la France reposait sur l’idée inverse : la France a bien, contrairement à l’une des sottises proférées par Macron, une culture, un mode de pensée largement dominant et qui consiste à « cultiver » l’esprit critique, la souplesse intellectuelle autant que la raison, en évitant les fanatismes et les systèmes
Notre pays collectionne les contradictions mortelles. Parmi celles-ci, il y a l’incroyable rencontre du multiculturalisme et de la pensée unique. La tradition cohérente de la France reposait sur l’idée inverse : la France a bien, contrairement à l’une des sottises proférées par Macron, une culture, un mode de pensée largement dominant et qui consiste à « cultiver » l’esprit critique, la souplesse intellectuelle autant que la raison, en évitant les fanatismes et les systèmes