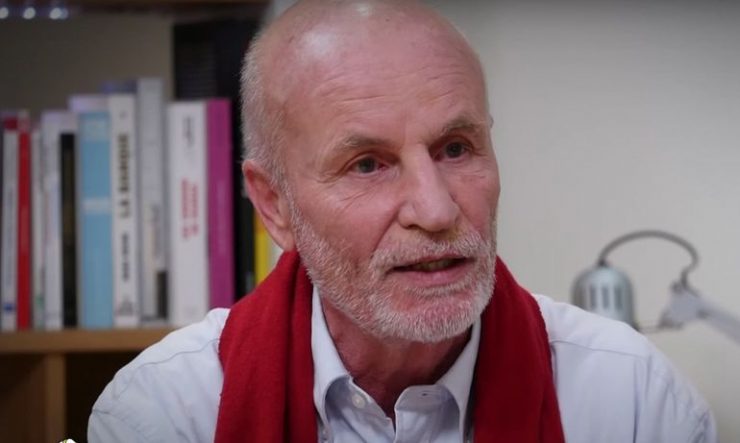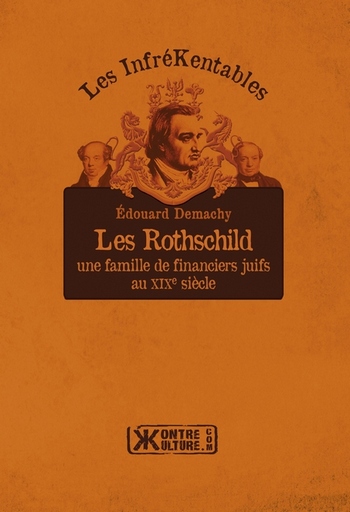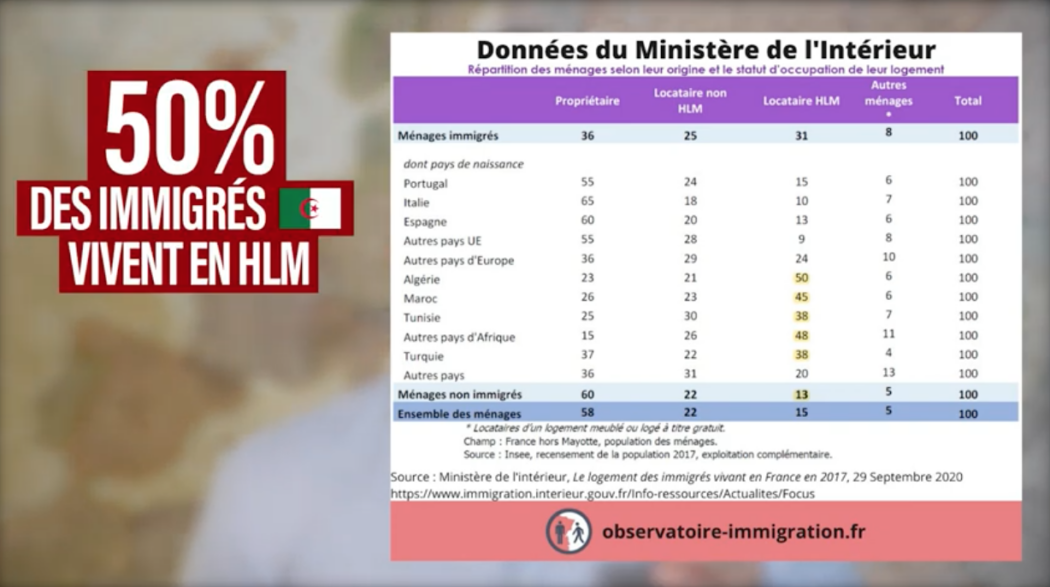Mais les lourdes charges financières imposées aux habitants n'étaient pas administrées arbitrairement ; l'État promouvait la construction des manufactures et des filatures, fondait des banques et entreprenait l'assèchement des marais. Cette politique, très moderne pour l'époque, créait emplois et subsistance, tout en étant accessoirement (et accessoirement seulement) philanthropique. Cette philanthropie accessoire déterminait aussi la politique d'immigration xénophile : huguenots, protestants de Salzbourg, vaudois, mennonites, presbytériens écossais, juifs, trouvèrent en Prusse une nouvelle patrie. Tous pouvaient parler leur langue, cultiver les valeurs religieuses de leur choix et vivre à leur façon. Les plus hautes fonctions leur étaient très rapidement accessibles. Les quelques millions de Polonais qui, après les conquêtes territoriales du XVIIIe siècle, étaient devenus Prussiens n'eurent à subir aucune politique de germanisation forcée, comme ce fut le cas quelques décennies plus tard. Une telle libéralité provenait du fait que la Prusse n'était pas un “État national” et ne souhaitait pas l'être ; son objectif était d'être un “État de raison”. La philanthropie n'y avait donc rien de sentimental, elle n'était qu'un moyen au service de la raison d'État.
Lire la suite