culture et histoire - Page 2005
-
Eric Zemmour et Aymeric Chauprade. Munich
-
LA SOUVERAINETÉ SELON CARL SCHMITT
L'originalité de Carl Schmitt est de rompre avec le discours classique sur le pouvoir politique. Toute la tradition philosophique, de Platon à Hegel, pense le pouvoir dans un rapport de subordination aux valeurs du droit et de la raison. Tous les efforts du libéralisme consistent à limiter le pouvoir, toujours suspect de force et d'arbitraire, en le divisant et en le soumettant à une légalité impersonnelle. C. Schmitt prend le parti inverse. Il rappelle contre le rationalisme politique et l’optimisme libéral que le pouvoir ne peut s'annuler dans un fonctionnement impersonnel de règles, dans la mesure où les hommes vivent dans un monde irréductiblement conflictuel. Carl Schmitt nous dit le contraire de ce que nous aimerions entendre. Il nous dit la face sombre et ténébreuse du pouvoir dans le droit fil d'un certain héritage d'un Machiavel ou d'un Hobbes.
Il est difficile de faire une présentation systématique de la pensée politique de C. Schmitt, car sa pensée a évolué des 1ères publications : Loi et Jugement (1912), Romantisme politique (1919), aux derniers ouvrages : Le Nomos de la terre (1950) et Théorie du partisan (1963). On peut expliquer cette évolution par son adaptation personnelle non dénuée d'opportunisme aux avatars de l'histoire. Toutefois certains concepts sont récurrents : le thème de la décision, au point que la théorie schmittienne est résumée dans le terme de "décisionnisme", la critique du libéralisme, et la définition de la politique pure. Ces 3 thèmes convergent tous vers la notion de souveraineté.
Carl Schmitt commence par une réflexion sur le droit. Dans Loi et Jugement, il montre que le jugement judiciaire ne peut être compris comme une subsomption du cas particulier sous la règle générale telle que l’interprète l’École de l’exégèse. Dans le jugement il y a un élément aléatoire, quelque chose qui relève irréductiblement de l'individu. Carl Schmitt s'oppose plus généralement à la conception normativiste du droit développée par Kelsen. Pour Kelsen toute norme tire sa validité d'une norme supérieure, jusqu’à une norme suprême qui est la constitution. L'État est un ensemble pyramidal de normes qui se présupposent toutes les unes les autres.
Mais c'est faire abstraction de la volonté souveraine qui l'institue (dans un pouvoir constituant) et du fait que la vie de l'État ne peut pas être totalement encadrée par des règles juridiques. La souveraineté politique est un commencement absolu en dehors de toute règle et de tout ordre. "Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle" (1). Le souverain apparaît là où il convient de décider s'il s'agit d'une situation d'urgence et ce qu'il faut faire dans cette situation. Dans la situation d'exception la forme régulière de la vie de l'État, le droit, est suspendue, et la décision politique apparaît dans sa pureté. "Avec l'exception, la force de la vie réelle brise la carapace d'une mécanique figée dans la répétition" (2).
C. Schmitt montre que la catégorie de l'exception a une dimension métaphysique et théologique comme tous les concepts politiques dans un de ses premiers livres, Théologie politique. L'exception a pour correspondant théologique le miracle par lequel Dieu intervient sans raison dans le cours régulier de la nature. En mettant en question la notion de miracle, le déisme et le rationalisme du XVIIIe siècle légitiment métaphysiquement l'élaboration de l'État de droit dont l'idéal est d'encadrer toutes les situations dans la légalité.
Le deuxième thème récurrent de la pensée schmittienne est la critique du libéralisme politique, ce qui fait plus particulièrement l'objet de Parlementarisme et Démocratie. Schmitt montre qu'il convient de distinguer la démocratie, telle que la définit Rousseau comme souveraineté du peuple, et le libéralisme, tel qu'il est défini par Benjamin Constant. La démocratie tend vers l'identité des gouvernants et des gouvernés en réalisant l'homogénéité des citoyens dans la communauté nationale. La démocratie est hostile à la représentation, comme l'a bien compris Rousseau, elle se réalise de manière privilégiée par l'acclamation. Le libéralisme définit l'État comme une association pacifique d'individus libres et égaux avec un centre politique minimal contrôlé par une élite représentative du peuple. Ces 2 principes politiques ont pu se mélanger au cours des XVIIIe et XIXe siècles, parce qu'associés dans leur lutte commune contre le principe monarchique, mais ils n'en ont pas moins des logiques profondément différentes dont la divergence apparaît clairement au XXe siècle (3).
Le parlement est essentiellement une institution libérale. Il se comprend comme une commission aristocratique du peuple qui définit à l'intérieur de lui-même une commission de second degré, le gouvernement, chargé de gérer les affaires publiques. Sa fonction principale n'est pas de désigner des personnes qui ont la confiance des citoyens, car cette fonction pourrait tout aussi bien être remplie par un césarisme antiparlementaire, mais d'organiser la discussion politique. L'échange des arguments dans la discussion doit permettre de faire émerger la vérité politique comprise comme vérité relative. C'est pourquoi la discussion ne s’arrête pas. Elle ne se confond pas en droit avec une négociation commerciale où ce qui prévaut est la lutte d’intérêts. Le député n'a pas un mandat impératif, il n'est pas le représentant d'un parti, mais de tout le peuple.
La recherche en commun de la vérité implique l'existence d'un espace publique où tout citoyen peut prendre connaissance des affaires politiques, ce qui nécessite la reconnaissance et la garantie de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Le parlementarisme s'appuie sur une véritable foi dans la vertu de la discussion, il suppose que les hommes sont capables de se laisser convaincre par des arguments et de vouloir la vérité. Le problème est de savoir si le parlementarisme qui a trouvé ses titres de noblesse dans l'Europe bourgeoise du XIXe s., particulièrement dans la France de la Monarchie de Juillet fondée sur un régime censitaire, est encore viable dans la démocratie de masse du XXe s. De fait l'État contemporain assume des responsabilités économiques et sociales de plus en plus importantes (ce que Schmitt appelle le virage vers "l'État total") et la vie politique est de plus en plus dominée par des partis qui agissent comme des groupes de pression en vue de la conquête du pouvoir en utilisant de puissants moyens de propagande.
C'est pourquoi C. Schmitt pense que le parlement est une institution désuète et inadaptée, qui affaiblit l'État par ses discussions perpétuelles. Il préconise le renforcement du pouvoir exécutif dans un régime présidentiel et le recours à une dictature provisoire (selon la définition romaine) pour répondre à l'urgence du moment et à la volonté suprême du peuple qui est la sauvegarde de son unité. « Le bolchevisme et le fascisme sont certes antilibéraux, comme toute dictature, mais pas nécessairement antidémocratiques... La volonté du peuple peut s'exprimer par acclamation, par sa présence évidente et non contestée, et par un processus démocratique encore meilleur que l'instrument statistique élabore avec un soin si minutieux depuis un siècle et demi » (4).
Le troisième thème est la définition du politique. Ce thème est développé dans le petit texte intitulé La Notion de politique (5), le livre le plus célèbre et le plus commenté de C. Schmitt. Dans ce texte C. Schmitt recherche la définition précise de la réalité politique selon une méthodologie empruntée à Max Weber. Le domaine moral se reconnaît à travers la distinction du bien et du mal, le domaine esthétique à travers la distinction du beau et du laid, le domaine économique à travers les valeurs de l'utile et du nuisible ou du rentable et du non-rentable. C. Schmitt prétend identifier le critère qui définit la spécificité du politique à travers la discrimination de l'ami et de l'ennemi.
La politique n'est pas un domaine, elle ne se confond pas avec l'État, elle se définit par un degré d'intensité qui peut concerner n'importe quel domaine et diviser les hommes en 2 camps susceptibles de s'affronter. « Est politique tout regroupement qui se fait dans la perspective de l'épreuve de force » (6). L'ennemi n'est pas l'adversaire dans une discussion ou le concurrent dans une compétition économique, c'est l'ennemi public (hostis) et non l'ennemi privé (inimicus). La réalité politique tient au fait que l'homme est fondamentalement un être dangereux. C'est pourquoi le jus belli et le jus vitae ac necis sont les attributs permanents de la souveraineté. Il ne s'agit pas de dire que la guerre est normale ou souhaitable, il s'agit seulement de reconnaître la possibilité effective de la guerre et le sérieux existentiel que cela implique pour tout homme de perdre sa vie ou de donner la mort.
Un monde où la possibilité de la guerre serait complètement écartée, un monde de totale neutralisation, serait un monde sans activité politique. Le fait politique par excellence est la division de l'humanité en unités politiques. « Le monde politique n'est pas un universum, mais, si l'on peut dire, un pluriversum » (7). Si un peuple n'est pas capable de lutter, il perd à plus ou moins long terme sa souveraineté. C. Schmitt dénonce la foi libérale qui veut mettre la guerre hors la loi. Selon lui l'idée d'une société des nations est une notion polémique qui a permis de lutter contre l'Europe des princes. Quant à ceux qui font la guerre au nom de la morale, ils ne font que renforcer la violence en diabolisant l'adversaire. Le libéralisme est par essence antipolitique. « Il n'y a pas de politique libérale sui generis, il n'y a qu'une critique libérale de la politique... La pensée libérale élude ou ignore l’État et la politique pour se mouvoir dans la polarité caractéristique et toujours renouvelée de 2 sphères hétérogènes : la morale et l'économie, l'esprit et les affaires, la culture et la richesse » (8). Le libéralisme ne supprime pas le politique, il n'a fait que le dissimuler dans un discours antipolitique.
C. Schmitt revendique la paternité de Hobbes pour étayer sa définition du politique. Mais la référence à Hobbes est pour le moins ambiguë, c'est ce que montre Leo Strauss dans son commentaire de La Notion de politique (9). Hobbes reconnaît l'état de guerre de tous contre tous à l'état de nature pour définir l'État comme condition d'une vie paisible entre les hommes permettant de développer l'économie et il définit le droit à la sûreté à la vie comme droit inaliénable, en ce sens Hobbes vise un au-delà du politique et fonde le libéralisme. Leo Strauss montre que Schmitt reste attaché au libéralisme malgré sa critique radicale.
La pensée schmittienne s'explique en grande partie par une philosophie de l'histoire inspirée par le catholicisme (10). C. Schmitt interprète le monde moderne comme un monde irreligieux et dépolitisé qui trouve son cri de ralliement dans la formule de Bakounine "ni Dieu, ni maître". Il voit dans le projet d'une société horizontale d'individus libres la destruction de la transcendance verticale du rapport de l'homme à Dieu. Les hommes semblent vouloir un bonheur confortable dans une société universelle avec comme seule idole la force neutre de la technique. À partir de son pathos religieux, sombre et exigeant, C. Schmitt rappelle de manière insistante aux bourgeois optimistes que nous sommes ("bourgeois" est pris ici au sens hégélien du terme, il désigne un homme uniquement préoccupé de sa vie privée) que nous vivons dans un monde dangereux où la division politique peut toujours atteindre des degrés extrêmes qui nous plongeront nécessairement dans la tragédie. De même que le sérieux de la vie personnelle se fait dans le choix entre Dieu et Satan, de même le sérieux de la vie publique tient à l'éventualité d'un choix entre 2 camps irréductiblement opposés.
C. Schmitt a d'une part le mérite de faire ressortir en pleine lumière les principes des théories qu'il critique. Il montre clairement les insuffisances du normativisme kelsénien, les faiblesses internes du parlementarisme et la foi indémontrable du libéralisme en la discussion. D'autre part C. Schmitt a l'originalité de vouloir penser le pouvoir indépendamment de toute subordination à une valeur extra ou supra-politique, ce qui est pratiquement unique dans l'histoire. Alors que toutes les philosophies politiques pensent la politique comme réalisation de valeurs morales : la paix, la justice, la liberté, C. Schmitt veut faire une description libre de toute considération de valeur (wertfrei) du politique.
On peut se demander si ce projet n'implique pas malgré tout une morale, non la morale de l'universalité développée par Kant, mais une morale dont le pathos serait la décision existentielle voulue pour elle-même. Par quoi la notion schmittienne de décision serait bien proche de la notion heideggerienne de résolution (Entschlossenheit). Mais si ces nouveaux moralistes nous rappellent au sérieux de l'existence (privée ou publique) sous l'horizon de la mort, encore convient-il de discerner dans la réalité ce qui augmente la violence et ce qui la limite, s'il est vrai que les hommes ne veulent pas seulement se savoir libres et authentiques en face de la violence, mais libres dans une réalité sensée.
► Texte de JF Robinet issu du volume Analyses et Réflexions sur... le pouvoir, vol. II, éd. ellipses, 1994. http://www.archiveseroe.eu
• Notes :
- Thélogie politique (1922), Gal., 1988, p. 25.
- Ibid. p. 25.
- Dans son maître ouvrage Théorie de la Constitution (Verfassungslehre, 1928) [PUF, coll. Léviathan, 1993], C. Schmitt ramène toutes les formes politiques modernes à la composition de 2 principes purs : l'identité où l'État se confond avec le peuple (l'idéal de la démocratie rousseauiste) et la représentation où l’État incarne le peuple (l'idéal de la monarchie selon Hobbes).
- Parlementarisme et Démocratie (1923), Seuil, 1988, p. 115.
- La Notion de politique a fait l'objet de 3 versions successives. Le texte, né d'une conférence à la Deutsche Hochschule für Politik à Berlin, fut publié en 1927 dans la revue Archiv für Socialwissenschaft und Sozialpolitik. Il fut réédité en 1928 dans un ensemble de contributions intitulé Problème der Demokratie. Il fut ensuite édité de manière indépendante sous forme d'un ouvrage appelé 3ème édition en 1933. La traduction française actuelle se trouve chez Flammarion (coll. Champs), avec une préface de Julien Freund. L'édition française contient également un très beau texte de théorie et d'histoire politique, Théorie du Partisan, que C. Schmitt a publié à la fin de sa vie, en 1963.
- Ibid. p. 78.
- Ibid. p. 95.
- Ibid. p. 115.
- Les "Remarques sur La Notion de politique de C. Schmitt" (1932) se trouvent à la fin de Parlementarisme et Démocratie.
- Sur l'importance du catholicisme dans la pensée de C. Schmitt, voir Heinrich Meier : Carl Schmitt, Léo Strauss et la Notion du Politique, Un dialogue entre absents (Julliard, 1990) et la longue préface d'O. Beaud à la traduction française de la Verfassungslehre.
-
Documentaire - L'AF et le Comte de Paris
-
CES LOBBIES QUI ÉTOUFFENT LA FRANCE
L'A.F. REÇOIT PIERRE DE VILLEMAREST
« À Lisbonne la Trilatérale a tenu la main de Sarkozy »
Pierre de Villemarest, journaliste professionnel, membre de l’Amicale des Anciens des services spéciaux de la Défense nationale, a rencontré depuis les années cinquante les personnages clefs de l’histoire du XXe siècle. Il a publié depuis 1962 une vingtaine d’ouvrages, notamment sur les services secrets soviétiques. L’ouvrage sur la Trilatérale que présente ci-contre Pascal Nari est le troisième d’une série intitulée Faits et chroniques interdits au public sur toutes sortes de clubs dont celui des Bilderberg. Il dirige depuis trente ans une Lettre d’Information confidentielle qui traite des dessous des événements contemporains avec des correspondants dans une vingtaine de pays. Il a bien voulu à l’occasion de la sortie de son nouveau livre nous accorder cet entretien, dont nous le remercions.
* Centre européen d’Information, La Vendômière , 27930 Cierrey
L’ACTION FRANÇAISE 2000 – Quelle est la spécificité de la Trilatérale par rapport aux autres groupes, Bilderberg, CFR... ? A-t-elle une philosophie propre ? Des moyens d’action particuliers ?
PIERRE DE VILLEMAREST – La Trilatérale est née en 1973 sous la tutelle du CFR (Council on Foreign Relations) à l’initiative de David Rockefeller et de son maître à penser Zbigniev Brzezinski. Je raconte dans mon livre comment cette création fut d’abord tenue secrète avant que Rockefeller lui-même avoue en 1991 devant les membres du cercle de Bilderberg en remerciant la grande presse d’avoir respecté les consignes de discrétion pendant des années : « Le monde est maintenant plus sophistiqué et disposé à marcher en direction d’un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et des banquiers internationaux est sûrement préférable à l’autodétermination telle qu’elle a été pratiquée durant les siècles passés. »
En fait, la Trilatérale a été créée sous prétexte d’appeler le Japon dans un système mondial qui s’érigerait comme puissance industrielle et commerciale, en vue de coiffer toutes les institutions européeennes et atlantiques et d’orchestrer la marche économique vers le mondialisme.
Mondialisation et mondialisme
L’AF 2000 – N’y a-t-il pas lieu de distinguer entre mondialisme et mondialisation ?
P. de V. – Les trilatéralistes utilisent la phraséologie courante pour cacher leur idéologie, mais il faut en effet distinguer la mondialisation qui est la conséquence fatale des progrès techniques, notamment dans le domaine de la communication, et le mondialisme qui est une doctrine imposée par une coterie élitiste qui impose son explication de notre temps et qui dicte la mondialisation, laquelle est organisée autour de cercles qui existent déjà pour aboutir à une sorte de directoire du monde. La tactique des hommes de la Trilatérale est toujours de multiplier les ponts et les contacts avec toutes sortes d’organismes à l’échelon mondial même si ceux-ci sont apparemment très différents et non liés entre eux tels l’lnstitut Aspen, dont l’origine est franco-germanique, ou encore l’Institut français des relations internationales (IFRI) que dirige Thierry de Montbrial.
Tous ces groupes se rejoignent dans l’idée de parvenir à la destruction des États nations. J’ajouterai les Amitiés France Amérique qui défendent l’idée de remplacer les nations par les régions.
Hégémonie américaine
L’AF 2000 – Peut-on dire de la Trilatérale qu’elle est l’instrument de l’impérialisme américain ?
P. de V. – Le problème se pose toujours entre trilatéralistes de savoir si la direction doit revenir à des groupes géographiques et commerciaux anonymes ou si l’Amérique doit prendre l’organisation en mains. C’est pour le moment l’impasse. Mais il faut noter que Rockefeller (91 ans) et Brzezinski sont toujours le moteur de l’affaire.
Je crois, par ce que j’ai vu et appris de l’intérieur, en parlant avec beaucoup de trilatéralistes, que les Américains pensent d’abord à leurs affaires (les firmes qui font partie de la Trilatérale représentent un poids supérieur à celui du budget des États Unis ; elles sont à même de dicter leurs volontés aux gouvernements américains. C’est bien la marche vers l’hégémonie capitaliste américaine.
L’AF 2000 – Pourtant la Trilatérale s’est souvent lourdement trompée. Par exemple - vous le dites dans votre livre - en ne prévoyant pas l’effondrement du communisme... Comment un organisme qui commet tant d’erreurs peut-il être aussi dangereux ?
P. de V. – La Trilatérale s’est trompée plusieurs fois dans ses prévisions et ses constatations ont éludé bien des problèmes. Ses textes sont sur le modèle des sociétés fabiennes : dans un même numéro des Affaires internationales on peut trouver la thèse et l’antithèse voire toutes sortes de contradictions. Les hommes de le Trilatérale n’ont pas su prévoir la chute du Mur de Berlin ni ses conséquences, pas plus qu’ils n’ont deviné qu’à côté du Japon émergeraient l’Inde et le Chine. Cela montre les limites de ces prévisionnistes. Ils n’en sont pas moins dangereux, car ils savent manipuler l’opinion à travers le commerce et les monnaies. Ils ont voulu l’euro, cette monnaie artificielle déjà préconisée par les Bilderberg ; aujourd’hui le secrétaire d’État au Trésor, H. Paulson, membre du CFR, peut en réalité coiffer l’économie de l’Europe occidentale.
Ils entretiennent aussi la crise artificielle du pétrole ; ils veulent que les puissances pétrolières qu’ils coiffent réduisent leurs livraisons par peur d’avoir à épuiser leurs réserves ; ils arguent de cela pour laisser monter les prix. On se trouve ainsi à la merci d’un groupe de direction qui prend sur lui d’influencer la politique mondiale à travers les enjeux économiques.
En route pour le mondialisme
L’AF 2000 – Quelle influence joue la Trilatérale dans la construction dont rêvent certains d’une Europe fédérale ?
P. de V. – Une certain nombre de ses membres appartiennent au groupe euro-atlantique des Bilderberg qui a tant contribué à lancer l’idée européenne, en liaison avec les comités d’action Jean Monnet, lesquels étaient financés avec parfois des rallonges par les Américains. Alors quand François Hollande dans Le Monde du 16 septembre 2004 revendique pour les socialistes la paternité des cinq ou six traités européens, on sait qui finançait. La Trilatérale a suggéré le texte “simplifié” et a tenu la main de Nicolas Sarkozy en posant le principe qu’on allait voter non par référendum mais seulement au Parlement. Car ils savent bien que d’instinct l’opinion voit quelque chose de louche dans l’affaire européenne, et redoute la catastrophe à plus ou moins long terme. Or, dans le traité “simplifié” il y a des signes inquiétants : si l’on a supprimé les symboles on n’en a pas moins gardé une espèce de ministre des Affaires étrangères avec une centaine d’ambassadeurs à travers les monde. On assistera donc bien à la soumission de la France à des étrangers.
L’AF 2000 – Les Français faisant partie de la Trilatérale puisent-ils dans cette participation au moins quelques bénéfices économiques pour notre pays ?
P. de V. – Ils obtiennent parfois quelques coups de pouce quand une firme a besoin d’aide, mais cela n’est pas calculé. En fait, ils y a à peu près quinze Français sur trois ou quatre cents trilatéralistes. Certains sont des passionnés du système mondialiste. Beaucoup sont seulement des opportunistes, sans grandes convictions. Je pense à Michel Crépeau, qui fut maire de La Rochelle, que j’ai interpellé un jour lors d’une réunion et qui m’a confié, à part, qu’ayant été chercher pour sa ville une aide aux États-Unis sur les conseils de Paul Delouvrier, directeur d’EDF et l’un des tout premiers trilatéralistes français, il en était revenu fort déçu et méfiant au sujet des antennes de la Trilatérale. Un petit groupe de personnes dirige tout. Donc les membres un peu trop tièdes sont vite détectés et leur mandat n’est pas renouvelé. Ils sont alors pour longtemps écoeurés d’avoir participé à de telles parlotes. D’autres se plaisent en revanche à siéger dans un club international, aussi mondain qu’artificiel.
L’art de piéger même sans convaincre
L’AF 2000 – Raymond Barre, ancien Premier ministre français, qui vient de mourir, était un trilatéraliste de haut niveau...
P. de V. – Certes, mais ces trois dernières années, il s’était aperçu de son erreur et se montrait beaucoup moins ardent, ce que Simone Veil lui a reproché...
L’AF 2000 – On ne peut pas à proprement parler accuser la Tilatérale de “complot” ; alors où réside la force de cet organisme ?
P. de V. – La grande discrétion des médias à son égard contribue évidemment à renforcer son influence sournoise. Je dois déplorer aussi que les journalistes lucides et qui recueillent des informations agissent trop souvent chacun de leur côté et se citent rarement les uns les autres. Car il importe de mettre à jour la tactique des hommes de la Trilatérale qui consiste, à l’instar des sociétés fabiennes, à convaincre avec patience, par imprégnation des idées, de la politique et de l’économie d’un pays, puis à piéger ceux qui ne pensent pas comme eux en les contournant afin d’arriver même sans les convaincre à les persuader qu’ils ont intérêt à s’arranger avec eux...
Propos recueillis par Michel FROMENTOUX L’Action Française 2000 du 15 au 28 novembre 2007 -
Le principe de souveraineté
L'une des premières définitions modernes de cette notion nous est donnée par Burlamaqui (1694-1748) dans ses Principes de droit politique. Celui-ci retient 3 éléments essentiels :
- un DROIT de direction,
- assorti d'un POUVOIR de commandement, de contrainte,
- ayant une valeur UNIVERSELLE, c'est-à-dire que cette combinaison juridico-politique s'applique à tous les membres d'une collectivité politique donnée (cité, nation, monarchie, empire, etc.).
La notion est définie par conséquent indépendamment du type de régime dans lequel elle s'applique. Cette définition retient notre attention essentiellement par son aspect moderne : c'est qu'elle utilise 2 concepts tirés du discours contemporains, à savoir le droit et le pouvoir politique. Il est à souligner cependant que la position originale de Burlamaqui constitue une rupture qui est à la fois historique et idéologique.
Le droit médiéval, fortement soumis aux règles du discours scolastique, ne pouvait concevoir une théorie de la souveraineté qui ne fut principalement théocratique et déiste. Or, alors que les légistes catholiques s'appliquaient à dégager une conception métaphysique, Bulamaqui propose une définition politique et juridique, renouant ainsi avec la tradition publiciste romaine. En introduisant dans sa recherche des principes et critères non-religieux (pour simplifier, disons "laïcisé", bien que le terme soit impropre de notre point de vue), ce penseur genevois revendique un acte contestataire.
L'originalité de cet "esprit contestataire" — qui va se développer au fil des siècles — peut être étudiée à travers 2 exemples :- d'une part, la théorie du mandat. Si l'on reconnaît la dichotomie souveraineté/ pouvoir divin, à qui peut-on alors attribuer cette souveraineté étant bien entendu que celle-ci n'est concédée qu'à titre relatif et provisoire au souverain ? Et, par ailleurs, qui est à l'origine de cette attribution ?
- d'autre part, le développement de l'idéologie démocratique de la souveraineté populaire. Cette idéologie, caractérisée par la notion de "contrat social", présente 2 versions : l'une post-scolastique (la doctrine des jésuites en est la plus brillante des représentations), l'autre républicaine (Hobbes, Rousseau).
La théorie du mandat
De la théorie du mandat peuvent être dégagées les esquisses idéologiques de ce qui était appelé à engendrer les grands principes de la pensée politique contemporaine. On y reconnaîtra, entre autres choses, les valeurs sous-jacentes aux idéologies égalitaires : dualisme, mécanicisme inorganique, attachement aux cadres logiques du droit privé.
Cette théorie présente une structure trinaire évidente. Trois facteurs, 3 niveaux, interviennent en effet : le mandataire, le mandaté et l'attribut du mandat. Le mandataire est Dieu, ou la puissance divine dans le langage des légistes de l'époque ; le mandaté, celui qui exerce le pouvoir en vertu d'un mandat explicite découlant d'une procédure historique (le pacte de Dieu et du roi prend la forme du baptême — Clovis — ou du sacre — les Bourbons) ; enfin, l'attribut même du mandat est représenté par la souveraineté, qui est à la fois droit et pouvoir.
Cette dialectique trinaire s'inspire d'une idéologie dualiste, essentialiste, qui apparaît clairement dans le schéma suivant :• Élément originel : Le mandataire = Dieu (A)
• Éléments dérivés : Le mandaté = Roi (B) ; L'attribut = Souveraineté (C).La relation causale, telle qu'elle transparaît dans ce dessin, entre celui qui est la source de tout pouvoir (Dieu) et ce que nous avons appelé les "éléments dérivés" de la structure (le souverain et son attribut), est frappante.
Ainsi, il n'existe qu'un rapport unilatéral entre l'élément originel et les éléments dérivés. Qu'est-ce à dire ? C'est que le souverain (l'État) n'est considéré que comme une instance soumise, déterminée. Simple super-structure dans le rapport trinaire que nous avons défini, il ne peut être une instance suprême. Au même titre, la souveraineté est conçue ici comme un pur "objet". Il n'est pas question de la valoriser, dans la mesure où elle participera de Dieu et du pouvoir politique temporel.
Au fond, l'État est un "objet" divisé, la souveraineté politique une instance médiatrice ; seule la puissance divine est présentée comme "sujet" total, instance suprême parce qu'englobante. C'est ainsi qu'un légiste de l'époque médiévale a pu écrire que l'État n'était en tout et pour tout qu'un fidei commis...
Une logique essentialiste, inorganique et déterministe
Cette logique "essentialiste", selon laquelle Dieu serait l'essence de toute chose (cf. Saint Augustin, Thomas d'Aquin) conduit à dévaloriser le pouvoir politique, opération caractéristique du manichéisme chrétien. Non seulement l'État n'est qu'une structure objective, mais il représente chez les doctrinaires chrétiens, une anti-thèse, un mal nécessaire.
Bien évidemment, la coloration donnée au pouvoir politique est négative. Si l'État est en possession de la souveraineté, il n'en a pas la propriété pleine et entière. Il n'est pouvoir que par accident et non par essence. En termes civilistes, il n'exerce pas un droit réel parfait de propriété.
Qu'est-ce que cette souveraineté, émanée de Dieu et qu'il peut reprendre à tout instant ?
Philologiquement, elle est superanum, c'est-à-dire supériorité. Pétris de droit romain et de droit canonique, les légistes de l'âge d'or du catholicisme sont les ardents défenseurs d'un ordre théocratique. Leur discours est moins idéologique que politique. Au service du pouvoir ecclésiastique, ils donnent à ce dernier un alibi intellectuel (1). Soulignons que cette dialectique n'est nullement organique. Elle relève au contraire d'une pure mécanique déterministe, dans laquelle l'homme n'a aucun droit.
Logiquement, les rapports qu'entretient cette puissance divine avec le souverain sont purement hiérarchiques. L'influence platonicienne apparaît ici considérable. Si rien ne se conçoit hors de Dieu, le pouvoir politique n'est que titularisation et jamais propriété ab origine. C'est ainsi que l'écrivaient les frères Carlyle dans un essai intitulé A History of Political Medieval Theory in the West (1903-1936) en rappelant le vieil adage des barons anglais et saxons : Nolimus leges anglicae mutare.
La souveraineté du peuple
Il est inévitable que cette seconde partie apparaisse comme un raccourci par trop fulgurant d'une évolution qui, bien que sensible, fut lente. Cette dernière est typique des mouvements observables dans la vie des idées, qui passent successivement par des phases de contraction puis de décontraction. Rythme biologique que nous retrouvons dans notre analyse. À l'époque où nous reprenons notre étude, les discours touchant à la notion de souveraineté populaire se sont multipliés. L'émergence d'un État puissant, centralisateur et volontaire a favorisé une telle poussée. La théorie du droit divin est une expression de notre époque de changements. Elle fournit une base idéologique à l'absolutisme du XVIIe siècle.
Deux inspirations sont à distinguer : l'une est d'origine chrétienne et représentée par les Monarchomaques et certains intellectuels jésuites (dont Francisco Suarez). L'autre est plus franchement laïque, entendons par là non directement attachée aux intérêts ecclésiastiques (Hobbes et le Léviathan, Rousseau et le Contrat Social). Penchons-nous tout d'abord sur la doctrine jésuite à travers les idées développées par Francisco Suarez (1548-1617).
Des jésuites aux doctrines du contrat social
Fidèles aux tendances égalitaires de leur doctrine dualiste - et de la théorie du mandat qui en est une expression particulière - ce sont des penseurs jésuites qui vont enclencher le mouvement qui débouchera sur la théorie du contrat social. Ce n'est là qu'un des multiples paradoxes apparents de l'histoire des idées. Certains auteurs ont voulu voir dans cette évolution une "laïcisation" de la théorie du mandat et il est évident qu'une tentative de dégagement du discours théocratique se manifeste timidement. Lato sensu, ils demeurent tout de même dans la ligne des héritiers de la pensée augustinienne et thomiste. Si les scolastiques perdent du terrain, la conception du monde dominante chrétienne se maintient. Les valeurs restent identiques. Quelles sont-elles ?
• Première idée : L'homme est un être social. L'ontologie sociale de la doctrine aristotélicienne est reprise dans l'augustinisme, par la reconnaissance de l'individu comme réalité politique. Comme valeur, l'homme est un absolu dans l'histoire et la Cité de Dieu est reliée à la Cité Terrstre par une "sphère de conciliation" qui n'est pas sans rappeler Socrate ou Chrysippe.
• Deuxième idée : Le mandataire n'est plus Dieu. Les monarchomaques sont les premiers à opérer cette substitution : la source du pouvoir n'est plus divine mais réside dans le peuple.
Les intellectuels jésuites vont introduire une révolution dans les idées. Au vieux principes thomiste "nulla potestas nisi a Deo" est substitué l'idée selon laquelle "nulla potestas nisi a Deo per populum"... Il s'agit là de quelque chose de révolutionnaire puisque c'est reconnaître au peuple au moins un rôle égal à celui de Dieu. Le "grand absent" (entendons le peuple) est désormais placé au premier rang. Ainsi pour le Cardinal Bellarmin (1542-1621), "tous les citoyens sont civilement égaux", ajoutant dans De Membris Ecclesiae, "le pouvoir a été donné au peuple et les hommes y sont égaux".
Il est d'ailleurs suivi dans cette voie par Suarez, un autre père des jésuites : "la sphère de conciliation" est facteur de synthèse, synthèse de Dieu et du peuple. La souveraineté populaire est donc dans le cadre de cette "sphère" concrétisée par un contrat de tous entre tous. La filiation est incontestable (cf. J. Rouvier, Les grandes idées politiques, t. 1, Bordas).
Deux aspects sont à distinguer :
- La société, d'une part, fondée sur un rapport de droit privé, de nature synallagmatique. Cette influence du droit privé rejoint celle aperçue dans la théorie du mandat. Dans cette société, les hommes sont égaux, comme créatures de Dieu. Celle-ci est une exigence de la nature, devant être régie par une autorité, nécessité par le bien commun. Ce syllogisme thomiste réduit le pouvoir à un mal nécessaire et sa souveraineté à une simple délégation du souverain suprême (Dieu ; puis Dieu et le peuple ; le peuple enfin). Ce rapport autrefois nommé "pactum" induit une délégation de pouvoir.
- En effet, le pouvoir résulte de ce "pactum subjectionnis". Il est mal tempéré en vue du bien commun ! Définir ce dernier est une tâche ardue mais il existe comme objectif.
Le dualisme manichéen est conservé...
Le dualisme manichéen est cependant conservé : le pouvoir demeure ce mal nécessaire. La cité des hommes, reflet dégénéré de la Cité de Dieu, réclame une caricature de pouvoir. L'exécutif, l'État, quelle que soit son appellation, est cette dernière. Le pacte est limité et partiel. Face à la société des hommes (valeur du bien), fondée sur un accord consensuel naturel (influence du jusnaturalisme), le pouvoir représente le pôle négati. C'est ainsi que nous arrivons à la théorie du contrat social, dont les principaux théoriciens furent Thomas Hobbes et J.J. Rousseau.
Dans son ouvrage principal, Le Léviathan (1651), Hobbes (1588-1679) nous expose les principes qui l'ont inspirés. C'est surtout chez Spinoza qu'il a puisé son inspiration. Ce dernier, dans son Traité théologico-politique développe l'idée selon laquelle l'état originel de l'homme est celui de nature. L'état de nature se définit comme "la possession d'un droit qui s'étend jusqu'où s'étend la puissance déterminée qui lui appartient" et présente donc un caractère actif d'une pluralité de rapports de puissance (cette idée s'oppose en fait à l'idéalisme pacifiste et plat des intellectuels contemporains). La fin d'un tel état est la conséquence de l'apparition de ce que Spinoza appelle la "multitude", connaissant 2 formes principales : la cité et la république.
À ce propos, Rousseau considérait que l'accroissement du nombre des individus est inversément proportionnel au degré de liberté dont ils jouissent. Cette conséquence du nombre en expansion (cf. chap. XVII du Léviathan), comme pure quantité arithmétique, produit inéluctablement une société de discipline qui trouve sa justification dans sa fonction d'assurance. Hobbes définit cette fonction comme celle consistant à "donner la pais et la sûreté".
La naissance de l'État totalitaire
Le problème qui se pose n'est plus alors de limiter ce pouvoir mais de l'organiser au mieux des intérêts collectifs. Le philosophe investit celui-ci d'un droit illimité d'action justifié par sa fonction. Chaque acte souverain a pour auteur l'ensemble des sujets. D'où l'apparition du Leviathan, "le plus grand des monstres froids" dont parle Nietzsche. En termes de sociologie politique, c'est l'acte de naissance intellectuelle de l'État totalitaire, de la dictature moderne, qu'elle soit nazie ou stalinienne.
On peut dégager chez Hobbes 2 idées dominantes, d'une part une méfiance a priori du pouvoir réhabilité mais condamnable tout à la fois, d'autre part une vue prospective quant à l'apparition de l'État moderne et de sa rhétorique égalitaire (cf. l'analyse brillante de B. de Jouvenel, Du pouvoir).
Deux acteurs entrent en jeu : le pouvoir exécutif et l'individu, liés par un contrat en vertu duquel toute personne aliène, en toute connaissance de cause, la totalité de ses doits au profit d'avantages à terme. Dans ce jeu d'un genre nouveau, le providentialisme explicatif de la période médiévale disparaît au profit d'un style que nous qualifions de réalitaire. Le jeu n'est plus troublé par un tiers divin, il est immanent au monde d'ici-bas. L'émancipation est de ce point de vue radicale. Le rapport politique Pouvoir/ Peuple est valorisé, maladroitement. Il est encore contractuel, toujours marqué de la mauvaise conscience d'un péché originel, traduit par l'aliénation de l'individu. Notons pour finir que Hobbes insiste avec bonheur sur la dialectique du politique excluant toute métaphysique détemrinante.
La logique de Rousseau
Le second théoricien qui nous intéresse ici est J.J. Rousseau (1712-1778) et son Contrat Social (1762). L'idée de base du rousseauisme est le mythe du Contrat social, événement "historial" au sens de Martin Heidegger, marquant la naissance de l'humanité historique ; la logique de Rousseau présente 2 aspects essentiels :
- une chronologie marquée par l'idée de rupture (historicisme). Le contrat social est un acte unique dans le temps, qui constitue la consommation première de l'aliénation. Telle est l'idée traditionnelle. Mais Rousseau est aussi le fondateur d'une doctrine historique. Il divise la genèse du contrat en 2 étapes : le surgissement, sous la nécessité démographique (cf. Hobbes) puis la désignation des dirigeants par les cocontractants. Par là est introduit le mythe fondateur historique d'une société décomposée en époques significatives et distinctes. Au providentialisme déterminant des jésuites, Rousseau substitue l'homme-sujet de l'histoire. Le destin n'est plus le résultat d'une volonté divine, transcendante à la terrestre humanité. Il est volonté humaine. Nous avons affaire là à une doctrine du volontarisme historique et subjectiviste.
- La question soulevée par la notion de souveraineté populaire est la suivante : quel peut être le degré d'aliénation des droits individuels ?
École anglo-saxonne et école continentale
On trouve au XVIIIe siècle 2 réponses, 2 sensibilités. Pour l'école anglo-saxonne (Locke et Hobbes), cette aliénation ne devait être que partielle, les individus conservant un "droit de réserve". Pour l'école continentale, il ne peut y avoir de demi-mesure : l'aliénation est totale. Le souverain étant le peuple, "les hommes ne peuvent s'engager qu'à obéir à leur totalité". Cette dernière constitue une entité essentiellement différente d'une somme arithmétique : il s'agit de la Nation qui bénéficie d'un transfert de l'ensemble des droits des particuliers. La modération graduée d'un Hobbes ou d'un Bossuet (cf. le Cinquième avertissement aux protestants) est étrangère à la pensée rousseauiste pour laquelle le droit de souveraineté s'avère absolu.
Voilà pourquoi Rousseau est généralement présenté comme le précurseur de tous les régimes totalitaires modernes. Mais on trouve également chez Rousseau une distinction fondamentale : gouvernement et souveraineté ne sont point identiques. La souveraineté populaire attribue l'imperium aux dirigeants, c'est un fait, mais elle demeure spécifique "chose-en-soi" qui ne peut être confondue avec la fonction exécutive. Cette dichotomie est un des points remarquables de la science politique moderne (cf. Du contrat social, Livre III, chap. II).
Le danger provient alors de la dynamique du pouvoir, tendance propre à tout pouvoir politique à envahir la dimension souveraine, brisant ainsi les temres du contrat social. Selon Rousseau, "ce vice inhérent et inévitable" est lié à toute société humaine. Ce qui donne à Bertrand de Jouvenel l'occasion de qualifier cette idéologie d'évolutionnisme pessimiste (in Du Principat, Hachette).
La souveraineté populaire rousseauiste est un des concepts les plus ambigus que l'on puisse trouver. A priori démocratique et égalitaire, elle est à l'origine des systèmes idéologiques nationaux des XIXe et XXe siècles. Le style impérial de cette souveraineté essentiellement immanente, son caractère communautaire et politico-historique, joint à une philosophie pessimiste, font de Jean-Jacques Rousseau un des principaux fondateurs de la doctrine de la souveraineté post-chrétienne.
L'idée de souveraineté, de par ses origines, constitue un des concepts-clés de l'histoire politique européenne. Fortement marquée par l'influence du droit privé romain, elle fut durant toute l'époque d'expansion chrétienne, un concept directement rattaché au pouvoir divin. Cette idée connut, au gré des fluctuations idéologiques et politiques, des interprétations sensiblement divergentes. N'est-ce pas, d'ailleurs, le sort réservé à toute tentative de systématisation politique ?
► Ange Sampieru, Vouloir n°54-55, 1989. http://www.archiveseroe.eu
Note 1 : L'Antiquité considérait la première fonction, dite souveraine, comme religieuse ET politico-juridique ainsi que Georges Dumézil l'a démontré dans maints ouvrages.
-
Jean-Baptiste Biaggi, résistant et membre de l’Action française
A l’image des jeunes lycéens qui manifestèrent le 11 novembre 1940, c’est de l’Action française que vinrent les premiers résistants. Des noms comme ceux d’Estiennes d’Orves ou du maréchal Leclerc sont dans toutes les mémoires. D’autres, moins connus et innombrables, prouvent qu’il était possible, si ce n’est logique, d’être résistant quand on était royaliste.
Comment avez-vous connu l’Action française ?
Jean-Baptiste Biaggi : dans mon petit village de Cagnano, en Corse, il y avait un curé, Ange Giudicelli, qui était maurrassien. Il y avait aussi un marin retraité abonné à l’Action Française. Je lisais donc l’Action Française, malgré l’interdiction du vatican. Ensuite j’ai été étudiant d’Action française et délégué de l’Action française à la faculté de droit. et c’est moi qui à ce titre, faisais le discours de bienvenue de Charles Maurras qui tous les ans, venait présider le banquet des étudiants d’Action française. J’assistais régulièrement à ses conférences.
Quel fut votre parcours dans la Résistance ?
Jean-Baptiste Biaggi : Durant la guerre, j’ai combattu, j’ai été blessé. Déclaré inapte à tout service, j’ai passé ma convalescence à Marseille, où je marchais avec deux cannes. C’est là que, par hasard, je rencontre Alain Griotteray. Nous sympathisons et il me demande d’organiser des passages de courriers, de renseignements vers l’Afrique du Nord. A partir de 1942, j’ai organisé le passage par l’Espagne de volontaires. Je continuais aussi à fournir du renseignement. Vous savez, le renseignement, c’est beaucoup plus utile qu’un petit meurtre à la sortie d’un métro parisien. Et puis ça ne provoque pas de représailles sur la population. On se fait prendre, on est fusillé, tout au plus avec ses complices. Mais le charcutier du coin et l’institutrice du village voisin, ils n’ont rien.Je suis allé quelques fois à Vichy, pour faire du renseignement. J’y ai rencontré un ancien camarade de Droit, Joseph Barthélémy, devenu ministre de la Justice de Vichy. Il m’a dit : "A Vichy, il y a plus de résistants que partout ailleurs !"
Ensuite, j’ai été arrêté et mis dans un train de déportation vers Bergen-Belsen. De ce train, je me suis évadé, grâce au corset médical qui me maintenait depuis mes blessures au ventre et au dos. Grâce à l’abbé Le Meur, et à la complicité d’un gardien du camp qui voulait déserter, j’ai remplacé les baleines du corset par des scies à métaux et un tournevis.J’ai ensuite organisé une évasion massive du convoi. Durant le transport, nous sommes quarante-cinq à avoir tenté et réussi l’évasion ! Pour cela, nous avons dû maîtriser les autres prisonniers qui menaçaient de nous dénoncer aux SS ! J’ai repéré le meneur, j’ai saisi mon tournevis, le lui ai mis sur le ventre et je lui ai dit : "Maintenant tu fermes ta gueule ou je te crève !" Il a compris. A cinq, nous avons gagné un petit village, où nous avons été hébergés et cachés par le jeune curé de la paroisse. Puis nous nous sommes procurés de faux papiers grâce à ce curé et au maire corse du village ! Nous avons même dormi dans les salons de la préfecture !De retour à Paris, j’ai repris mes activités à Orion jusqu’à la fin de la guerre. Puis j’ai rejoint les Commandos de France.
La doctrine maurrassienne a-t-elle influencé votre engagement dans la résistance ?
J.-B. Biaggi : c’est véritablement la haine des Allemands qui a motivé mon engagement. L’amour de mon pays martyrisé par ceux que nous appelions "les Boches", et la germanophobie en soi. Il n’y a pas eu de complication dialectique ou intellectuelle, comme chez certains qui ne résistent qu’à partir de 1941 par pure stratégie idéologique. Nous avons eu l’instinct de la Résistance, car Maurras nous avait parfaitement formés. Les Allemands étaient chez nous ; ils ne devaient pas y rester. Donc il fallait les chasser. C’est ce à quoi nous nous sommes employés. Nous avons tenté de toutes nos forces, de chasser les envahisseurs. Ce dont nous avions conscience, c’est de l’intérêt supérieur du pays. C’est ça, le fond de la doctrine maurrassienne. Que Maurras ait eu une autre méthode que nous pour remédier à la crise, c’est conjoncturel. Je le dis très franchement et même fièrement : j’ai toujours été maurrassien ; je le suis toujours resté ; et à mon âge, je crois bien devoir vous dire que je le resterai toujours. La Résistance était un réflexe patriotique. L’école politique qui enseignait le patriotisme au plus haut degré, c’était l’Action française.
Un dernier mot sur Maurras ?
J.-B. Biaggi : Il faut raconter une anecdote de Marcel Jullian répondant à un proche du général De Gaulle qui, après la victoire, lui reprochait son attachement à Maurras, coupable d’intelligence avec l’Allemagne : "Vous avez très mal choisi, monsieur. Maurras avait toutes les formes possibles de l’intelligence, sauf celle là !"
-
Méridien zéro : Hommage à Maurice Bardèche…
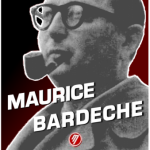
RBN Méridien zéro cliquez ici
-
Charles Maurras vu par Tony kunter
-
LA GUERRE DES GAULES
-
Carl Schmitt, Leo Strauss et le concept du politique
Avec ses rééditions successives1, le Begriff des Politischen occupe une place exceptionnelle dans l‟oeuvre de Carl Schmitt (1888-1985). D‟abord, il accompagne2 toute cette oeuvre, de 1927 à 1971. Ensuite, il s‟agit du livre le plus célèbre du juriste allemand et de l‟un de ceux qui lui ont valu le plus d‟hostilité. D‟après Heinrich Meier, cette hostilité ressortait de l‟intention de Schmitt. « À une époque où “rien n‟est plus moderne que la lutte contre le politique”, il lui importe de faire ressortir l‟„irréductibilité‟ du politique et l‟„inéluctabilité‟ de l‟hostilité, quitte à être lui-même l‟ennemi de tous ceux qui ne veulent plus se reconnaître d‟ennemis »3. Mais loin de se contenter de cet « examen », il refuse l‟abolition du politique et de l‟hostilité. Il justifie implicitement ce refus éthique par un credo religieux, et explicitement par la dénonciation des effets pervers de la criminalisation de la guerre ou de l‟ennemi. Il n‟est pas possible de se cantonner à l‟interprétation4 qui confine le Begriff des Politischen à la recherche « modeste »5 d‟un critère permettant de délimiter ce qui est politique, le fameux critère ami-ennemi en l‟occurrence. Carl Schmitt veut refonder théologiquement le politique, le dogme du péché originel lui servant de credo anthropologique. Enfin, le Begriff des Politischen est le seul ouvrage à travers lequel l‟auteur mène avec un commentateur : Leo Strauss, un dialogue mi-avoué, mi-caché, qui l‟entraîne à réviser son argumentation. Dans sa discussion avec Schmitt, Strauss se place sur le terrain de la philosophie politique en faisant abstraction de la théologie politique schmittienne, mais sa critique obtient que le juriste se révèle davantage « théologien politique », tant les réponses qu‟il donne font apparaître la foi orientant sa doctrine. Le Commentaire de Strauss, seul auteur contemporain dont Schmitt ait dit qu‟il était un « philosophe important », est donc exceptionnel parmi les études qui ont été consacrées au Begriff6, car de l‟aveu de Schmitt, personne n‟a mieux compris que lui son intention en rédigeant l‟essai7.
I. Le politique, l’hostilité, la guerre et l’Etat
L‟approche schmittienne obéit à la problématique fameuse de la décision et de l‟exception. La guerre est l‟épreuve décisive et l‟exception est « révélatrice du fond des choses », puisque Bellone manifeste la logique ultime de la configuration ami-ennemi. Politique et Etat sont en relation dialectique. Le noyau de l‟Etat, c‟est la relation de protection et d‟obéissance, puisqu‟il a pour fonction d‟assurer la sécurité des personnes et des biens (Etat = sécurité). Le noyau du politique, c‟est la relation ami-ennemi, puisque c‟est dans les situations d‟exception que se manifeste l‟essence du politique (politique = hostilité). Etat et politique n‟en sont pas moins liés, car l‟Etat, en tant qu‟unité politique, doit conserver le monopole de la désignation de l‟ennemi8 s‟il veut continuer d‟assurer la protection et d‟imposer l‟obéissance. C‟est en ce sens qu‟il est souverain, c‟est-à-dire capable de maintenir l‟ordre public. Or, les situations exceptionnelles que sont la révolution ou la guerre civile montrent que le monopole étatique peut être remis en question, en cas de dissensus extrême quant à la légitimité du pouvoir. De même qu‟il définit le politique par la relation d‟hostilité, Schmitt définit l‟Etat à travers son antonyme : la guerre civile. Tout antagonisme n‟est jamais complètement supprimé au sein de l‟Etat. Le rapport ami-ennemi demeurant latent au sein de l‟unité politique, celle-ci peut être brisée lorsque les oppositions internes atteignent une certaine intensité, dont le degré extrême est la guerre civile. Celle-ci voit la relation d‟hostilité (la relation politique) s‟exacerber entre l‟Etat et les partis révolutionnaires ou entre les différents partis ennemis, jusqu‟à la victoire de l‟un des protagonistes, ou l‟établissement d‟un compromis entre eux, ou leur épuisement mutuel.
En tant que duel, la guerre suppose la désignation de l‟ennemi, c‟est-à-dire l‟autre, l‟étranger, l‟antagoniste, dont l‟existence représente concrètement la négation de notre propre forme d‟existence, sans que le conflit puisse être réglé pacifiquement. L‟ennemi n‟est ni le concurrent ni l‟adversaire, car « les concepts d‟ami, d‟ennemi, de combat tirent leur signification objective de leur relation permanente à… la possibilité de provoquer la mort physique »9. L‟ennemi n‟est pas non plus l‟inimicus, c‟est l‟hostis, l‟ennemi public, non l‟ennemi privé. Carl Schmitt repousse l‟accusation selon laquelle le christianisme n‟aurait point le sens du polemos. Le commandement : « aimez vos ennemis », concerne l‟inimicus, non l‟hostis. Visant la paix des coeurs, non la paix politique, la doctrine évangélique « ne signifie surtout pas que l‟on aimera les ennemis de son peuple et qu‟on les soutiendra contre son propre peuple ». L‟ennemi au sens public n‟impliquant aucune haine personnelle à son encontre, ce n‟est que dans la sphère privée que cela a un sens d‟« aimer son ennemi ». Il est essentiel pour notre auteur catholique de dissocier christianisme et pacifisme. Mais, observe Löwith, Schmitt est obligé, pour montrer que l‟exigence chrétienne n‟affecte pas sa distinction politique, de ramener d‟une façon libérale l‟éthique de l‟Evangile à une affaire privée et non publique, de faire de la guerre (de la mort physique), à la place du Jugement dernier (du salut de l‟âme), le « cas extrême » déterminant10 !
II. Affirmation du politique et critique de la « philosophie de la culture » (« dialogue I »)
L‟idée que la guerre, non la paix, constitue l‟horizon de la politique, d‟où la primauté du concept d‟ennemi par rapport à celui d‟ami, peut conduire à deux positions. On verra dans l‟Etat l‟instance qui permet de dépasser la crainte de la mort violente. Le libéralisme a ainsi une conception instrumentale de l‟État, mis au service de la vie, de la liberté et de la propriété des individus. Ou bien, l‟hostilité ne pouvant jamais être entièrement éliminée, on continuera de voir dans le risque du conflit mortel l‟essence de la relation politique. Qu‟on insiste sur le droit à la sécurité ou sur l‟inéluctabilité du conflit, les conséquences de la définition du politique par les situations extrêmes, de Machiavel et Hobbes à Max Weber et Carl Schmitt, changent donc profondément. D‟un côté, il s‟agira, au nom du « progrès de la civilisation », de dépasser l‟existence politique en la résorbant dans des activités économiques, sociales, culturelles… De l‟autre, il s‟agira, au nom des « valeurs héroïques », de préserver l‟existence politique en affirmant son irréductibilité à l‟économie, à la société, à la culture… Telle est la problématique de Schmitt. Tel est aussi le premier « dialogue » entre Schmitt et Strauss.
La « vérité » du politique bat en brèche l‟autonomie du sujet, car elle le soumet à une obligation supra-personnelle. Avant Hegel, Pufendorf avait déjà observé que l‟état politique est tout autre que l‟état social, parce qu‟il implique pour l‟homme un changement radical de condition, à savoir « l‟assujettissement à une autorité disposant du droit de vie et de mort sur lui-même »11. L‟individu peut être libre dans les sphères de l‟économie, de la société, de la culture ; il ne l‟est plus face au politique. Il « peut, observe Strauss, donner sa vie volontairement pour la cause qu‟il voudra ; c‟est là, comme tout ce qui est essentiel à l‟homme dans une société… libérale, une affaire tout à fait privée, c‟est-à-dire relevant d‟une décision libre »12. Mais la guerre le place dans une situation qui le contraint existentiellement. La « liberté pour la mort » de la décision individuelle cède la place au « sacrifice de la vie » que l‟État est en droit d‟exiger (Karl Löwith). « La guerre n‟est pas seulement „le moyen politique ultime‟, c‟est l‟épreuve décisive, et pas seulement dans un domaine „autonome‟ -celui du politique- mais tout simplement pour l‟homme parce qu‟elle a une relation permanente à la possibilité réelle de provoquer la mort physique ; cette relation, constitutive du politique, montre que le politique est fondamental et non pas un „domaine relativement autonome‟ parmi d‟autres. Le politique est le facteur décisif »13.
C‟est ce passage du Commentaire de Strauss de 1932 que Carl Schmitt développe en 1933 pour souligner son opposition à cette philosophie et à ses « domaines autonomes ». On ne pourra continuer à parler de « l‟autonomie » de la morale, de l‟art, de l‟économie…, dit-il, qu‟aussi longtemps que l‟on méconnaîtra la nature du politique. Du point de vue du libéralisme, « la culture », c‟est la totalité « de la pensée et de l‟action des hommes » qui se distribue en « domaines divers et relativement autonomes ». Or, en affirmant la spécificité du politique, « non au sens où il correspondrait à un domaine nouveau qui lui serait propre », Schmitt conteste cette théorie des « domaines autonomes ». Cette contestation implique « une critique fondamentale du concept dominant de culture »14. Cette critique passe d‟abord par celle de l‟autonomie de l‟art, axe central de la « philosophie de la culture » libérale. Précisément, du Politische Romantik de 1919 au Hamlet oder Hekuba de 195615, en passant par la conférence sur « L‟ère des neutralisations et des dépolitisations » et les versions du Begriff des Politischen, Schmitt récuse continûment l‟autonomie de l‟art. « L‟évolution qui part de la métaphysique et de la morale pour aboutir à l‟économie passe par l‟esthétique, déclare-t-il en 1929, et la consommation et la jouissance esthétiques, si raffinées soient-elles, représentent la voie (directe) vers une emprise totale de l‟économie sur la vie intellectuelle et vers une mentalité qui voit dans la production et dans la consommation les catégories centrales de l‟existence humaine ». Après 1932, les remarques de Strauss poussent Schmitt à souligner encore davantage son opposition à la conception libérale de l‟art et à supprimer carrément l‟idée des « domaines relativement autonomes »16.
Par son commentaire, le philosophe protège le juriste, qui le lit attentivement, du malentendu consistant à dire qu‟« après que le libéralisme a fait reconnaître l‟autonomie de l‟esthétique, de la morale, de la science, de l‟économie, etc., (Carl Schmitt) veut quant à lui faire reconnaître l‟autonomie du politique, contre le libéralisme mais en restant dans l‟esprit des aspirations libérales à l‟autonomie »17. Un tel projet n‟est pas celui de Schmitt. Soulignant son opposition à ladite « philosophie de la culture », il écrit en 1933, après les observations straussiennes : « l‟unité politique est toujours, tant qu‟elle existe, l‟unité décisive, totale et souveraine. Elle est „totale‟ parce que, d‟une part, toute occasion qui se présente peut devenir politique, et de ce fait, être concernée par la décision politique, et que, d‟autre part, l‟homme est saisi tout entier et existentiellement dans la participation politique. La politique est le destin »18. C‟est pourquoi il ne saurait y avoir de « société » politique, mais seulement une « communauté » politique. Du point de vue de l‟individualisme libéral, rien ne permet d‟exiger le sacrifice de l‟individu. Au contraire, le jus vitae ac necis montre à la fois combien l‟unité politique -l‟Etat- est au-dessus de toute espèce d‟association et combien sont précaires les « droits de l‟homme », puisqu‟en cas extrême -en cas de guerre, « vérité » du politique- l‟Etat a la faculté d‟ordonner à ses nationaux d‟infliger la mort et de risquer leur vie19.
III. L’appréciation de Hobbes (« dialogue II »)
Le mouvement essentiel de la modernité, dont le libéralisme est le moteur, est caractérisé par la négation du politique (au sens schmittien). Par conséquent, la première récusation du libéralisme, comme l‟a vu Strauss, c‟est l‟affirmation du politique. Le libéralisme a « déformé et dénaturé l‟ensemble des notions politiques »20. Mais il n‟a pu échapper au politique. Il « a fait de la politique en parlant un langage antipolitique »21. Ressaisir la « vérité » du politique implique donc d‟affirmer le politique contre le libéralisme. Jusqu‟en 1933, Schmitt est conscient que le « systématisme de la pensée libérale » n‟a pas été remplacé en Europe, « en dépit de ses revers ». Il signale par là même la difficulté de son entreprise puisqu‟il se trouve contraint d‟utiliser des éléments de cette pensée. Aussi la mise en place de ses idées n‟est-elle que provisoire. Comme il le dit lui-même, il veut simplement « fournir un cadre théorique à un problème non délimitable », « un point de départ »22. Strauss renforce ses intentions en interprétant sa position théorique comme une tentative de négation rigoureuse du libéralisme : c‟est une « critique radicale du libéralisme qu‟il ambitionne ». Mais le juriste, poursuit-il, ne mène pas cette critique à son terme car, telle qu‟elle est menée, elle reste « contenue (dans) le „systématisme de la pensée libérale‟ toujours vainqueur à ce jour ». Ce qui l‟intéresse donc, « c‟est la critique du libéralisme faisant signe vers son accomplissement ». Or, celle-ci « n‟est possible que si elle s‟appuie sur une compréhension adéquate de Hobbes », le fondateur du libéralisme d‟après Strauss23. Mais Schmitt n‟a pas compris Hobbes. Tel est le noyau du commentaire straussien, qui voit une contradiction centrale dans le fait que le juriste allemand se place sous le patronage du philosophe anglais.
Strauss montre que Schmitt a remis en vigueur le concept hobbesien d‟« état de nature », car sa notion du politique n‟est pas autre chose que le status naturalis rejeté dans l‟oubli par la « philosophie de la culture ». Celle-ci, arguant de l‟autonomie de la « culture » dans sa totalité, a oublié que cette « culture » est « culture de la nature » et que son fondement ultime, c‟est la nature humaine. Cette nature humaine, Hobbes la pense à partir de la situation-limite qu‟est la lutte à mort. Il définit le status naturalis comme un status belli, lequel « ne consiste pas dans un combat effectif, mais dans une disposition avérée allant dans ce sens ». Or, pour Schmitt aussi, le politique ne réside pas « dans la lutte elle-même », mais « dans un comportement commandé par l‟éventualité effective de celle-ci ». De ce point de vue, le politique est donc « le status „naturel‟, fondamental et extrême de l‟homme ». Strauss est conscient que « l‟état de nature » de l‟Allemand est toutefois très différent de celui de l‟Anglais. Chez celui-ci, il s‟agit d‟un état de guerre abstrait entre individus, où chacun est l‟ennemi de chacun. Chez celui-là, il s‟agit d‟un état de guerre concret entre groupes, la relation politique étant orienté par l‟ennemi et l‟ami. Surtout, Hobbes conçoit le status naturalis comme un état qui doit être dépassé et aboli dans le status civilis, la disparition de la peur de l‟autre ne faisant qu‟un avec l‟institution de l‟Etat, dont la fonction est de délivrer les hommes du bellum omnium contra omnes. « A cette négation de l‟état de nature ou du politique, Schmitt oppose l‟affirmation du politique ». Cette opposition est masquée par le fait que, chez le philosophe de Malmesbury, « l‟état de nature » subsiste entre les nations et qu‟il n‟y a donc pas une « négation totale du politique ». Plus généralement, l‟enracinement anthropologique du conflit implique que l‟artifice ne pourra jamais se substituer entièrement à la nature. La paix reste menacée, à l‟intérieur comme à l‟extérieur, car il n‟y a pas parmi les hommes une raison universelle qui ferait l‟accord de tous les peuples24.
Mais la différence avec le juriste devient manifeste lorsque le politique est perçu comme une « réquisition existentielle par une force investie d‟autorité »25. Pour Schmitt, l‟Etat peut exiger des citoyens qu‟ils soient prêts à tuer et à mourir. Pour Hobbes, l‟Etat est déterminé par une revendication de l‟individu (la sécurité) s‟appuyant sur un droit naturel (le droit d‟autoconservation) antérieur et supérieur à l‟Etat. En ce sens, l‟Etat ne peut exiger de l‟individu qu‟une obéissance conditionnelle, qui n‟entre pas en contradiction avec la préservation de la vie, dont la protection est la raison dernière de l‟Etat. S‟il affirme qu‟un citoyen ne peut refuser de risquer sa vie dans la guerre, lorsque le salut de l‟Etat l‟exige, c‟est seulement parce qu‟il est rationnel que le citoyen protège dans la guerre l‟institution qui assure sa protection dans la paix. Tous les devoirs civiques dérivent du droit à la vie, seul droit inconditionnel. L‟individu est terminus a quo et terminus ad quem de la construction hobbésienne. Par conséquent, si l‟on entend la politique au sens schmittien, il faut dire que l‟auteur du Léviathan voulait affranchir les hommes de cette politique-là et qu‟il est le penseur « antipolitique » par excellence (P. Manent). S‟il souligne le caractère dangereux de l‟homme pour l‟homme, c‟est dans l‟intention de domestiquer ce caractère, tout comme il essaie de surmonter le status naturalis. Plus encore, il considère comme innocente la « méchanceté » de l‟homme, puisqu‟il nie le péché. Et il nie le péché parce qu‟en relativiste, il ne reconnaît aucune obligation supérieure qui restreindrait la liberté humaine. « Avec un tel point de départ, on ne peut élever des objections de principes contre la proclamation des droits de l‟homme considérés comme des revendications adressées par l‟individu à l‟Etat et contre l‟Etat »26. Leo Strauss développe et précise son propos en 1954 : « s‟il nous est permis d‟appeler libéralisme la doctrine politique pour laquelle le fait fondamental réside dans les droits naturels de l‟homme et pour laquelle la mission de l‟Etat consiste à protéger (ces) droits, il nous faut dire que le fondateur du libéralisme fut Hobbes »27.
L‟opposition entre Hobbes et Schmitt porte encore sur le conflit entre « l‟affirmation du politique » et « l‟affirmation de la civilisation ». Strauss montre que les principes individualistes qui poussent l‟Anglais à « nier » le politique sont les principes à l‟origine du projet visant à « l‟unité du monde » dépolitisé et pacifié. C‟est précisément contre ce projet, on le verra, que l‟Allemand défend l‟idée de « l‟inéluctabilité » du politique. Hobbes est l‟initiateur de l‟idéal bourgeois de la civilisation, l‟idéal de la sécurité et de la prospérité, qui est à la base de la théorie des droits subjectifs développée par le libéralisme. Si sa doctrine individualiste est adossée à une doctrine autoritaire, c‟est parce qu‟« il sait et voit contre quoi il faut imposer l‟idéal libéral de la civilisation : contre la méchanceté naturelle de l‟homme ; dans un monde qui n‟est pas libéral, il installe les fondements du libéralisme contre la nature non libérale de l‟homme, tandis que ses successeurs, ignorants de leurs présupposés et de leurs fins, font confiance en la bonté originelle de la nature humaine ou nourrissent l‟espoir, sur la base d‟une neutralité censément scientifique, d‟améliorer la nature, alors que rien dans l‟expérience que l‟homme fait de lui-même ne permet de l‟espérer ». L‟idéal hobbésien : paix, sécurité, prospérité, corrobore parfaitement la définition polémique du bourgeois de Hegel, reprise par Schmitt. L‟affirmation du politique équivaut au refus de l‟existence « bourgeoise » dont l‟Anglais fait l‟éloge, puisqu‟il remplace l‟ethos de l‟honneur par l‟ethos de la crainte, passion rationnelle à l‟origine du status civilis. In fine, l‟auteur du Léviathan, dans un monde non libéral, jette les fondations du libéralisme, tandis que l‟auteur du Begriff, dans un monde libéral, entreprend la critique du libéralisme, dont il voit la racine dans la négation hobbesienne de « l‟état de nature »28.
De 1927 à 1933 et au-delà, Carl Schmitt a modifié sensiblement son avis sur Hobbes, de manière extrêmement significative après le Commentaire de Leo Strauss. En 1927, il est « de loin le plus grand et peut-être le seul penseur politique vraiment systématique ». En 1932, il devient un « grand et vraiment systématique penseur ». En 1933, il n‟est plus qu‟« un grand et vraiment systématique penseur », chez qui, « malgré son individualisme extrême, la conception „pessimiste‟ de l‟homme est si forte qu‟elle maintient le sens politique ». La caractérisation de la doctrine hobbésienne se transforme parallèlement. En 1927, Schmitt parle de « son système de pensée spécifiquement politique » ; en 1932, d‟« un système de pensée spécifiquement politique » ; en 1933, d‟« un système de pensée qui sait encore poser des questions spécifiquement politiques et y répondre ». De 193429 à 193830, la critique de la philosophie du droit et de la philosophie de l‟Etat de Hobbes se précisera. Les modifications apportées au Begriff en 1933 montrent que l‟auteur suit son commentateur, même s‟il ne cite pas ce « savant juif ». Hobbes n‟est pas un penseur « politique » au sens où Schmitt entend ce terme. Ses principes individualistes, en particulier sa désignation de la mort violente comme « le plus grand des maux », contredisent l‟affirmation schmittienne du politique. Malgré son idéal bourgeois de la civilisation, son pessimisme anthropologique maintient chez lui le sens du concept. C‟est pourquoi Schmitt ne peut être totalement considéré comme un « anti-Hobbes ». Fait significatif : à partir de 1938, il identifie son destin à celui du solitaire de Malmesbury31.
IV. Affirmation du politique, éthique et critique du relativisme (« dialogue III »)
L‟affirmation schmittienne du politique est une affirmation de l‟éthique, au sens hégélien. Comment cela s‟accorde-t-il avec la polémique contre la morale qui traverse le Begriff ? L‟explication, c‟est que « morale » signifie ici une morale particulière, qui est en totale contradiction avec le politique, à savoir la morale humanitaire et pacifiste. Comme Max Weber32, Carl Schmitt identifie morale et morale humanitaire. En ne se détachant pas de la conception de ses adversaires, il ne remettrait donc pas en cause la prétention de cette morale-là à être la morale. C‟est pourquoi, selon Leo Strauss, « il reste prisonnier de la thèse qu‟il combat »33. Cela ne l‟empêche pourtant pas de porter un jugement éthique sur la morale au sens libéral. L‟affirmation du politique requiert ainsi une conception éthique, même si la compréhension du politique tend à infirmer tout jugement normatif sur le politique. L‟affirmation de l‟éthique consubstantielle à l‟affirmation du politique équivaut au double refus de « l‟existence du bourgeois » et de « l‟idéal de la civilisation », qui entend faire de ce type d‟existence un destin universel, en prétendant construire une société sans politique ni Etat.
Cette double affirmation correspond à la récusation de l‟individualisme au nom de la vertu civique. Si Hegel, selon le juriste, est un « penseur politique », c‟est aussi parce qu‟il a contre-distingué le bourgeois du citoyen : la condition bourgeoise, inscrite dans le droit privé et l‟économie marchande, est la négation de l‟éthique de l‟Etat. Se référant à cette « première définition polémique et politique », Schmitt caractérise le bourgeois comme « l‟homme qui refuse de quitter sa sphère privée non politique, protégée du risque, et qui, établi dans la propriété privée et dans la justice qui régit la propriété privée, se comporte en individu face au tout, qui trouve une compensation à sa nullité politique dans les fruits de la paix et du négoce, qui la trouve surtout dans la sécurité totale de cette jouissance, qui prétend par conséquent demeurer dispensé de courage et exempt du danger de mort violente »34. Mais l‟individu n‟a d‟existence « authentique » qu‟au sein d‟une communauté pour laquelle il est prêt au sacrifice. Lorsque le citoyen s‟expose au risque de la mort violente pour son peuple, dit Hegel, le courage prend « la figure la plus haute » : c‟est un courage personnel « qui n‟est plus personnel »35. Clausewitz, de son côté, célèbre dans la guerre, le « courage d‟endosser des responsabilités », le « courage face au danger moral » et le triomphe sur « l‟indécision » grâce à « l‟acuité d‟un esprit devinant toute vérité »36. Quant à Max Weber, il souligne que l‟Etat peut exiger « de l‟individu qu‟il affronte le sérieux de la mort pour les intérêts de la communauté »37. Au contraire, l‟idéal libéral d‟un monde pacifié est l‟idéal d‟« un monde sans politique ». « Ce monde-là pourrait présenter une diversité d‟oppositions et de contrastes peut-être intéressants, toutes sortes de concurrences et d‟intrigues, mais il ne présenterait logiquement aucun antagonisme au nom duquel on pourrait demander à des êtres humains de faire le sacrifice de leur vie »38.
Cet idéal d‟un « état idyllique de paix universelle où la dépolitisation est totale et définitive », Schmitt ne le rejette nullement comme « utopique ». Ne déclare-t-il pas qu‟il ignore s‟il ne pourrait se réaliser ? Il l‟a en horreur. Un monde sans distinction ami-ennemi est un monde où « il n‟y aura plus que des faits sociaux purs de toute politique : idéologie, culture, civilisation, économie, morale, droit, arts, divertissements, etc., mais il n‟y aura plus ni politique ni Etat »39. Strauss insiste sur le mot « divertissements » car il est le finis ultimus de l‟énumération. Ce que Schmitt cherche à faire comprendre, dit-il, c‟est que le politique et l‟Etat sont la seule garantie qui préserve le monde de devenir un monde de « divertissements ». En 1963, l‟auteur du Begriff note que son commentateur a souligné à juste titre ce mot. A cette date, il mettrait « jeu » (Spiel) pour faire ressortir l‟opposition à « sérieux » (Ernst)40. Ce n‟est pas par hasard s‟il utilise en 1932 ledit mot, qui a une longue histoire. Pascal appelait « divertissements » ce par quoi les hommes se fuient eux-mêmes. Hegel parlait des « divertissements » auxquels se livrent ceux qui renoncent au risque politique41. Quant à Clausewitz, il voyait dans la guerre « un moyen sérieux au service d‟une cause sérieuse », la guerre étant le « côté sérieux » de la vie ; l‟homme y est placé devant le risque de son trépas ; c‟est l‟homme nu qui apparaît alors42. Le « sérieux » de la guerre rend ainsi contingent et relatif ce qui est, par nature, contingent et relatif : la vie, la liberté, la propriété privées, tout ce à quoi l‟état de paix semble conférer aux individus une valeur suprême. Un monde sans politique, si « intéressant » et « divertissant » fût-il, n‟a rien qui puisse exiger des hommes qu‟ils risquent leur vie. Dans un monde politique, par contre, il peut y avoir quelque chose qui justifie ce risque. Schmitt exprime son effroi et son mépris pour l‟idéal d‟un monde dépolitisé. Cet idéal ne saurait être celui d‟un homme digne de ce nom. Il n‟est possible qu‟en raison de l‟oubli des enjeux véritables. L‟affirmation du politique contre un idéal qui réduirait l‟humanité à « une société coopérative de consommation et de production »43, est décidément une affirmation de l‟éthique. « Le sérieux de la vie humaine est menacé quand le politique est menacé », écrit Strauss en écho44. En augustinien, Schmitt récuse la « paix de Sardanapale », le régime de lâche tolérance et de jouissance qui ne veut pas que l‟ennemi -celui qui n‟admet pas cette forme de bonheur- porte atteinte à sa félicité. Un chrétien ne saurait tolérer ni cette « paix » ni cette « félicité »45.
Leo Strauss observe qu‟affirmer le politique en tant que tel revient à affirmer le combat sans souci de la cause pour laquelle il est mené, donc avoir un comportement « neutre » à l‟égard de tous les regroupements ami-ennemi. Carl Schmitt respecterait tous ceux qui sont prêts à se battre et à périr, quel que soit le contenu de leur décision et le sens de leur action. Il serait aussi tolérant que les libéraux, bien que pour des raisons opposées. « Alors que le libéral tolère et respecte toutes les convictions „honnêtes‟ à condition que l‟ordre légal et la paix soient pour elles sacro-saints, celui qui affirme le politique comme tel tolère et respecte toutes les convictions „sérieuses‟, c‟est-à-dire toutes les décisions qui sont orientées vers la possibilité de la guerre. L‟affirmation du politique comme tel se révèle être un libéralisme inversé »46. Ainsi se vérifierait le constat straussien que le « systématisme de la pensée libérale » reste vainqueur et n‟a pas été remplacé. Ce constat recoupe la critique de Löwith sur « l‟occasionnalisme » de la pensée schmittienne. L‟indifférence radicale à l‟égard des contenus politiques caractériserait le concept « formel » et « nihiliste » du juriste, qui voit l‟essence du politique non plus dans la polis (l‟ordre des choses humaines) mais dans le jus belli (le cas extrême existentiel). La guerre, id est le fait d‟être disposé à tuer et à mourir, serait « l‟instant suprême », sans qu‟importe la cause47. Le critique de « l‟occasionnalisme » aurait pu citer Jurieu, l‟adversaire de Bossuet : c‟est par « occasion que les rois ont des ennemis à vaincre, c‟est par institution qu‟ils ont des sujets à gouverner ». Th. Heuss, qui deviendra Président de la République fédérale d‟Allemagne, reproche lui aussi au juriste la réduction de « l‟essence du politique au formalisme indigent de la relation ami-ennemi, la banalisation des différences spécifiques entre engagements politiques, dont les valeurs respectives qui en font la substance sont évacuées au profit de la forme anonyme du conflit comme tel »48. Mais l‟affirmation du combat comme tel n‟est pas le « dernier mot » de Schmitt. Srauss lui-même l‟a reconnu. « Son dernier mot, c‟est „l‟ordre des choses humaines‟ ».
Carl Schmitt n‟est pas un relativiste à la Max Weber, comme le confirmera sa critique de la philosophie des valeurs49. Le sociologue allemand a posé le double principe de la neutralité axiologique des sciences et de la liberté individuelle des choix valoriels. Ce double principe signifie que les valeurs sont des préférences subjectives non rationalisables, séparées de l‟analyse scientifique et ne pouvant faire l‟objet d‟une science. Il ne saurait y avoir une « science des valeurs » car le Beau, le Bien, le Vrai sont affaires d‟opinion subjective et relative. La séparation des faits et des valeurs implique que la science soit éthiquement neutre, qu‟elle réponde à des problèmes de « fait » et de causalité, qu‟elle soit incompétente devant des problèmes de « valeur » et de finalité, donc impuissante à résoudre les antagonismes valoriels décisifs. Puisqu‟il ne peut y avoir de connaissance authentique du devoir-être et que les valeurs sont irréductiblement plurielles, la solution wébérienne, à la fois agnostique et agonale, est de laisser la décision libre, non rationnelle, à chaque individu. Plus que Schmitt, c‟est Strauss qui a examiné la dialectique de la raison et de la valeur chez Max Weber. Cet examen permet de montrer l‟opposition entre le juriste et le sociologue. L‟homme est libre, dit Weber, dans la mesure où il est guidé par un examen rationnel des fins et des moyens. Les moyens sont déterminés par la rationalité instrumentale, qui met la raison au service des passions. Les fins sont déterminées par le choix des valeurs, qui transfigurent les passions. La dignité humaine est de définir ces valeurs et d‟obéir à la maxime : « deviens ce que tu es » ou « choisis ton destin ». Un impératif catégorique est apparemment conservé : « tu auras des idéaux ». Mais cet impératif n‟est que formel, car il ne détermine pas le contenu des idéaux. « Ecoute Dieu ou diable », mais lutte résolument pour une cause, tel devient l‟idéalisme wébérien. Max Weber en arrive à mettre sur un même plan la raison et les valeurs irrationnelles : « tu auras un idéal » se transforme en « tu vivras passionnément ». Dès lors, qu‟est-ce qui autorise à mépriser la médiocrité au nom des valeurs, si l‟on rejette les obligations éthiques au nom du relativisme de ces mêmes valeurs ? Le sociologue admet que c‟est seulement par un jugement de valeur que l‟on tient les « spécialistes sans âme et les sybarites sans coeur » pour des êtres humains avilis. L‟énoncé final est donc : « tu auras des préférences ». Pour Schmitt comme pour Strauss, c‟est ce relativisme qui est la source du nihilisme50.
En 1933, le juriste, désireux d‟éviter le malentendu selon lequel il affirmerait le combat sans se soucier de la causa, explicite l‟ancrage et l‟orientation théologiques de son affirmation du politique. Il souligne la « distinction métaphysique entre la pensée agonale et la pensée politique », qui « apparaît dans toute analyse approfondie de la guerre ». Elle est notamment apparue dans la confrontation entre Ernst Jünger et Paul Adams. Le premier représente le principe agonal : « l‟homme n‟est pas fait pour la paix », tandis que le second voit le sens de la guerre dans l‟avènement de l‟autorité, de l‟ordre et de la paix. Dans cette controverse, Schmitt ne se trouve pas du côté du nationaliste « belliciste », mais du catholique « autoritaire ». Pas plus que l‟art, le combat ne contient son but en lui-même. Politique et guerre ne sont pas des éléments d‟une « vision esthétique du monde ». Des formules du type : « la résolution pour la résolution » ou « décider pour décider » ne caractérisent pas leur véritable substance. A cet égard, le juriste ne se situe pas dans la lignée de Nietzsche ou de Max Weber. Il est dans une « opposition métaphysique » avec Jünger, qui retire de la guerre la leçon de « l‟agonalité ». Il réaffirme cette opposition en 1936. Le différend sur l‟essence du politique ne porte pas sur la question : la politique peut-elle ou non renoncer au combat ? Elle ne le pourrait pas sans cesser d‟être la politique. Elle porte sur une autre question : où le combat trouve-t-il son sens ? Dans la conception « agonale », celle de Jünger, la guerre trouve en elle-même son sens, son droit et son héroïsme. Elle est ainsi « mère de toutes choses » (Héraclite). Dans la conception « politique », celle d‟Adams ou de Schmitt, la guerre est un moyen de la politique et son sens est d‟être menée « pour faire advenir la paix »51. L‟affirmation du politique est ainsi bien autre chose que l‟affirmation pure et simple du combat. La théorie schmittienne n‟est donc pas un « occasionnalisme » ni un « libéralisme inversé ». La morale humanitaire et pacifiste n‟est pas inversé en « son autre », la morale guerrière. C‟est dans la perspective « théologico-politique » qui est la sienne qu‟il « précise » sa pensée au sujet des guerres saintes et des croisades de l‟Eglise. En 1927, la rhétorique de la politique « pure » ne leur laisse aucune place. En 1932, ce sont des « entreprises » qui « comme d‟autres guerres reposent sur une décision d‟hostilité ». En 1933, elles reposent « sur une décision d‟hostilité particulièrement authentique et profonde »52.
V. De l’anthropologie à la théologie politique (« dialogue IV »)
Carl Schmitt prétend fonder théologiquement le politique : le politique se déploie entre ces deux extrêmes que sont le péché ou la « méchanceté » humaine et le miracle ou « l‟exception ». Parallèlement, la modernité libérale est appréhendée comme une « chute », d‟où l‟attente d‟une « rédemption » (M. Revault d‟Allonnes). Leo Strauss a renforcé la position de l‟auteur tout en faisant abstraction de sa théologie politique, mais les questions qu‟il soulève et les contradictions qu‟il révèle poussent ce dernier « à donner des réponses qui font d‟autant mieux ressortir la foi sous-tendant sa doctrine »53. Le « dialogue » entre le juriste et le philosophe est particulièrement manifeste quand il porte sur les arguments qu‟avance le premier et que récuse le second pour prouver « l‟inéluctabilité » du politique, à savoir : l‟affirmation du « caractère dangereux » de l‟homme, credo anthropologique dont le pivot est la foi dans le péché originel.
Le Begriff des Politischen s‟appuie sur une anthropologie pessimiste. Considérer l‟homme comme un être « dangereux », pas simplement « mauvais », est le postulat spécifique du politique au sens schmittien, non le postulat de la théologie chrétienne. En effet, le problème de la nature humaine n‟a pas été tranché par la doctrine catholique, à la différence de la doctrine protestante qui voit l‟humanité radicalement corrompue. Elle ne parle pas, à l‟instar des penseurs contre-révolutionnaires du XIXème siècle, d‟une déchéance humaine absolue. Elle parle seulement de « blessure » en laissant subsister la possibilité d‟aller vers le bien. D‟un point de vue religieux, Jacques Maritain, par exemple, a donc raison de critiquer Carl Schmitt et ceux qui exagèrent la malignité de l‟homme. Mais le juriste n‟entend pas suivre un dogme ; il entend récuser l‟axiome de l‟homme bon, à travers une décision « théologico-politique », id est une prise de position sur la nature humaine. De son point de vue, toute doctrine politique prend d‟une manière ou d‟une autre position sur cette question et toute doctrine politique « véritable » se fonde sur une conception négative de la nature humaine54. On pourrait ainsi classer « toutes les théories de l‟Etat et toutes les doctrines politiques en fonction de leur anthropologie sous-jacente », selon qu‟elles posent en hypothèse un homme mauvais ou un homme bon de nature55.
Cette distinction « sommaire » peut revêtir de multiples formes. Mais elle est déterminante, car on ne saurait échapper au présupposé anthropologique, souligne Schmitt. Les théories qui postulent un homme bon de nature sont, d‟une part, les théories libérales, d‟autre part, les théories anarchistes. Pour les premières, la bonté de l‟homme est un argument pour mettre l‟Etat au service d‟une société qui « trouve son ordre en elle-même ». Pour les secondes, la bonté de l‟homme sert à la négation de l‟Etat, « le radicalisme ennemi de l‟Etat (croissant) en fonction de la foi en la bonté radicale de la nature humaine », car l‟un est lié à l‟autre. Le libéralisme ne va pas si loin, car il « n‟a jamais été radical au sens politique du terme ». Rationaliste, il croit avant tout, avec Condorcet, que l‟homme est perfectible et que la pédagogie finira par rendre superflu l‟Etat. Il s‟est donc borné à soumettre le politique à la morale et à l‟économie, à créer un système de freins et de contrepoids à la puissance publique. Si le radicalisme révolutionnaire est plus profond et conséquent que le modérantisme libéral, et si ce radicalisme s‟accentue aussi, en sens inverse, dans la philosophie de la contre-révolution, cela est dû « à l‟importance accrue des thèses axiomatiques sur la nature de l‟homme ». Pour les anarchistes athées, l‟homme est décidément bon ; tout mal est la conséquence de la pensée théologique et des représentations de l‟autorité qui en dérivent ; seuls sont méchants les hommes qui tiennent l‟homme pour tel. A l‟inverse, les contre-révolutionnaires catholiques radicalisent le dogme du péché originel « pour en faire une doctrine du caractère pécheur et de la dépravation absolus de la nature humaine ». Le marxisme, lui, tient pour superflue la question anthropologique, car il croit pouvoir changer les hommes grâce à la transformation des conditions économiques et sociales. Mais cette question ne saurait être évacuée, parce que « toutes les théories politiques véritables postulent un homme corrompu, c‟est-à-dire un être dangereux et dynamique, parfaitement problématique »56.
Les présupposés anthropologiques varient selon les secteurs d‟activités. Le pédagogue doit nécessairement tenir l‟homme pour un être éducable et perfectible. Le moraliste postule une liberté de choix entre le bien et le mal. Le théologien pense que les hommes sont pécheurs et qu‟il leur faut une rédemption. L‟homme politique « véritable » suppose que les hommes sont dangereux par nature. Schmitt voit une affinité spécifique entre dogmes théologiques et théories politiques. Tandis que la politique suppose l‟existence de l‟ennemi, la théologie présuppose le caractère pécheur de l‟homme. Hostilité et péché du monde rendent impossible l‟optimisme indifférencié propre aux conceptions, libérales ou libertaires, de l‟homme naturellement bon. Dans un monde d‟hommes bons, règnent la paix et la sécurité. Prêtres, hommes politiques et militaires y sont superflus. « La corrélation de méthode entre postulats théologiques et postulats politiques est (donc) évidente ». Le politique trouve ainsi dans le péché originel sa justification la plus profonde, puisque la négation du péché ne signifie rien d‟autre que l‟anarchie. C‟est précisément dans le chapitre consacré aux « fondements anthropologiques des théories politiques » que le juriste met en évidence l‟ancrage théologique de son concept57.
La nécessité du politique a pour « présupposé ultime », observe Strauss, la thèse de la dangerosité humaine. Or, ce caractère dangereux est-il indéracinable ? Schmitt ne parle que d‟« hypothèse » ou de « credo anthropologique ». Si ledit caractère n‟est que supposé ou cru et pas su réellement, on peut penser que le contraire est également possible et tenter d‟éliminer ce caractère. « Si le caractère dangereux de l‟homme n‟est que cru, alors il est, et le politique avec lui, menacé dans son principe »58. Que signifie « caractère dangereux » ? Essentiellement « besoin d‟être gouverné ». La vraie confrontation n‟a pas lieu entre pacifisme et bellicisme ou entre internationalisme et nationalisme59, mais entre les « théories anarchistes et autoritaires »60. L‟auteur de Politische Romantik citait de Maistre : « l‟homme en sa qualité d‟être à la fois moral et corrompu, juste dans son intelligence et pervers dans sa volonté, doit nécessairement être gouverné »61. La dangerosité de l‟homme ne peut être comprise que comme corruption morale. « Pour lancer la critique radicale du libéralisme qu‟il ambitionne, Schmitt doit renoncer à l‟idée que l‟homme est méchant comme l‟est l‟animal et par conséquent innocent, pour revenir à la conception de la méchanceté humaine comme bassesse morale »62. En effet, l‟opposition entre bonté et méchanceté perd son sens quand la « méchanceté » est considérée comme « innocente » ou « animale ». Après que Strauss lui ait reproché de mettre en relation la nature humaine et la formule : « animalité, instincts, passions », Schmitt efface en 1933 une série de passages pouvant donner l‟impression d‟une telle équivoque. De même que l‟homme est au-dessus de l‟animal, la distinction ami-ennemi est au-dessus des conflits du règne animal. L‟hostilité entre les hommes contient une tension qui transcende de beaucoup le naturel, écrit-il en 1959. Ce n‟est pas la nature qui est en cause, mais quelque chose de spécifique à l‟homme, de plus que naturel, qui provoque la tension politique63. L‟anthropologie du juriste s‟enracine dans la tradition catholique révisée par les contre-révolutionnaires, pas dans la biologie ou l‟éthologie. Il aurait pourtant pu trouver dans les notions d‟agressivité ou de territorialité, un appui « scientifique » pour sa démonstration. Mais si le mal n‟est qu‟un prétendu « mal » parce qu‟il est biologiquement déterminé, donc sans dimension « morale », le risque, inacceptable pour un catholique, serait de nier le libre arbitre et le péché.
L‟enjeu véritable du chapitre consacré à « l‟anthropologie » est « l‟ancrage du politique dans le théologique »64. D‟après Strauss, Schmitt ne parvient pas à prouver « l‟inéluctabilité » du politique, dès lors que celle-ci repose sur une dangerosité humaine qui n‟est que supposée ou crue, pas sue. Aussi le philosophe insiste-t-il sur l‟insuffisance de la foi et oppose-t-il le savoir à la foi. Mais le juriste ne se place pas sur le terrain de « l‟irréfutabilité » ; il se place sur le terrain de la « vérité », la vérité de la foi. La Révélation est une source si absolue de « savoir intègre », au sens de la gnose et non de la science, que face à la vérité du péché originel, tout ce que l‟anthropologie pourrait expliquer reste secondaire. La politique a besoin de la théologie, car celle-ci en est la condition sine qua non. Peut-elle disparaître ? On ne peut que la nier, pas l‟éliminer, car elle ne peut être que « sécularisée » sous la forme de l‟idéologie. Théologie et politique sont donc « inéluctables ». Ainsi, au lieu d‟écrire comme en 1932, que dans un monde d‟hommes bons, théologiens et politiques sont « superflus », Schmitt écrit en 1933 : théologiens et politiques « dérangent », ils ne dépérissent pas d‟eux-mêmes, il faut les combattre ou les exclure, donc renouveler la relation d‟hostilité. L‟essence du politique a un substrat théologique, parce que le politique a une destination théologique. Au caractère impérieux du choix entre le Christ et l‟Antéchrist dans la sphère de la théologie, correspond l‟impossibilité d‟échapper à la distinction ami-ennemi dans la sphère de la politique. « J‟ignore si la Terre et l‟humanité connaîtront jamais » un état dépolitisé « et quand cela se produira », déclare le juriste65. Mais Strauss fait remarquer qu‟il ne peut se contenter de dire qu‟« en attendant », cet état « n‟existe pas ». Compte tenu de l‟existence d‟un mouvement puissant qui veut éliminer la guerre, donc abolir le politique au sens schmittien, et même s‟il est admis que son éventualité subsiste « aujourd‟hui », on peut se demander si sa possibilité réelle subsistera demain ou après-demain. En 1932, Schmitt écrit : la dimension polémique est inscrite dans la nature humaine, c‟est pourquoi l‟homme cesse d‟être homme dès qu‟il cesse d‟être politique. En 1933, il n‟écrit plus « aujourd‟hui », mais « à une époque qui masque sous des prétextes moraux ou économiques ses oppositions métaphysiques »66.
VI. Philosophie politique versus théologie politique (« dialogue V »)
Pour Strauss comme pour Schmitt, le problème essentiel de la politique moderne est celui de la perte des valeurs, due au relativisme : l‟homme moderne ne croit plus possible la distinction objective du bien et du mal. Il se borne à rechercher la paix. Mais la recherche de la paix à tout prix n‟est possible que si l‟homme renonce à se demander ce qui est juste. « C‟est dans le sérieux de la question de la justice que le politique trouve sa justification »77. A cette question, deux réponses opposées s‟affrontent. Chez Schmitt, la réponse est apportée par la théologie politique ; chez Strauss, par la philosophie politique. Leur refus commun de l‟idéal libéral ne s‟effectue donc pas du tout sur le même terrain.
Chez l‟un, la question ultime est adressée à l‟homme, car le juste est un objet de foi. La foi elle-même est le « bastion inexpugnable » du politique et son « noyau indestructible »78. Chez l‟autre, la question ultime est posée par l‟homme, car le juste est un objet de raison. Telle est « l‟alternative fondamentale » entre la théologie et la philosophie. « Il est impossible, souligne H. Meier, de combler le gouffre qui sépare la théologie politique de la philosophie politique ; il sépare Carl Schmitt et Léo Strauss même là où l‟un et l‟autre paraissent avoir les mêmes positions politiques, même là où ils sont effectivement d‟accord dans la critique politique d‟un adversaire commun »79. Pour le juriste, toute réponse à la sommation de l‟histoire est un acte de soumission à Dieu. Du fait de la foi qui est au centre de sa pensée politique, il se croit lié à une « obligation », la politique n‟étant pas « libre décision », mais « destin ». De son point de vue, la seule façon d‟être sauvé du relativisme, c‟est la vérité pleine d‟autorité de la Révélation et de la Providence. La critique du libéralisme et le Commentaire straussien font émerger les présupposés théologiques qui permettent à Schmitt d‟affirmer « l‟inéluctabilité » du politique. Pourquoi s‟efforce-t-il de dissimuler ces présupposés ? D‟une part, parce que la vérité de la foi est inaccessible à une discussion avec les incroyants. D‟autre part, parce que le libéralisme « aimerait dissoudre la vérité métaphysique elle-même dans la discussion »80. Il refuse donc d‟exposer au débat le noyau théologique de sa pensée, pour ne pas le relativiser. Au contraire, « il décide d‟obéir à la stratégie suivante : faire de la „métaphysique‟ du libéralisme l‟objet de la critique, tirer au clair „la logique de son système métaphysique global‟ en l‟examinant dans la perspective de la théologie politique et attaquer „la croyance en la discussion‟ sans exposer à la discussion la substance intime de sa propre politique, sans la livrer à la „conversation éternelle‟ ou laisser s‟en emparer „l‟affrontement éternel des opinions‟ qui la relativiserait »81. Strauss, lui, ne pense pas à l‟horizon de la foi quand il écrit que la critique du libéralisme « ne peut être menée à son terme qu‟à la condition de conquérir un horizon au-delà du libéralisme »82.
Pour lui, cette critique est un commencement nécessaire pour parvenir à une connaissance authentique, c‟est-à-dire, selon le sens originel de la philosophie, pour sortir de la « caverne » de l‟existence historique et accéder à la lumière d‟un « savoir intègre ». Dans cette quête de ce qui est vrai et juste, qui passe nécessairement par la remise en question des opinions dominantes, l‟auteur de Maïmonide rencontre d‟abord le défi lancé par la conviction de l‟époque présente, à savoir que toute pensée et toute action sont historiques et valent hic et nunc. Ensuite, il entreprend d‟examiner à fond le conflit entre les Lumières et l‟orthodoxie. A l‟issue de ce conflit, on s‟aperçoit que les affirmations de la tradition n‟ont pas été réfutées, car elles reposent sur le présupposé irréfutable que Dieu est insondable et omnipotent. Les Lumières n‟ont pu démontrer l‟impossibilité des miracles ou de la Révélation. Elles ont simplement montré que les présupposés de l‟orthodoxie ne sont pas des objets de savoir mais de foi, qu‟ils n‟ont pas à proprement parler la force de ce qui est su. Enfin, dans son « retour à l‟origine », Strauss ne s‟arrête pas au fondateur du libéralisme, à Hobbes, mais c‟est vers Socrate, le fondateur de la philosophie politique, qu‟il se tourne. La question socratienne de l‟Unique nécessaire l‟a ainsi obligé à reprendre sans cesse la confrontation avec le théologique et le politique, le « problème théologico-politique » ayant été le thème de ses investigations, menées d‟un point de vue philosophique. Politique et religion requièrent son attention parce qu‟il recherche la discussion sur ce qui est juste. Mais si la politique a une importance centrale chez lui, la question de l‟ennemi lui importe peu, car un « savoir intègre » ne peut émerger d‟une intention polémique ni d‟une confrontation83.
VII. La récusation de la philosophie de « l’unité du monde » et de la « philosophie de l’histoire »
La grande traduction de la notion schmittienne du politique en philosophie des relations internationales, plus précisément, sur le plan des idéaux de la philosophie des relations internationales, est la récusation de la philosophie de « l‟unité du monde » et de la « philosophie de l‟histoire » propre au libéralisme comme au marxisme. Avant comme après la Seconde Guerre mondiale, Carl Schmitt rejette l‟idéal du One World par le marché et la technologie. Il affirme l‟irréductible pluralité politique du monde. Il récuse les conceptions supranationales et universalistes du droit international public. Il leur oppose sa doctrine des « grands espaces » (Grossräume).
L‟humanité est une biologiquement et moralement, mais plurielle culturellement et politiquement. C‟est ainsi qu‟il y a plusieurs unités politiques dans le monde, et non pas une unité politique du monde. Il ne saurait y avoir d‟unité politique, ni d‟Etat, ni de fédération « universels », car l‟unité politique implique d‟autres unités politiques, l‟Etat, d‟autres Etats, la fédération, d‟autres fédérations. La Société des Nations ou l‟Organisation des Nations Unies favorise-t-elle l‟unification ou la pacification du monde ? Non. Les organisations internationales ne suppriment ni les Etats ni les guerres. Elles ne sont que des organisations interétatiques créées par des traités interétatiques, où siègent des représentants des Etats, dont les résolutions résultent de coalitions d‟Etats qui se nouent ou se dénouent. Elles ne font que distinguer les guerres licites ou illicites, en suivant les décisions des grandes puissances (des membres permanents du Conseil de la SDN ou de l‟ONU). Le projet du One World reste fondamentalement utopique. Il ne fait que masquer un impérialisme arrivé au stade suprême de l‟universalisme.
De Campanella à McLuhan, toutes les « utopies planétaires » ont un ressort technologique : le progrès technique serait la matrice de l‟unification de l‟humanité84. Le monde se rapproche de son unité au fur et à mesure que croissent les moyens de transports et de communications d‟une part, les moyens de production et de destruction d‟autre part, autrement dit, au fur et à mesure que la puissance humaine domine la Terre et que l‟humanité se rassemble dans une même organisation techno-économique. De ce point de vue déterminé par le progrès technique, la réalisation de « l‟unité du monde » devient inéluctable. En réalité, pour Schmitt, l‟idée du One World n‟est pas une « fatalité technique ». Elle relève d‟une conception téléologique de l‟histoire humaine, selon laquelle le mouvement de l‟histoire s‟identifie à la marche d‟un progrès techniquement déterminé. Cette vision d‟un univers unifié par la technique est partagée par les élites des deux superpuissances (« partagée » au double sens du terme : elle est commune à l‟Est et à l‟Ouest, mais l‟Est et l‟Ouest en ont une conception concurrente). L‟industrialisation est le destin de l‟humanité, reconnaît le juriste. Mais « l‟unité du monde » n‟est pas une question technique, c‟est une question politique : celle de l‟amitié entre les peuples, les classes, les cultures, les religions, les races. Or, loin de l‟unité, le monde politique d‟après 1946 donne l‟image de la dualité, l‟image de la division politique entre le capitalisme et le socialisme.
Comment penser cette dualité ? Schmitt donne sa vision philosophique du conflit Est-Ouest. Ce conflit a l‟apparence d‟une confrontation entre deux types opposés de systèmes politiques, économiques, sociaux. En vérité, « la tension inhérente au dualisme suppose dialectiquement l‟existence d‟une affinité réciproque. Cette affinité réside dans la vision du monde et de l‟histoire propre aux deux acteurs du duopole mondial. La lutte mondiale entre le catholicisme et le protestantisme aux XVIème et XVIIème siècles supposait un fond commun chrétien. De même, c‟est une interprétation philosophico-historique commune qui sous-tend aujourd‟hui la dualité du monde »85. La foi dans le progrès technique (dans l‟industrialisation) comme matrice de l‟unification du genre humain est la « philosophie de l‟histoire » de l‟Est comme de l‟Ouest. Le conflit Est-Ouest ne fait qu‟opposer deux méthodes visant l‟industrialisation la plus efficace, mené par deux Puissances se réclamant de la démocratie. Ce conflit se déroule dans le cadre d‟un programme idéologique commun, dont le noyau est une interprétation téléologique de l‟histoire. D‟après celle-ci, le progrès industriel -grâce au plan ou grâce au marché- doit mener à la « fin de l‟histoire », c‟est-à-dire à un état final de l‟humanité -le communisme ou la démocratie libérale86.
L‟existence d‟une même « philosophie de l‟histoire » de part et d‟autre du Rideau de Fer implique-t-elle l‟unification du monde ? Ceux qui répondent oui à cette question croient que le dualisme n‟est qu‟une transition vers l‟unité87. Le conflit Est-Ouest se terminera par une victoire de l‟une des superpuissances et la défaite de l‟autre. S‟ensuivra un monde unipolaire, dominé par une superpuissance unique qui entreprendra, en vertu de la dynamique historique, l‟unification du monde selon ses conceptions et ses objectifs : le socialisme mondial ou le le capitalisme mondial. D‟après Schmitt, au contraire, le « dualisme du monde » n‟annonce pas « l‟unité du monde », car « l‟histoire » -la division politique de l‟humanité- l‟emportera sur la « philosophie de l‟histoire » -sur la croyance en l‟unification de l‟humanité comme sens de l‟histoire. Le monde n‟est pas inclus tout entier dans la dualité Est-Ouest. Il existe des tierces forces et des troisièmes voies, notamment dans le tiers monde : les pays « non alignés » qui refusent la bipolarité comme l‟unipolarité. Le dualisme tendra à la pluralité plutôt qu‟à l‟unité. Le développement industriel ne mène pas au One World mais aux Grossräume88, c‟est-à-dire à des regroupements régionaux ou à des Unions d‟Etats. Au-delà du conflit Est-Ouest, la grande antithèse de la politique mondiale est celle de l‟universalisme du monde unipolaire d‟un côté, de la multipolarité des « grands espaces » de l‟autre. C‟est la dialectique de « l‟occidentalisation » qui tranchera cette antithèse : il y aura soit homogénéisation culturelle de l‟humanité, soit maintien de la pluralité des civilisations89.
On l‟aura compris, si Schmitt estime qu‟il n‟y aura pas d‟« unité du monde », c‟est aussi parce qu‟il ne veut pas d‟« unité du monde » ! L‟avènement du One World, parce qu‟il signifierait la « centralisation » et la « dépolitisation », entraînerait la fin des indépendances nationales et le règne du Bourgeois universel. Surtout, un tel avènement serait sacrilège : l‟épisode biblique de la Tour de Babel indique le refus divin de l‟unité politique du genre humain. Là encore, la comparaison Schmitt/Strauss est significative. Le philosophe critique l‟idée (hégéliano-kojévienne) selon laquelle l‟histoire du monde est « un mouvement vers l‟Etat universel et homogène ». Mais c‟est parce que l‟avènement d‟un tel Etat « marquerait la fin de la philosophie sur terre ». Lui aussi méprise un monde, celui du « dernier homme », qui n‟est qu‟« intéressant » et « divertissant ». Mais c‟est assurément sur le terrain de la philosophie politique qu‟il se place. Une vie confortable ne s‟exposant pas au danger de l‟interrogation radicale sur soi ne lui paraît pas digne d‟être vécue. Avec « l‟unité du monde », « l‟histoire est terminée, il n‟y a plus rien à faire ». Mais « il y aura toujours des hommes qui se révolteront ». La négation nihiliste de « l‟Etat universel » deviendra peut-être le dernier acte noble possible lorsque cet Etat sera devenu inévitable. Comme l‟écrit Kojève, la « fin de l‟histoire » signifie la fin des grands conflits, donc celle de la philosophie. L‟homme ne changeant plus, il n‟y a plus de raison de changer les principes à la base de sa connaissance du monde. « Mais tout le reste peut se maintenir indéfiniment : l‟art, l‟amour, le jeu, etc., bref, tout ce qui rend l‟homme heureux »90.
David Cumin - Klesis – Revue philosophique – 2011 : 19 – Autour de Leo Strauss
* David Cumin est Maître de conférences (HDR) à l‟Université Jean Moulin Lyon III (CLESID).
1 Piet Tommissen (« Contributions de Carl Schmitt à la polémologie », Revue européenne des sciences sociales. Cahiers Vilfredo Pareto, n°44, 1978, pp.141-170, pp.142-145) a exposé les « variantes du texte ».
2 Avec les écrits qui lui sont liés, sur l‟Etat, « l‟Etat total », la guerre ou « l‟unité du monde ».
3 Heinrich Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique. Un dialogue entre absents, Paris, Julliard, 1990, p. 16.
4 D‟après Julien Freund, le Begriff est « uniquement un essai destiné à fournir un cadre théorique à l‟immense problème du politique » ; son objectif « précis » est de « discerner ce qui est purement politique indépendamment de toute autre relation » (préf. à La notion de politique, op. cit., pp. 22, 23).
5 Cet adjectif revient à plusieurs reprises sous la plume de Schmitt en 1963 et sous celle de Freund dans sa préface de 1972 à La notion de politique, ibid., pp. 22, 53, 56, 211.
6 Le commentaire de Leo Strauss : « Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen », est paru d‟abord dans l‟Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik en août-septembre 1932. Il a été republié en appendice à Hobbes‟ politische Wissenschaft en 1965 et, la même année, en appendice à l‟édition américaine de Spinoza‟s Critique of Religion. Dans le recueil Parlementarisme et démocratie (Paris, Seuil, 1988, pp. 187-214), Jean-Louis Schlegel a traduit en français ce commentaire. Trad. à comparer avec celle de Françoise Manent dans l‟ouvrage de Heinrich Meier (pp.129-162). Schmitt a conservé les lettres de Strauss dans un dossier à part : « au sujet de La notion de politique, trois correspondances importantes : 1. Leo Strauss (1929), 1932-1934, 2. Alexandre Kojève (1955), 3. Joachim Schikel (1970), 1968-1970 » (H. Meier, op. cit., p.174).
7 H. Meier a retracé l‟évolution de cet essai, ibid., pp. 15–25, 35-42, 48–50).
8 Version schmittienne du monopole wébérien de la violence légitime.
9 La notion de politique, p. 73.
10 K. Löwith, « Le décisionnisme (occasionnel) de Carl Schmitt », in Les Temps modernes, 1991 (1935, sous le pseudonyme d‟Hugo Fiala), pp. 15–50, pp. 47–49.
11 A. Dufour : « Jusnaturalisme et conscience historique. La pensée politique de Pufendorff », in Cahiers de philosophie politique et juridique, Des théories du droit naturel, Caen, Centre de Publications de l‟Université de Caen, 1988, pp. 101–125, p. 108.
12 La notion de politique, p. 93.
13 L. Strauss, « Commentaire sur „La notion de politique‟ », in H. Meier, op. cit., p.136.
14 Ibid., p. 133.
15 Trad. française Romantisme politique, Paris, Librairie Valois-Nouvelle Librairie nationale, 1928, partiellement reprise in Du politique… (recueil), Puiseaux, Pardès, 1990, « Romantisme politique », pp. 1–17 ; trad. française Hamlet ou Hécube. L‟irruption du temps dans le jeu, Paris, L‟Arche, 1992.
16 « L‟ère des neutralisations et des dépolitisations », in La notion de politique, p.138, cité par L. Strauss, op. cit., p. 134 et par H. Meier, op. cit., p. 30. H. Meier indique que dans la conférence de 1929 telle qu‟est ajoutée à l‟édition de 1932, Schmitt a biffé et remplacé les mots « culture » et « culturel » pas moins de 31 fois sur 54 occurrences.
17 L. Strauss, op. cit., p. 134.
18 Cité par H. Meier, op. cit., p. 32.
19 La notion de politique, pp.90, 117. La guerre fait comprendre que tout pouvoir est absolu, disait Alain.
20 Ibid., p. 116.
21 L. Strauss, op. cit., p. 131.
22 La notion de politique, pp.118, 155, cité par L. Strauss, op. cit., p. 132.
23 L. Strauss, op. cit., pp. 150, 160.
24 Ibid., pp. 138–139.
25 H. Meier, op. cit., p .56.
26 L. Strauss, op. cit., pp. 139, 149.
27 Droit naturel et histoire, Paris, Flammarion, 1986 (1953), pp. 165–166.
28 L. Strauss, « Commentaire sur “La notion de politique” », pp. 140–141.
29 Cf. Ueber die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, trad. française Les trois types de pensée juridique, Paris, PUF, 1995, préf. D. Seglard.
30 Cf. Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, trad. française Le Léviathan dans la doctrine de l‟Etat de Thomas Hobbes. Sens et échec d‟un symbole politique, Paris, Seuil, 2002, préf. E. Balibar, postf. W. Palaver. Cf. aussi « Der Staats als Mechanismus bei Hobbes und Descartes » (1937), trad. française « L‟Etat comme mécanisme chez Hobbes et Descartes », in Les Temps modernes, 1991, pp. 1-14. Tous les écrits de Schmitt sur Hobbes ont été réunis in Scritti su Thomas Hobbes (recueil), Milan, Giuffré, 1986, préf. C. Galli.
31 H. Meier, op. cit., pp. 58–59, 77.
32 Sur la primauté du conflit chez Max Weber, son ethos guerrier par opposition à la morale pacifiste, sa volonté, via le nationalisme et la Machtpolitik, de préserver, contre la bureaucratisation, les chances d‟une existence « authentique » c‟est-à-dire « tragique », cf. L. Strauss, Droit naturel et histoire, pp. 69–73.
33 L. Strauss : « Commentaire sur „La notion de politique‟ », p. 156.
34 La notion de politique, p. 108, cf. aussi pp. 95, 205, et la Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993 (1928), préf. O. Beaud, p. 388.
35 G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Vrin, 1982 (1821), pp. 324-333 ; A. Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, Paris, Vrin, 1976, « Éthique et guerre dans la pensée de Hegel », pp. 55–66.
36 C. von Clausewitz : De la guerre, Paris, Minuit, 1955 (1832-1837), pp. 51-69.
37 Cité par C. Colliot-Thélène, Le désenchantement de l‟Etat. De Hegel à Max Weber, Paris, Minuit, 1992, p. 214.
38 La notion de politique, p. 75.
39 Ibid., pp. 97–98.
40 Préf. à La notion de politique, p. 190.
41 G. W. F. Hegel, op. cit., p.69.
42 A. Philonenko, « Clausewitz ou l‟oeuvre inachevée : l‟esprit de la guerre », in Revue de métaphysique et de morale, n°4, 1990, pp. 471-512, pp. 473–474.
43 La notion de politique, p. 102.
44 Ibid., p. 153.
45 G. de Plinval : La pensée de saint Augustin, Paris, Bordas, 1954, pp. 164-174.
46 L. Strauss, op. cit., p. 153.
47 K. Löwith, art. cit., pp. 25–31.
48 Cité par A. Dorémus, « Introduction à la pensée de Carl Schmitt », in Archives de philosophie, XLV, 4, 1982, pp. 585–665, p. 658.
49 Cf. Die Tyrannei der Werte. Ueberlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1960 (2ème éd. aug. in Säkularisation und Utopie. Erbracher Studien, Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, 1967, pp.37-62), ainsi que : « Le contraste entre communauté et société en tant qu‟exemple d‟une distinction dualiste. Réflexions à propos de la structure et du sort de ce type d‟antithèses » (1960), in Res Publica, XVII, 1, 1975, pp. 100–119, pp. 105-119 ; Théorie du partisan, pp. 317, 325 ; Théologie politique II, Paris, NRF Gallimard, 1988, préf. J.-L. Schlegel, pp. 104, 167–182.
50 L. Strauss, Droit naturel et histoire, « Le droit naturel et la distinction entre faits et valeurs », pp .44–82.
51 H. Meier, op. cit.., pp.95-97, citations extraites de « Politik », in H. Franke (Hrsg.), Handbuch der neuzeitlichen Wehrwissenschaften, Bd. I, Wehrpolitik und Kriegsführung, Berlin-Leipzig, W. de Gruyter, 1936, pp. 547–549.
52 H. Meier, op. cit., pp. 97–98.
53 Ibid., p. 81.
54 Théologie politique I, pp. 64–67.
55 La notion de politique, p. 103.
56 Théologie politique I, p. 65 ; La notion de politique, pp. 103, 106–107.
57 La notion de politique, pp. 103, 111.
58 L. Strauss, « Commentaire sur “La notion de politique” », pp. 145–146.
59 Leo Strauss a analysé la convergence empirique de l‟antagonisme : internationalisme pacifiste/ nationalisme belliciste et de l‟antagonisme : anarchie/autorité. Le lien autorité/nationalisme s‟explique de la manière suivante. L‟homme étant méchant de nature, il a besoin d‟être gouverné. L‟instauration d‟un gouvernement, c‟est-à-dire le rassemblement des hommes en une unité, ne s‟effectue que contre d‟autres hommes. Il y a ainsi une tendance primaire de la nature humaine à former des groupes exclusifs. Cette tendance à l‟exclusion, et le regroupement ami-ennemi, sont donnés avec la nature de l‟homme. Ils sont donc en ce sens « destin ». La réalité de l‟hostilité, de l‟alliance et de la neutralité entre groupes, « c‟est ce que démontre l‟histoire de l‟humanité jusqu‟à nos jours » (ibid., pp. 147–148, 168–169).
60 La notion de politique, p. 105.
61 In Romanticismo politico, Milan, Giuffré, 1981, préf. C. Galli, p.205, trad. italienne de Politische Romantik.
62 L. Strauss, op. cit., p. 150.
63 « Die planetarische Spannung zwischen Ost und West und der Gegensatz von Land und Meer » (1959), in Schmittiana III, Bruxelles, 1991, pp.19-44, p. 26.
64 H. Meier, op. cit., p. 82.
65 La notion de politique, p. 98.
66 H. Meier, op. cit., pp. 94–95.
67 L. Strauss, op. cit., p. 155.
68 H. Meier, op. cit., p. 86.
69 Ibid., p. 71.
70 Théologie politique I, p. 71, cité par H. Meier, op. cit., p. 99.
71 H. Meier, op. cit., p. 99.
72 L. Strauss, op. cit., p. 160.
73 L. Strauss, Maïmonide, Paris, PUF, 1988 (1935), pp. 17–23.
74 Sur l‟histoire de la philosophie de l‟unité du genre humain, cf. A. Mattelart, Histoire de l‟utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale, Paris, La Découverte, 1999.
75 Cf. « L‟unité du monde II », in Du politique…, pp. 237–249, p. 240.
76 Schmitt expose le credo Est-Ouest : le développement industriel conduit à l‟abondance généralisée ; celle-ci, en mettant fin à la rareté des ressources, rend sans objet les luttes tournant autour de leur appropriation ou de leur répartition ; elle abolit donc le risque de guerre et permet la réconciliation de l‟humanité. Mais ce credo suppose que les conflits sont économiquement déterminés, ce qui n‟est pas nécessairement le cas. Même dans cette hypothèse, la croissance démographique et la croissance économique, par conséquent la croissance de la consommation de ressources naturelles limitées, renouvellent les problèmes d‟appropriation et de répartition, donc les oppositions politiques. Sera-t-il possible que la technologie émancipe l‟humanité de la nature ? Sera-t-il possible de réguler mondialement la démographie et l‟économie ? Cf. « À partir du “nomos” : prendre, pâturer, partager. La question de l‟ordre économique et social » (1953), in Commentaire, n°87, automne 1999, pp. 549–556.
77 Selon Pierre Lévy, la guerre froide a été menée pour la domination « d‟un globe suffisamment rétréci pour que la notion d‟empire mondial ne soit pas vide de sens » (World Philosophie. Le marché, le cyberespace, la conscience, Paris, O. Jacob, 2000, p. 25).
78 Cf. « Grand espace contre universalisme. Le conflit sur la doctrine de Monroe en droit international » (1939), in Du politique…, pp.127-136 ; Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin-Leipzig-Vienne, Deutscher Rechtsverlag, 1942, 4ème et dernière éd. aug. (les trois premières se sont succédées en 1939, 1940 et 1941) ; Le Nomos de la Terre dans le droit des gens du jus publicum europaeum, Paris, PUF, 2001 (1950), préf. P. Haggenmacher.
79 Sur cette partie, cf. La notion de politique, pp.97-103 ; « Drei Möglichkeiten eines christlichen Geschichtsbildes », art. cit., p.297 ; « Historiographie existentielle : Alexis de Tocqueville », « L‟unité du monde » I et II, in Du politique…, pp.211-214, 225-249 ; « Die Ordung der Welt nach zweiten Weltkrieg » (1962), in Schmittiana II, 1990, pp. 11–30, pp. 12–27 ; « The Legal World Revolution » (1978), Telos, n°72, pp. 73–89 (trad. en langue anglaise de « Die legale Weltrevolution. Politischer Mehwert als Prämie auf juristiche Legalität und Superlegalität »), pp. 79, 86.
80 L. Strauss, De la tyrannie, Paris, NRF Gallimard, 1954 (1948), « Mise au point », pp. 282–344, pp. 309–342.