culture et histoire - Page 2007
-
L'Action Française (1898-1945) Troisième République
-
La décroissance démographique: danger ou opportunité ?
La chute de la natalité des populations de souche européenne, partout dans le monde, est perçue comme une menace dont la conséquence majeure serait la fin du modèle civilisationnel qu’elles ont porté. En dehors de cet espace, la majorité des peuples, excepté en Afrique subsaharienne, ont entamé leur transition démographique. Malgré le péril à avancer une cause unique pour expliquer ce phénomène, il est troublant de constater que le courant écologiste avait annoncé cette évolution au début des années 1970. Plus récemment, les écologistes ont montré que depuis le milieu des années 1980, les besoins en ressources naturelles de l’humanité excèdent la productivité de la biosphère. Aussi, d’un point de vue écologique, la transition démographique n’est pas incompréhensible car toute population confrontée à des limites écosystémiques voit ses effectifs régulés. La conclusion à cet article est, par conséquent, que la situation démographique d’aujourd’hui est peut-être la solution à la crise de l’environnement dont une des conséquences annoncées est la faillite écologique. Cependant, cette transition doit être gérée d’un point de vue politique pour préserver les populations engagées dans cette transition des explosions démographiques encore constatées.
Faits et controverses sur la démographie : le bilan
En 1982, sur le fondement d’études réalisées durant les années 1970, Jacques Leridon écrivait dans le magazine La Recherche: “La population mondiale est entrée dans une phase de décélération”. En 1995, dans la même revue, Jean-Claude Chesnais dressait le bilan suivant: “Les pays où la baisse séculaire de la fécondité ne semble pas encore amorcée ne représentent qu'environ 8% de la population mondiale”. La même année, Thérèse Locoh s’intéressant à la singularité africaine, soulignait que le maintien dans toute l'Afrique subsaharienne de niveaux élevés de fécondité -de cinq à sept enfants par femme- est une donnée majeure du présent et de l'avenir de la population mondiale. Seuls quelques pays d'Asie du Sud, d'Amérique centrale et du Moyen-Orient ont encore des niveaux de croissance annuelle de la population comparables à ceux de l'Afrique subsaharienne (3 % l'an en moyenne), ce qui correspond à un doublement de la population en vingt-trois ans. Par comparaison, le taux d'accroissement de la population des pays développés est en moyenne six fois plus faible (0,6% par an). Celui de l'ensemble des pays en développement atteint 2 % l'an. Elle poursuivait en montrant qu’à l'horizon de l’an 2025, selon le rapport de l’ONU de 1993, il y aurait un milliard cinq cents millions d'habitants en Afrique subsaharienne si l'hypothèse d'une baisse lente de la fécondité se réalisait et “seulement” un milliard cent millions si une baisse rapide survenait. Entre ces deux perspectives, il y a quatre cents millions d'habitants, en plus ou en moins, à accueillir en Afrique subsaharienne.
Les conclusions à tirer de son article sont sans appel: quelle que soit l’hypothèse démographique retenue, la pression des populations africaines sur l’Europe n’est pas derrière nous, mais devant nous.
Cependant, malgré la singularité africaine, sur le fondement du rapport ‘World population to 2300’ de l’ONU, la transition démographique est entamée. Partout les taux de fécondité déclinent, mais pas les populations en raison de la croissance de la durée de vie (Figure 1. Estimated world population, 1950-2000, and projections: 2000-2050; Figure 3. Total fertility, major areas:1950-2050; Figure 4, World total fertility and life expectancy at birth :1995-2050).
La stabilisation, voire la décroissance de la population, est une hypothèse désormais admise, les prévisions de hausse étant régulièrement revues à la baisse. Mais, à un Max Singer pronostiquant qu’à partir de 2050, la population mondiale devrait commencer à baisser et qu’à terme elle ne devrait pas dépasser celle des Etats-Unis d’aujourd’hui, Jean-Marie Robine de l’Inserm répond qu’”il ne parierait pas un dollar sur cette prévision (...)”.
Aussi, malgré l’incertitude sur l’évolution de la démographie, un constat s’impose. Il existe un différentiel démographique entre les différentes catégories de la population mondiale, les populations de souche européenne étant celles ayant entamé cette transition en premier. Deux phénomènes sont, par conséquent, à gérer : la décroissance de la croissance à l’échelle mondiale; le différentiel démographique entre les peuples. Ceux-ci sont à l’origine de débats nourris des incertitudes et des paradigmes de référence des protagonistes dont les propos portent sur les chiffres, sur les risques et sur les solutions.
Trois catégories de risques majeurs sont associées à ce constat sur la démographie. Le premier porte sur la pérennité de civilisations ou de singularités culturelles confrontées à des pressions démographiques allogènes; le second concerne la puissance politique obérée par une démographie déclinante; le troisième enfin serait la fin d’un modèle politique fondé sur développement économique. Notons que le courant écologiste s’est construit en réaction à ce dernier.
Les débats
La crise démographique comme menace pour la survie d’une population et de son identité est une antienne de la philosophie occidentale. C’est le premier risque. En citant J.J. Spengler et L. Dublin qui, au début des années 1930, prophétisaient l'effondrement des sociétés occidentales que leur anémie démographique exposait dangereusement aux débordements des populations du tiers-monde, Jacques Leridon rappelle qu’hier, la chute de la natalité des pays occidentaux avait suscité les mêmes craintes qu’aujourd’hui.
Plus près de nous, et malgré la suspicion qui pèse sur les démographes et hommes politiques prolongeant cette tradition, des auteurs courageux osent évoquer cette menace. Jacques Attali, par exemple, écrit en conclusion de “Les Juifs, le monde et l’argent” que : “si les tendances actuelles se prolongent, le tiers de la Diaspora aura disparu en 2020, et les deux tiers en 2050 (...). Le peuple juif aurait alors vécu deux mille ans en avant-garde pour disparaître (...)”.
Dans une perspective plus large, Yves-Marie Laulan écrit dans "Les Nations suicidaires" : "L’Occident se meurt, l’Occident est mort. Enfin presque. Mais il ne le sait pas... ". Après avoir rappelé les projections de l’ONU et noté qu’à la fin des années 1980, on prévoyait encore 12 milliards d’habitants pour 2050, il souligne que les prévisions continuent de baisser avec rapidité une année après l’autre. Mais la baisse de la fertilité dans les nations occidentales prend une tournure dramatique dans des pays comme l’Espagne ou l’Italie (nombre d’enfant par femme : 1,2) et surtout en ex-Allemagne de l’Est (0,8 et jusqu’à 0,6 dans plusieurs grandes villes).La perte d’une identité par implosion démographique ou assimilation à une démographie plus vigoureuse est une des interrogations actuelles dont le corollaire est la perte de puissance politique. C’est le second risque. La situation de la Russie et la politique engagée sur ce sujet sont le meilleur exemple d’une prise de conscience politique. Selon J.-C. Chesnais, de 1995 à 2001 la Russie a perdu 4 millions d’habitants et en 1999, la différence entre le nombre des décès moins celui des naissances atteignait 900 000 soit près de 0,6% de la population. En comparaison, pendant le demi-siècle 1860-1914 la croissance russe était de 2% par an et il y avait en moyenne 7 à 8 enfants par famille; ceci malgré la démographie des populations allogènes de l’Empire russe et des émigrations qui compteraient assez peu. Si les choses continuent ainsi, la population de la Russie, où l’on a compté 4 millions de naissances en 1900 pour 1,2 million seulement en 2000, pourrait baisser de 144 millions aujourd’hui à 125 millions en 2020 et peut-être 100 millions en 2050 passant ainsi du 6ième au 20ième rang dans le monde avec toutes les conséquences politiques et économiques de cette évolution. Depuis 1989 les mouvements de populations sont beaucoup plus libres en Russie. Le grand Nord et la Sibérie se vident peu à peu de russes (note 1) alors que les peuples asiatiques et turcs continuent d’alimenter la démographie mondiale. Les Russes ont conscience de la gravité de la situation. Dans le discours sur l’état de la Nation de juillet 2000, le président Vladimir Poutine souligne que le défi le plus important à relever est le problème démographique.
Le troisième risque identifié est qu’une baisse généralisée de la croissance démographique obère un modèle politique fondé sur le développement économique dont le capitalisme est la pierre angulaire. Le livre d’Isaac Johsua “Le grand tournant” résume assez bien cette angoisse. L’auteur estime que la croissance démographique, depuis le XVIIIième siècle, a été un des ressorts de l’expansion capitaliste dont un des piliers est une main-d’œuvre disponible à profusion. La pénurie généralisée de main-d’œuvre provoquerait la fin du capitalisme car la demande de travail des entreprises se heurterait à une offre de travail décroissante.
Quelles sont alors les solutions avancées par les différents protagonistes au débat ? Selon les courants politiques et les présupposés qui les structurent, les attitudes sont singulièrement différentes. De pays comme la Russie pratiquant des politiques natalistes ciblées aux pays comme la France ou les Etats-Unis ayant opté pour l’immigration allogène, pariant sur une adhésion de ces populations à leur modèle civilisationnel, toutes les hypothèses sont envisagées pour remédier à la décroissance démographique des populations de souche européenne, aujourd’hui, et du monde dans son ensemble demain. Cependant, les écologistes font entendre un autre discours : la décroissance démographique permettrait d’éviter la faillite écologique.
Contraintes écologiques et développement économique
La relation entre une croissance, quelle qu’elle soit, et les facteurs la conditionnant est un des fondements de la pensée écologiste. Pour des écologues comme P. Duvigneaud ou E.P. Odum, une “croissance infinie est une vue théorique car, des facteurs dépendant de la densité interviennent et modifient la marche de la croissance de la population qui est ainsi plus ou moins freinée par la résistance de l’environnement”. A un moment ou à une autre, des facteurs limitants freinent cette croissance. Leur étude est un des principaux axes de recherche en écologie.
Ces thèses, consolidées au milieu du XXème siècle, sont à l’origine des conceptions de l’écologie politique dont un des actes fondateurs est l’introduction faite par René Dubos (note 2) à la première Conférence mondiale sur l'environnement humain de Stockholm en 1972.“En voulant produire sans cesse davantage, l’homme pollue davantage l'air, l'eau et le sol et il gaspille des ressources qui ne sont pas inépuisables. En voulant maîtriser la maladie sans s'être soucié de l'expansion démographique, il est en train d'épuiser la terre. Où en serons-nous dans trente ans, lorsque six ou sept milliards de gens devront exister sur la planète ?”. La même année, le Club de Rome publiait un rapport intitulé The Limit to Growth traduit en français par “Halte à la croissance”. Ce réquisitoire d'économistes animés par D. Meadows prônait la “croissance zéro” de la démographie humaine pour épargner des matières premières non renouvelables. En réaction à cette approche renouant avec les vues des premiers économistes comme David Ricardo (1772-1823) ou Thomas R. Malthus (1766-1834), les économistes contemporains ont développé la théorie moderne de la croissance.
Au milieu du vingtième siècle des économistes comme Sir Roy F. Harrod (1900-1978) ont établi des modèles de croissance capitaliste qui suggéraient que celle-ci était instable et marquée par des crises périodiques. Puis Robert M. Solow, prix Nobel d’économie en 1987, argua que les opportunités de substituer du capital au travail dans le processus de production devaient favoriser une croissance stable limitant les crises périodiques. Plus tard, le modèle de croissance de Solow envisagea la possibilité d’une élévation du niveau de vie général par le progrès technologique. Ces modèles excluaient le rôle de l’’environnement’ dans la production. Le travail et le capital étaient combinés pour produire, mais aucune ressource naturelle et énergie n’étaient requises pour le faire. Comme Solow lui-même en fit la critique, “la fonction de production est homogène au premier degré. Cela suppose qu’il n’y a pas de ressources épuisables comme la terre”.
C’est à partir des années 1970 que les conditions de la croissance économique intégrèrent la dimension environnementale. D. Meadows, sous l’égide du Club de Rome, et d’autres établirent l’existence de limites biophysiques à la croissance, entraînant celle-ci vers une fin. Les théories de la croissance commencèrent donc à intégrer les ressources naturelles et la pollution dans les modèles conçus à partir des années 1970. J. Stiglitz (1974) proposa une fonction de production combinant travail, capital et ressources substituables. Son modèle supposait que la raréfaction des ressources naturelles serait compensée par le progrès technologique: “Avec le progrès technique, quel que soit son niveau, nous pouvons trouver des voies de croissance positive... Cette croissance par individu requiert un niveau constant de changement technologique”. Ainsi, les limites à la croissance ne dépendraient pas des ressources naturelles mais du niveau de développement technologique.
En réaction aux conceptions pessimistes sur les potentialités de croissance des années 1970 obérées par les contraintes écologiques, les années 1980 furent celles de l’optimisme écologique. Concernant les liens entre la croissance économique et le monde naturel, W.J. Baumol (1986) affirmait que les inventaires des ressources naturelles pourraient croître en permanence, même si les stocks physiques diminuaient rapidement. Dans cet esprit, les ressources dont les quantités physiques décroissent et sont finies peuvent néanmoins être augmentées par l’évolution technologique selon leur contribution future à l’économie et permettre ainsi d’envisager sereinement l’avenir.
Des théories économiques comme celle de Stiglitz ou de Baumol ont laissé des traces dans les théories économiques des années 1990. P. Aghion et P. Howitt (1998) reconnaissent que la pollution et les ressources naturelles sont des valeurs à considérer. Cependant, leur modèle schumpetérien implique que l’accumulation de ‘capital intellectuel’ peut compenser les contraintes biophysiques de l’activité économique et ainsi permettre une croissance indéfinie.
R. Barrow et X. Sala-i-Martin (1995) ne mentionnent même pas la terre, l’énergie, les ressources naturelles et la pollution dans leurs modèles de croissance économique. Pour eux, la production de biens et le savoir-faire de l’homme sont à la base du capital. L’activité macro-économique se résume alors à puiser dans la nature les ressources et à y évacuer les déchets. Un débat sur les relations entre la nature et la croissance économique n’a donc aucun intérêt.
D’autres auteurs ont cependant tenté de renouer avec l’idée de limites biophysiques au développement, mais sans grandes influences sur les théories modernes de la croissance économique. Ainsi, H.E. Daly (1996) évoque des facteurs éthiques et biophysiques comme bases d’une économie durable. Cela suppose entre autres une population stable, une production et des besoins en énergie limités aux seuls besoins de ces populations.
Le débat fait rage entre les partisans du modèle dominant : celui de l’économie capitaliste ou libérale, c’est selon, et le modèle écologiste. L’enjeu de ce débat est la consubstuabilité des écosystèmes artificiels aux écosystèmes naturels. Les premiers sont-ils indissociables des seconds ou pas ?
Deux thèses s’affrontent: les économistes postulent à une substituabilité du capital humain (technologie, population) au capital naturel alors que les écologistes limitent cette substituabilité à des seuils critiques de capital naturel; l’auto-reproduction de celui-ci étant le niveau à ne pas transgresser.Le modèle dominant actuellement est celui du développement économique infini; ce dernier permettant à terme de résoudre les maux de nos sociétés. Guerre, chômage, misère, etc. sont solubles dans le développement. Or, ce développement infini suppose un support, lui aussi, infini. Les économistes établissent que ce support est le progrès technologique, a priori incommensurable; les écologistes, quant à eux, rappellent la finitude de l’écosphère.
Les faits semblent donner raison à ces derniers. Les prévisions du rapport Meadows de 1972, qui ne sont que le résultat de la modélisation de facteurs limitant la croissance économique et démographique sont, trente années après, avérées. Cependant, leur audience est réduite, au mieux, aux cercles initiés; au pire, leurs thèses sont galvaudées par des mouvements politiques qui en trahissent l’esprit. Mais depuis, de nouveaux outils sont apparus comme l’empreinte écologique.
L’empreinte écologique
L’empreinte écologique est une méthode inventée au début des années 1990 par Mathis Wackernagel et William Rees pour agréger des données sur les capacités de la biosphère à supporter un développement humain et économique. Elle est fondée sur la productivité des ressources terrestres et aquatiques nécessaires pour satisfaire les besoins en consommation de la population à partir de sources pérennes. Cet outil a pour vocation de mesurer l’impact des modes de vie humains sur l’environnement en calculant la superficie des sols productifs nécessaires à la production des ressources et à l’absorption des déchets d’une population humaine donnée. L’unité de référence est la superficie de terres et d‘écosystèmes aquatiques exprimée en hectares globaux. Cette unité permet d’unifier des surfaces aux bioproductivités différentes par l’application d’un coefficient d’équivalence.
L’ambition des promoteurs de l’indicateur ‘empreinte écologique‘ est que celui-ci devienne le pendant environnemental aux PIB (Produit intérieur brut) et inflation pour l’économie et IDH (Indicateur de développement humain) pour les aspects sociaux. Ces derniers n’ont pas vocation à piloter des politiques environnementales. Ainsi, le PIB n’intègre pas le coût environnemental des activités économiques. La pollution y est conçue comme un double gain; d’une part celui généré par l’activité polluante (production de biens) et d’autre part, la dépollution rendue nécessaire. La conclusion est que plus l’on pollue, plus l’on est obligé de dépolluer, plus le PIB augmente. Simon Kuznets (1901-1985), prix Nobel d’économie en 1971, initiateur du PIB comme système de comptabilité nationale, écrivait dans son premier rapport au Congrès américain en 1934 “la richesse d’une nation ne peut qu’avec difficulté être déduite de la mesure du revenu national”.
Le Word Wild Fund (WWF) a publié en 2002 le rapport “Planète vivante” montrant qu’en 1997 l’empreinte écologique de la population mondiale était au moins 30% plus importante que la capacité productive biologique de la planète. Une des conclusions les plus médiatisées du recours à cet outil est l’équivalent en planète-terre dont nous aurions besoin pour vivre si les 6 milliards d’habitants avaient le même niveau de développement que les Américains des Etats-Unis: 5 planètes. Ce chiffre est de 3 pour les habitants de l’Union européenne. Malgré les critiques dont cet indicateur est l’objet, la conclusion avancée est que le niveau de développement actuel n’est pas durable car, traduit en surface, celui-ci oblige à utiliser des surfaces dont nous ne disposons pas; donc à puiser dans le capital naturel disponible, mais non renouvelable. La transition entre une sous-utilisation et une sur-utilisation des biocapacités de la planète date du milieu des années 1980 (Humanity’s Footprint 1961-200. Figure : Global demand vs. Supply).
Il est délicat de réduire l’évolution d’un phénomène multifactoriels comme la démographie à une de ses composantes. Il est toutefois opportun d’établir une corrélation entre le début de la décroissance de la natalité et les enseignements issus du recours à l’empreinte écologique. Au facteur d’erreur près, l’époque à laquelle l’humanité a commencé à entamer son stock de capital naturel coïncide avec le début de la diminution des taux de fécondité: la fin du vingtième siècle.
Gérer la transition
Au regard de la crise de l’environnement, la baisse de la croissance démographique, prélude possible à une diminution de la démographie, est une aubaine susceptible de pérenniser un modèle civilisationnel auquel l’ensemble de la planète adhère aujourd’hui. Demain, des civilisations millénaires comme l’Inde ou la Chine nous auront peut-être rejoints, voire dépassés. Ce choix a été réalisé sciemment par ces civilisations car ce modèle contribue à la puissance politique de ceux qui l’adoptent. Mais la contrepartie est la crise écologique.
La baisse prévisible de la démographie est, par conséquent, une chance à saisir à la réserve de modifier profondément nos pratiques politiques. L’existence de croissances régionales comme en Afrique et l’absence de réponse politique est sans aucun doute un enjeu contemporain vital. La transition est à gérer d’un point de vue politique, sinon...Frédéric Malaval 8/01/2005 © POLEMIA
Notes:
1. Héritage de la période soviétique, la citoyenneté et la nationalité sont des concepts distincts en Russie. La première repose sur des critères juridiques alors que la seconde est fondée sur des critères ethniques.
2. Dubos René (1901-1982). Médecin et biologiste américain d’origine française. Né dans le Val d’Oise à Saint-Brice, fut professeur honoraire à la Rockefeller University, mais aussi professeur de pathologie comparée et de médecine tropicale à la Harvard University Medical School. Ses travaux ont ainsi ouvert la voie au développement des antibiotiques. En matière d’environnement, sa contribution principale fut sa mémorable intervention à la Conférence sur l’environnement, tenue à Stockholm en 1972 sous l’égide de l’O.N.U..
3. Rapport World Population to 2030, United Nations department of Economic and Social Affairs/Population Division, cosultable sur: http://www.un.org/esa/population/unpop.htm)
4. Extrait de Humanity’s Footprint 1961-2001 : “Figure ‘Global demand vs. Supply’ shows the ratio between the world's demand and the world's biocapacity in each year, and how this ratio has changed over time. Expressed in terms of "number of Earths," the biocapacity of the Earth is always 1 (represented by the horizontal blue line). This graph shows how humanity has moved from using, in net terms, about half the planet's biocapacity in 1961 to 1.2 times the biocapacity of the Earth in 2001. The global "ecological deficit" of 0.2 Earths is equal to the globe's ecological overshoot” (http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=global_footprint).
Bibliographie
Aghion P., P. Howitt, “Endogenous Growth Theory”, MIT Presse, 1998
Attali Jacques, “Les Juifs, le monde et l’argent”, Fayard, 2002
Barrow R., X. Sala-i-Martin, “Economic Growth”, Mc Graw-Hill, 1995
Baumol W.J., “On the possibility of continuing expansion of finite resources”, Kyklos, 1986
Carrère d’Encausse Hélène, “L’empire éclaté”, Flammarion, 1992
Chesnais Jean-Claude, “La bombe démographique, un pétard mouillé ?”, La Recherche, septembre 1995
Chesnais Jean-Claude, “L’implosion démographique de la Russie”, Groupe X-Démographie-Economie-Population (DEP), Conférence du 13 mars 2001
Daly H.E., “Beyond Growth: the Economics of Sustainable Development”, Beacon Presse, 1996
Duvigneaud Paul, “La synthèse écologique”, Doin, 1980
Empreinte écologique http://www.footprintnetwork.org/
England, Richard W., “Natural capital and the theory of economic growth”, Ecological Economics, September 2000
“Histoire des pensées économiques: les fondateurs”, Sirey, 1988
Favé M.-G., J. Van Niel, “Analyse stratégique du positionnement de l’empreinte écologique comme indicateur environnemental pour les institutions”, Mémoire de DESS Ecologie industrielle, UTT-WWF, 2004
Feldman Marcus, Richard Lewontin, Mary-Claire King, “Les races humaines existent-elles ?”, La Recherche, juillet-août 2004
Johsua Isaac, “Le grand tournant”, PUF, 2003
Laulan Yves-Marie, “Les nations suicidaires”, X-DEP, Conférence du 18 novembre 1998
“Le rapport Meadows” dans http://www.manicore.com/documentation/club-rome.htmlManicore
Leridon Henri, “Vers une baisse de la fécondité”, La Recherche, avril 1982
“Living Planet Report”, WWF, 2002
Locoh Thérèse, “Afrique: la natalité en déclin”, La Recherche, janvier 1995
Meadows D., Randers J., Behrens W, “The limits to growth”, Universe, 1972
Odum P. Eugène, “Ecologie”, Editions hrw (Doin), 1976
Osmanova Faïna, Anatoli Vichnievsky, “La démographie russe”, Ogoniek, Moscou, octobre 2003
Ropke Inge, “The early history of modern ecological economics”, Ecological Economics 50, 2004
Singer Max, “Vers un monde moins peuplé que les Etats-Unis ?”, La Recherche, janvier 2000Stiglitz J., “Growth with exhaustible natural resources: efficient and optimal growth paths”, Rev. Econ. Studies, 1974
Sullerot Evelyne, “Histoire et prospectives de la famille”, X-DEP, Conférence du 14 octobre 1998
Wackernagel Mathis, William Rees, “Notre empreinte écologique”, éditions Ecosociété, 1999
“Word Population to 2300”, United Nations, Departement of Economics and Social Affairs, Population Division, 2004
“World Population Prospect, the 1992 revision”, Organisation des Nations unies, 1993
-
Carl Schmitt actuel
Tel est l’intitulé qu’Alain de Benoist vient de donner à son nouvel opus. Sous-titré « guerre juste, terrorisme, état d’urgence, ‘‘nomos de la terre’’ », l’ouvrage se propose, effectivement, d’interpréter l’Histoire du monde contemporain, notamment depuis un certain “11-Septembre”, à la lumière des concepts inventés par Carl Schmitt à une époque elle-même soumise à de grands bouleversements politiques et géopolitiques.
Idées à l’endroit
Si Marx a été l’un des grands idéologues des XIXe et XXe siècles, Schmitt pourrait être le philosophe du XXIe. Tel serait le présupposé implicite de ce Carl Schmitt actuel. Cette assertion n’est pas sans risques et les contempteurs haineux comme les thuriféraires fanatiques de Schmitt, tous ignorants de sa pensée, ont, depuis longtemps, pris conscience de l’impact de cette argumentation et de sa réversibilité.
Alain de Benoist ne s’y trompe guère, qui commence par remettre quelques idées à l’endroit, singulièrement en ce qui concerne l’influence réelle ou supposée de Leo Strauss dans les milieux néoconservateurs américains. « L’idée générale était que Schmitt aurait été un penseur ‘‘nazi’’, que Leo Strauss, complice de Schmitt, aurait propagé à sa suite les mêmes idées ‘‘nazies’’ en Amérique, et que l’entourage de George W. Bush, influencé par la pensée de Leo Strauss, se rattacherait par son intermédiaire aux idées de Schmitt et donc au nazisme. » Cette thèse, évidemment délirante, demeure pourtant tenace, bien qu’il soit fermement établi sans que le doute ne soit plus permis, sauf chez les ignares et les dogmatiques, que « le lien entre les deux hommes [fut] plutôt ténu » et qu’il a été démontré « l’incompatibilité radicale existant entre la théologie politique de Schmitt et la philosophie politique de Strauss ».
De ce point de vue, l’argumentaire d’Alain de Benoist est absolument convaincant. Une vision par trop monolithique du monde conduit inexorablement et tout uniment les adversaires et les tenants de Schmitt, qu’ils se recrutent au sein des atlantistes ou des anti-américains, à ne pas voir que les libéraux européens sont plus à droite que les libéraux outre-Atlantique (plus à gauche) et que les néoconservateurs américains sont plus proches de ceux-là que de ceux-ci. Dès lors, en toute logique, Schmitt devrait être honni tant par les néoconservateurs américains que par les libéraux européens. Les notions schmitiennes du politique, de l’ordre concret, de l’état d’exception sont, en effet, aux antipodes des conceptions bushistes ou humanitaro-kouchnériennes de criminalisation de l’ennemi, d’”Axe du mal”, de “guerre juste” ou d’antiterrorisme messianique.
Nouveau Nomos
De Benoist montre très clairement, en définitive, que Schmitt, des deux côtés de l’Atlantique, n’ayant été ni lu, ni compris, n’a pu être appliqué. Au contraire, depuis le “11-Septembre”, la réponse proprement politique, inhérente au jus publicum europeanum, s’est muée en ce que Schmitt redoutait par-dessus tout, comme négation du politique, en réponse théologique, c’est-à-dire totalitaire. La métaphysique universaliste informée par une vision religieuse des droits de l’Homme a, de manière assez horrifique, supplanté la métaphysique réelle, autrement dit la physique traditionniste des sociétés politiques. Au « Nomos concret du droit international public classique se substitue ce que Schmitt appelait un ‘‘ordre mondial universel’’ et abstrait. Assurément (et malheureusement), l’on assiste à l’émergence d’un nouveau Nomos que Schmitt enfermait dans cette alternative : “grands espaces contre universalisme” ».
À ce propos, Alain de Benoist nous explique que selon Schmitt, cette nouvelle catégorie juridique de “grand espace” (« Graußraum ») « est appelée à se substituer à l’ancien ordre étatique national entré en crise dès les années trente et aujourd’hui devenu obsolète ». Le « Graußraum » par excellence serait constitué par les empires qui « pourraient bien devenir les principaux acteurs des relations internationales ». Il convient d’être prudent et de se garder de toute dérive nominaliste face à ce type d’analyse qui ferait prendre un constat visionnaire pour une conviction profonde de Schmitt qui, subitement, serait hissé au panthéon des pères fondateurs de l’Europe actuelle.
Si Alain de Benoist ne prend pas explicitement position sur cette question, on sent bien que ses préférences inclinent vers une rhétorique peu favorable à l’État nation. C’est oublier que Schmitt, dans Le nouveau Nomos de la terre, étude publiée en 1955, ménageait l’hypothèse d’une réactivation de l’ancien ordre juridique européen, certes différent du premier, mais prenant appui sur le paradigme étatique, fût-il le fruit d’un redécoupage géopolitique. À l’instar de toutes les sociétés humaines, les nations évoluent et se transforment au gré des circonstances et des aléas de l’Histoire. C’est dire, en tout cas, que la pensée de Carl Schmitt ne se laisse pas appréhender facilement, la subtilité d’approche étant préférable à une lecture hâtive.
L’“exécutif unitaire”
Quoi qu’il en soit, cette actualisation des concepts schmittiens intervient à point nommé, à un moment où l’on parle de plus en plus de la théorie dite de “l’exécutif unitaire” (« unitary executive »), très en vogue aux États-Unis, d’où elle est originaire, mais également en France où elle commence à faire des émules. Nicolas Sarkozy est ainsi loin d’y être insensible à telle enseigne qu’il n’a pas hésité à rencontrer le 16 juillet 2007 le président de la Cour suprême américaine, John G. Roberts (nommé par George W. Bush, le 19 juillet 2005). Ce dernier, inconnu des européens non spécialistes des questions juridiques, passe pour être un membre influent de la Federalist Society, sorte de réservoir de pensée qui défend, entre autre, l’idée selon laquelle le président des États-Unis, contre la lettre de la Constitution elle-même, peut étendre indéfiniment ses pouvoirs, y compris jusqu’à ceux dévolus au Congrès et sans qu’une autorité judiciaire, quelle qu’elle soit, ne puisse s’opposer à cette expansion. Partant, le président des États-Unis, notamment par la pratique des “déclarations de signatures” (« signing statements ») réécrit et livre sa propre interprétation des lois.
La justification de cette concentration des pouvoirs réside dans la lutte contre le terrorisme international et contre tout ennemi des États-Unis et de ses intérêts internes et externes. Les détentions arbitraires sur le site de Guantánamo, la torture des détenus, le “Patriot Act” (24 octobre 2001), le “Military Order” (13 novembre 2001), la volonté de l’administration Bush-Cheney-Rice de s’affranchir des conventions internationales sont directement inspirés de ces juristes, tenants de “l’exécutif unitaire”.
Depuis la nomination, le 31 janvier 2006, de Samuel Alito, la Cour suprême des États-Unis compterait désormais en son sein cinq juges sur neuf qui seraient membres de la Federal Society. Doit-on voir dans ces redoutables déviations du pouvoir une application de la “dictature souveraine” de Schmitt ? Certainement pas, car là où Schmitt se préoccupait de vouloir rétablir un “ordre” (« ordnung ») mis en péril par un état d’exception (« ausnahmefall »), Bush et ses juristes cherchent d’abord à consolider leur hyperpuissance. Le “11-Septembre” a, de ce fait, constitué l’accélérateur autant que le parfait alibi pour asseoir un peu plus leur « hégémonie bienveillante » (« benign hegemony »).
Le drame est que la France, par les voix irresponsables de Nicolas Sarkozy et de Bernard Kouchner, veuille adhérer à cette doctrine dangereuse, apatride et si peu conforme à ses intérêts. La guerre en Iran est pour bientôt et la France, hélas, n’y sera pas étrangère...
Aristide LEUCATE L’Action Française 2000 du 1er au 14 novembre 2007 aleucate@yahoo.fr
* Alain de Benoist : Carl Schmitt actuel. Éd. Krisis, 164 pages, 19 euros. -
Edmond Burke et la Révolution Française
Homme politique anglais qui publie, dès 1790, un manifeste contre-révolutionnaire : Réflexions sur la Révolution en France, qui connaîtra un grand succès. Longtemps négligées par les historiens français, longtemps méconnues en France, les Réflexions de Burke trouvent dans les lectures contemporaines de la Révolution une nouvelle actualité. Burke dénonce la philosophie rationaliste de Révolutionnaires qui prétendent, en faisant table rase de l'histoire, reconstruire l'homme et la société à partir d'une idée de la nature.
 Les Réflexions sur la Révolution en France, publiées à Londres le 1er novembre 1790 par Edmund Burke, célèbre parlementaire irlandais, n'ont cessé depuis lors d'irriter la longue suite de nos dirigeants politiques épris de niaiseries démagogiques et accoutumés à endormir l'opinion de mascarades égalitaires dans l'imposture généralisée des “Droits de l'homme et du citoyen”.
Les Réflexions sur la Révolution en France, publiées à Londres le 1er novembre 1790 par Edmund Burke, célèbre parlementaire irlandais, n'ont cessé depuis lors d'irriter la longue suite de nos dirigeants politiques épris de niaiseries démagogiques et accoutumés à endormir l'opinion de mascarades égalitaires dans l'imposture généralisée des “Droits de l'homme et du citoyen”. À la veille du Bicentenaire dont les fastes dispendieux et grotesques vont encore ajouter au trou sans fond de la Sécurité Sociale et crever un peu plus la misérable vache à lait électorale saignée à blanc par les criminels irresponsables qui, au nom de l'État et pour le bonheur du peuple, osent encore exhiber le bonnet phrygien et se réclamer de la “Carmagnole”, la lecture de Burke, telle une cure d'altitude, est un merveilleux contrepoison.
Félicitons comme ils le méritent le jeune historien Yves Chiron (auquel l'Académie vient de décerner le Prix d'Histoire Eugène Colas) et son éditeur qui rendent enfin accessible au public un ouvrage depuis longtemps introuvable, un auteur dont la liberté d'expression, la vigueur de pensée, la puissance évocatrice et prophétique toujours intacte, réduisent à son abjection et à son néant “l'Événement” dont on nous somme sans répit de célébrer la générosité sublime, la gloire sans pareille, et une grandeur que le monde entier, jusqu'au dernier Botocudo, jusqu'à l'ultime survivant de la terre de Feu et de Rarotonga, ne cesse de nous envier frénétiquement.
Cependant, Yves Chiron note à juste titre dans son étude que « ce qui se passe en 1789-1790 n'est pas un évènement localisé et spécifiquement français : c'est le premier pas vers un désordre généralisé où se profilent la vacance du pouvoir, la disparition des hiérarchies sociales, la remise en question de la propriété — la fin de toute société ».
Plus précisément, c'est la date du 6 octobre 1789 que Burke, contemporain, retient comme signe fatal et révélateur, marqué par le glissement irréversible dans la boue et le sang :
« Dans une nation de galanterie, dans une nation composée d'hommes d'honneur et de chevalerie, je crois que dix mille épées seraient sorties de leurs fourreaux pour la venger (la Reine) même d'un regard qui l'aurait menacée d'une insulte ! Mais le siècle de la chevalerie est passé. Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé : et la gloire de l'Europe est à jamais éteinte ».
Burke fut le premier à dénoncer l'imposture des “droits de l'homme”
Or, par une sinistre ironie de l'Histoire, il se trouve que la France s'est précipitée dans cet interminable bourbier au moment précis où son prestige était le plus éclatant, son économie en pleine ascension, la qualité de sa civilisation reconnue partout sans conteste. Ainsi que le souligne Yves Chiron, Burke note que les “droits de l'homme” flattent l'égoïsme de l'individu et sont ainsi négateurs, à terme, de la vie sociale. Dans un discours au Parlement (britannique), en février 1790, il s'élève avec violence contre ces droits de l'homme tout juste bons, dit-il, « à inculquer dans l'esprit du peuple un système de destruction en mettant sous sa hache toutes les autorités et en lui remettant le sceptre de l'opinion ».
L'abstraction et la prétention à l'universalisme de ces droits, poursuit Chiron, contredisent trop en Burke l'historien qui n'apprécie rien tant que le respect du particulier, la différence ordonnée et le relativisme qu'enseigne l'Histoire. Il n'aura pas de mots assez durs pour stigmatiser Jean-Jacques Rousseau, “ami du genre humain” dans ses écrits, “théoricien” de la bonne nature de l'homme et qui abandonne les enfants qu'il a eu de sa concubine : « la bienveillance envers l'espèce entière d'une part, et de l'autre le manque absolu d'entrailles pour ceux qui les touchent de près, voilà le caractère des modernes philosophes… ami du genre humain, ennemi de ses propres enfants ».
Un autre paradoxe, et non des moindres, a voulu que les sociétés de pensée, l'anglomanie aveugle et ridicule qui sévissait partout en France alors même que la plupart de nos distingués bonimenteurs de salon ne comprenait un traître mot d'anglais, aient pu répandre l'idée que les changements qui se préparaient seraient à l'image de cette liberté magnifique qui s'offrait Outre-Manche à la vue courte, superficielle et enivrée, d'un peuple d'aristocrates honteux, de sophistes à prétention philosophiques, de concierges donneurs de leçons et de canailles arrogantes.
Logorrhée révolutionnaire et pragmatisme britannique
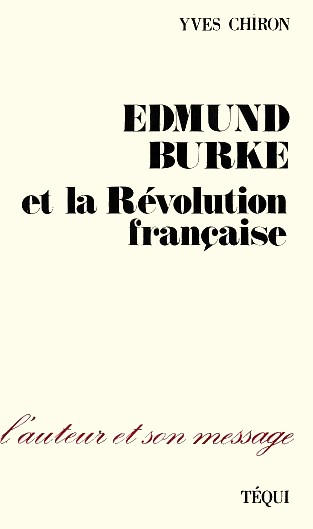 Nul ne s'avisait dans le tumulte emphatique qui remplissait ces pauvres cervelles de débiles et de gredins, de ces “liaisons secrètes” que Chateaubriand a si bien perçues par la suite entre égalité et dictature, et qui la rendent parfaitement incompatible avec la liberté. L'Angleterre, pays de gens pratiques, ne pouvait qu'être aux antipodes de l'imitation “améliorée” que l'on croyait en faire, « et ses grands seigneurs, accourus pour acheter à vil prix le mobilier et les trésors de la Nation vendus à l'encan, n'en revenaient pas de ce vertige de crétinisme et de l'hystérie collective et criminelle emportant follement le malheureux peuple de France vers l'esclavage, la ruine et l'effacement de la scène du monde, au nom de fumées et d'abstractions extravagantes, mensongères et pitoyables ».
Nul ne s'avisait dans le tumulte emphatique qui remplissait ces pauvres cervelles de débiles et de gredins, de ces “liaisons secrètes” que Chateaubriand a si bien perçues par la suite entre égalité et dictature, et qui la rendent parfaitement incompatible avec la liberté. L'Angleterre, pays de gens pratiques, ne pouvait qu'être aux antipodes de l'imitation “améliorée” que l'on croyait en faire, « et ses grands seigneurs, accourus pour acheter à vil prix le mobilier et les trésors de la Nation vendus à l'encan, n'en revenaient pas de ce vertige de crétinisme et de l'hystérie collective et criminelle emportant follement le malheureux peuple de France vers l'esclavage, la ruine et l'effacement de la scène du monde, au nom de fumées et d'abstractions extravagantes, mensongères et pitoyables ». Quant à la masse du peuple, dit Burke, quand une fois ce malheureux troupeau s'est dispersé, quand ces pauvres brebis se sont soustraites, ne disons pas à la contrainte mais à la protection de l'autorité naturelle et de la subordination légitime, leur sort inévitable est de devenir la proie des imposteurs :
« Je ne peux concevoir — dit-il encore — comment aucun homme peut parvenir à un degré si élevé de présomption que son pays ne lui semble plus qu'une carte blanche sur laquelle il peut griffonner à plaisir. (…) Un vrai politique considérera toujours quel est le meilleur parti que l'on puisse tirer des matériaux existants dans sa patrie. Penchant à conserver, talent d'améliorer, voilà les deux qualités qui me feraient juger de la qualité d'un homme d'État ».
Burke, écrit Chiron, « ne conteste pas que la France d'avant 1789 n'ait eu besoin de réformes, mais était-il d'une nécessité absolue de renverser de fond en comble tout l'édifice et d'en balayer tous les décombres, pour exécuter sur le même sol les plans théoriques d'un édifice expérimental ? Toute la France était d'une opinion différente au commencement de l'année 1789 ». En effet. Et, comme l'exprime si justement la sagesse populaire anglaise, “l'enfant est parti avec l'eau du bain”. L'énigmatique “kunsan-kimpur” [calembour phonétique du vers “qu'un sang impur...”] que nos marmots ont obligation d'ânonner dans nos écoles avec les couplets de l'amphigourique et grotesque “Marseillaise” n'abreuve depuis lurette le plus petit sillon de notre exsangue et ratatiné pré carré. Seuls des politiciens que le sens du ridicule n'étouffe pas vibrent encore de la paupière et des cordes vocales tandis que de leur groin frémissant s'échappe indéfiniment, telle une bave infecte, la creuse et mensongère devise de notre constitution criblée d'emplâtres : “Liberté, égalité, fraternité”.
Céline décrit le résultat...
Céline, si lucide et si imperméable à la rémoulade d'abstractions humanitaires dont résonnent sans trève nos grands tamtams médiatiques, et qui savait son Histoire comme on ne l'enseigne nulle part, a décrit la situation une fois pour toutes dans une des pages les plus saisissantes du Voyage.
« Écoutez-moi bien, camarade, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre Société : “L'attendrissement sur le sort, sur la condition du miteux… !” (…) C'est le signe… Il est infaillible. C'est par l'affection que ça commence. (…) Autrefois, la mode fanatique, c'était “Vive Jésus ! Au bûcher les hérétiques !” mais rares et volontaires, après tout, les hérétiques. Tandis que désormais (…) les hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne, les Pacifiques puants, qu'on s'en empare et qu'on les écartèle (…) pour que la Patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce ! Et s'il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n'ont qu'à aller s'enterrer tout de suite avec les autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout du cimetière sous l'épithète infâmante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d'ombre du monument adjudicataire et communal élevé pour les morts convenables dans l'allée du centre, et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de l'écho du Ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le Préfet et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner ».
Que l'on me pardonne cette citation un peu longue et d'ailleurs incomplète, mais elle m'a paru comme un prolongement naturel des Réflexions de Burke, tout en évoquant irrésistiblement l'Auguste Président, grand amateur de cimetières, panthéons et nécropoles, qui s'apprête à commémorer en grande pompe et dans l'extase universelle le Bicentenaire de l'incomparable Révolution française.
◘ Yves Chiron, Edmond Burke et la Révolution Française, Téqui, 1988, 185 p.
► Jacques d'Arribehaude, Vouloir n°50-51, 1988. (et : Bulletin célinien n°73, sept. 1988)
-
L’Église, les Lumières et l’éducation au XVIIIe siècle
Entre le XVIe siècle et la Révolution, un débat s’instaure entre défenseurs et adversaires de l’éducation du peuple. Ce débat met en jeu la nécessité de christianiser les masses, la recherche de l’efficacité économique et l’élévation morale de l’homme par l’instruction. A contrario des idées reçues, les défenseurs de la « démocratisation » de l’instruction ne se trouvent pas du côté que l’on croit !
I. L’Église et l’éducation
Au XVIe siècle, l’Église fait de l’éducation du peuple un devoir pour les clercs et les évêques. Le péril protestant accélère l’ouverture d’écoles élémentaires : dans les régions où progresse le protestantisme, il est impensable de laisser le monopole de l’instruction aux huguenots. Au XVIIe, les missionnaires découvrent dans certaines régions de France une ignorance religieuse préoccupante, qu’ils mettent en parallèle avec l’ignorance des peuples « exotiques ».
Des instituts religieux tels les Frères des Écoles chrétiennes (les lasalliens, du nom du fondateur saint Jean-Baptiste de La Salle) ou des éducateurs tels les prêtres Charles Démia et Jacques de Batencour, ouvrent des écoles primaires gratuites pour enseigner des rudiments de lecture, d’écriture et de calcul, et inculquer une bonne conduite morale et spirituelle. Certes, l’enseignement religieux tient la première place dans ces petites écoles, mais les bases du savoir ne sont pas oubliées.
Les collèges, qui viennent juste après l’école élémentaire, sont eux aussi tenus par des ordres tels les Jésuites, les Oratoriens ou les Dominicains et inculquent un enseignement solide et gratuit essentiellement basé sur les humanités.
L’Église défend l’instruction de tous parce qu’elle considère que celle-ci est utile à l’ordre public, l’ignorance entraînant l’oisiveté et le libertinage, nuisibles à la société. L’enseignement a d’abord pour finalité de former « de bons serviteurs de Dieu, de fidèles sujets de Sa Majesté, de sages citoyens de leur ville » (Charles Démia). Cette mission « civilisatrice » de l’école se traduit aussi par l’accueil et l’instruction des enfants vagabonds, perçus comme des porteurs de fainéantise et d’impiété : l’éducation a pour but de les sauver.
Le roi de France va se faire protecteur des petites écoles dans deux déclarations royales, celles des 13 décembre 1698 et 14 mai 1724, où il est dit à l’article IV (identique dans les deux déclarations) : « Voulons que l’on établisse, autant qu’il sera possible, des maîtres et des maîtresses dans toutes les paroisses où il n’y en a point, pour instruire tous les enfants. ». La déclaration de 1698 pose le principe de l’obligation scolaire jusqu’à 14 ans (presque 200 ans avant Jules Ferry !), qui ne sera pas cependant pas appliqué sur le terrain.
II. L’opposition des Lumières à la « culture pour tous »
C’est une argumentation socio-économique qui est déployée par les philosophes des Lumières. Les thèses mercantilistes associent étroitement la richesse d’une nation à sa production matérielle : les intellectuels (au sens large du terme : notaires, juristes, clercs, …) sont perçus comme des parasites ne produisant rien de concret. L’instruction des masses est vue comme un danger car elle pourrait pousser une grande partie de la population à se détourner des travaux manuels (agriculture et artisanat) pour devenir des parasites préjudiciables à l’ensemble de la société.
Il me paraît essentiel qu’il y ait des gueux ignorants. [...] Ce n’est pas le manœuvre qu’il faut instruire, c’est le bon bourgeois, c’est l’habitant des villes » – Voltaire à Damillaville, 1766.
La figure de premier plan des Lumières, Voltaire, généralement présenté comme un défenseur des opprimés et en première ligne dans la lutte contre l’ignorance, répète à plusieurs reprises dans ses correspondances son hostilité à l’instruction du peuple. A La Chalotais qui dans son Essai d’éducation nationale venait d’affirmer que « le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s’étendent pas plus loin que ses occupations », il écrit en 1763 : « Je vous remercie de proscrire l’étude chez les laboureurs. » Trois ans plus tard, dans une lettre à Damillaville, il récidive : « Il me paraît essentiel qu’il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre, et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n’est pas le manœuvre qu’il faut instruire, c’est le bon bourgeois, c’est l’habitant des villes ».
L’autre grande figure des Lumières françaises, Rousseau, est aussi opposée à l’instruction des masses mais pour une tout autre raison : il faut éloigner le moins possible l’homme de l’état de nature, et l’éducation est corruptrice. Le programme d’éducation de l’Émile n’est pas destiné aux laboureurs mais aux bourgeois. « N’instruisez pas l’enfant du villageois, car il ne lui convient pas d’être instruit » écrit-il dans la Nouvelle Héloïse. Dans le même ouvrage, il rajoute : « Ceux qui sont destinés à vivre dans la simplicité champêtre n’ont pas besoin pour être heureux du développement de leur faculté, et leurs talents enfouis sont comme les mines d’or du Valais que le bien public ne permet pas qu’on exploite. »
Quelques philosophes se démarquent comme Diderot, d’Holbach et Helvétius, laissant entendre que l’instruction populaire est un moyen d’éveiller l’esprit critique et donc d’arracher les masses à la « tyrannie » des rois et des clercs, mais ce son de cloche reste très minoritaire dans les cercles philosophiques. Plus tard, dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, on remarquera qu’aucun article ne se rapporte à l’éducation (pas de droit à l’instruction).
Ces idées des Lumières imprègnent les notables locaux et les milieux bourgeois. Ainsi naissent au XVIIIe des oppositions à l’établissement des écoles de charité. En 1754 à Rennes, la municipalité affirme : « L’utilité de l’érection d’une école publique se réduit donc à apprendre à lire et à écrire aux enfants des pauvres artisans. C’est en cela même porter un coup mortel au commerce civil et à l’ordre politique qui le maintient ; les enfants passent à apprendre à lire et à écrire le temps d’un apprentissage beaucoup plus utile, c’est-à-dire celui de la profession de leur père. Savent-ils lire et écrire : ils se dégoûtent des métiers mécaniques et veulent à la faveur de cette éducation manquée s’élever à un état plus honorable. ».
Louis Philipon de la Madelaine, dans ses Vues patriotiques sur l’éducation du peuple tant des villes que des campagnes (1783), intitule un chapitre « Danger des écoles répandues dans les bourgs et les villages » et y écrit : « On se plaint que les campagnes manquent de bras, que le nombre des artisans diminue, que la classe des vagabonds s’augmente. N’en cherchons la cause que dans cette multitude d’écoles dont fourmillent nos bourgs et nos villages. Il n’est pas de hameau qui n’ait son grammairien. Et qu’y fait-il autre chose que de semer parmi les manœuvres, les artisans, les laboureurs, le dégoût de leurs professions ? … Je le dis hardiment : il n’y aura jamais de bonne éducation pour le peuple, si l’on ne commence à faire disparaître du milieu des bourgs et des campagnes ces recteurs d’écoles qui dépeuplent également nos champs et nos ateliers ». Le même auteur, éclairé par ailleurs, demande l’installation de paratonnerres sur les maisons d’école et l’inoculation des élèves contre la variole !
III. Des arguments de bonne foi ?
Comment expliquer cette opposition ? Les philosophes des Lumières et leurs disciples craignaient-ils vraiment un abandon massif des travaux manuels ?
Bernard Grosperrin (cf. sources) juge que « les arguments avancés ne paraissent pas toujours manifester beaucoup de bonne foi. Passe encore qu’on ait pu croire à une dépopulation des campagnes : le fait est inexact, mais tout le monde à l’époque le tenait pour vrai. Mais comment pouvait-on voir dans ces écoles, à l’objectif si humble, les antichambres des collèges ? Ce n’était que tout à fait exceptionnellement que certains de leurs élèves poursuivaient des études de type « secondaire ». En réalité, plus que l’abandon des activités manuelles, on craignait une sorte de déstabilisation de la société par l’irruption du niveau culturel de l’écrit, jusque-là réservé aux éléments dirigeants, dans la masse du peuple. […] Que chacun reste en son état et dans sa condition, tel est le vœu quasi-unanime des élites des temps modernes, y compris celles qui sont le plus marquées par la revendication des droits naturels. » (p. 20-21, Les petites écoles sous l’Ancien Régime).Bibliographie :
BAECQUE (de), Antoine ; MÉLONIO, Françoise. Histoire culturelle de la France. III – Lumières et liberté. Seuil, 1998.
GARNOT, Benoît. Société, cultures et genres de vie dans la France moderne. Hachette, 1991.
GROSPERRIN, Bernard. Les petites écoles sous l’Ancien Régime. Éditions Ouest France, 1984.
LEBRUN, François ; QUÉNIART, Jean ; VENARD, Marc. Histoire de l’enseignement et de l’éducation. II – 1480-1789. Nouvelle Librairie de France, 1982. -
Eric Anceau : « La trahison des élites »
Eric Anceau est un historien français, maître de conférence à Paris IV-La Sorbonne et enseignant à Sciences-Po, spécialiste du Second Empire et des élites en France de 1815 à nos jours. Il a notamment écrit une biographie de référence de Napoléon III. (NDLR)
« Aujourd’hui, l’élite est en complet déni de la réalité et en totale incapacité de proposer une issue raisonnable à la crise dans laquelle elle a largement contribué à précipiter le pays.»
« Que les élites dirigeantes puisent leur légitimité dans la tradition, le charisme ou la légalité, selon la typologie bien connue proposée par Max Weber (1919), elles doivent savoir gérer les crises qui, périodiquement, frappent les sociétés dont elles ont la charge pour se maintenir au pouvoir. Faute de l’avoir compris, la noblesse française, crispée sur ses privilèges et désireuse d’en obtenir davantage, a tout perdu en ouvrant, entre 1787 et 1789, la boîte de Pandore d’un réformisme incomplet parce qu’exclusivement destiné à lui profiter.
Depuis, le rôle de nos élites est plus complexe. Au travers de quinze changements de régimes, elles sont restées au pouvoir sous divers avatars dans le cadre d’une démocratisation relative mais réelle et au prix de concessions importantes. Dans sa fresque monumentale, La Responsabilité des dynasties bourgeoises (1943-1973), Beau de Loménie présentait l’extraordinaire capacité des mêmes familles et des mêmes réseaux à se maintenir au sommet, en dépit d’effondrements nationaux dont ils étaient, en grande partie, responsables, et qui s’étaient payé à chaque fois par l’occupation et le démembrement du territoire : 1815, 1870, 1940 ! Caricatural dans ses détails – l’auteur relayait par exemple le « mythe des deux cents familles » –, le tableau présentait un fond de vérité. Au cours des Trente Glorieuses, ces mêmes élites n’en ont pas moins défini une nouvelle politique sociale, construit une industrie moderne et animé, à partir de 1958, sous la direction du général de Gaulle, un régime qui a fait rayonner la France. Lorsque mourut Beau de Loménie en 1974, sa fresque semblait décrire un passé révolu.
En 1960, Raymond Aron lui-même évoqua une démocratie libérale chimiquement pure et préservée de tout péril majeur par le contrôle que des catégories dirigeantes différenciées exerçaient les unes sur les autres. Il n’occultait cependant ni les menaces, ni les limites qui pesaient sur le régime selon son cœur. L’un de ses collègues d’outre-Atlantique, Charles Wright Mills n’avait-il pas publié quatre ans plus tôt The Power Elite dans lequel il décrivait, force chiffres et exemples à l’appui, la collusion entre le monde politique, les magnats du capitalisme financier et le lobby militaro-industriel qui menaçait l’essence de la démocratie américaine ? De fait, la France ne fut pas épargnée.
En 1977, Pierre Birnbaum dénonçait dans Les Sommets de l’État, l’interpénétration de la politique et de l’administration. Le phénomène ne fit que s’accélérer au cours des décennies suivantes, au point que désormais la classe politique, la haute fonction publique, le grand patronat industriel, le monde de la finance et de nombreux journalistes travaillant pour les médias mainstream ne composent plus qu’une seule élite. Le clivage gauche-droite hérité de 1789 est devenu secondaire. Une véritable oligarchisation du pouvoir est même en cours. Le népotisme actuel dépasse celui qu’ont connu nos défuntes monarchies. Comme l’ont montré maints ouvrages récents dont les enquêtes édifiantes de Sophie Coignard et Romain Gubert, L’Oligarchie des incapables et de Noël Pons, La Corruption des élites, ce phénomène s’accompagne d’un dévoiement de l’expertise et de multiples conflits d’intérêts.
Aujourd’hui, l’élite est en plein rejet du passé, en complet déni de la réalité et en totale incapacité de proposer une issue raisonnable à la crise dans laquelle elle a largement contribué à précipiter le pays. Revenons brièvement sur cette trahison, au sens où l’élite manque à l’immense responsabilité dont elle est investie.
Depuis la Révolution, les élites ont réussi à se perpétuer au pouvoir parce qu’elles ont su ajuster notre modèle d’État-nation aux transformations du monde, aux crises intérieures et aux périls extérieurs. Après la Première Guerre mondiale, certains avaient cherché à encourager le dialogue direct des associations internationales et des régions par-dessus les États, lors de la Conférence de Versailles, mais ils avaient échoué devant l’opposition des gouvernements. L’avènement des États-Unis en tant que superpuissance changea la donne après 1945. Nul n’ignore le rôle que ceux-ci jouèrent dans la construction européenne lors de la Guerre froide.
Le discours sur la péremption des États-nations de la Vieille Europe, d’abord limité à quelques cercles atlantistes, à la Conférence Bilderberg et à la Trilatérale a fini par gagner Bruxelles, Luxembourg, Francfort et Paris. Il est devenu le discours dominant de l’élite. L’universalisme français né durant les Lumières et développé par la Révolution missionnant la Grande Nation pour le propager à travers le monde a été transformé en un cosmopolitisme dissolvant. De façon improbable il y a encore trente ans, le néolibéralisme, la démocratie-chrétienne et le gauchisme libertaire finissent par se retrouver dans une forme de pensée unique post-nationale. Nombre de « féodaux » à la tête de nos régions attendent impatiemment le moment proche où ils vont bénéficier de la gestion des fonds structurels.
Le peuple qui conserve son attachement à l’État-nation, à la démocratie et à la République est qualifié au mieux de poujadiste, au pire de nationaliste
Déjà méprisé, le peuple qui conserve son attachement à l’État-nation, à la démocratie et à la République est qualifié au mieux de poujadiste, au pire de nationaliste, alors même que le printemps arabe et l’émergence de puissances comme la Chine, l’Inde ou le Brésil soulignent la vitalité des États-nations. Ainsi que Renan l’écrivait : « L’existence des nations est la garantie de la liberté qui serait perdue si le monde n’avait qu’une loi et qu’un seul maître ».
Des discours exclusivement passéistes et radicaux apportent de l’eau au moulin de l’élite, mais ne suffisent pas à éradiquer le patriotisme, comme la victoire du « non » au référendum de 2005 l’a montré. Une grande partie de l’élite partage donc le vœu formulé par l’universitaire américain Bryan Caplan dans The Myth of the Rational Voter (2008) : il faudra bien remplacer la démocratie par le marché, puisque le peuple est ignare mais indispensable à la consommation. L’ère post-démocratique annoncée par Jürgen Habermas, Hubert Védrine ou Emmanuel Todd est peut-être proche.
S’ajoute le complet déclin du sens du service public et désintéressé face au libéralisme-libertaire du gagner-toujours-plus-pour-jouir-davantage. Le culte de l’argent et les rémunérations disproportionnées ont progressé au cours des dernières années, en raison de la financiarisation de l’économie et de l’impuissance à établir des contrôles et des freins efficaces. Comme Christopher Lasch l’a montré dans La Révolte des élites et la trahison de la démocratie (1994), il n’est pas surprenant que l’élite qui démissionne de son rôle historique pour défendre ses privilèges et ses intérêts particuliers impose la règle de la non-règle, entonne l’hymne de la pluralité et ne soit guère disposée à lutter contre une tendance d’une partie de nos compatriotes à se penser non en citoyens appartenant à une même république, mais en individualités relevant de communautés.
Les médias qui avaient joué un rôle essentiel dans l’affirmation de la nation et dans l’épanouissement du vivre-ensemble ont promu de faux maîtres à penser dans le cadre d’une « société du spectacle » et d’un « festivisme » dénoncés par Guy Debord et par Philippe Muray.
Au vrai, une forme de schizophrénie française amène notre élite à osciller entre la confiance aveugle en elle-même et la haine de soi, telle que définie en 1930 par Theodor Lessing et qui s’applique si bien à nombre de nos dirigeants conscients de leur impuissance. L’instinct grégaire, le conformisme et l’incapacité à penser la complexité internationale amènent l’élite, d’une part, à s’en remettre à la fraction d’entre elle – les financiers – la plus en phase avec la mondialisation et accessoirement qui maîtrise l’usage de l’anglais, à défaut d’avoir su prévoir et vaincre la crise et, d’autre part, à rejeter tous ceux qui pensent différemment.
Notre seul prix Nobel d’économie, Maurice Allais, mort en 2010, n’était plus invité nulle part, parce qu’il avait eu le malheur de dénoncer le dogme du libre-échange. La formation élitaire à la française porte ici une part de responsabilité comme de nombreuses études l’ont montré depuis une trentaine d’années.
Tout concourt donc à amener l’élite à s’exonérer de la mission qui lui incombe : penser la France telle que son histoire l’a faite, telle qu’elle est et telle qu’elle devrait être, ni figée dans son passé, ni soumise à une réformite aiguë mal pensée et destructrice, mais réformée raisonnablement, stratégiquement et courageusement, pour continuer de tenir un rang dans le monde de demain. La situation actuelle présente quelque analogie avec 1788 et nos dirigeants doivent prendre garde, car comme l’écrivit Vilfredo Pareto en 1916, « l’histoire est un cimetière d’élites ».
Ils doivent retrouver au plus vite l’intelligence du cours des choses dans cette crise qui n’est pas seulement politique, économique et sociale. Elle risque de les emporter et notre civilisation avec eux. Le grand philosophe de l’histoire, Arnold J. Toynbee nous a prévenus : « Les civilisations ne meurent pas assassinées. Elles se suicident. »
-
Carl Schmitt : Changement de structure du droit international (1943) (2/2)
On ne peut nier qu'un morceau de culture européenne ait été transplanté sur le sol américain. En tant qu'Européens de la vieille Europe, nous ne devons pas hésiter à reconnaître ouvertement —sans qu'il y ait là de concession à la fierté américaine— que des hommes comme George Washington et Simón Bolívar étaient indubitablement de grands Européens et qu'ils se sont probablement davantage rapprochés du sens idéal de ce mot que la plupart des hommes d'État anglais ou continentaux de cette époque. Face à la corruption parlementaire et à la dégénérescence absolutiste du XVIIIe siècle en France et en Angleterre, et plus encore face à l'étroitesse et à la servitude de la réaction et de la restauration postnapoléoniennes du XIXe siècle, l'Amérique avait de grandes chances de représenter l'Europe authentique et véritable. L'ambition qu'avait l'Amérique d'être la véritable Europe fut un facteur historique de très grande portée. Elle était une énergie politique réelle, ou comme on dit aujourd'hui dans la terminologie de l'actuel état de guerre totale, un potentiel guerrier de premier rang. Ce réservoir de force historique a continué à être alimenté au XIXe siècle, surtout par les révolutions européennes de 1848. Des milliers d'Européens déçus et désillusionnés, parmi lesquels de nombreux hommes d'envergure ainsi qu'un nombre non négligeable de jeunes paladins de la liberté ont quitté la vieille Europe réactionnaire au XIXe siècle pour émigrer en Amérique.
Mais dès la fin du siècle, autour de 1900, toutes ces grandes possibilités internes et externes paraissaient épuisées et caduques. L'invasion de Cuba fut le signal de politique étrangère qui annonça au monde le passage à l'impérialisme. Cet impérialisme ne s'en tenait plus aux vieilles conceptions continentales de l'hémisphère occidental, mais il s'avançait loin dans le Pacifique et en direction de l'ancien Orient. De vastes espaces furent alors soumis au principe de la « porte ouverte» qui remplaça la doctrine Monroe périmée (6). Géographiquement et à l'échelle du globe, c'était un pas de l'Orient vers l'Occident. Par rapport à l'espace oriental d'Asie qui réémerge aujourd'hui comme facteur de l'histoire universelle, le continent américain se trouvait alors dans la même situation que cent ans plus tôt la vieille Europe, lorsque l'irruption de l'Amérique dans l'histoire universelle l'avait déplacée dans l'hémisphère oriental. Un tel changement d'éclairage est un thème vraiment sensationnel pour une «géographie de l'esprit». C'est sous l'impression que laissait cette lumière nouvelle que l'on proclama en I930 l'avènement d'un Nouveau Monde qui devait unir l'Amérique avec la Chine (7).
Mais l'ancienne foi dans ce Nouveau Monde s'effritait désormais elle aussi de l'intérieur, avec la même force et la même ampleur qui avait caractérisé les déplacements politiques de l'Occident vers l'Orient. Avec l'émergence de l'impérialisme nord-américain en politique extérieure s'annonçait également la fin d'une époque des États-Unis du point de vue interne. Les fondements de tout ce qui avait fait la substance, et pas seulement l'idéologie, de ce qu'on appelait la « nouveauté » et la « liberté » de l'hémisphère occidental s'effondrèrent par la base. En I890, l'occupation intérieure de terres aux États-Unis cessait d'être libre. La colonisation des sols restés libres prit fin. Jusque-là les anciennes frontières des États-Unis séparant la terre colonisée des terres libres et ouvertes à l'occupation avaient toujours été en vigueur. Le frontier avait toujours existé, ce type de frontalier prêt à passer du sol peuplé au sol libre, propre à ces lignes limitrophes. Avec le sol libre disparut aussi l'ancienne liberté. Ainsi se transforma la loi fondamentale des États-Unis, même si la façade des normes constitutionnelles de 1787 fut maintenue. Tous les bons observateurs le remarquèrent et parmi ceux qui l'exprimèrent, John Dewey, le représentant typique du pragmatisme américain est peut-être celui qu'il faut mentionner en premier du fait qu'il a pris la disparition du frontier comme point de départ de ses analyses sur la réalité sociale concrète de l'Amérique.
Dès lors, le nomos de l'Amérique — entendu comme le fondement des rapports sociaux et juridiques— se transforma du tout au tout. Le monde jusque-là libre et neuf se mit à ressembler de plus en plus à l'ancien et cela à un rythme tel qu'en quelques années, l'ancien Monde fut rattrapé et dépassé par le nouveau. Les États-Unis se transformèrent en une image agrandie et grossière de la vieille Europe. La question sociale, démographique, raciale, les problèmes de chômage et de liberté politique se posèrent comme dans la vieille Europe mais de façon décuplée, comme après un accroissement et une intensification fantastiques. Dans le même temps s'épuisèrent toutes les énergies historiques qui avaient conféré à la ligne d'auto-isolement de Jefferson sa solidité intérieure.
Que des peuples et des empires s'isolent du reste du monde et cherchent à se protéger par une ligne défensive de toute contamination extérieure n'est pas un fait nouveau dans l'histoire universelle. Le limes est un phénomène originaire dans l'histoire ; la muraille de Chine est, semble-t-il, une construction typique, et les colonnes d'Hercule sont restées de tout temps l'image de la frontière mythique. La question cruciale est celle de l'attitude qu'engendrent cet isolement et ce retranchement par rapport au reste du monde. La prétention américaine d'être un Nouveau Monde non corrompu a été supportable pour le reste du monde tant qu'elle s'est combinée à un isolement conséquent. Une ligne globale partageant le monde en deux moitiés selon le bien et le mal est une ligne qui distribue les bons et les mauvais points dans l'ordre moral. Si elle ne s'en tient pas à une stricte position défensive et à l'auto-isolement, elle représente un défi politique permanent pour l'autre partie de la planète. Ni simple problème de cohérence logique, ni pure question d'opportunité pratique, ni thème pour conversations juridiques, se pose la question de savoir si la doctrine Monroe est un principe de droit (un legal principle) ou une maxime politique. C'est en réalité un dilemme politique auquel personne ne peut se soustraire, ni le fondateur de la ligne d'auto-isolement, ni le reste du monde. La ligne d'auto-isolement se renverse effectivement en son contraire quand elle se mue en ligne de disqualification et de discrimination du reste du monde. Il y a une raison à cela : la neutralité de droit international correspondant à cette ligne d'auto-isolement est, par ses conditions et ses fondements, un principe absolu, plus strict que la neutralité de l'ancien droit international européen qui était apparue à l'occasion des guerres interétatiques des XVIIIe et XIXe siècles. Quand la neutralité absolue propre à l'auto-isolement devient caduque, l'isolation se transforme en un principe d'intervention illimitée qui embrasse sans distinction toute la planète. Le gouvernement des États-Unis s'érige alors en juge de la terre entière et s'arroge le droit d'intervenir dans les affaires de tous les peuples et de tous les espaces. L'attitude défensive propre à l'auto-isolement révèle ses contradictions internes et se renverse en un pan-interventionnisme extrême, sans limites ni attaches spatiales.
Tout ce que le gouvernement des États-Unis a entrepris depuis quarante ans est marqué par ce dilemme aigu entre isolement et pan-interventionnisme. Il devient plus pressant et irrésistible à mesure qu'augmentent jusqu'à la démesure les dimensions spatiales et politiques qui sous-tendent une telle pensée par lignes globales.
L'hémisphère occidental est livré à ce dilemme considérable depuis le début de l'ère impérialiste, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Tout sociologue, tout historien et tout juriste ayant suivi l'évolution depuis 1890 des États-Unis et de l'hémisphère qu'ils dominent a nécessairement remarqué les contradictions immanentes à ce développement. La masse continentale immense oscille brusquement et sans transition d'un extrême à l'autre sous l'emprise de cet antagonisme vertigineux. Ce ne sont pas là seulement des tendances contraires, des contrastes et des tensions intérieures comme on en trouve dans toute vie intense et naturellement dans tout grand empire. Il s'agit plutôt d'un nœud de problèmes irrésolus qui contraint par malheur l'hémisphère occidental et le reste du monde à transformer la guerre interétatique du droit international européen en guerre mondiale. Quand l'auto-isolement face au reste du monde se renverse en discrimination du monde extérieur, la guerre devient une action punitive qui stigmatise en l'adversaire le criminel. Cette guerre n'est pas la guerre « juste » des théologiens du Moyen Âge dont parlait Vitoria, et sous son influence, Grotius et les internationalistes du XVIIe et du XVIIIe siècles. C'est un phénomène radicalement nouveau — parce qu'il est global et embrasse le monde entier — que cette prétention d'éliminer l'adversaire politique en le faisant passer pour un criminel qui menace le monde et pour l'ultime obstacle à la paix mondiale. J'ai appelé cette attitude Le passage au concept discriminatoire de guerre (8). En revendiquant le droit de se défendre contre un adversaire politique, mais aussi de le disqualifier et de le diffamer du point de vue du droit international, le gouvernement de Washington a l'intention de faire accéder l'humanité à un nouveau type de guerre en droit international. Pour la première fois dans l'histoire, la guerre est une guerre mondiale globale.
Lors de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, la politique du président W. Wilson vacillait déjà entre les extrêmes de l'auto-isolement et de l'intervention planétaire, jusqu'à ce qu'elle bascule violemment du côté de l'interventionnisme et d'une guerre qui entreprenait d'abaisser l'adversaire au niveau du criminel. Je ne citerai que deux déclarations de Wilson, à première vue contradictoires, la première, date de 1914, la seconde coïncide avec l'entrée en guerre de l'Amérique en 1917. Dans son discours du 9 août 1914, Wilson se ralliait solennellement à l'idéal d'une neutralité absolue, stricte, scrupuleuse, qui se gardait anxieusement de faire la moindre différence entre les belligérants et qui respectait avec une rigueur absolue l'isolement que s'impose à soi-même la neutralité. Le président somma alors ses compatriotes de s'abstenir de toute prise de parti, même dans leur conscience, car cette attitude n'aurait été neutre que de nom, tandis que leur âme aurait renoncé à la neutralité réelle : « Nous devons être impartiaux en pensée et en acte, tenir en bride nos sentiments, et éviter toute action qui pourrait être interprétée comme une préférence accordée à l'un des deux camps. » Dans sa déclaration du 2 avril 1917, il change radicalement de position et proclame ouvertement que non seulement le moment d'être neutre mais aussi l'ère de la neutralité sont révolus, et que la paix du monde et la liberté des peuples justifient la participation à une guerre européenne. Suite à l'intervention des États-Unis, celle-ci se transforma en guerre mondiale et de l'humanité entière.
L'histoire américaine des dernières décennies enseigne qu'il ne s'agit pas d'un changement d'opinion personnelle de Wilson ni d'excès relevant de la psychologie individuelle. À chaque moment décisif, la même problématique de l'isolement et de l'intervention planétaire resurgit. Du point de vue du droit international, la proscription de la guerre instituée par le Pacte Kellogg du 27 août 1928 revient pour les États-Unis à garder en mains la grande décision sur la guerre mondiale et sur l'aggressor, même par rapport à la SDN, et à bannir du droit international le concept traditionnel de neutralité auquel le pacte de Genève faisait encore une place. « Auparavant », écrit John B. Whitton, un internationaliste qui représente bien cette mentalité, « la neutralité était un symbole de paix, elle est maintenant, grâce au nouveau droit international issu du Pacte de la Société des Nations et du Pacte Kellogg, un symbole de guerre. »
Au cours de la guerre mondiale actuelle, l'oscillation extrême entre isolement neutre et pan-interventionnisme s'est retrouvée au mot près et suivant un parallélisme rigoureux dans de nombreuses déclarations du président Franklin D. Roosevelt. Si, pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918, ce dilemme s'est reflété dans les déclarations de Wilson, à partir de 1939, cette contradiction se répète de façon à tel point stéréotypée qu'on ne peut que supposer qu'elle surgit d'une identité profonde. La déclaration officielle de neutralité des États-Unis du 5 septembre 1939 se réclamait solennellement du vieux concept de neutralité défini par la plus stricte impartialité et le maintien d'une amitié égale avec toutes les parties belligérantes. On y trouve même l'expression on terms of friendship qui est la formule de la tradition européenne pour dire que la neutralité repose sur une amitié égale avec les deux parties en conflit. Inutile de décrire ici ce qu'il en fut réellement de cette impartialité et de cette amitié américaines entre septembre 1939 et l'ouverture des hostilités lors de l'entrée en guerre officielle de 1941. Après les nombreux discours du président Roosevelt, après l'ingérence dans les affaires intérieures européennes au détriment de l'Allemagne en France, en Finlande, dans les Balkans et presque partout dans le monde, après le traité signé avec l'Angleterre en octobre 1940 fournissant des bases militaires anglaises aux destroyers américains, rien ne sert de dépeindre en détail l'attitude partiale et non neutre des États-Unis. Ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est le problème de l'hémisphère occidental et l'immense contradiction sans cesse accrue depuis le début du siècle que recouvre ce concept. La stricte neutralité qu'impliquait l'auto-isolement a elle aussi été jetée par-dessus bord pendant la Deuxième Guerre mondiale après avoir été solennellement ratifiée au début de la guerre. Le mémoire qu'a rédigé le procureur général et ministre de la Justice Jackson à bord du yacht présidentiel Potomac, lu le 31 mars 1941 lors d'une conférence de presse de la Maison-Blanche, ne fait que tirer la conclusion ultime et dresser le bilan quand il annonce la mort de l'ancien principe de l'isolement et de la neutralité : « Je ne nie pas, a dit le porte-parole du gouvernement des États-Unis, qu'au XIXe siècle l'idée de neutralité ait été à la base de certaines règles spéciales, règles qui ont ensuite été complétées par les différentes Conventions de La Haye. Mais ces règles ont fait leur temps. Les évènements de l'actuelle guerre mondiale les ont réduites à néant et privé de toute validité. L'adoption par la Société des Nations du principe des sanctions contre l'agresseur, le Pacte Briand-Kellogg et le Pacte argentin de proscription de la guerre ont définitivement balayé ces principes du XIXe siècle selon lesquels tous les belligérants devaient être traités de façon égale. Nous sommes revenus à des conceptions plus anciennes et plus saines. »
Notre obstination à souligner la profonde contradiction interne entre isolement et intervention a pour seul but de mettre en lumière de façon simple et percutante la situation politique et juridique de l'hémisphère occidentale. Toutes les décisions et tous les évènements essentiels de l'actuel continent américain révèlent cette faille intérieure et il n'est pas de problème important, que ce soit le problème racial, le problème social ou celui de la planification économique, qui ne donne lieu à cette même oscillation entre les deux extrêmes. À cause de son importance en droit international, j'aimerais me tourner maintenant vers la question de la reconnaissance internationale. Elle livre une autre manifestation de cet antagonisme. La reconnaissance internationale est une institution du droit international européen qui tente de concilier l'intérêt qu'a l'État à reconnaître une partie contractante digne de confiance avec le principe de la non-intervention dans les problèmes constitutionnels internes de l'État reconnu. Ainsi, selon la conception courante, la reconnaissance internationale d'un État étranger et de son gouvernement n'est pas interprétée comme un acte constituant ni comme une formalité vide, mais plutôt comme un « certificat de confiance » dans les relations d'État à État, de gouvernement à gouvernement. La pratique européenne s'efforce ainsi difficilement de se frayer un chemin de traverse entre l'ingérence — inacceptable— et l'abstention complète de toute prise de position, impossible dans les faits. Mais sur le sol américain, l'antagonisme entre intervention et non-intervention s'est manifesté là encore de façon si brusque et si violente que l'Amérique est à nouveau apparue comme une image grossière et déformée de la problématique européenne du XIXe siècle. Il existe même une doctrine de la pratique américaine de la reconnaissance des autres États qui porte le nom de doctrine Wilson. D'après celle-ci, seul un gouvernement « légal », au sens qu'a le mot « légal » dans une constitution démocratique, peut être reconnu. Il va de soi que dans la pratique la signification des mots « démocratique » et « légal » est « déterminée, interprétée et sanctionnée » au cas par cas par le gouvernement des États-Unis. La doctrine et la pratique sont l'une comme l'autre extrêmement interventionnistes ; elles reviennent à ce que le gouvernement de Washington contrôle en fait tous les changements de régime et de constitution des autres États américains. En Amérique latine en revanche, on invoque l'indépendance et la souveraineté des États pour rejeter la reconnaissance internationale et la considérer comme un moyen d'intervention illicite en droit international. La conception mexicaine qui s'exprime dans la doctrine Estrada va même jusqu'à récuser toute reconnaissance en droit international, considérant qu'elle est un affront pour l'État ou le gouvernement à reconnaître (9). Par conséquent, toutes les relations juridiques entre États deviennent des relations isolées et purement factuelles, définies au cas par cas. On a là le pôle opposé au concept de reconnaissance des États-Unis. Les deux « doctrines » représentent des positions absolument contraires ; le parallélisme avec la contradiction interne entre isolement et discrimination interventionniste est nettement perceptible. Des contradictions insolubles surgissent sans cesse dans l'hémisphère occidental, elles prennent naissance dans la structure interne d'un continent déchiré et soumis à l'hégémonie des États-Unis et qui ne dispose pas d'un principe propre qui lui permettrait de décider entre isolement et intervention.
Ainsi le mythe de l'hémisphère occidental aboutit intérieurement comme extérieurement à un interventionnisme illimité. Son instrument spécifique est la « reconnaissance » du droit international, non seulement au sens de la reconnaissance traditionnelle d'États et de régimes nouveaux mais aussi comme prise de position sur tous les changements importants, notamment les changements territoriaux. Dans la doctrine Stimson du 7 janvier 1932, les États-Unis se réservent le droit partout sur la planète de refuser leur reconnaissance à tous les changements de possession accomplis par la violence. Ce qui signifie que les États-Unis, sans se préoccuper de la distinction entre hémisphères occidental et oriental, s'arrogent le droit de décider sur la terre entière de l'aspect juste ou injuste de toute modification territoriale. Il y a peu de temps encore, tout tournait autour de la délimitation géographique de la doctrine Monroe et de l'hémisphère occidental. On avait besoin d'une frontière parce que ce qui justifiait politiquement, juridiquement et moralement la doctrine Monroe, c'était la formation d'un domaine d'autodéfense qui soit légal. C'est pourquoi il peut être utile de rappeler face à l'interventionnisme illimité, global et universel d'aujourd'hui que tous ces efforts pour délimiter le domaine géographique de la doctrine Monroe et de l'hémisphère occidental n'avaient pas d'autre justification juridique que la nécessité de délimiter un domaine américain d'autodéfense. Quand on proclame le droit à l'autodéfense, fût-ce à l'intérieur de frontières tracées généreusement, on reconnaît implicitement le droit à l'autodéfense au-delà de ces mêmes frontières. Fondement et frontière - comme toujours en droit et surtout en droit international - sont ici des termes équivalents. Avec la disparition actuelle de toutes les frontières, l'aspiration des États-Unis à étendre leurs interventions et leur reconnaissance à tous les espaces de la terre équivaut à nier le droit à l'autodéfense de tous les autres gouvernements. Voilà la signification véritable, du point de vue du droit international, du pan-interventionnisme global auquel aboutit finalement le principe de l'hémisphère occidental. Parce que cet interventionnisme a perdu tout sens de la mesure et des limites, les fondements de l'ancienne doctrine Monroe ont été détruits, ainsi que le panaméricanisme qui lui était propre.
Mais la suppression de toute mesure et de toute limite qui caractérise l'interventionnisme américain a un sens non seulement global mais aussi total. Elle agit aussi bien sur les affaires intérieures que sur les rapports sociaux, économiques et culturels et traverse en leur cœur les peuples et les États. Puisque le gouvernement des États-Unis a le pouvoir de discriminer les autres gouvernements, il a bien sûr aussi le droit de dresser les peuples contre leurs propres gouvernements et de transformer la guerre entre États en guerre civile. La guerre mondiale discriminatoire de style américain se transforme ainsi en guerre civile mondiale de caractère total et global. C'est la clé de cette union à première vue invraisemblable entre le capitalisme occidental et le bolchevisme oriental. L'un comme l'autre font de la guerre un phénomène global et total et transforment la guerre interétatique du droit international européen en guerre civile mondiale. On comprend mieux le sens profond de ce que Lénine qualifiait de problème de la guerre totale quand il soulignait que dans la situation actuelle de la terre, il n'y avait plus qu'un seul type de guerre juste : la guerre civile. C'est seulement en adoptant ce point de vue global que l'on commence à comprendre quelle portée a pour le reste du monde le vacillement incessant de l'hémisphère occidental. La tendance à l'isolement faisait partie du patrimoine traditionnel et conservateur des États-Unis. Elle disparaît et l'aspiration à l'hégémonie mondiale contenue en germe dans la guerre mondiale discriminatoire pousse les États-Unis à intervenir militairement non seulement dans tous les espaces politiques, mais aussi dans tous les rapports sociaux de la terre. L'histoire contradictoire et en apparence énigmatique de la neutralité américaine entre 1914 et 1941 n'est rien d'autre que l'histoire de cette contradiction interne entre auto-isolement et discrimination du monde.
Aujourd'hui, en 1943, les États-Unis tentent de se faire une place en Afrique et au Proche-Orient. De l'autre côté du globe, ils étendent une main vers la Chine et l'Asie centrale. Ils recouvrent la terre d'un système de bases militaires et de voies aériennes et proclament le «siècle américain » de notre planète. On ne peut plus parler de frontières, aussi généreusement tracées soient-elles. Ainsi se termine le mythe politique de l'hémisphère occidental. Mais sa fin est aussi la fin de toute une époque et d'un stade déterminé de l'évolution du droit international. C'est la fin de l'époque qui pensait par lignes globales et la fin de la structure du droit international qui correspondait à cette pensée. Dans les différents types de lignes globales - la raya hispano-portugaise, l'amity line anglaise, et la ligne d'auto-isolement de l'hémisphère occidental - on décelait une aspiration à modeler un ordre spatial de la terre entière, un nomos planétaire. Aujourd'hui tous ces efforts sont historiquement dépassés. Dès lors que la dernière de ces lignes globales, celle de l'hémisphère occidental, a basculé dans l'interventionnisme illimité et global, nous avons affaire à une situation radicalement nouvelle. Un autre nomos de la terre tente de contrecarrer la tendance au contrôle universel de la planète et à l'hégémonie mondiale. Son idée centrale consiste à partager la terre en plusieurs grands espaces distincts définis par leur substance historique, économique et culturelle.
Les lignes globales caractérisaient le premier stade d'une lutte dont c'était l'enjeu de déterminer le nomos de la terre et la structure du droit international. Mais leurs divisions de la terre étaient abstraites et superficielles au sens plein du terme. En elles, tous les problèmes se résolvaient en géométrie. Abstrait et superficiel, l'impérialisme global et délocalisé de l'Occident capitaliste et de l'Est bolchevique l'est aussi. Entre les deux, l'Europe tente aujourd'hui de défendre sa substance qui risque elle aussi d'être traitée comme simple superficie. Face à l'unité globale de l'impérialisme planétaire — capitaliste ou bolchevique — se dresse une multiplicité de grands espaces denses et concrets. C'est la structure du futur droit international qui est l'enjeu de la lutte, les combats doivent trancher entre la coexistence future d'une multitude d'entités autonomes ou de simples filiales décentralisées, régionales ou locales, appartenant à un seul « maître du monde ». Les idylles locales ou régionales ne sont plus capables de résister à l’impérialisme global. Seuls les véritables grands espaces sont en mesure de l'affronter. Un grand espace digne de ce nom contient la mesure et le nomos de la terre à venir. C'est là son sens dans l'histoire universelle et en droit international.
Le secrétaire d'État Henry L. Stimson qui a donné son nom à la fameuse et interventionniste « doctrine Stimson » a précisé le sens de cette conception globale dans une conférence du 9 juin 1941 devant les cadets de West Point. Il y affirme que la terre n'est pas plus grande aujourd'hui que ne l'étaient les États-Unis d'Amérique en 1861, alors déjà trop petits pour contenir l'opposition entre les États du Nord et ceux du Sud. « La terre, déclara Stimson, est aujourd'hui trop petite pour deux systèmes opposés. » Mais nous lui répondons que la terre sera toujours plus grande que les États-Unis d'Amérique et que jusqu'à ce jour, elle est suffisamment grande pour abriter plusieurs grands espaces au sein desquels les hommes épris de liberté peuvent défendre leur substance propre et leur spécificité historique, économique, et spirituelle.
Carl SCHMITT http://www.theatrum-belli.com/
Notes
1. Le philosophe italien Giorgio Agamben s'appuie sur le livre de Schmitt sur la dictature pour critiquer Guantanamo. C'est un des usages possibles de la pensée schmittienne, mais ne faut-il pas préciser aussitôt que dans la Théorie du partisan, et plus clairement encore dans sa correspondance, Carl Schmitt s'exprime lui-même sur la lutte contre le terrorisme (ce qui est loin d'être le cas dans La dictature), et que c'est pour critiquer vertement les Conventions de Genève de 1949 pour leur «juridisme utopique» ?
2. Ces textes sont tous inédits en français hormis «Prendre/partager/paître» dont il existe une traduction de Théodore Paléologue parue dans Commentaire, n° 87, Plon, automne 1999. Les nombreux passages de «Changement de structure du droit international »repris dans Le nomos de la terre (Paris, PUF, 2001) ont d'autre part été traduits par Lilyane Deroche-Gurcel et révisés par Peter Haggenmacher. Deux textes essentiels de droit international attendent encore d'être traduits en français : Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff (1938) et Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mâchte (1941). Schmitt ne traite presque plus de questions de droit interne après 1945. Il estime qu'il ne peut plus intervenir directement sur certaines questions et se fait « représenter » par d'autres, notamment par Forsthoff. Sur le tribunal de Nuremberg, Wilhelm Grewe a écrit le livre qu'il aurait voulu écrire. Voir : Wilhelm Grewe, Nürnberg als Rechtsfrage, Stuttgart, Ernst Klett, 1947.
3. Carl Schmitt, Glossarium, annotation du 8 février 1950, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, p. 297.
4. Schmitt semble avoir été opportuniste et carriériste dès le début, ce qui aurait joué un rôle fondamental dans son engagement nazi.
5.Giorgio Agamben, État d'exception, Paris, Le Seuil, 2003, p. 12.
6. Ce texte a été prononcé par Schmitt à Madrid lors d'une conférence de juin 1943 (voir note 1 p. 168) ; il est pour une grande part repris dans «Die letzte globale Linie» («La dernière ligne globale», août 1943) où l'expression «guerre civile mondiale» apparaît à nouveau, Cf. Staat, Großraum, Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, édité par Günter Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, p. 441, et sous une forme incomplète et très remaniée dans Le nomos de la terre, Paris, PUF, 2001. L'expression apparaît sous une forme très proche dès 1938 dans Le passage au concept discriminatoire de guerre (Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, Duncker & Humblot, 1938, p. 48) où Schmitt parle de «guerre civile internationale». C'est la structure eschatologique de la guerre juste comme «toute dernière guerre de l'humanité», comme «guerre contre la guerre» qui est désignée pour la première fois comme «internationaler Bürgerkrieg». Ernst Jünger parle de Wetlbürgerkrieg dans La paix (publié en 1945, écrit en 1941), mais dans une optique claire : il souhaite, lui, l'avènement d'un État mondial. Voir : Ernst Jünger, Der Friede, in Sâmtliche Werke, Vol. 7, Stuttgart, Klett-Cotta, 1980, p. 198. Notons que l'expression « Weltrevolutionskrieg» («guerre révolutionnaire mondiale ») était, semble-t-il, assez courante dès 1918-1919 dans la littérature antibolchevique et anti-franc-maçonnerie. On la retrouve par exemple chez Eduard Stadtler (1886-1945), l'idéologue fasciste du «Casque d'acier ». Lénine avait parlé de «transformation de la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire» dès 1914. On trouve fréquemment les expressions «guerre civile» et «guerre révolutionnaire» dans les textes marxistes du XXe siècle et il semble que l'expression de «guerre civile mondiale» soit dans la littérature de droite une réaction aux expressions communistes, qui sert à biffer le prestige de la révolution et à dire : votre prétendue révolution ne donne lieu qu'à une interminable guerre civile.
7. Schmitt se réjouissait de la rumeur disant que Koselleck était « la Théologie politique Ill de Schmitt ».
8. Voir l'introduction de : Reinhart Koselleck, Le règne de la critique, Paris, Éd. de Minuit, 1979.
9. Ernst Nolte, La guerre civile européenne, 1917-1945 : national-socialisme et bolchevisme, Paris. Éd. des Syrtes, 2000.
-
Carl Schmitt : Changement de structure du droit international
Changement de structure du droit international (1943) (1/2)
La guerre mondiale actuelle prend des dimensions que n'ont connues aucun des conflits belliqueux antérieurs. On se bat aujourd'hui sur toute la terre pour l'ordre de la terre entière. L'affrontement actuel dépasse en effet en ampleur et en intensité toutes les limites dans lesquelles les guerres s'étaient tenues jusqu'alors. Même le conflit « mondial » de 1914-1918 n'a pas véritablement été une guerre mondiale en comparaison du combat qui se déroule actuellement entre nations et continents. La guerre est devenue planétaire : son sens et son but ne concernent rien de moins que le nomos de notre planète.
Par nomos, je n'entends pas ici une série de règles et d'accords internationaux, mais le principe fondamental de répartition de l'espace terrestre. La structure du droit international repose sur certaines notions et mesures spatiales relatives au sol et à la surface de la terre. Je vais tenter d'évoquer ce qu'ont été les grandes lignes qui ont constitué les principales partitions et divisions du sol de la terre. J'ai conscience de m'adresser aux membres d'une nation qui, depuis sept ans, depuis 1936, a pris position dans la grande lutte mondiale (1) et dont la grande histoire entretient un double rapport avec le thème de cette conférence : à travers l'exploit militaire, maritime, administratif et culturel de la découverte et de l'européanisation d'un Nouveau Monde, et à travers l'autre exploit de la même époque, sur le terrain scientifique et spirituel, qu'a été la création d'un nouveau droit des gens européen (2). Mon exposé ne pourra bien sûr pas atteindre à cette grandeur. Je vais cependant m'efforcer d'élargir suffisamment l'horizon de mes observations afin que mon champ de vision rende quelque peu honneur à la grandeur du thème.
À toute conception de la terre dans sa totalité correspond une image de la partition de la terre. Pendant des millénaires, l'humanité a eu une image mythique de la terre prise comme un tout et non une expérience scientifique. Mais à peine la représentation de la terre comme une sphère s'était-elle imposée dans la pratique grâce à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, que s'est posé le problème radicalement nouveau d'un ordre international à l'échelle du globe entier. Aussitôt s'est engagée la lutte pour le partage de la nouvelle terre et de la nouvelle mer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a tracé des lignes globales afin d'établir un ordre spatial de la terre. À mesure que les hommes ont pris connaissance de la géographie de la terre entière et l'ont cartographiée, la nécessité politique d'un partage raisonnable s'est fait jour. Arrêtons un instant notre regard sur ces lignes « globales ».
La première est la fameuse ligne tracée dans l'édit Inter caetera divinae du 4 mai 1494 par le pape Alexandre VI, quelques mois à peine après la découverte de l'Amérique. Elle court du pôle Nord au pôle Sud, 100 milles à l'ouest du méridien des Açores et du Cap-Vert. Elle est aussitôt suivie par la ligne déplacée un peu à l'ouest, à peu près au milieu de l'océan Atlantique, que trace le traité de répartition hispano-portugais de Tordesillas du 1er juin 1494 (370 milles à l'ouest du Cap-Vert). Par ce traité les deux puissances catholiques se sont mises d'accord sur le fait que tous les territoires découverts à l'ouest de cette ligne reviendraient à l'Espagne, et ceux à l'est de la ligne au Portugal. Cette partición del mar Océano a été confirmée en 1506 par le pape Jules II. Sur l'autre moitié du globe, c'est la ligne des Moluques qui s'est imposée comme frontière. Le traité de Saragosse a tracé une raya en 1529 à travers l'océan Pacifique, qui correspondait au 135e méridien actuel ; elle passait par la Sibérie orientale, le Japon et l'Australie. Dès 1508, le roi d'Espagne demandait à la Casa de la Contratación de Séville d'établir des cartes exactes. L'histoire de ces délimitations a fait l'objet d'une recherche précise, les sources en donnent une connaissance parfaite.
Avec le traité franco-espagnol de Cateau-Cambrésis du 3 avril 1559, un tout nouveau genre de lignes globales a fait son apparition. Une clause orale secrète de ce traité établissait que les lignes de paix et d'amitié n'entreraient en vigueur qu'en deçà d'une certaine limite géographique et qu'au-delà de cette limite régnerait une sorte d'état de nature et de droit du plus fort. Ce sont elles qu'on appelle les lignes d'amitié, les amity lines des XVIe et XVIIe siècles, elles étaient reconnues expressément ou tacitement, c'est à elles que se rapporte le fameux beyond the line des pirates anglais des XVIe et XVIIe siècles, des flibustiers et des boucaniers. Géographiquement, ces lignes coupaient au sud l'Équateur ou le tropique du Cancer, à l'ouest le degré de longitude des îles Canaries ou des Açores, dans l’océan Atlantique, ou bien elles parcouraient à la fois cette ligne du sud et celle de l'ouest. Le problème cartographique de la délimitation exacte de la ligne prenait une signification extraordinaire, surtout à l'ouest, et il donnait lieu à une multitude de réglementations officielles. L'Europe finissait à cette ligne, où commençait le Nouveau Monde. Le droit public européen cessait de valoir de l'autre côté de la ligne, où une zone « transatlantique » commençait, soumise au «droit du plus fort».
Le propre de la raya hispano-portugaise était que les princes des nations chrétiennes, dont le fondement commun était la foi chrétienne et qui honoraient le pape comme l'autorité suprême de l'Église, se reconnaissaient comme des égaux dans le traité de division et de répartition. Ce qu'on appelle les lignes d'amitié se rapportait aussi à l'occupation de la terre et de la mer du Nouveau Monde. Mais leurs présupposés sont assez différents de ceux de la raya. La ligne d'amitié délimite une zone de lutte à outrance entre les parties contractantes parce qu'elles n'ont aucune base commune et ne reconnaissent aucune autorité commune. La ligne laisse le champ libre au droit du plus fort, à l'occupant réel et durable, elle ouvre un domaine d'usage libre et sans entraves de la force. Elle présuppose certes comme une évidence que seuls les princes et les peuples chrétiens et européens peuvent contracter de tels traités. Mais ce principe de communauté n'impliquait ni une instance arbitrale commune assurant une légitimation concrète, ni aucun autre principe de répartition que le droit du plus fort et l'occupation effective. Il résultait de cette vision des choses que tout ce qui se passait « au-delà de la ligne » restait hors des critères juridiques, moraux et politiques reconnus en deçà de la ligne.
Les lignes d'amitié des XVIe et XVIIe siècles permettent de distinguer deux espaces « libres » où l'activité des peuples européens se déverse sans entrave : d'une part un espace non délimité de terre libre, le Nouveau Monde, l'Amérique, la terre de la liberté, c'est-à-dire le domaine où les Européens ont toute liberté de conquérir des terres et où le « vieux » droit perd sa force ; et d'autre part la mer libre, l'océan tout juste découvert que les Français, les Hollandais et les Anglais considèrent comme un domaine de liberté. Mais la liberté des mers fut tout de suite embrouillée par les juristes romanistes qui y mêlèrent des concepts de droit civil comme la res communis omnium et les « choses d’usage commun ». En réalité, ce n’était pas le droit romain qui faisait soudain irruption en plein XVIe siècle, mais la vieille idée primitive que le droit et la paix n'entrent en vigueur que sur terre. Et de façon analogue, sur la « nouvelle terre », le sol américain, aucun droit bien enraciné ne s'était encore implanté, on avait en fait de droit que ce que les conquérants européens en avaient apporté. C'est sur l'articulation de ces deux nouveaux espaces « libres », non compris dans l'ordre européen antérieur de la terre ferme, qu'est fondée la structure alors naissante du droit international européen.
On peut dire que grosso modo, du point de vue de l'histoire du droit, l'idée de délimiter un espace d'action non soumis au droit et une sphère extra-juridique d'usage de la violence correspond à un courant de pensée très ancien. Mais à partir du XVIe siècle, cette idée devient typiquement anglaise et étrangère au continent où la pensée est toujours restée centrée sur l'État. D'une façon apparemment analogue, la construction anglaise de l'état d'exception dans le droit politique interne, la Martial Law, présuppose la même idée d'un espace non soumis au droit. La Martial Law du droit constitutionnel anglais crée un domaine non juridique, limité dans le temps et dans l'espace, séparé dans le temps de l'ordre juridique normal par la proclamation de l'état de guerre au début et par une loi d'exonération à la fin, domaine dans lequel peut se produire tout ce que les circonstances exigent. En un sens distinct mais proche, les idées de mer libre, de libre commerce et de libre économie mondiale sont elles aussi liées à la délimitation d'un espace ouvert à la concurrence et à la libre exploitation par le plus fort.
Les deux lignes, la ligne de répartition hispano-portugaise et la ligne d'amitié anglaise correspondent à l'occupation européenne des terres et des mers du Nouveau Monde. Elles sont fondamentalement des pactes entre puissances occupantes. Mais la raya latine a une fonction distributive ; elle est dénommée linea de partición del mar dans le traité de Tordesillas de 1494. L'amity line anglaise a au contraire un caractère agonistique. La délimitation d'un domaine de lutte à outrance découle logiquement, comme nous l'avons dit, de l'absence d'un principe de répartition reconnu et d'une instance arbitrale commune réglant le partage et l'attribution entre les puissances occupantes. Le seul titre juridique reconnu est alors l'occupation effective. Cela n'exclut cependant pas qu'il faille au besoin mener une longue lutte avant que l’occupation soit reconnue comme effective, c’est-à-dire comme réelle et durable.
Le dernier exemple historique d'une application de ces principes de répartition européenne et de lignes d'amitié est la Conférence du Congo qui eut lieu à Berlin en 1884-85. Elle est en quelque sorte la dernière tentative faite par les puissances européennes, dans le dernier quart du XIXe siècle, de régler en commun l'occupation du sol africain. De la même façon, on essaya de neutraliser le bassin du Congo en créant une sorte de ligne d'amitié inversée selon laquelle les guerres entre puissances européennes ne devaient pas affecter le territoire du Congo ni partir de lui. À vrai dire, durant la grande guerre de 1914, ni les Anglais ni les Français ne respectèrent cette ligne d'amitié. La tentative de la Conférence du Congo offrit ainsi un symptôme évident de l'incapacité où se trouvait désormais l'ancienne communauté des peuples européens à occuper en commun un sol non-européen.
Le troisième exemple de ligne globale est bien sûr plus important encore, il s'agit de la ligne américaine de l'hémisphère occidental. Elle forme un type distinct de la raya hispano-portugaise et de l'amity line anglaise. Son développement et son destin sont d'une importance décisive pour la structure et les problèmes du droit international, ils méritent donc qu'on leur prête une attention particulière.
Dans le testament politique du président Washington, la célèbre lettre d'adieu de 1796, l'hémisphère occidental n'apparaît pas encore comme un concept géographique. Le message du président Monroe du 2 décembre 1823, document de base de ce qu'on appelle la doctrine Monroe, emploie en revanche consciemment le mot hémisphère et lui confère un accent spécifique. Il dénomme son espace propre tantôt l'Amérique, tantôt ce continent ou enfin cet hémisphère (this hemisphere). Intentionnellement ou non, l'expression hémisphère est mise en relation avec l'idée que le système politique de l'hémisphère occidental est un régime de liberté par rapport au système des monarchies absolues de l'Europe d'alors.
Depuis lors, la doctrine Monroe et l'hémisphère occidental sont des termes équivalents. Ils ouvrent la voie à la délimitation géographique d'une sphère de special interests des États-Unis allant bien au-delà de leur territoire propre et formant ce qu'on appellerait aujourd'hui dans le langage courant du droit international un « grand espace ».
À partir de 1939, l’expression hémisphère occidental se consolide. Le gouvernement des Etats-Unis employa le terme de nombreuses déclarations, et il sembla qu'au début du conflit mondial actuel celui-ci allait devenir un véritable slogan de la politique des États-Unis. C'est pourquoi il est frappant que d'autres déclarations n'émanant pas du gouvernement de Washington, en particulier les résolutions communes des ministres américains des Affaires étrangères de Panama (octobre 1939) et de Cuba (juin 1940) n'utilisent pas l'expression d'« hémisphère occidental », mais parlent seulement d'« Amérique », de « continent américain » ou de « régions appartenant géographiquement à l'Amérique ». Sous la différence des usages linguistiques se cachent des distinctions très profondes. Ici transparaît l'abus dont procède l'instrumentalisation du panaméricanisme par la politique des États-Unis. La remarque du président du Brésil, il y a quelques jours, dans sa déclaration du 4 mai 1943, selon laquelle l'île française de la Martinique appartiendrait à l'« hémisphère occidental » n'y change rien.
La Déclaration de Panama du 3 octobre 1939 revêt une importance particulière, que nous allons examiner brièvement, pour le problème spatial en droit des gens actuel. À l'intérieur des « zones de sécurité » établies par cette déclaration pour protéger la neutralité des États américains, les belligérants n'ont le droit d'accomplir aucun acte hostile. La ligne de la zone neutre de sécurité s'étend de part et d'autre des côtes américaines jusqu'à trois cents milles marins dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Au niveau de la côte brésilienne, elle atteint le 24e degré de longitude à l'ouest de Greenwich, et se rapproche donc du 20e degré qui est la ligne de séparation habituelle entre l'est et l'ouest dans la cartographie. Cette « zone de sécurité américaine » ainsi délimitée en octobre 1939 perdit toute valeur pratique quand disparut ce qui en était la condition : la neutralité des États américains. Elle reste malgré tout d'une importance extrême pour le problème spatial en droit international moderne. Pour le moment, le concept d'« Amérique » perdure grâce à elle, ainsi que la limitation qu'implique ce concept, en dépit du fait que la politique actuelle des États-Unis ne connaît plus ni limite ni frontière. Elle a d'ailleurs eu une répercussion considérable qu'on peut même qualifier de sensationnelle puisqu'elle a réduit magnifiquement et jusqu'à l'absurde les mesures et les critères servant jusque-là à définir la zone de la mer libre et la dimension traditionnelle des eaux territoriales. Elle a eu enfin pour effet de soumettre l'océan libre à l'idée de « grand espace », dans le même moment qu’elle introduisait un nouveau genre de délimitation spatiale à partir de la liberté des mers. Tout cela fut rapidement perçu et souligné par la science allemande du droit international. Mais les juristes américains objectèrent eux aussi sans tarder que la déclaration de Panama d'octobre 1939 faisait subir à l'un des aspects de la doctrine Monroe, the two spheres aspect, une modification importante. Auparavant, quand on parlait de la doctrine Monroe, on ne pensait en général qu'à la terre ferme de l'hémisphère occidental, tandis que pour l'océan on présupposait toujours la liberté des mers au sens du XIXe siècle. Dès lors, les frontières de l'Amérique s'étendirent jusque sur les mers (3).
Ce dernier point est d'une importance particulière. Le pas de la terre vers la mer a toujours eu des conséquences et des effets incalculables dans l'histoire universelle.
Tant que l'expression d'« hémisphère occidental » ne se référait qu'à l'espace continental, elle impliquait une démarcation mathématique et géographique et elle était par ailleurs une figure concrète sur le plan de la géographie physique et de l'histoire. Son élargissement et son déplacement vers la mer rendent la notion d'« hémisphère occidental » encore plus abstraite et lui donne grosso modo le sens d'une surface vide, définie en premier lieu en termes géographiques et mathématiques. La plane étendue de la mer fait apparaître l'espace « dans toute sa pureté », selon l'expression de Friedrich Ratzel. Et même dans les études militaires et stratégiques, on tombe parfois sur la formule un peu extrême d'un auteur français selon lequel la mer est une plaine lisse, sans obstacles, où la stratégie se dissout en géométrie.
Influencés par l'usage politique de l'expression, de nombreux géographes de métier se sont penchés ces dernières années sur le problème de l'« hémisphère occidental ». Particulièrement intéressante est la précision géographique donnée au vocable par le géographe du State Department des États-Unis, S. W. Boggs, quand il délimite l'hémisphère occidental par rapport au domaine défini par la doctrine Monroe. Dans ses analyses, il part du principe qu'on entend en général par hémisphère occidental le Nouveau Monde découvert par Christophe Colomb et que par ailleurs les notions géographiques et historiques d'Occident et d'Orient ne sont définies ni par la nature ni par des conventions humaines. Les cartographes ont pris l'habitude de tracer une ligne au milieu de l’Atlantique qui passe au 20e degré de longitude à l’ouest du méridien de Greenwich. De ce point de vue, les Açores et les îles du Cap-Vert font partie de l'hémisphère occidental, bien que cela contredise comme Boggs l'admet lui-même leur appartenance historique à l'Ancien Monde. Selon le géographe, le Groenland fait partie de l'hémisphère occidental bien qu'il n'ait pas été découvert par Christophe Colomb (4). Il ne dit rien des régions arctiques et antarctiques des Pôles. Sur le versant pacifique du globe, au lieu de faire passer la limite au 160e degré de longitude, aux antipodes du 20e degré, il la place sur la ligne internationale dite de changement de date, soit au 180e degré de longitude, ce qui ne va pas sans certains empiètements au nord et au sud. Il attribue les îles occidentales de l'Alaska ainsi que la Nouvelle-Zélande à l'Occident, alors qu'il classe l'Australie dans l'autre hémisphère. Et cela ne cause à ses yeux aucune difficulté pratique, excepté, au pire, l'indignation éventuelle des cartographes, que les immenses surfaces de l'océan Pacifique soient « provisoirement », comme il dit, attribuées à l'hémisphère occidental (tout cela avant que la guerre avec le Japon n'éclate) (5). L'internationaliste américain P. C. Jessup ajoute dans son compte-rendu du mémorandum de Boggs que « les dimensions changent vite de nos jours et que l'intérêt que nous avions pour Cuba en 1860 correspond à celui que nous avons aujourd'hui pour Hawaii ; l'argument de l'autodéfense conduira peut-être un jour les États-Unis à faire la guerre sur le Yang-Tsé, la Volga ou le Congo. »
La ligne américaine de l'hémisphère occidental n'est ni une raya ni une amity line. Toutes les lignes que nous avons évoquées concernent des occupations de terres, et de celles accomplies par les puissances européennes. La ligne américaine, quant à elle, est une réponse dès 1823 avec le message du président Monroe, aux prétentions des Européens à l'occupation de terres. Vue d'Amérique, elle a un caractère défensif et équivaut à une protestation adressée aux puissances de la vieille Europe contre toutes les occupations que l'Europe voudra entreprendre sur le sol américain. On voit sans peine qu'un espace libre est ainsi tracé pour l'occupation américaine du sol américain, espace aux dimensions gigantesques à l'époque. Mais n'oublions pas que l'attitude de l'Amérique à l'encontre de la vieille Europe monarchiste ne signifiait pas son renoncement à la civilisation européenne ni à son appartenance à la communauté internationale d’alors, essentiellement européenne. Ni le message d’adieu du président Washington de 1796 ni le message de Monroe de 1823 n’ont l’ambition de fonder un droit international extra-européen. Bien au contraire, les États-Unis se sont pris dès le départ pour les porteurs attitrés de la civilisation européenne et du droit international européen. Même les États naissants d'Amérique latine se considéraient tout naturellement comme des membres de la « famille des nations européennes» et de sa communauté internationale, si ce n'est en tant que nations chrétiennes, tout au moins en tant que nations « civilisées ». Tous les manuels de droit international américain du XIXe siècle partent de ce présupposé « évident » bien qu'ils distinguent un droit international américain à côté du droit international européen. La ligne globale que contient l'hémisphère occidental, même si elle exclut géographiquement l'Europe, n'est anti-européenne qu'en un certain sens ; en un autre sens, elle renferme au contraire l'aspiration morale et culturelle à être l'Europe authentique et véritable. Il ne fait pas de doute que c'est cette aspiration qui se cachait derrière l'apparence d'un isolement radical. La ligne de séparation de l'hémisphère occidental est à première vue spécifiquement une ligne d'isolement. Par rapport à la raya distributive et à l'amity line agonistique, elle se présente comme un troisième type de ligne, à savoir une ligne d'auto-isolement.
1410628596.jpgTenons-nous en aux formulations cohérentes auxquelles cette conception a donné lieu à propos de la ligne dite Jefferson. Il suffira pour cela de citer deux déclarations, l'une du 2 juin 1812 et l'autre du 4 août 1820. Elles méritent qu'on s'y attarde en raison du rapport qu'elles entretiennent avec le message de Monroe de 1823. Dans l'une comme dans l'autre, on détecte la haine de l'Angleterre et le mépris de la vieille Europe. « Le destin de l'Angleterre, dit Jefferson au début de l'année 1812, est presque chose faite, et la forme actuelle de son existence entre en déclin. Si notre force nous permet un jour d'édicter la loi dans notre hémisphère, cela veut dire que le méridien qui coupe l'Atlantique en deux constituera la ligne de démarcation entre la guerre et la paix, en deçà de laquelle aucune hostilité ne devra être commise et le lion et l'agneau auront à cohabiter en paix. » Quelque chose résonne là qui ressemble à une ligne d'amitié, à cette différence près que l'Amérique n'est plus comme aux XVIe et XVIIe siècles le théâtre de luttes à outrance mais au contraire un havre de paix, tandis que le reste du monde demeure un théâtre de guerres, mais ce sont les guerres des autres, l’Amérique n’y participe pas. Ce qui était typique des anciennes lignes d’amitié, à savoir leur sens et leur caractère agonistiques, fait défaut. Jefferson disait en 1820 : Le jour approche où nous exigerons formellement un méridien de partition de l'océan qui sépare les deux hémisphères, en deçà duquel aucun coup de feu européen ne pourra se faire entendre, ni aucun coup de feu américain au-delà. » Comme dans le message de Monroe, l'expression « hémisphère occidental » signifie ici que les États-Unis s'identifient à tout ce qui moralement, culturellement ou politiquement constitue la substance de cet hémisphère.
La racine spirituelle des déclarations de Jefferson et d'autres qui leur sont apparentées est le calvinisme extrême et le puritanisme, l'un et l'autre étrangers à l'Amérique non anglo-saxonne. Néanmoins cet esprit puritain dans sa forme sécularisée a été déterminant dans l'attitude du panaméricanisme international. L'isolement fondamental qui le caractérise tente de forger un nouvel ordre spatial de la terre au moyen de la démarcation entre un camp de la paix et de la liberté garantie et un camp du despotisme et de la corruption. Cette conception américaine de l'isolement a fait l'objet de nombreuses études. Elle nous intéresse ici uniquement à cause de ce qui la relie à l'ordre spatial de la terre et à la structure du droit international. Si l'« hémisphère occidental » est un Nouveau Monde non corrompu et non infecté par la dégénération de l'Ancien, alors il est clair que du point de vue du droit international, il appartient aussi à une autre région que ce monde corrompu, porteur il y a peu de temps encore et créateur du droit international chrétien et européen. Si l'Amérique est la terre du salut pour les élus, le fondement d'une existence nouvelle et plus pure dans des conditions vierges, alors toute ambition européenne relative à l'Amérique devient caduque. Le sol américain possède alors un statut entièrement nouveau du point de vue du droit international, qui diffère de tous les statuts de sol reconnus jusque-là. Jusqu'en 1823 il y eut divers types de sols reconnus par le droit international européen. Le sol américain ne relève d'aucun de ces types ; il n'est ni une terre sans maître, ni un sol librement occupable au sens traditionnel, ni non plus un sol européen du type des territoires étatiques d'Europe, ni une terre de luttes au sens des anciennes lignes d'amitié.
Quel est donc selon cette « ligne » le statut de droit international des deux continents américains ? Il s'agit de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'élu. Ce serait encore trop peu de dire que l'Amérique est l'asile de la justice et de la vertu. Le sens spécifique de cette ligne est bien plutôt que le sol américain est le seul à jouir d'une situation qui rend possible le droit et la paix, les conduites et les habits sensés. À croire ce que racontent encore parfois certains philosophes américains, la situation de la vieille Europe est si corrompue que tout homme au naturel et au caractère honnêtes ne peut que s'y transformer en criminel et en délinquant. En Amérique en revanche, la distinction entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, l'homme honnête et le criminel n'est pas brouillée par des situations fausses et des habits fallacieux. La ligne globale est donc comme une sorte de quarantaine, de cordon sanitaire qui protège contre la peste. Le message du président Monroe ne l'exprime pas aussi clairement que la déclaration de Jefferson. Mais qui a des yeux pour lire et des oreilles pour entendre décèlera sans peine dans ce message la condamnation morale portée contre le « système » politique des puissances européennes alliées qui confère à la ligne américaine de séparation et d'isolement son sens moral et politique.
Il est curieux que la formule de l'« hémisphère occidental » se réfère justement à l'Europe, au vieil Occident comme à un adversaire. Elle n'est pas dirigée à l'origine contre l'Asie et l'Afrique, mais contre le vieil Occident. Le nouvel Occident prétend être l'Occident véritable, la véritable Europe. Le nouvel Occident, l'Amérique, tente de déplacer l'ancien Occident, de lui prendre sa place d'axe de l'histoire mondiale et de centre du monde. Il ne prétend pas détruire, éliminer, ni même détrôner l'Occident, avec tout ce que le terme implique, il essaye seulement de le déplacer. Le droit international cesse d'avoir son centre de gravité dans la vieille Europe. Le centre s'est déplacé vers l'Ouest, vers l'Amérique. L'ancienne Europe, comme les vieux continents d'Asie et d'Afrique, est reléguée au passé. L'ancien et le nouveau, on ne saurait trop insister sur ce point, sont ici non seulement des critères de répartition, mais aussi de mise en accusation, d'où leur très grande valeur historique et politique. Ils ont transformé la structure du droit des gens européen traditionnel bien avant que, à partir de 1890, des États asiatiques, Japon en tête, en se joignant à la communauté du droit international européen, l'aient finalement transformée en un droit international universaliste sans attache spatiale.
Nous ne nous demanderons pas ici dans quelle mesure les ambitions de Jefferson et de Monroe et la croyance qu’ils avaient de représenter un Nouveau Monde moral et politique correspondaient à la réalité.
☞ Changement de structure du droit international (1943) (2/2)
On ne peut nier qu'un morceau de culture européenne ait été transplanté sur le sol américain. En tant qu'Européens de la vieille Europe, nous ne devons pas hésiter à reconnaître ouvertement - sans qu'il y ait là de concession à la fierté américaine - que des hommes comme George Washington et Simón Bolívar étaient indubitablement de grands Européens et qu'ils se sont probablement davantage rapprochés du sens idéal de ce mot que la plupart des hommes d'État anglais ou continentaux de cette époque. Face à la corruption parlementaire et à la dégénérescence absolutiste du XVIIIe siècle en France et en Angleterre, et plus encore face à l'étroitesse et à la servitude de la réaction et de la restauration postnapoléoniennes du XIXe siècle, l'Amérique avait de grandes chances de représenter l'Europe authentique et véritable. L'ambition qu'avait l'Amérique d'être la véritable Europe fut un facteur historique de très grande portée. Elle était une énergie politique réelle, ou comme on dit aujourd'hui dans la terminologie de l'actuel état de guerre totale, un potentiel guerrier de premier rang. Ce réservoir de force historique a continué à être alimenté au XIXe siècle, surtout par les révolutions européennes de 1848. Des milliers d'Européens déçus et désillusionnés, parmi lesquels de nombreux hommes d'envergure ainsi qu'un nombre non négligeable de jeunes paladins de la liberté ont quitté la vieille Europe réactionnaire au XIXe siècle pour émigrer en Amérique.
Mais dès la fin du siècle, autour de 1900, toutes ces grandes possibilités internes et externes paraissaient épuisées et caduques. L'invasion de Cuba fut le signal de politique étrangère qui annonça au monde le passage à l'impérialisme. Cet impérialisme ne s'en tenait plus aux vieilles conceptions continentales de l'hémisphère occidental, mais il s'avançait loin dans le Pacifique et en direction de l'ancien Orient. De vastes espaces furent alors soumis au principe de la « porte ouverte» qui remplaça la doctrine Monroe périmée (6). Géographiquement et à l'échelle du globe, c'était un pas de l'Orient vers l'Occident. Par rapport à l'espace oriental d'Asie qui réémerge aujourd'hui comme facteur de l'histoire universelle, le continent américain se trouvait alors dans la même situation que cent ans plus tôt la vieille Europe, lorsque l'irruption de l'Amérique dans l'histoire universelle l'avait déplacée dans l'hémisphère oriental. Un tel changement d'éclairage est un thème vraiment sensationnel pour une «géographie de l'esprit». C'est sous l'impression que laissait cette lumière nouvelle que l'on proclama en I930 l'avènement d'un Nouveau Monde qui devait unir l'Amérique avec la Chine (7).
Mais l'ancienne foi dans ce Nouveau Monde s'effritait désormais elle aussi de l'intérieur, avec la même force et la même ampleur qui avait caractérisé les déplacements politiques de l'Occident vers l'Orient. Avec l'émergence de l'impérialisme nord-américain en politique extérieure s'annonçait également la fin d'une époque des États-Unis du point de vue interne. Les fondements de tout ce qui avait fait la substance, et pas seulement l'idéologie, de ce qu'on appelait la « nouveauté » et la « liberté » de l'hémisphère occidental s'effondrèrent par la base. En I890, l'occupation intérieure de terres aux États-Unis cessait d'être libre. La colonisation des sols restés libres prit fin. Jusque-là les anciennes frontières des États-Unis séparant la terre colonisée des terres libres et ouvertes à l'occupation avaient toujours été en vigueur. Le frontier avait toujours existé, ce type de frontalier prêt à passer du sol peuplé au sol libre, propre à ces lignes limitrophes. Avec le sol libre disparut aussi l'ancienne liberté. Ainsi se transforma la loi fondamentale des États-Unis, même si la façade des normes constitutionnelles de 1787 fut maintenue. Tous les bons observateurs le remarquèrent et parmi ceux qui l'exprimèrent, John Dewey, le représentant typique du pragmatisme américain est peut-être celui qu'il faut mentionner en premier du fait qu'il a pris la disparition du frontier comme point de départ de ses analyses sur la réalité sociale concrète de l'Amérique.
Dès lors, le nomos de l'Amérique - entendu comme le fondement des rapports sociaux et juridiques- se transforma du tout au tout. Le monde jusque-là libre et neuf se mit à ressembler de plus en plus à l'ancien et cela à un rythme tel qu'en quelques années, l'ancien Monde fut rattrapé et dépassé par le nouveau. Les États-Unis se transformèrent en une image agrandie et grossière de la vieille Europe. La question sociale, démographique, raciale, les problèmes de chômage et de liberté politique se posèrent comme dans la vieille Europe mais de façon décuplée, comme après un accroissement et une intensification fantastiques. Dans le même temps s'épuisèrent toutes les énergies historiques qui avaient conféré à la ligne d'auto-isolement de Jefferson sa solidité intérieure.
Que des peuples et des empires s'isolent du reste du monde et cherchent à se protéger par une ligne défensive de toute contamination extérieure n'est pas un fait nouveau dans l'histoire universelle. Le limes est un phénomène originaire dans l'histoire ; la muraille de Chine est, semble-t-il, une construction typique, et les colonnes d'Hercule sont restées de tout temps l'image de la frontière mythique. La question cruciale est celle de l'attitude qu'engendrent cet isolement et ce retranchement par rapport au reste du monde. La prétention américaine d'être un Nouveau Monde non corrompu a été supportable pour le reste du monde tant qu'elle s'est combinée à un isolement conséquent. Une ligne globale partageant le monde en deux moitiés selon le bien et le mal est une ligne qui distribue les bons et les mauvais points dans l'ordre moral. Si elle ne s'en tient pas à une stricte position défensive et à l'auto-isolement, elle représente un défi politique permanent pour l'autre partie de la planète. Ni simple problème de cohérence logique, ni pure question d'opportunité pratique, ni thème pour conversations juridiques, se pose la question de savoir si la doctrine Monroe est un principe de droit (un legal principle) ou une maxime politique. C'est en réalité un dilemme politique auquel personne ne peut se soustraire, ni le fondateur de la ligne d'auto-isolement, ni le reste du monde. La ligne d'auto-isolement se renverse effectivement en son contraire quand elle se mue en ligne de disqualification et de discrimination du reste du monde. Il y a une raison à cela : la neutralité de droit international correspondant à cette ligne d'auto-isolement est, par ses conditions et ses fondements, un principe absolu, plus strict que la neutralité de l'ancien droit international européen qui était apparue à l'occasion des guerres interétatiques des XVIIIe et XIXe siècles. Quand la neutralité absolue propre à l'auto-isolement devient caduque, l'isolation se transforme en un principe d'intervention illimitée qui embrasse sans distinction toute la planète. Le gouvernement des États-Unis s'érige alors en juge de la terre entière et s'arroge le droit d'intervenir dans les affaires de tous les peuples et de tous les espaces. L'attitude défensive propre à l'auto-isolement révèle ses contradictions internes et se renverse en un pan-interventionnisme extrême, sans limites ni attaches spatiales.
Tout ce que le gouvernement des États-Unis a entrepris depuis quarante ans est marqué par ce dilemme aigu entre isolement et pan-interventionnisme. Il devient plus pressant et irrésistible à mesure qu'augmentent jusqu'à la démesure les dimensions spatiales et politiques qui sous-tendent une telle pensée par lignes globales.
L'hémisphère occidental est livré à ce dilemme considérable depuis le début de l'ère impérialiste, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Tout sociologue, tout historien et tout juriste ayant suivi l'évolution depuis 1890 des États-Unis et de l'hémisphère qu'ils dominent a nécessairement remarqué les contradictions immanentes à ce développement. La masse continentale immense oscille brusquement et sans transition d'un extrême à l'autre sous l'emprise de cet antagonisme vertigineux. Ce ne sont pas là seulement des tendances contraires, des contrastes et des tensions intérieures comme on en trouve dans toute vie intense et naturellement dans tout grand empire. Il s'agit plutôt d'un nœud de problèmes irrésolus qui contraint par malheur l'hémisphère occidental et le reste du monde à transformer la guerre interétatique du droit international européen en guerre mondiale. Quand l'auto-isolement face au reste du monde se renverse en discrimination du monde extérieur, la guerre devient une action punitive qui stigmatise en l'adversaire le criminel. Cette guerre n'est pas la guerre « juste » des théologiens du Moyen Âge dont parlait Vitoria, et sous son influence, Grotius et les internationalistes du XVIIe et du XVIIIe siècles. C'est un phénomène radicalement nouveau - parce qu'il est global et embrasse le monde entier - que cette prétention d'éliminer l'adversaire politique en le faisant passer pour un criminel qui menace le monde et pour l'ultime obstacle à la paix mondiale. J'ai appelé cette attitude Le passage au concept discriminatoire de guerre (8). En revendiquant le droit de se défendre contre un adversaire politique, mais aussi de le disqualifier et de le diffamer du point de vue du droit international, le gouvernement de Washington a l'intention de faire accéder l'humanité à un nouveau type de guerre en droit international. Pour la première fois dans l'histoire, la guerre est une guerre mondiale globale.
Lors de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, la politique du président W. Wilson vacillait déjà entre les extrêmes de l'auto-isolement et de l'intervention planétaire, jusqu'à ce qu'elle bascule violemment du côté de l'interventionnisme et d'une guerre qui entreprenait d'abaisser l'adversaire au niveau du criminel. Je ne citerai que deux déclarations de Wilson, à première vue contradictoires, la première, date de 1914, la seconde coïncide avec l'entrée en guerre de l'Amérique en 1917. Dans son discours du 9 août 1914, Wilson se ralliait solennellement à l'idéal d'une neutralité absolue, stricte, scrupuleuse, qui se gardait anxieusement de faire la moindre différence entre les belligérants et qui respectait avec une rigueur absolue l'isolement que s'impose à soi-même la neutralité. Le président somma alors ses compatriotes de s'abstenir de toute prise de parti, même dans leur conscience, car cette attitude n'aurait été neutre que de nom, tandis que leur âme aurait renoncé à la neutralité réelle : « Nous devons être impartiaux en pensée et en acte, tenir en bride nos sentiments, et éviter toute action qui pourrait être interprétée comme une préférence accordée à l'un des deux camps. » Dans sa déclaration du 2 avril 1917, il change radicalement de position et proclame ouvertement que non seulement le moment d'être neutre mais aussi l'ère de la neutralité sont révolus, et que la paix du monde et la liberté des peuples justifient la participation à une guerre européenne. Suite à l'intervention des États-Unis, celle-ci se transforma en guerre mondiale et de l'humanité entière.
L'histoire américaine des dernières décennies enseigne qu'il ne s'agit pas d'un changement d'opinion personnelle de Wilson ni d'excès relevant de la psychologie individuelle. À chaque moment décisif, la même problématique de l'isolement et de l'intervention planétaire resurgit. Du point de vue du droit international, la proscription de la guerre instituée par le Pacte Kellogg du 27 août 1928 revient pour les États-Unis à garder en mains la grande décision sur la guerre mondiale et sur l'aggressor, même par rapport à la SDN, et à bannir du droit international le concept traditionnel de neutralité auquel le pacte de Genève faisait encore une place. « Auparavant », écrit John B. Whitton, un internationaliste qui représente bien cette mentalité, « la neutralité était un symbole de paix, elle est maintenant, grâce au nouveau droit international issu du Pacte de la Société des Nations et du Pacte Kellogg, un symbole de guerre. »
Au cours de la guerre mondiale actuelle, l'oscillation extrême entre isolement neutre et pan-interventionnisme s'est retrouvée au mot près et suivant un parallélisme rigoureux dans de nombreuses déclarations du président Franklin D. Roosevelt. Si, pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918, ce dilemme s'est reflété dans les déclarations de Wilson, à partir de 1939, cette contradiction se répète de façon à tel point stéréotypée qu'on ne peut que supposer qu'elle surgit d'une identité profonde. La déclaration officielle de neutralité des États-Unis du 5 septembre 1939 se réclamait solennellement du vieux concept de neutralité défini par la plus stricte impartialité et le maintien d'une amitié égale avec toutes les parties belligérantes. On y trouve même l'expression on terms of friendship qui est la formule de la tradition européenne pour dire que la neutralité repose sur une amitié égale avec les deux parties en conflit. Inutile de décrire ici ce qu'il en fut réellement de cette impartialité et de cette amitié américaines entre septembre 1939 et l'ouverture des hostilités lors de l'entrée en guerre officielle de 1941. Après les nombreux discours du président Roosevelt, après l'ingérence dans les affaires intérieures européennes au détriment de l'Allemagne en France, en Finlande, dans les Balkans et presque partout dans le monde, après le traité signé avec l'Angleterre en octobre 1940 fournissant des bases militaires anglaises aux destroyers américains, rien ne sert de dépeindre en détail l'attitude partiale et non neutre des États-Unis. Ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est le problème de l'hémisphère occidental et l'immense contradiction sans cesse accrue depuis le début du siècle que recouvre ce concept. La stricte neutralité qu'impliquait l'auto-isolement a elle aussi été jetée par-dessus bord pendant la Deuxième Guerre mondiale après avoir été solennellement ratifiée au début de la guerre. Le mémoire qu'a rédigé le procureur général et ministre de la Justice Jackson à bord du yacht présidentiel Potomac, lu le 31 mars 1941 lors d'une conférence de presse de la Maison-Blanche, ne fait que tirer la conclusion ultime et dresser le bilan quand il annonce la mort de l'ancien principe de l'isolement et de la neutralité : « Je ne nie pas, a dit le porte-parole du gouvernement des États-Unis, qu'au XIXe siècle l'idée de neutralité ait été à la base de certaines règles spéciales, règles qui ont ensuite été complétées par les différentes Conventions de La Haye. Mais ces règles ont fait leur temps. Les évènements de l'actuelle guerre mondiale les ont réduites à néant et privé de toute validité. L'adoption par la Société des Nations du principe des sanctions contre l'agresseur, le Pacte Briand-Kellogg et le Pacte argentin de proscription de la guerre ont définitivement balayé ces principes du XIXe siècle selon lesquels tous les belligérants devaient être traités de façon égale. Nous sommes revenus à des conceptions plus anciennes et plus saines. »
Notre obstination à souligner la profonde contradiction interne entre isolement et intervention a pour seul but de mettre en lumière de façon simple et percutante la situation politique et juridique de l'hémisphère occidentale. Toutes les décisions et tous les évènements essentiels de l'actuel continent américain révèlent cette faille intérieure et il n'est pas de problème important, que ce soit le problème racial, le problème social ou celui de la planification économique, qui ne donne lieu à cette même oscillation entre les deux extrêmes. À cause de son importance en droit international, j'aimerais me tourner maintenant vers la question de la reconnaissance internationale. Elle livre une autre manifestation de cet antagonisme. La reconnaissance internationale est une institution du droit international européen qui tente de concilier l'intérêt qu'a l'État à reconnaître une partie contractante digne de confiance avec le principe de la non-intervention dans les problèmes constitutionnels internes de l'État reconnu. Ainsi, selon la conception courante, la reconnaissance internationale d'un État étranger et de son gouvernement n'est pas interprétée comme un acte constituant ni comme une formalité vide, mais plutôt comme un « certificat de confiance » dans les relations d'État à État, de gouvernement à gouvernement. La pratique européenne s'efforce ainsi difficilement de se frayer un chemin de traverse entre l'ingérence - inacceptable - et l'abstention complète de toute prise de position, impossible dans les faits. Mais sur le sol américain, l'antagonisme entre intervention et non-intervention s'est manifesté là encore de façon si brusque et si violente que l'Amérique est à nouveau apparue comme une image grossière et déformée de la problématique européenne du XIXe siècle. Il existe même une doctrine de la pratique américaine de la reconnaissance des autres États qui porte le nom de doctrine Wilson. D'après celle-ci, seul un gouvernement « légal », au sens qu'a le mot « légal » dans une constitution démocratique, peut être reconnu. Il va de soi que dans la pratique la signification des mots « démocratique » et « légal » est « déterminée, interprétée et sanctionnée » au cas par cas par le gouvernement des États-Unis. La doctrine et la pratique sont l'une comme l'autre extrêmement interventionnistes ; elles reviennent à ce que le gouvernement de Washington contrôle en fait tous les changements de régime et de constitution des autres États américains. En Amérique latine en revanche, on invoque l'indépendance et la souveraineté des États pour rejeter la reconnaissance internationale et la considérer comme un moyen d'intervention illicite en droit international. La conception mexicaine qui s'exprime dans la doctrine Estrada va même jusqu'à récuser toute reconnaissance en droit international, considérant qu'elle est un affront pour l'État ou le gouvernement à reconnaître (9). Par conséquent, toutes les relations juridiques entre États deviennent des relations isolées et purement factuelles, définies au cas par cas. On a là le pôle opposé au concept de reconnaissance des États-Unis. Les deux « doctrines » représentent des positions absolument contraires ; le parallélisme avec la contradiction interne entre isolement et discrimination interventionniste est nettement perceptible. Des contradictions insolubles surgissent sans cesse dans l'hémisphère occidental, elles prennent naissance dans la structure interne d'un continent déchiré et soumis à l'hégémonie des États-Unis et qui ne dispose pas d'un principe propre qui lui permettrait de décider entre isolement et intervention.
Ainsi le mythe de l'hémisphère occidental aboutit intérieurement comme extérieurement à un interventionnisme illimité. Son instrument spécifique est la « reconnaissance » du droit international, non seulement au sens de la reconnaissance traditionnelle d'États et de régimes nouveaux mais aussi comme prise de position sur tous les changements importants, notamment les changements territoriaux. Dans la doctrine Stimson du 7 janvier 1932, les États-Unis se réservent le droit partout sur la planète de refuser leur reconnaissance à tous les changements de possession accomplis par la violence. Ce qui signifie que les États-Unis, sans se préoccuper de la distinction entre hémisphères occidental et oriental, s'arrogent le droit de décider sur la terre entière de l'aspect juste ou injuste de toute modification territoriale. Il y a peu de temps encore, tout tournait autour de la délimitation géographique de la doctrine Monroe et de l'hémisphère occidental. On avait besoin d'une frontière parce que ce qui justifiait politiquement, juridiquement et moralement la doctrine Monroe, c'était la formation d'un domaine d'autodéfense qui soit légal. C'est pourquoi il peut être utile de rappeler face à l'interventionnisme illimité, global et universel d'aujourd'hui que tous ces efforts pour délimiter le domaine géographique de la doctrine Monroe et de l'hémisphère occidental n'avaient pas d'autre justification juridique que la nécessité de délimiter un domaine américain d'autodéfense. Quand on proclame le droit à l'autodéfense, fût-ce à l'intérieur de frontières tracées généreusement, on reconnaît implicitement le droit à l'autodéfense au-delà de ces mêmes frontières. Fondement et frontière - comme toujours en droit et surtout en droit international - sont ici des termes équivalents. Avec la disparition actuelle de toutes les frontières, l'aspiration des États-Unis à étendre leurs interventions et leur reconnaissance à tous les espaces de la terre équivaut à nier le droit à l'autodéfense de tous les autres gouvernements. Voilà la signification véritable, du point de vue du droit international, du pan-interventionnisme global auquel aboutit finalement le principe de l'hémisphère occidental. Parce que cet interventionnisme a perdu tout sens de la mesure et des limites, les fondements de l'ancienne doctrine Monroe ont été détruits, ainsi que le panaméricanisme qui lui était propre.
Mais la suppression de toute mesure et de toute limite qui caractérise l'interventionnisme américain a un sens non seulement global mais aussi total. Elle agit aussi bien sur les affaires intérieures que sur les rapports sociaux, économiques et culturels et traverse en leur cœur les peuples et les États. Puisque le gouvernement des États-Unis a le pouvoir de discriminer les autres gouvernements, il a bien sûr aussi le droit de dresser les peuples contre leurs propres gouvernements et de transformer la guerre entre États en guerre civile. La guerre mondiale discriminatoire de style américain se transforme ainsi en guerre civile mondiale de caractère total et global. C'est la clé de cette union à première vue invraisemblable entre le capitalisme occidental et le bolchevisme oriental. L'un comme l'autre font de la guerre un phénomène global et total et transforment la guerre interétatique du droit international européen en guerre civile mondiale. On comprend mieux le sens profond de ce que Lénine qualifiait de problème de la guerre totale quand il soulignait que dans la situation actuelle de la terre, il n'y avait plus qu'un seul type de guerre juste : la guerre civile. C'est seulement en adoptant ce point de vue global que l'on commence à comprendre quelle portée a pour le reste du monde le vacillement incessant de l'hémisphère occidental. La tendance à l'isolement faisait partie du patrimoine traditionnel et conservateur des États-Unis. Elle disparaît et l'aspiration à l'hégémonie mondiale contenue en germe dans la guerre mondiale discriminatoire pousse les États-Unis à intervenir militairement non seulement dans tous les espaces politiques, mais aussi dans tous les rapports sociaux de la terre. L'histoire contradictoire et en apparence énigmatique de la neutralité américaine entre 1914 et 1941 n'est rien d'autre que l'histoire de cette contradiction interne entre auto-isolement et discrimination du monde.
Aujourd'hui, en 1943, les États-Unis tentent de se faire une place en Afrique et au Proche-Orient. De l'autre côté du globe, ils étendent une main vers la Chine et l'Asie centrale. Ils recouvrent la terre d'un système de bases militaires et de voies aériennes et proclament le «siècle américain » de notre planète. On ne peut plus parler de frontières, aussi généreusement tracées soient-elles. Ainsi se termine le mythe politique de l'hémisphère occidental. Mais sa fin est aussi la fin de toute une époque et d'un stade déterminé de l'évolution du droit international. C'est la fin de l'époque qui pensait par lignes globales et la fin de la structure du droit international qui correspondait à cette pensée. Dans les différents types de lignes globales - la raya hispano-portugaise, l'amity line anglaise, et la ligne d'auto-isolement de l'hémisphère occidental - on décelait une aspiration à modeler un ordre spatial de la terre entière, un nomos planétaire. Aujourd'hui tous ces efforts sont historiquement dépassés. Dès lors que la dernière de ces lignes globales, celle de l'hémisphère occidental, a basculé dans l'interventionnisme illimité et global, nous avons affaire à une situation radicalement nouvelle. Un autre nomos de la terre tente de contrecarrer la tendance au contrôle universel de la planète et à l'hégémonie mondiale. Son idée centrale consiste à partager la terre en plusieurs grands espaces distincts définis par leur substance historique, économique et culturelle.
Les lignes globales caractérisaient le premier stade d'une lutte dont c'était l'enjeu de déterminer le nomos de la terre et la structure du droit international. Mais leurs divisions de la terre étaient abstraites et superficielles au sens plein du terme. En elles, tous les problèmes se résolvaient en géométrie. Abstrait et superficiel, l'impérialisme global et délocalisé de l'Occident capitaliste et de l'Est bolchevique l'est aussi. Entre les deux, l'Europe tente aujourd'hui de défendre sa substance qui risque elle aussi d'être traitée comme simple superficie. Face à l'unité globale de l'impérialisme planétaire - capitaliste ou bolchevique - se dresse une multiplicité de grands espaces denses et concrets. C'est la structure du futur droit international qui est l'enjeu de la lutte, les combats doivent trancher entre la coexistence future d'une multitude d'entités autonomes ou de simples filiales décentralisées, régionales ou locales, appartenant à un seul « maître du monde ». Les idylles locales ou régionales ne sont plus capables de résister à l’impérialisme global. Seuls les véritables grands espaces sont en mesure de l'affronter. Un grand espace digne de ce nom contient la mesure et le nomos de la terre à venir. C'est là son sens dans l'histoire universelle et en droit international.
Le secrétaire d'État Henry L. Stimson qui a donné son nom à la fameuse et interventionniste « doctrine Stimson » a précisé le sens de cette conception globale dans une conférence du 9 juin 1941 devant les cadets de West Point. Il y affirme que la terre n'est pas plus grande aujourd'hui que ne l'étaient les États-Unis d'Amérique en 1861, alors déjà trop petits pour contenir l'opposition entre les États du Nord et ceux du Sud. « La terre, déclara Stimson, est aujourd'hui trop petite pour deux systèmes opposés. » Mais nous lui répondons que la terre sera toujours plus grande que les États-Unis d'Amérique et que jusqu'à ce jour, elle est suffisamment grande pour abriter plusieurs grands espaces au sein desquels les hommes épris de liberté peuvent défendre leur substance propre et leur spécificité historique, économique, et spirituelle.
Carl Schmitt, In La guerre civile mondiale http://www.theatrum-belli.com
Notes
1. Le philosophe italien Giorgio Agamben s'appuie sur le livre de Schmitt sur la dictature pour critiquer Guantanamo. C'est un des usages possibles de la pensée schmittienne, mais ne faut-il pas préciser aussitôt que dans la Théorie du partisan, et plus clairement encore dans sa correspondance, Carl Schmitt s'exprime lui-même sur la lutte contre le terrorisme (ce qui est loin d'être le cas dans La dictature), et que c'est pour critiquer vertement les Conventions de Genève de 1949 pour leur «juridisme utopique» ?
2. Ces textes sont tous inédits en français hormis «Prendre/partager/paître» dont il existe une traduction de Théodore Paléologue parue dans Commentaire, n° 87, Plon, automne 1999. Les nombreux passages de «Changement de structure du droit international »repris dans Le nomos de la terre (Paris, PUF, 2001) ont d'autre part été traduits par Lilyane Deroche-Gurcel et révisés par Peter Haggenmacher. Deux textes essentiels de droit international attendent encore d'être traduits en français : Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff (1938) et Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mâchte (1941). Schmitt ne traite presque plus de questions de droit interne après 1945. Il estime qu'il ne peut plus intervenir directement sur certaines questions et se fait « représenter » par d'autres, notamment par Forsthoff. Sur le tribunal de Nuremberg, Wilhelm Grewe a écrit le livre qu'il aurait voulu écrire. Voir : Wilhelm Grewe, Nürnberg als Rechtsfrage, Stuttgart, Ernst Klett, 1947.
3. Carl Schmitt, Glossarium, annotation du 8 février 1950, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, p. 297.
4. Schmitt semble avoir été opportuniste et carriériste dès le début, ce qui aurait joué un rôle fondamental dans son engagement nazi.
5.Giorgio Agamben, État d'exception, Paris, Le Seuil, 2003, p. 12.
6. Ce texte a été prononcé par Schmitt à Madrid lors d'une conférence de juin 1943 (voir note 1 p. 168) ; il est pour une grande part repris dans «Die letzte globale Linie» («La dernière ligne globale», août 1943) où l'expression «guerre civile mondiale» apparaît à nouveau, Cf. Staat, Großraum, Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, édité par Günter Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, p. 441, et sous une forme incomplète et très remaniée dans Le nomos de la terre, Paris, PUF, 2001. L'expression apparaît sous une forme très proche dès 1938 dans Le passage au concept discriminatoire de guerre (Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, Duncker & Humblot, 1938, p. 48) où Schmitt parle de «guerre civile internationale». C'est la structure eschatologique de la guerre juste comme «toute dernière guerre de l'humanité», comme «guerre contre la guerre» qui est désignée pour la première fois comme «internationaler Bürgerkrieg». Ernst Jünger parle de Wetlbürgerkrieg dans La paix (publié en 1945, écrit en 1941), mais dans une optique claire : il souhaite, lui, l'avènement d'un État mondial. Voir : Ernst Jünger, Der Friede, in Sâmtliche Werke, Vol. 7, Stuttgart, Klett-Cotta, 1980, p. 198. Notons que l'expression « Weltrevolutionskrieg» («guerre révolutionnaire mondiale ») était, semble-t-il, assez courante dès 1918-1919 dans la littérature antibolchevique et anti-franc-maçonnerie. On la retrouve par exemple chez Eduard Stadtler (1886-1945), l'idéologue fasciste du «Casque d'acier ». Lénine avait parlé de «transformation de la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire» dès 1914. On trouve fréquemment les expressions «guerre civile» et «guerre révolutionnaire» dans les textes marxistes du XXe siècle et il semble que l'expression de «guerre civile mondiale» soit dans la littérature de droite une réaction aux expressions communistes, qui sert à biffer le prestige de la révolution et à dire : votre prétendue révolution ne donne lieu qu'à une interminable guerre civile.
7. Schmitt se réjouissait de la rumeur disant que Koselleck était « la Théologie politique Ill de Schmitt ».
8. Voir l'introduction de : Reinhart Koselleck, Le règne de la critique, Paris, Éd. de Minuit, 1979.
9. Ernst Nolte, La guerre civile européenne, 1917-1945 : national-socialisme et bolchevisme, Paris. Éd. des Syrtes, 2000. -
Julien Freund et l’essence du politique par Georges FELTIN-TRACOL
Il est des livres qui traversent les années sans bénéficier de la moindre publicité et qui acquiert pourtant une notoriété certaine. L’essence du politique est l’un d’eux. Depuis sa parution en 1965 aux Éditions Sirey dans la collection « Philosophie politique » dirigée par Raymond Polin, l’ouvrage de Julien Freund n’a pas cessé d’être consulté par des générations d’étudiants dans les bibliothèques universitaires ou publiques. Saluons les Éditions Dalloz d’avoir enfin décidé de sa réimpression.
Julien Freund a l’ambition de démontrer le plus clairement possible ce que le politique a d’essentiel. « L’essence, écrit-il, a un caractère ontologique. Elle définit alors une des orientations et activités vitales ou catégoriques de l’existence humaine, sans lesquelles l’être humain ne serait plus lui-même; par exemple il y a une politique parce que l’homme est immédiatement un être social, vit dans une collectivité qui constitue pour une grande part la raison de son destin. La société est donc la donnée du politique, comme le besoin est la donnée de l’économique ou la connaissance celle de la science. » Il en ressort que le conflit, loin d’être un fait exceptionnel ou une anomalie, appartient pleinement à la vie. Penser le politique signifie donc considérer l’affrontement en tant que part intégrante et fondamentale de l’humanité, et c’est la raison pour laquelle J. Freund attache une si grande importance à la paix, car « objet et théâtre de la lutte politique, la paix est un produit de l’art politique ».
Sa démarche s’inscrit dans une perspective pragmatique qui n’accorde pas au politique une exclusivité absolue. Julien Freund est le premier à reconnaître l’existence d’autres essences (l’économique, le religieux, le scientifique, l’artistique et, plus tard, la technique remplaçant la morale). Il avait même l’intention de les étudier une à une. Malheureusement, hormis L’essence du politique, il n’a laissé que L’essence de l’économique qui parut en 1992 peu de temps après sa disparition.
Dès les premières pages, à l’opposé du raisonnement dogmatique, il avertit que « la société […] est une condition existentielle qui impose à l’homme, comme tout milieu, une limitation et une finitude. Vivre en société signifie donc du point de vue politique qu’il incombe à l’homme de l’organiser et de la réorganiser sans cesse en fonction de l’évolution de l’humanité, déterminée par le développement discordant des diverses activités humaines ». Ce réalisme de bon aloi, affirmé et assumé, à une époque où l’Université française suivait aveuglément divers mirages idéologiques a fait de Julien Freund un penseur à part, non-conformiste, vite rejeté par ses pairs moutonniers dans les limbes de l’institution.
Le politique repose sur trois présupposés que J. Freund agence en couples : le commandement et l’obéissance, le privé et le public, l’ami et l’ennemi. Cet ordonnancement lui facilite l’examen par étapes successives de concepts philosophiques, politologiques et juridiques variées telles que, par exemple, la souveraineté, la puissance, la révolte, la communauté, la liberté, l’amitié, la violence… Il détermine par ailleurs pour chaque couple de présupposés une dialectique. Ainsi, l’ordre est la dialectique du commandement et de l’obéissance; l’opinion celle du privé et du public, la lutte celle de l’ami et de l’ennemi. À de nombreuses reprises, il n’hésite pas à citer Carl Schmitt – le grief majeur que lui reprochent amèrement ses détracteurs – d’autant qu’il lui exprime publiquement sa dette en écrivant : « Toute ma reconnaissance va également à M. Carl Schmitt pour les belles journées passées en sa compagnie dans la retraite de Plettenberg – qui est devenu son San Casciano – et au cours desquelles nous avons longuement débattu du politique. » Il conclut : « J’ai deux grands maîtres », Raymond Aron et Carl Schmitt.
Cette reconnaissance affichée à l’auteur allemand a trop longtemps pesé sur Julien Freund considéré de la sorte comme son disciple français ou l’importateur en France de théories fallacieuses, si ce n’est factieuses. Il serait trop simple de faire de L’essence du politique, à l’origine thèse de philosophie soutenue sous la direction de Raymond Aron, une adaptation française des options schmittiennes. C’est en outre méconnaître fortement le tempérament de J. Freund. Quand il entreprend ce travail considérable, il possède une solide expérience d’adulte. Faire croire qu’il aurait été un jeune étudiant à peine sorti de l’adolescence, tombant sous le charme « venimeux » du juriste allemand est à la fois ridicule et stupide. J. Freund a simplement eu l’intelligence de comprendre, parmi les premiers, la formidable perspicacité des considérations de C. Schmitt.
L’attrait pour une pensée déjà incorrecte à l’époque, agrémenté de vigoureuses remarques, n’a fait qu’accentuer la méfiance des belles âmes et des bien-pensants. Ainsi, J. Freund note que « la politique provoque la discrimination et la division, car elle en vit. Tout homme appartient donc à une communauté déterminée et il ne peut la quitter que pour une autre. Il en résulte que la société politique est toujours société close. […] Elle a des frontières, c’est-à-dire elle exerce une juridiction exclusive sur un territoire délimité. Qu’importe l’étendue d’un pays ! […] Elle est l’âme des particularismes. En effet, toute société politique perdurable constitue une patrie et comporte un patrimoine. […] Le particularisme est une condition vitale de toute société politique ». Il est dès lors évident que « le concept d’un État mondial est […] politiquement une absurdité, car il ne serait ni un État, ni une république, ni une monarchie, ni une démocratie, mais tout au plus la cœxistence d’individus et de groupes comme les abonnés au gaz ou les occupants d’un immeuble ». Ces propos prennent une singulière résonance en ces temps de promotion de la lutte contre les discriminations et d’apologie sentencieuse en faveur d’un monde sans frontières… Parions que L’essence du politique ne sera pas le livre de chevet des animateurs de certaines associations revendicatives !
Si l’intelligentsia a ignoré J. Freund, c’est parce qu’il décortique les mécanismes de l’idéologie qui « est une véritable machine intellectuelle distributrice de conscience : elle donne bonne conscience à ses partisans en leur fournissant les justifications, les disculpations, les prétextes et les excuses capables d’apaiser leurs éventuels remords ou scrupules, mais accable de mauvaise conscience les adversaires qu’elle dégrade en êtres collectivement coupables. Il n’y a plus de faute ni de responsabilité, mais des actes ou entièrement innocents ou entièrement inexcusables, suivant que l’on appartient à tel ou tel groupe, race ou classe. L’appartenance sociale peut ainsi devenir une espèce de péché originel. Aussi, chaque fois qu’une situation politique devient idéologique, l’éthique se trouve monopolisée, et c’est parce que de nos jours les problèmes politiques s’expriment à la fois en terme de puissance et d’idéologie que la culpabilité et surtout la culpabilité collective sont devenues des instruments politiques. La morale devient ainsi un stratagème, un pur moyen de justification et d’accusation, c’est-à-dire de dissimulation. Il ne faut pas mésestimer les capacités de séduction de cette éthique dégradée ni son efficacité politique. Elle est une véritable arme. » N’est-ce pas une appréciation visionnaire ?
Julien Freund se défie en outre de la constitution d’une justice internationale. Avec une belle lucidité, il explique par anticipation ce qui se réalisera à la fin de la décennie 1990 dans les Balkans. « L’appel à la conscience appartient davantage au domaine de la ruse politique qu’à celui de la morale proprement dite. Avec le développement et la prospérité des polémiques idéologiques cette méthode s’est encore renforcée. En effet, le mot d’ordre n’est plus seulement d’instaurer la paix, mais encore la justice internationale. Ce qui fait que certains groupes de nations ont tendance à s’ériger en juges des autres, à trouver des coupables dans chaque conflit plutôt que d’essayer de le régler, car là où il y a des juges il faut aussi des coupables. […] Encore faut-il que cette méthode des condamnations actuellement en honneur dans les relations internationales ne tourne pas à une parodie de justice. Il est en effet bien rare que les nations, quelles qu’elles soient, qui distribuent à discrétion la culpabilité, ne tombent pas elles-mêmes sous les mêmes chefs d’accusation dont elles accablent les autres, non seulement au regard de leur histoire passée, mais aussi présente. On peut même se demander si les nations n’ont pas besoin de vilipender les autres pour dissimuler leurs propres tares. Les crimes nazis sont inqualifiables et il faut avoir soi-même l’âme criminelle pour leur trouver un soupçon d’excuse. Mais que dire des États-Juges du procès de Nuremberg qui ont à leur actif le massacre de Katyn et celui de populations entières du Caucase ou la bombe d’Hiroshima ? »
On l’aura compris : L’essence du politique recèle bien d’autres réflexions pertinentes, plus que jamais contemporaines. Ce traité rétablit enfin quelques vérités. La fin des idéologies modernes n’implique pas l’effacement du politique. Intimement et intrinsèquement attaché à l’homme, le politique ne peut pas disparaître. Il peut en revanche se métamorphoser, prendre de nouvelles formes, investir de nouveaux champs. Sa présence n’en est pas moins permanente. L’essence du politique est une magnifique réhabilitation de la dimension politique. Raison supplémentaire pour le (re)découvrir sans tarder.
Georges Feltin-Tracol http://www.europemaxima.com
• Julien Freund, L’essence du politique, Éditions Dalloz, 2004, 867 p., postface de Pierre-André Taguieff, 45 €.
• Paru dans Relève politique, n° 5, hiver 2005.
-
La monnaie : Du pouvoir d’achat au pouvoir d’être
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, économie et finance, lobby 0 commentaire