Né en 1841, mort en 1931, le docteur Gustave Le Bon est resté célèbre dans l'histoire des idées contemporaines pour son ouvrage historique, La psychologie des foules, paru en 1895. Pourtant, en dépit de plusieurs décennies de gloire, que Catherine Rouvier situe entre 1910 (date de la plus grande diffusion de son ouvrage) et 1931, année de sa mort, il erre depuis maintenant 50 ans dans un pénible purgatoire. Cette éclipse apparaît, au regard de la notoriété de Le Bon, comme un sujet d'étonnement. L’influence de Le Bon ne fut pas seulement nationale et française. Son livre fut lu, loué et utilisé dans de nombreux pays étrangers. Aux États-Unis, par ex., où le Président Théodore Roosevelt déclarait que l’ouvrage majeur de Gustave Le Bon était un de ses livres de chevet. Dans d'autres pays, le succès fut également assuré : en Russie, où la traduction fut assurée par le Grand-Duc Constantin, directeur des écoles militaires ; au Japon et en Égypte aussi, des intellectuels et des militaires s'y intéressent avec assiduité. Cette présence significative de Gustave Le Bon dans le monde entier ne lui évita pourtant pas la fermeture des portes des principales institutions académiques françaises, notamment celles du monde universitaire, de l'Institut et du Collège de France.
Un ostracisme injustifié
Le mystère de cet ostracisme, exercé à l'encontre de ce grand sociologue aussi célèbre qu'universel est l'un des thèmes du livre de Catherine Rouvier. La curiosité de l’auteur avait été éveillée par une étude sur le phénomène, très répandu, de la "personnalisation du pouvoir". Autrement dit, pourquoi les régimes modernes, parlementaires et constitutionnalistes, génèrent-ils aussi une "humanisation" de leurs dirigeants ? Ce phénomène apparaît d'ailleurs concomitant avec un phénomène qui lui est, historiquement parlant, consubstantiel : l'union des parlementaires contre ce que le professeur Malibeau nommait une "constante sociologique". De Léon Gambetta à Charles de Gaulle, l’histoire récente de France démontre à l'envi cette permanence. D'ailleurs les régimes démocratiques, à l'époque de Le Bon, n'étaient évidemment pas seuls à sécréter cette tendance. Les régimes totalitaires étaient eux-mêmes enclins à amplifier cette constante (Hitler en Allemagne, Staline en Russie). Après maintes recherches dans les textes devenus traditionnels (Burdeau, René Capitant) Catherine Rouvier découvrit l'œuvre maîtresse de Le Bon. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans sa recherche laborieuse d'ouvrages traitant des grandes lignes de la réflexion de Le Bon, c'est finalement dans un article paru en novembre 1981 dans le journal Le Monde, double compte-rendu de 2 ouvrages traitant du concept central de Le Bon, la foule, que l'auteur trouva les 1ers indices de sa longue quête. En effet les 2 ouvrages soulignaient l’extrême modernité de la réflexion de Le Bon. Pour Serge Moscovici, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences sociales, et auteur de L'Âge des foules (Paris, Fayard, 1981), Le Bon apporte une pensée aussi nouvelle que celle d'un Sigmund Freud à la réflexion capitale sur le rôle des masses dans l'histoire. Il dénonce dans la même foulée l'ostracisme dont est encore frappé cet auteur dans les milieux académiques français.
Pour Moscovici, les raisons sont doubles : d'une part, "la qualité médiocre de ses livres", et d'autre part, le quasi-monopole exercé depuis des années par les émules de Durkheim dans l'université française. Et, plus largement, l'orientation à gauche de ces milieux enseignants [mode du freudo-marxisme]. Contrairement au courant dominant, celui que Durkheim croyait être source de vérité, Le Bon professait un scepticisme général à l'égard de toutes les notions communes aux idéologies du progrès. Les notions majeures comme celles de Révolution, de socialisme, de promesse de paradis sur terre, etc. étaient fermement rejetées par Le Bon. On l'accusa même d'avoir indirectement inspiré la doctrine de Hitler. Sur quoi Catherine Rouvier répond : pourquoi ne pas citer alors Staline et Mao qui ont, eux aussi, largement utilisé les techniques de propagande pour convaincre les foules ?
Une dernière raison de cet ostracisme fut le caractère dérangeant de la pensée de Le Bon. Son approche froidement "objective" du comportement collectif, le regard chirurgical et détaché qu'il porte sur ses manifestations historiques, tout cela allait bien à l'encontre d'un certain "moralisme politique". En associant psychologie et politique, Le Bon commettait un péché contre l'esprit dominant.
De la médecine à la sociologie en passant par l'exploration du monde...
Avant de revenir sur les idées politiques de G. Le Bon, rappelons quelques éléments biographiques du personnage. Fils aîné de Charles Le Bon, Gustave Le Bon est né le 7 mai 1841 dans une famille bourguignonne. Après des études secondaires au lycée de Tours, G. Le Bon poursuit des études de médecine. Docteur en médecine à 25 ans, il montre déjà les traits de caractère qui marqueront son œuvre future : une volonté de demeurer dans l'actualité, une propension à la recherche scientifique, un intérêt avoué pour l'évolution des idées politiques. En 1870, il participe à la guerre, d’où il retire une décoration (il est nommé chevalier de la légion d'honneur en décembre 1871). Paradoxalement, cet intérêt pour des sujets d'actualité n'interdit pas chez cet esprit curieux et travailleur de poursuivre des recherches de longue haleine. Ainsi en physiologie, où il nous lègue une analyse précise de la psychologie de la mort. Gustave Le Bon est aussi un grand voyageur. Il effectue de nombreux déplacements en Europe et, en 1886, il entame un périple en Inde et au Népal mandaté par le Ministère de l'Instruction publique. Il est d'ailleurs lui-même membre de la Société de Géographie. Et c'est entre 1888 et 1890 que ses préoccupations vont évoluer de la médecine vers les sciences sociales. Le passage du médical au "sociologique" passera vraisemblablement par le chemin des études d'une science nouvelle au XIXe siècle : l'anthropologie. Il rejoindra d'ailleurs en 1881 le domaine de l'anthropologie biologique par l'étude de l'œuvre d'AIbert Retzius sur la phrénologie (étude des crânes).
De cet intérêt est né la "profession de foi" anthropologique de Le Bon, consignée dans L'homme et les sociétés. La thèse principale de ce pavé est que les découvertes scientifiques, en modifiant le milieu naturel de l'homme, ont ouvert à la recherche une lecture nouvelle de l'histoire humaine. Le Bon utilise d'ailleurs l'analogie organique pour traiter de l'évolution sociale. Avant Durkheim, il pose les bases de la sociologie moderne axée sur les statistiques. Il propose aussi une approche pluridisciplinaire de l'histoire des sociétés. Mais, en fait, c'est l'étude de la psychologie qui va fonder la théorie politique de Le Bon.
Naissance de la "psychologie sociale"
En observateur minutieux du réel, le mélange des sciences et des acquis de ses lointains voyages va conduire Le Bon à la création d'un outil nouveau : la "psychologie sociale". La notion de civilisation est au centre de ses réflexions. Il observe avec précision, en Inde et en Afrique du Nord, le choc des civilisations que le colonialisme provoque et exacerbe. C'est ce choc, dont la dimension psychologique l'impressionne, qui mènera Le Bon à élaborer sa théorie de la "psychologie des foules" qui se décompose en théorie de la "race historique" et de la "constitution mentale des peuples". Rejetant le principe de race pure, Le Bon préfère celle de "race historique", dont l'aspect culturel est prédominant. Là s'amorce le thème essentiel de toute son œuvre : "le mécanisme le propagation des idées et des conséquences". À la base, Le Bon repère le mécanisme dynamique de la "contagion". La contagion est assurée par les 1ers "apôtres" qui eux mêmes sont le résultat d'un processus de "suggestion". Pour Le Bon, ce sont les affirmations qui entraînent l'adhésion des foules, non les démonstrations. L'affirmation s'appuie sur un médium autoritaire, dont le 'prestige" est l'arme par excellence.
Le Bon est aussi historien. Il trouve dans l'étude des actions historiques le terrain privilégié de sa réflexion. Deux auteurs ont marqué son initiation à la science historique : Fustel de Coulanges et Hippolyte Taine. La lecture de La Cité Antique, ouvrage dû à Fustel de Coulanges, lui fait comprendre l'importance de l'étude de l'âme humaine et de ses croyances afin de mieux comprendre les institutions. Mais Taine est le véritable maître à penser de Le Bon. Les éléments suivants sous-tendent, selon Taine, toute compréhension attentive des civilisations : la race, le milieu, le moment et, enfin, l'art. La théorie de la psychologie des foules résulte d'une synthèse additive de ces diverses composantes. Mais Le Bon va plus loin : il construit une définition précise, "scientifique", de la foule. L'âme collective, mélange de sentiments et d'idées caractérisées, est le creuset de la "foule psychologique". Le Bon parle d'unité mentale...
Un autre auteur influence beaucoup Le Bon. Il s'agit de Gabriel de Tarde. Ce magistrat, professeur de philosophie au Collège de France, est à l'origine de la "loi de l’imitation", résultat d'études approfondies sur la criminalité. La psychologie des foules, théorie de l'irrationnel dans les mentalités et les comportements collectifs (titre de la 1ère partie), offre à Gustave Le Bon une théorie explicative de l'histoire et des communautés humaines dans l'histoire. À travers elle, l'auteur aborde de nombreux domaines : les concepts de race, nation, milieu sont soumis à une grille explicative universelle.
Une nouvelle philosophie de l'histoire
Le Bon se permet aussi une analyse précise des institutions politiques européennes : ainsi sont décortiquées les notions de suffrage universel, d'éducation, de régime parlementaire. L'actualité fait aussi l'objet d'une approche scientifique : Le Bon analyse les phénomènes contemporains de la colonisation, du socialisme, ainsi que les révolutions et la montée des dictatures. Enfin, Le Bon traite de la violence collective au travers de la guerre, abordant avec une prescience remarquable les concepts de propagande de guerre, des causes psychologiques de la guerre, etc. Tous ces éléments partiels amènent Le Bon à dégager une nouvelle philosophie de l'histoire, philosophie qui induit non seulement une méthode analytique, mais aussi et surtout les facteurs d'agrégation et de désintégration des peuples historiques (plus tard, à sa façon, Ortega y Gasset parlera, dans le même sens, de peuples "vertébrés" et "invertébrés"). La civilisation est enfin définie, donnant à Le Bon l'occasion d’aborder une des questions les plus ardues de la philosophie européenne, celle que Taine avait déjà abordé et celle que Spengler et Toynbee aborderont.
G. Le Bon est un auteur inclassable. Profondément pessimiste parce que terriblement lucide à propos de l'humanité, Le Bon utilise les outils les plus "progressistes" de son époque. Il sait utiliser les armes de la science tout en prévenant ses lecteurs des limites de son objectivité. Observateur des lois permanentes du comportement collectif, Le Bon est un historien convaincu. Il comprend très vite l'importance, en politique, de la mesure en temps. L'histoire est le résultat d'une action, celle qu'une minorité imprime sur l'inconscient des masses. Il constate que cette influence des minorités agit rarement sur la mentalité, donc sur les institutions de ses contemporains. Il y a donc un écart historique entre l'action et la transformation effective du réel. L'élaboration d'une idée est une étape. La pénétration concrète de cette idée est l'étape suivante. Son application enfin, constitue une autre étape. Cette mesure au temps vaut au fond pour tous les domaines où l'homme s'implique. Dans l'histoire bien sûr mais aussi dans la science, dans le politique. Le grand homme politique est simplement celui qui pressent le futur de son présent. Il est la synthèse vivante et dynamique des actions posées par les générations précédentes. L'histoire du passage de l'inconscient au conscient est aussi à la mesure de ce temps. Les institutions et le droit sont les fruits de l'évolution des mentalités.
Au-delà des misères de la droite et de la gauche
Le livre de Catherine Rouvier a un immense mérite : comprendre, au travers de l'œuvre de Le Bon, comment l'histoire des idées politiques est passée du XIXe au XXe siècle. La multiplicité des questions abordées par l'auteur est le miroir de l'immense variété des outils de réflexion utilisés par Le Bon. Les idées politiques de Gustave Le Bon supportent mal une classification simplette. Si la droite libérale lance aujourd'hui une tentative de récupération de Le Bon et si la gauche continue à dénoncer ses théories, on peut déceler dans ces 2 positions, au fond identiques même si elles sont formellement divergentes, une même incompréhension fondamentale de la théorie de Le Bon. Les idées politiques de ce sociologue de l'âge héroïque de la sociologie, dont le soubassement psychologique est présenté ici, ne sont en fait ni de droite ni de gauche. La dialectique d'enfermement du duopole idéologique moderne refuse catégoriquement toute pensée qui n'est pas immédiatement encastrée dans une catégorie majeure. C'est le cas de Le Bon. Catherine Rouvier compare d'ailleurs, avec beaucoup de pertinence, cette originalité à celle des travaux de Lorenz (cf. Postface, p. 251 et s.). Le Bon exprime bien l’adage très connu de Lénine : les faits sont têtus...
Petites phrases :
"Nous sommes à l'époque des masses, les masses se prosternent devant tout ce qui est massif." Nietzsche, Par delà Bien-Mal, § 241
"La foule est plus susceptible d'héroïsme que de moralité." G. Le Bon, Aphorismes du temps présent
"La preuve du pire, c'est la foule." Sénèque, De beatam vitam
"Non, le mal est enraciné en chacun, et la foule placée devant l'alternative vie-mort crie "La mort ! La mort !" comme les Juifs répondaient à Ponce-Pilate "Barabas ! Barabas !" ". M. Tournier, Le Roi des Aulnes
"Une société de masse n'est rien de plus que cette espèce de vie organisée qui s'établit automatiquement parmi les êtres humains quand ceux-ci conservent des rapports entre eux mais ont perdu le monde autrefois commun à tous." H. Arendt, La Crise de la culture
"Il faut se séparer, pour penser, de la foule / Et s'y confondre pour agir." Lamartine
"La maturité des masses consiste en leur capacité de reconnaître leurs propres intérêts." A. Koestler, Le Zéro et l'Infini
"En fait, la plupart du temps, la masse les précède, leur indique le chemin en silence, mais d'un silence qui n'est pas moins efficace puisque c'est de leur capacité à savoir l'écouter que ces "grands hommes" tirent leur pouvoir." M. Maffesoli, La Transfiguration du politique
"Toute la publicité, toute l'information, toute la classe politique sont là pour dire aux masses ce qu'elles veulent." / "L'énergie informatique, médiatique, communicationnelle dépensée aujourd'hui ne l'est plus que pour arracher une parcelle de sens, une parcelle de vie à cette masse silencieuse." J. Baudrillard, Les Stratégies fatales.
Notes : Recension Les idées politiques de Gustave Le Bon, Catherine Rouvier (PUF, 1986).
source : Revue Vouloir n°35/36 (janv. 1987)

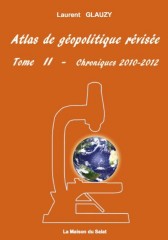 Après le succès de son
Après le succès de son