 C'est dans une indifférence polie que l'occident a tout juste effleuré ce 21 août la commémoration du 50e anniversaire du printemps de Prague, liquidé le 21 août 1968 par les chars du pacte de Varsovie.
C'est dans une indifférence polie que l'occident a tout juste effleuré ce 21 août la commémoration du 50e anniversaire du printemps de Prague, liquidé le 21 août 1968 par les chars du pacte de Varsovie.
On me pardonnera j'espère de m'en tenir ici aux souvenirs personnels.
Pour le jeune militant anticommuniste, étudiant en Sciences économiques, qu'était alors votre serviteur, cette expérience était marquée par la personnalité et les idées du concepteur tchèque d'une troisième voie[1], Ota Sik.
À cet égard on doit rappeler que cette séquence faisait novation. Elle était, certes, conduite politiquement par le dirigeant du parti communiste Alexander Dubcek, arrivé au pouvoir le 5 janvier. Mais il ne s'agissait pas seulement en Tchécoslovaquie d'une volonté d’indépendance nationale de type hongrois, comme celle de l'héroïque Imre Nagy en 1956, ou même yougoslave, à partir de l’expulsion de Tito du Kominform en 1948.
On admirait beaucoup alors, à Paris, l'ex aventurier des Brigades internationales qui régnait à Belgrade. Certains prenaient au sérieux son programme d'autogestion. Mais, désormais on se trouvait en présence d'une critique bien mieux construite. Le modèle soviétique de planification et de développement extensif à base d'industrie lourde avait définitivement échoué. Peu de Français en semblaient hélas, à cette époque convaincus[2]. Ota Sik en dénonçait l'absolue inadaptation à des pays d'Europe centrale comme le sien. Il n'écrivait pas au nom de ce qu'un Raymond Barre[3] préconisait, la promotion des grandes unités capitalistiques, ce que l'on appelait ordinairement les trusts. Mais au contraire, répudiant en fait le marxisme et l'économie planifiée, il s'agissait de revitaliser et de réhabiliter les petites unités de production. Tel a toujours été, je l'avoue humblement, d'instinct, ma conception indéfectible.
Il faut ajouter une intéressante leçon apprise par la poignée de militants anticommunistes venus crier, dans la chaude nuit du 21 au 22 août 1968 au Quartier latin, et jusques aux portes de l'ambassade tchèque, leur adhésion à la cause de la Liberté à Prague. Une phalange bien huilée d'apparatchiks du PCF était bel et bien présente, quant à elle, pour détourner la protestation : il ne fallait pas, disaient-ils, se rallier aux mots d'ordre des fascistes.
Autre étonnant commentaire : celui des gens du pouvoir. Ils venaient de remporter les élections législatives des 23 et 30 juin. Leur plateforme se basait sur le rejet du communisme par les Français. Or, à les entendre, les évènements de Bohème devaient être considérés comme une simple péripétie et les Soviétiques comme d'excellents conservateurs de frontières. Des amis par conséquent. Cela aussi mérite d'être inscrit dans nos mémoires.
JG Malliarakis
Apostilles
[1] Livre publié sous ce titre en Allemagne en 1972 et en France par Gallimard en 1974.
[2] On doit saluer ici l'exception que représentait la préface de Jules Monnerot à la réédition en 1963 de sa Sociologie du Communisme, dans laquelle il prévoyait la défaite du bloc soviétique et de son économie, telles que l'URSS s'est effectivement effondrée.
[3] Barre était alors le rédacteur du principal manuel d'Économie politique de 1re et de 2e années en collection Thémis. Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il l'appellera au gouvernement saluait en lui le meilleur économiste de France.
http://www.insolent.fr/2018/08/que-reste-t-il-du-printemps-de-prague-.html
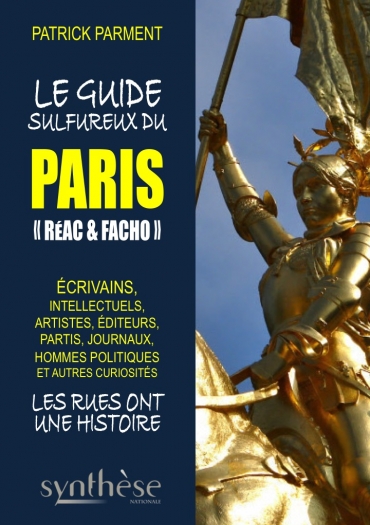
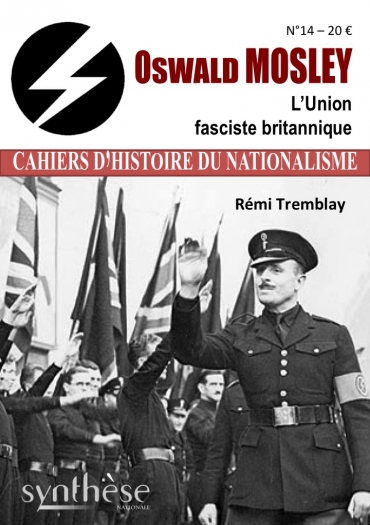

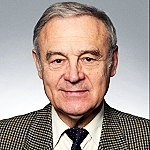 Par Marc Rousset
Par Marc Rousset La Russie est née avec la Rous’ de Kiev (882-1169) lorsque le prince varègue Oleg, venu de Novgorod, s’empare de Kiev en 882 pour former un des plus grands États d’Europe au Xe siècle, de la Baltique à la mer Noire. La Russie devient chrétienne orthodoxe lors de la conversion, en 988, du prince Vladimir de la Rous’ de Kiev à Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Aujourd’hui, l’Ukraine est un pays majoritairement orthodoxe.
La Russie est née avec la Rous’ de Kiev (882-1169) lorsque le prince varègue Oleg, venu de Novgorod, s’empare de Kiev en 882 pour former un des plus grands États d’Europe au Xe siècle, de la Baltique à la mer Noire. La Russie devient chrétienne orthodoxe lors de la conversion, en 988, du prince Vladimir de la Rous’ de Kiev à Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Aujourd’hui, l’Ukraine est un pays majoritairement orthodoxe.
