
Par Ligne droite, rassemblement de Français engagés pour une droite nouvelle
Malgré toutes les promesses faites dans ce domaine, les impôts et les charges ne cessent d’augmenter. Non seulement leur poids total s’alourdit, mais il se concentre par ailleurs sur les Français des classes moyennes et sur les PME, créant ainsi une profonde injustice qui rend l’impôt de moins en moins supportable. Aussi, Ligne droite considère-t-elle indispensable que l’impôt soit à nouveau payé par tous les citoyens, chacun en fonction de ses capacités contributives. Une réforme qui doit viser la justice, mais aussi la simplification et aboutir à une baisse globale des taux de prélèvement.
L’augmentation des impôts pour le plus grand nombre, pur produit de l’ultralibéralisme mondialiste
Les gouvernements qui se succèdent se révèlent incapables de réduire les impôts et les charges parce qu’ils restent prisonniers de la logique ultralibérale, libertaire et mondialiste du Système. La situation qui en résulte n’est pas sans rappeler l’inégalité fiscale qui régnait à la fin de l’Ancien Régime, avec des écarts de patrimoines et de revenus se creusant de façon excessive.
La logique de la politique du Système est en effet implacable. Le chômage de masse, fruit de la désindustrialisation, réduit les recettes fiscales tout en augmentant les dépenses sociales. Plus globalement, l’abolition des frontières, l’immigration et la dérégulation de l’économie et de la finance provoquent une augmentation constante des charges pesant sur les budgets publics. Sans compter que cette dérégulation permet aux grandes entreprises mondialisées et aux super riches d’organiser leur évasion fiscale et de payer moins d’impôts.
Résultat : les budgets publics sont devenus systématiquement déficitaires au cours de la seconde moitié du XXesiècle, entraînant un accroissement spectaculaire du montant des dettes publiques.
Un impôt à la fois élevé et injustement réparti
Les tenants du Système nous répètent à l’envi que pour « rétablir l’équilibre des comptes publics », il faudrait diminuer de plus en plus les dépenses publiques et les prestations sociales tout en augmentant les prélèvements « sociaux ». Une politique qui a été agrémentée de différents artifices pour essayer de rendre l’impôt plus indolore, comme hier la CSG (création du socialiste Michel Rocard), la mensualisation, la télédéclaration et aujourd’hui la retenue à la source.
Mais cette politique, mise en œuvre depuis bientôt trente ans, n’a nullement produit les bénéfices escomptés. D’abord parce qu’elle provoque un effet économique récessif qui renforce l’impact négatif du chômage de masse. Ensuite parce qu’elle néglige le fait que, l’impôt étant très inégalement réparti, son rendement ne peut que plafonner. L’efficacité fiscale diminue en effet aux deux extrémités de la pyramide sociale. Les plus riches y échappent nettement plus que la classe moyenne parce que le capital se trouve moins taxé que les revenus, ce qui profite à ceux dont l’essentiel de la richesse provient justement des revenus du capital. De l’autre côté, les populations d’origine immigrée dont le taux d’activité est plus faible que la moyenne nationale, payent moins d’impôts que le reste de la population.
Dès lors, la charge fiscale et sociale non seulement augmente, mais se concentre sur ceux qui n’ont pas la possibilité de délocaliser leurs avoirs ou de vivre de transferts sociaux, c’est-à-dire principalement sur les salariés et les retraités de la classe moyenne ainsi que sur les PME.
Profondément malsaine, cette situation dans laquelle à peine un Français sur deux paye l’impôt est source d’injustice et d’inefficacité. Aussi Ligne droite propose-t-elle une grande réforme de la fiscalité fondée sur trois principes : la justice, la modération et la simplification.
Une priorité : rétablir la justice fiscale
La droite nouvelle doit prioritairement rétablir la justice fiscale, ce qui améliorera le rendement de l’impôt et permettra ensuite d’en réduire le poids.
Pour ce faire, il faut en premier lieu augmenter l’imposition du capital, et notamment du capital financier, afin de garantir une réelle progressivité fiscale et une meilleure équité par rapport à l’imposition du travail et de la consommation. Il s’agit à cet égard de faire le contraire de M. Macron qui supprime l’ISF et crée un impôt sur le patrimoine immobilier des Français, avec comme conséquence de réduire encore l’impôt des super riches qui tirent l’essentiel de leurs revenus des produits financiers et de taxer ceux qui ont économisé pour acquérir un bien immobilier à transmettre à leurs enfants. Une démarche qui favorise la richesse hors sol aux dépens de la richesse enracinée.
Il faut ensuite étendre l’assiette de l’impôt sur le revenu pour qu’il redevienne un impôt citoyen payé par la totalité de la population et élargir dans le même temps le barème afin de mieux mettre à contribution les plus hauts revenus. Une formule qui permettra de réduire d’autant les taux d’imposition des revenus moyens.
Engager un plan de baisse des impôts
Le rétablissement de la justice fiscale permettra de dégager des ressources supplémentaires de nature à abaisser les prélèvements pesant sur les classes moyennes. Mais plus globalement, ce sont les différents volets de la politique préconisée par Ligne droite qui, en assainissant les comptes publics, rendront possibles les baisses d’impôt. D’abord, la régulation des échanges commerciaux et le blocage des courants migratoires, voulus par ailleurs par la droite nouvelle, amélioreront l’équilibre des finances publiques en diminuant le chômage et les dépenses sociales induites. Cette embellie financière sera de plus facilitée dans le court terme par le programme de réduction des dépenses publiques préconisé par Ligne droite. Quant à l’amélioration des comptes sociaux, elle viendra également de l’augmentation du nombre d’actifs et du redressement de la démographie française, deux domaines dans lesquels Ligne droite fait aussi des propositions précises.
Dans ce contexte, la droite nouvelle pourra faire voter une loi de programme fixant pour la durée de la législature un plan de baisse des impositions et des prélèvements sociaux qui comportera dès la première année une diminution de 10 % de l’impôt sur le revenu ainsi qu’une réduction équivalente de l’impôt sur les bénéfices des PME.
Une simplification importante du code général des impôts
Par ailleurs, et pour rendre l’impôt plus acceptable et plus compréhensible, une action de simplification du système fiscal devra être engagée. Actuellement, le code général des impôts, qui compte plus de mille articles, des centaines de taxes et de prélèvements, de décotes et de dégrèvements divers, génère un méandre fiscal, source d’insécurité et d’instabilité pour les citoyens. Ligne droite préconise en conséquence de simplifier considérablement la législation fiscale, notamment par la réduction drastique du nombre de taxes ainsi que par la diminution des niches fiscales. Une simplification qui devra concerner tout particulièrement la fiscalité locale.
Une approche européenne de la fiscalité
Par ailleurs, Ligne droite estime que la question fiscale ne doit pas se concevoir uniquement dans un cadre français. L’Europe confédérale que la droite nouvelle s’efforcera de mettre sur pied suppose en effet une régulation des flux économiques et financiers transfrontières mais aussi une plus grande coordination des politiques fiscales.
Dans cet esprit, par exemple la fiscalité des bénéfices des grandes entreprises de même que celle portant sur le capital doivent être harmonisées à l’échelle européenne pour éviter les distorsions et les effets de dumping entre États membres. C’est dans un cadre européen également qu’il faut concevoir l’harmonisation de l’imposition pesant sur la consommation et principalement sur la TVA.
Pour Ligne droite, la baisse des impôts et des charges n’est donc pas une utopie : mais le fruit d’une politique volontariste et cohérente.
Ligne droite 04/07/2018
Source : Ligne droite
Crédit photo : dierck schaeffer via Flickr (recadré) cc
https://www.polemia.com/la-hausse-des-impots-et-des-charges-nest-pas-une-fatalite/
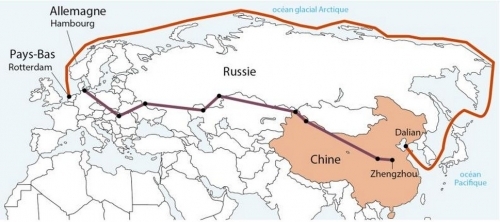


 Nicolas Tardy-Joubert, Conseiller Régional PCD d'Ile de France,
Nicolas Tardy-Joubert, Conseiller Régional PCD d'Ile de France, 
 Marc Rousset
Marc Rousset

