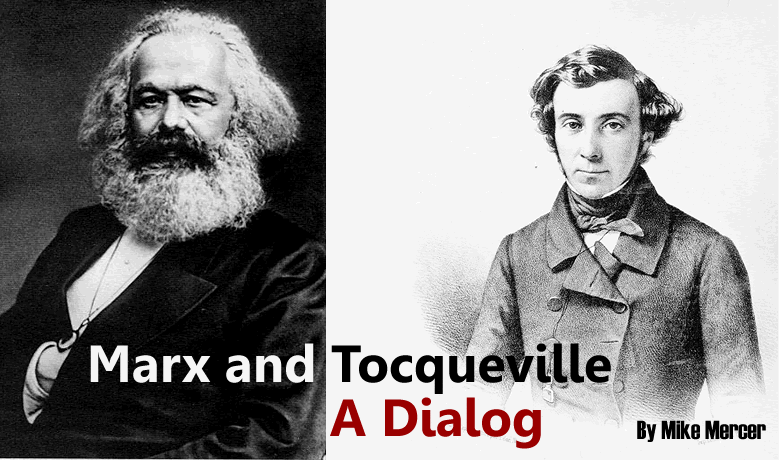Alors, ce code du travail, Macron va le simplifier, ou pas ? Réformera, réformera pas ? Au vu des dernières avancées – fort timides – et du dégonflement presque comique de la loi de moralinisation de la vie politique, on est déjà en droit de douter. Malgré tout, les parlementaires viennent de donner leur aval à la modification du droit du travail par ordonnance. Un nouveau chapitre législatif vient de s’ouvrir.
Et concernant ce droit du travail, il y a de quoi faire, n’en déplaise à certains politiciens béats manifestement déconnectés du réel ainsi qu’aux instituts et autres émanations étatiques pour lesquels le principal obstacle au plein emploi ne serait pas, que nenni, dans cet épais ramassis de contraintes et de vexations furieuses (ben voyons).
En pratique, l’évolution en poids, complexité et nombre d’articles de ce code et des procédures qui l’accompagnent est joliment corrélé à l’installation d’un chômage de masse dans le pays et d’un marché noir parfaitement assumé par une frange croissante de la population qui ne peut plus subvenir à ses besoins lorsqu’elle se contente de rester dans les clous. Comportement qu’on retrouve aussi bien du côté des employeurs que des employés : les premiers tendent à s’affranchir des déclarations et autres montagnes de cerfas qu’on leur impose, les seconds font progressivement tout pour favoriser sinon le black, au moins le troc et les renvois d’ascenseurs que l’administration fiscale, si elle pouvait les quantifier, n’hésiterait pas à taxer.
Ce que la population générale subit et la façon dont elle réagit, les administrations publiques subissent aussi et, même si elles sont souvent les premières instigatrices de ces débordements législatifs compulsifs, les voilà qui réagissent parfois de la même façon… Ce qui donne des situations particulièrement croquignolesques.
C’est ainsi qu’on découvre que l’URSSAF Bretagne vient d’être récemment condamnée à payer 150.000 euros à une ancienne salariée pour … non paiement d’heures supplémentaires, ainsi que pour un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Apparemment, ce sont 240 heures supplémentaires qui n’ont pas été payées parce que l’organisme – pourtant chargé de faire respecter aux entreprises des principes d’élaboration et de conservation des preuves de l’horaire de travail de leurs collaborateurs – a intentionnellement dissimulé les heures de travail de la plaignante.
C’est aussi de la même façon qu’on découvre que la CARMI, Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines, est actuellement poursuivie pour avoir délivré 1117 contrats à durée déterminée à la même personne pour différents postes sur les 12 dernières années, couplés à des périodes de plusieurs semaines sans jours de repos et des enchaînements de postes sur plus de 12 heures d’affilée.
Autrement dit, l’organisme « social », quasi ou para-public, se fend d’à peu-près tous les vices qu’un patron voyou ne pourrait espérer aligner sans se faire étriller par, justement, tous les organismes quasi ou para-publics que la France héberge généreusement et qui se chargeraient de bien lui faire comprendre le sens des réalités françaises et l’épaisseur de son code du travail.
Je pourrais, assez facilement, multiplier sans mal les exemples de la sorte où telle administration territoriale exploite sans vergogne le petit personnel ou les agents contractuels virables ad nutum, tel organisme prétendument social fait dans l’esclavagisme plus ou moins camouflé derrière un salaire de misère et des conditions de travail insupportables, telle institution entretient les pires habitudes d’emploi au sein de ses équipes alors même que, officiellement, elle est chargée de faire respecter la loi et ce fameux code du travail sur lequel elle fait du trampoline les fesses à l’air…
Mais ce n’est guère nécessaire, les deux exemples précédents suffisant largement à établir mon point : non seulement, les patrons voyous se trouvent aussi dans la fonction publique et assimilée, mais les pratiques de nos administrations n’ont, de ce point de vue, absolument rien à envier aux pires entreprises privées régulièrement dénoncées par une presse toujours aux aguets…
D’ailleurs et de façon intéressante, là où cette presse n’hésite pas à se déchaîner lorsqu’un tel patron se fait attraper, elle reste bien plus sage et mesurée lorsqu’il s’agit d’institutions républicaines, réputées travailler pour le bien collectif, voire, soyons fous, pour ce vivrensemble qui fait vibrer tant de Français.
Pourtant, ces institutions sont d’autant plus redevables à la population de leur exemplarité qu’elles tirent leurs budgets de cette dernière, de plus en plus mise à contribution. Elles devraient être d’autant plus irréprochables que ce sont ces mêmes entités qui viennent fourrer leur nez dans les affaires des Français pour leur infliger amendes, redressements voire peines de prison lorsque ces derniers n’ont pas respecté ces lois qu’elles piétinent si régulièrement et avec un cynisme qui frise la psychiatrie.
Malgré cela et alors que ces exemples s’accumulent au fil du temps, la presse et ses journalistes affûtés comme du beurre chaud continuent de nous les peindre, régulièrement, comme les seules capables de ménager nos « biens communs », ce vivrensemble fameux et ces valeurs républicaines jamais écrites mais partout vantées.
Plus grave : ce sont ces mêmes entités, ces mêmes administrations et leurs armées de bureaucrates qui seront chargées d’appliquer les « réformes » qu’entendent faire passer nos parlementaires.
Finalement, le mécanisme est partout le même : à chaque fois, l’augmentation des lois et des contraintes, toutes censées améliorer la situation, finissent rapidement par l’empirer. Les codes, de plus en plus joufflus, sont alimentés par des politiciens de plus en plus déchaînés qui prétendent résoudre des problèmes que les adultes responsables résolvaient jadis très bien sans eux.
Le code bancaire est devenu énorme ; jamais les banques n’ont aussi peu inspiré confiance aux déposants et jamais elles n’ont paru aussi fragiles. Le code immobilier est maintenant obèse et la France croule sous les SDF, les logements insalubres ; la pénurie de logement fait rage, les loyers flambent et devenir propriétaire semble chaque jour plus difficile.
Les codes de l’urbanisme, de la sécurité sociale, du commerce, des assurances, de la consommation, de l’énergie ou de l’environnement ont tous considérablement augmenté, sans que ces augmentations puissent prétendre couvrir les problèmes posés au jour le jour. À croire que dans les années 50, 60 ou 70, lorsque la sialorrhée législative n’était pas généralisée, la France n’était qu’un pays de barbares où rien n’était régulé et où chacun pouvait, à tout moment, se faire détrousser en toute impunité, et que, depuis, seule nous a sauvé du pire la production continue et intensive de textes abscons dans l’un des près de soixante (!) codes disponibles dans ce pays d’indécrottables ronds-de-cuir.
Or, jusqu’à présent et devant ce constat, la réaction globale fut dans le pire des cas d’en ajouter une couche en estimant que les problèmes observés étaient essentiellement dus à une trop grande timidité dans la production législative. Dans le meilleur des cas, ce fut la « simplification administrative », et le quinquennat hollandesque nous aura permis de mesurer ce qui se cachait réellement derrière… à savoir une nouvelle bordée de lois et une couche administrative supplémentaire. (Si vous trouvez que le meilleur des cas ressemble furieusement au pire, vous avez raison.)
Les parlementaires veulent réformer le code du travail ? Fort bien. Mais vu ces exemples, vu l’historique des réformes et vu ceux qui devront appliquer ces réformes, ne placez pas vos espoirs trop haut.
De toute façon, ce pays est foutu.
Source
http://www.voxnr.com/12815/ladministration-francaise-patron-voyou
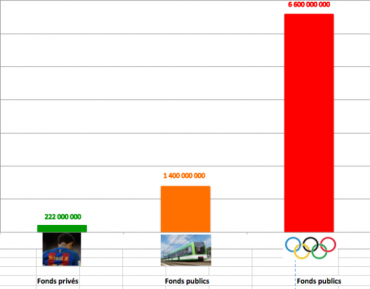

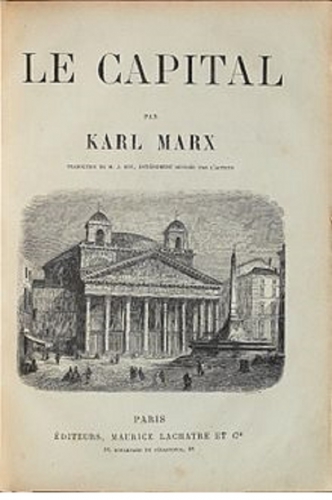 Peu de livres, dans l’histoire de la pensée politique, ont suscité des polémiques prolongées au delà d’un siècle. Parmi eux, Le Prince, de Nicolas Machiavel, publié en 1513, Du contrat social, de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762 et Le Capital de Karl Marx.
Peu de livres, dans l’histoire de la pensée politique, ont suscité des polémiques prolongées au delà d’un siècle. Parmi eux, Le Prince, de Nicolas Machiavel, publié en 1513, Du contrat social, de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762 et Le Capital de Karl Marx.