Sur son blog, l’éditorialiste du Figaro Ivan Rioufol estimait hier que le retour de Nicolas Sarkozy (dans la course pour la présidentielle en 2017) est « entravé par le FN ». Appelant implicitement de ses vœux une union des droites contre la gauche, il affirme que « l’erreur qui démange la droite centriste serait de continuer à décréter le FN infréquentable en dépit des nouveaux électeurs qui le rejoignent : ce serait là le meilleur moyen de radicaliser une frange de plus en plus importante d’un électorat qui en a assez d’être méprisé ». Par ailleurs, « les réalités politiques obligent à plus de modestie vis-à-vis du FN et, probablement, à des compromis ou des rapprochements ». Ainsi, « si les divergences (entre l’UMP et le FN) ne manquent pas sur le plan économique (son idéologie antilibérale contredit son pragmatisme sociétal), des convergences existent sur les risques du communautarisme, de l’immigration de masse, de l’oubli de soi, etc. Sarkozy ne pourrait surprendre que s’il décidait de jeter des ponts, en rompant avec l’ostracisme qui n’accorde d’ouvertures qu’à la gauche. Son savoir-faire politique peut l’en rendre capable. Mais il lui faudrait alors affronter, nonobstant d’éventuelles suites judiciaires dans des affaires en cours, le tribunal médiatique et ses inquisiteurs. Chiche ? »
Est-ce à dire que les divergences sur le plan économique entre l’opposition nationale et les partis européistes de droite, pour faire court, sont surmontables ? Il est clair en tout cas que lagauche bruxelloise, dans son exercice du pouvoir, se livre à des avancées que ne renieraient pas de nombreux dirigeants de l’UMP. Sous la plume de Laurent Jauffret, Minute se penche dans son dernier numéro sur le reportage daté de 2012 « Le plan de bataille de financiers » produit par La coopérative industrielle, Les mutins de Pangée, le journal Fakir et le site la-bas.org, le site non officiel de l’émission de Daniel Mermet Là bas si j’y’ suis.
Si tout ce petit monde évolue clairement dans les eaux de l’extrême gauche , ledit reportage n’en démasque pas moins le double langage, les mensonges du PS. A l’appui de sa démonstration, le journaliste évoque les propos de Nicolas Doisy , chief economist deChevreux, filiale de courtage de la Corporate investment Bank, « qui conseille des centaines de fonds de pension ». « Dans une note confidentielle destinée aux opérateurs de marché il avait tenu à rassurer ces derniers quant à l’impossibilité pour François Hollande de tenir sa promesses de brider la finance (..) que le bonimenteur avait promis au peuple ».
Selon M. Doisy, interrogé par les auteurs de ce reportage le 19 mars 2012, Hollande « qui allait être élu quelques semaines plus tard, ne pouvait faire autrement que de libéraliser le marché du travail ou selon ses mots, de réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont bénéficient jusqu’à présent les titulaires de CDI (…) et imposer plus de flexibilité aux travailleurs. Ce fut effectivement le cas quelques mois plus tard avec l’accord sur l’emploi signé le 11 janvier 2013 ».
Passé largement inaperçu du fait de l’attention médiatique qui s’est focalisée sur la bataille autour du Mariage pour tous (une diversion pour occulter cette trahison, faire passer cette pilule là selon certains), « un employeur peut donc, désormais depuis cette loi se fonder sur les compétences professionnelles de son salarié pour le licencier, ce qui est la porte ouverte aux critères subjectifs ».
« C’est regrettable pour François Hollande mais la nécessité d’une libéralisation du marché du travail est le résultat de l’appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l’une sans avoir l’autre écrivait Nicolas Doisy dans sa note ». Quant au pacte budgétaire européen, « il estimait qu’il serait politiquement intelligent que les partenaires européens de la France permettent à François Hollande de prétendre qu’il leur a arraché quelques concessions, même si c’est faux en réalité. La demande de renégociations du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter de réformes convenables dont celle du marché du travail ».
Et Julien Jauffret de noter que « la situation est aujourd’hui beaucoup plus simple qu’on ne le croit parfois: une bande de prédateurs qui se prend pour la nouvelle race des seigneurs a décidé de réduire en semi-esclavage une bonne partie de la planète pour son profit exclusif».
Si le Front National est de très loin le plus cohérent dans sa dénonciation de toutes les perversités du mondialisme sur le plan économique, identitaire, social comme sociétal, il n’a certainement pas échappé à M. Rioufol que le « libéralisme » à la sauce européiste est incompatibles avec la défense de nos intérêts nationaux. Libéralisme incarné par Jean-Claude Juncker, ex-Premier ministre du Luxembourg, désigné à la présidence de laCommission européenne par le Parti populaire européen (PPE) auquel appartient l’UMP,avec le soutien du Parti socialiste européen (PSE) …Pour faire bon mesure le socialisteMartin Schulz, alias « Papa Schulz , »a obtenu le soutien des mêmes pour la présidence de l’UE. La boucle est bouclée…
Dans une tribune publiée sur le site du Nouvel Obs, l’inénarrable Dominique Sopo, président du SOS racisme, dénonce rituellement le FN et sa « matrice » de haine » (sic). Il appelle à une énième mobilisation contre le camp patriotique, tout en concédant que « la gauche qui est aujourd’hui au pouvoir « , « a trahi ses électeurs » que « les deux années qui viennent de s’écouler auront été des années de renoncements ».
Mais très significativement, M. Sopo se garde bien de pointer les véritables trahisons de la gauche euromondialiste dont nous évoquions plus haut un échantillon. Non la gauche aurait failli à sa « mission » en « (refusant) d’engager les combats du progrès en matière d’égalité », « d’ initier une nouvelle page dans la conquête de l’égalité ». « Droit de vote des étrangers, remise d’un ticket lors des contrôles policiers, politique de lutte contre les discriminations, relance de la politique de la Ville, politique de la jeunesse : comment la gauche au pouvoir a pu abandonner ces combats ? »
Il est évident que le poids électoral du FN a permis en effet de freiner les manifestations les plus visibles, perceptibles aux yeux de l’opinion de son immigrationnisme échevelé, et de son laxisme délirant. Un récent sondage n’indiquait-il pas également que 79% des Français estimaient qu’il y avait « trop d’immigrés » en France ?
Pour autant M. Sopo sait parfaitement qu’au sein de notre démocratie confisquée, le projet multiculturaliste, de disparition des identités nationales, reste plus que jamais la mauvaise boussole qui guide les dirigeants de la caste politico-médiatique.
Il va de pair avec la soumission (par conviction ou intérêt) de ce gouvernement et nos élitesaux autres diktats de la ploutocratie planétarienne. Pour répondre encore aux interrogations de M. Rioufol, force est de constater affirme Bruno Gollnisch que dans le domaine de la politique d’immigration également, la droite sarkozyste au pouvoir s’est acharnée à décevoir et à mentir aux Français . « Laisser faire, laisser passer », l’inoxydable slogan de toutes les démissions…
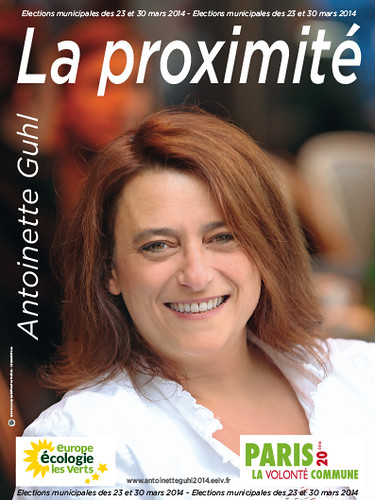 Et Frigide Barjot n’est pas un cas isolé. Les élus parisiens (PS, EELV, Front de Gauche ou UMP) -qui ne cessent de parler d’égalité- profitent eux aussi sans vergogne du logement social en dépit de leurs revenus confortables. Ainsi
Et Frigide Barjot n’est pas un cas isolé. Les élus parisiens (PS, EELV, Front de Gauche ou UMP) -qui ne cessent de parler d’égalité- profitent eux aussi sans vergogne du logement social en dépit de leurs revenus confortables. Ainsi  Didier Guillot, conseiller municipal PS du 18e arrondissement vit, quant à lui, depuis 2000 dans un appartement de 113 m², géré par la RIVP, loué 1 900 euros. Dans le privé, il lui en coûterait au minimum 2 500 euros. Chose aggravante, il s’agit là de son deuxième logement social. Didier Guillot avait obtenu le premier en 1997 alors qu’il était salarié du conseil régional d’Ile-de-France.
Didier Guillot, conseiller municipal PS du 18e arrondissement vit, quant à lui, depuis 2000 dans un appartement de 113 m², géré par la RIVP, loué 1 900 euros. Dans le privé, il lui en coûterait au minimum 2 500 euros. Chose aggravante, il s’agit là de son deuxième logement social. Didier Guillot avait obtenu le premier en 1997 alors qu’il était salarié du conseil régional d’Ile-de-France. Conseillère de Paris déléguée à la petite enfance et à l’innovation citoyenne, Anne-Christine Lang bénéficie d’un logement social dans le 13e arrondissement parisien. Obtenu en 1999, lorsqu’elle n’exerçait aucun mandat, cet appartement de 110 m² serait là encore loué à un prix inférieur à celui du marché.
Conseillère de Paris déléguée à la petite enfance et à l’innovation citoyenne, Anne-Christine Lang bénéficie d’un logement social dans le 13e arrondissement parisien. Obtenu en 1999, lorsqu’elle n’exerçait aucun mandat, cet appartement de 110 m² serait là encore loué à un prix inférieur à celui du marché. Plus rigolo est la réaction de Raphaëlle Primet (Front de gauche), qui occupe un appartement HLM « de base » dans le 20e arrondissement de Paris. Contactée par Le Point.fr, elle s’en défend : « Ma situation est très particulière. (…) Je dois bientôt passer devant une commission. Il se peut que je sois contrainte de payer un surloyer » se justifie-t-elle. Mais Raphaëlle Primet n’est pas prête à quitter cet appartement obtenu au bout de dix longues années d’attente. Pour elle, partir reviendrait à trahir ses électeurs nous apprend Le Point.
Plus rigolo est la réaction de Raphaëlle Primet (Front de gauche), qui occupe un appartement HLM « de base » dans le 20e arrondissement de Paris. Contactée par Le Point.fr, elle s’en défend : « Ma situation est très particulière. (…) Je dois bientôt passer devant une commission. Il se peut que je sois contrainte de payer un surloyer » se justifie-t-elle. Mais Raphaëlle Primet n’est pas prête à quitter cet appartement obtenu au bout de dix longues années d’attente. Pour elle, partir reviendrait à trahir ses électeurs nous apprend Le Point. Les élus de gauche ne sont pas les seuls à être présents à la gamelle, ceux de l’UMP ne sont pas en reste. Avec des arguments tout aussi déroutants. Ainsi, Nathalie Fanfant, élue UMP du 20e arrondissement, bénéficie elle aussi d’un logement géré par la RIVP dans le 19e arrondissement. Jointe par Le Point.fr, elle indique être à la recherche d’un bien dans le privé. Mais pour l’heure, elle n’a pas dégoté la perle rare. La faute aux loyers prohibitifs. « Me priver de mon appartement reviendrait à interdire la politique à toutes les personnes gagnant moins de 10 000 euros par mois » réplique-t-elle. Avant de raccrocher, Nathalie Fanfant tient à rappeler « la précarité d’un élu pour qui une réélection n’est jamais assurée. » Elle nous arracherait presque une larme si on ne se rappelait pas que sa précarité politique s’élève à 4 186 euros bruts par mois.
Les élus de gauche ne sont pas les seuls à être présents à la gamelle, ceux de l’UMP ne sont pas en reste. Avec des arguments tout aussi déroutants. Ainsi, Nathalie Fanfant, élue UMP du 20e arrondissement, bénéficie elle aussi d’un logement géré par la RIVP dans le 19e arrondissement. Jointe par Le Point.fr, elle indique être à la recherche d’un bien dans le privé. Mais pour l’heure, elle n’a pas dégoté la perle rare. La faute aux loyers prohibitifs. « Me priver de mon appartement reviendrait à interdire la politique à toutes les personnes gagnant moins de 10 000 euros par mois » réplique-t-elle. Avant de raccrocher, Nathalie Fanfant tient à rappeler « la précarité d’un élu pour qui une réélection n’est jamais assurée. » Elle nous arracherait presque une larme si on ne se rappelait pas que sa précarité politique s’élève à 4 186 euros bruts par mois.