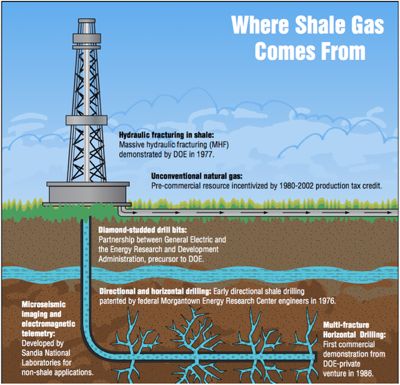Voici, aujourd’hui, publié en avant-première, le sixième extrait du prochain livre de Frédéric Malaval, Ecoracialisme.
Après avoir présenté dans son introduction sa thèse selon laquelle des évolutions irrépressibles obligeront les différentes races humaines à vivre dans leur écosystème d’origine, Frédéric Malaval a développé plusieurs argumentaires qui se construisent à partir d’observations sur la société humaine, sur un certain confort de vie après les grandes calamités du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, sur « l’insondable origine des peuples » et, enfin, dans son cinquième extrait, sur une certaine modernité venue tout droit des Etats-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce sixième extrait, publié ci-après, son approche se fixe sur une géopolitique directement issue des écosystèmes, avec évidemment une évolution qui se fait et se défait au gré des ressources naturelles de la planète. polemia
(…) Cette approche écosystémique permet aussi d’éclairer la géopolitique associée aux deux révolutions industrielles des XIXe et XXe siècles.
La première révolution industrielle est la conséquence de l’utilisation du charbon dans les machines à feu, objet de la thermodynamique. (…) La seconde révolution industrielle a comme origine la substitution du pétrole au charbon comme combustible alimentant les machines à feu.
(…) Mais alors que l’utilisation du charbon repose sur la maîtrise politique des territoires où se déroule la première révolution industrielle, le recours au pétrole va changer la donne géopolitique. Il y a alors rupture avec une géopolitique traditionnelle associant territoire et ressources. Le jeu géopolitique est modifié par le recours au pétrole. En effet, de nombreux Etats n’ont pas ou plus la maîtrise politique des territoires où se situe cette ressource à l’origine des caractéristiques écosystémiques de leur société. Ce découplage alimente toute la géopolitique depuis les années 1930, période où le pétrole s’impose comme l’énergie du futur. Une nouvelle vision de la Seconde Guerre mondiale en est issue. Celle-ci opposa des empires (USA, Russie soviétique, Royaume-Uni, France, Chine) ayant la maîtrise politique des territoires où se situait cette nouvelle ressource, à des nations qui n’en disposaient pas (Allemagne, Japon, Italie). L’effort de guerre de l’Allemagne ne pouvait s’appuyer que sur les ressources pétrolières de Roumanie, l’obligeant à une stratégie reposant sur la Blitzkrieg, incapable qu’elle était de soutenir une guerre longue. Les trop faibles ressources naturelles du Japon et de l’Italie les plaçaient dans la même situation à l’origine du Pacte Antikomintern (1936) et le rêve de se retrouver ensemble, installés sur les gigantesques ressources de l’Eurasie centrale.
Cette approche éclaire les grands mouvements de cette période à l’origine du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. L’Italie engagea le mouvement en cherchant à conquérir les pétroles de la Libye ; l’Allemagne au printemps 1942 s’associa à l’Italie dans sa lutte contre le Royaume-Uni pour maîtriser l’Afrique du Nord tout en s’engageant au même moment vers les champs de pétrole du Caucase de la Russie soviétique. Le Japon, de son côté, optait pour la conquête des pétroles de l’Asie du Sud-Est (Philippines, Malaisie) après avoir été refoulé en Sibérie à la bataille de Khalkhin-Gol en 1939, là aussi contre la Russie soviétique. Par manque de ressources durables, ces trois protagonistes échouèrent dans leurs tentatives d’accéder au pétrole, laissant aux empires en place la maîtrise du monde. Le différentiel démographique entre les deux blocs n’est pas le seul responsable de ces défaites. Malgré les hautes qualités de leurs armées, l’impossibilité d’accéder au pétrole participa à leur échec.
(…) L’actualité rend compte quotidiennement des mouvements dont la finalité poursuit le jeu engagé dans les années 1930 et dont la justification est le découplage entre ressources énergétiques et souveraineté politique. Avant d’envisager la fin du pétrole comme énergie de référence, sa maîtrise politique est vitale pour les sociétés modernes ultra-complexes (ou ultra-artificialisées, c’est pareil) ne possédant pas cette énergie sur leur sol ou voulant empêcher les autres d’y accéder. C’est le grand jeu géopolitique depuis 1950. Une sorte d’écopolitique… Or, les données de cette écopolitique changent fondamentalement avec les évolutions que l’extension de la technosphère a permises sur l’ensemble de la planète. Le plus important est la forte croissance démographique que cela a engendrée en tous points du globe. La conséquence la plus directe est la fin de la suprématie européenne, tant démographique que technologique.
La question démographique a déjà été traitée. La question technologique mérite une attention particulière car elle est déterminante pour qu’un peuple existe en soi.
(…) Aujourd’hui, des savants berbères, arabes, turcs ou perses, mais qui travaillent souvent en Europe ou en Amérique, sont réputés dans de nombreux domaines. Ainsi, l’invention de la logique floue en mathématiques est attribuée à un Iranien. Mais il travaille en Amérique. Un constat s’impose : de l’Atlantique à l’Océan indien, le monde musulman a les personnalités pour maîtriser les techniques qui firent la force des Européens chrétiens.
Quant aux Africains, régulièrement stigmatisés pour leur refus d’embrasser la Modernité, leurs contributions les plus fameuses sont le téléphone cellulaire, le réfrigérateur, l’ascenseur, etc. Dans les années 1890, l’illustre Thomas Edison perdit même un procès contre un inventeur africain à qui il contestait l’invention du système de télégraphie à induction. Granville T. Woods gagna finalement les droits du brevet. Depuis, Woods est au monde africain ce qu’Edison est au monde européen.
(…) La conclusion à tirer de cette évocation est que la techno-science n’est plus l’apanage des Européens. Tous les peuples possèdent la capacité de créer une technosphère. Mais pour des raisons que les spécialistes étudient, ils avaient initialement refusé de surartificialiser leurs écosystèmes. Cela était-il nécessaire d’ailleurs ? La Modernité européenne, en revanche, a fait ce choix. Pourquoi les autres ne l’ont-ils pas fait ? Par sagesse écologique sans doute. En des temps où chaque peuple vivait sur le territoire dont il était issu, cela n’empêchant pas les mouvements intraclimatiques, une certaine forme de cohérence collective préservait les fondamentaux de chaque civilisation, forcément adaptée aux contraintes naturelles irrépressibles qu’elle vivait. Les cités grecques, par exemple, ne cessaient de se faire la guerre avant que Rome ne leur apportât la Pax romana IIe siècle av. JC), mais elles prenaient soin d’éviter de le faire pendant la période des récoltes les obligeant à des luttes brèves et violentes. Ceci est à l’origine du modèle grec de la guerre. En outre, les peuples étaient isolés les uns des autres : mers, montagnes et déserts limitant les migrations interclimatiques. En Europe, cet équilibre fut transgressé. Cela a permis à cette civilisation d’envahir l’écosphère, de détruire les autres civilisations, mais pas les peuples. Or, ceux-ci réagissent maintenant à la fois par la démographie et par la technologie.
(…) Le rêve d’une société mondiale unifiée par un ordre marchand sous la tutelle des Etats-Unis s’effrite chaque jour. Des manifestations quotidiennes de ces fractures saturent la Toile. Ainsi, en avril 2011, Superman décidant de renoncer à sa nationalité américaine pour embrasser « la citoyenneté du monde » provoqua une réaction d’indignation d’Américains refusant la symbolique associée à cette mutation. Même dans la matrice de la Mondialisation, le peuple s’interroge sur l’abandon des identités d’essence nationale.
Aujourd’hui, l’alternative apparaît limpide, reléguant dans les oubliettes de l’Histoire tous les autres antagonismes. A la mondialisation capitaliste est opposée une approche plus particulariste, mais qui se cherche encore. Alors que le monde est pensé par l’oligarchie mondiale européenne comme unifié par la mondialisation, il est en train de se fractionner. Les contraintes de tous ordres, mais surtout celles relevant de l’écologie, vont imposer à chaque peuple, dans un monde de 10 milliards d’habitants maîtrisant tous la technologie, de réintégrer son espace d’évolution naturel. Cela permettra, d’une part, de limiter autant que faire se peut l’artificialisation des écosystèmes et, d’autre part, de bénéficier des atouts « militaires » que donne le fait de vivre sur son sol pour s’opposer à d’éventuelles tentatives de conquête de peuples exogènes. Tout cela est positif car au sentiment de supériorité européen va succéder un monde diversifié où chaque peuple inséré dans son écosystème d’origine limitera ainsi son artificialisation au niveau suffisant lui permettant de vivre. La paix durable voulue par la Modernité se réalisera par la PostModernité. La fameuse guerre des civilisations que nous promettent les uns et les autres est donc un leurre car elle n’est écologiquement pas possible.
Frédéric Malaval Polémia 26/03/2013