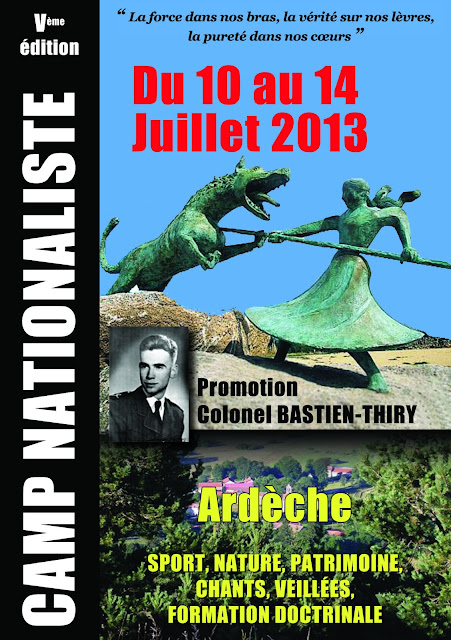Il est en fait bien connu de tous les historiens des idées, qui le considèrent en général comme le plus fidèle disciple de Georges Sorel, auteur des Réflexions sur la violence et des Illusions du progrès. Édouard Berth (1875-1939) a été l’un des principaux théoriciens du syndicalisme révolutionnaire, c’est-à-dire de cette branche du mouvement ouvrier qui, estimant que la classe ouvrière ne pouvait compter que sur elle-même pour instaurer la « société des producteurs », n’avait qu’hostilité pour les partis politiques et donnait la priorité à « l’action directe » (soit l’action sur les lieux de travail) développée par les syndicats. Ce sont les représentants les plus actifs de cette tendance révolutionnaire, Victor Griffuelhes et Émile Pouget, qui parvinrent, en octobre 1906, à faire adopter par la CGT la célèbre Charte d’Amiens que l’on considère aujourd’hui comme l’acte fondateur du syndicalisme français. Berth eut, par ailleurs, un itinéraire extrêmement original puisque, sans jamais abandonner ses convictions, il participa, à la veille de la Première Guerre mondiale, à l’aventure du Cercle Proudhon, où se rencontrèrent maurrassiens et syndicalistes révolutionnaires, puis s’enthousiasma vers 1920 pour la révolution russe, au point de collaborer régulièrement à la revue Clarté, fondée par Henri Barbusse. Revenu de son léninisme, il collabora jusqu’à sa mort à La Révolution prolétarienne de Pierre Monatte.
Ce qui frappe, c’est aussi le contraste entre socialisme d’antan, tout entier voué à la défense de la classe ouvrière, et Parti socialiste actuel. Ce PS est-il encore socialiste ?
En janvier 1905, le « règlement » de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) – Parti socialiste de l’époque – se présentait comme un « parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d’échange, c’est-à-dire de transformer la société capitaliste en société collectiviste, et pour moyen l’organisation économique et politique du prolétariat ». Allez donc demander aujourd’hui aux travailleurs de PSA, de Florange ou d’ArcelorMittal ce qu’ils pensent du « socialisme » de Hollande !
Qu’un dirigeant du PS, en l’occurrence Dominique Strauss-Kahn, ait pu être appelé à la direction du Fonds monétaire international (FMI) pour y mettre en œuvre la même politique que pratique aujourd’hui Christine Lagarde était déjà tout un symbole. Et maintenant ? Ni le mariage homosexuel, ni la légalisation du cannabis, ni la lutte pour la parité (sauf dans le mariage !), ni l’immigration incontrôlée, ni l’abolition des frontières, ni même la défense des « droits de l’homme » (dont Marx avait fait une critique impitoyable) ne sont évidemment des mesures « socialistes ». Ce sont des mesures libérales, censées répondre aux caprices et aux désirs individuels. Devenu un parti social-libéral – de plus en plus libéral et de moins en moins social –, le PS ne conçoit plus la société que comme une addition d’individus. C’est pour cela que le gouvernement actuel, privilégiant le sociétal au détriment du social, a choisi de faire diversion en cachant les cinq millions de chômeurs derrière le mariage pour tous.
Le bilan social-défaitiste de François Hollande est évident dans tous les domaines. De l’abandon de toute réforme fiscale d’envergure à l’absence de politique industrielle, de la révision du Code du travail dans le sens exigé par le MEDEF au chantage à l’emploi pour faire baisser les salaires – tandis que ceux des grands patrons ne seront finalement pas « encadrés » –, sans oublier la loi sur la « sécurisation de l’emploi » (sic), qui a signé l’arrêt de mort du contrat à durée indéterminée (CDI), chaque jour qui passe administre la preuve de la totale soumission de François Hollande aux exigences de la finance.
Rallié depuis au moins trente ans au système de l’argent, le PS est devenu un parti de fonctionnaires, de technocrates et de bobos ayant oublié le socialisme depuis belle lurette et ne s’intéressant qu’au « pourtoussisme », aux interventions « humanitaires » et à la défense des « victimes » sur le mode émotionnel et lacrymal. Ce n’est donc pas sur ses dirigeants qu’il faut compter pour expliquer que la crise actuelle est d’abord une crise du mode de production capitaliste, c’est-à-dire une crise généralisée de la logique de valorisation du capital, et moins encore pour tenter d’y remédier.
Comment expliquer cette évolution ? Passer d’un Édouard Berth à un DSK…
Ce qu’on appelle la « gauche » est né en France, à l’époque de l’affaire Dreyfus, de la fusion de deux courants totalement différents : une aspiration à la justice sociale portée par le mouvement ouvrier et une philosophie du progrès héritée des Lumières, que Sorel a justement définie comme fondamentalement bourgeoise. Le problème est que l’idéologie du progrès n’a que méfiance pour ce que Pasolini appelait la « force révolutionnaire du passé ». Or, le socialisme originel, s’il s’opposait bien entendu aux hiérarchies d’Ancien Régime, n’entendait nullement abolir les solidarités organiques traditionnelles ni s’attaquer aux fondements communautaires du lien social. Il contestait en revanche hautement l’idée libérale selon laquelle le marché, la logique de l’intérêt et le droit procédural suffiraient à faire tenir ensemble une société.
Dès les années 1980, la gauche, sous couvert de se « moderniser », a commencé à s’adapter aux modèles libéraux. Elle a, de ce fait, abandonné les idéaux du socialisme. Il lui reste la métaphysique du progrès, qu’elle partage avec la droite libérale. Dans ces conditions, le libéralisme sociétal de la gauche rejoint tout naturellement le libéralisme économique de la droite. Être de gauche, désormais, c’est adhérer à la logique de « l’antiracisme » et de la « lutte-contre-toutes-les-discriminations » pour masquer le fait que l’on a cessé d’être anticapitaliste.
Édouard Berth se faisait une idée « sublime » de la classe ouvrière, appelée selon lui à détruire le capitalisme bourgeois en reprenant à son compte les valeurs héroïques de l’Antiquité. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la gauche actuelle n’a pas le même rapport au peuple…
Le peuple et la gauche n’ont jamais été des notions équivalentes, comme on l’a vu lors des journées de juin 1848 et de la Commune de 1871, lorsque la gauche bourgeoise faisait tirer sur le peuple. Lisez le livre de Bertrand Rothé récemment paru aux Éditions du Seuil, De l’abandon au mépris, sous-titré Comment le PS a tourné le dos à la classe ouvrière. Le mot de mépris n’est pas exagéré. L’auteur explique très bien comment les élites du PS ont abandonné les ouvriers au nom de la modernité, et parfois aussi de la « préférence étrangère ». Éric Zemmour résume parfaitement la situation quand il écrit que « la gauche se croit aujourd’hui antilibérale alors que son obsession progressiste en fait la meilleure servante du marché », tandis que la droite s’imagine « défendre les valeurs traditionnelles alors que le marché, qu’elle admire, détruit ce qu’elle est censée défendre ». Le grand clivage actuel n’est plus celui qui oppose la droite et la gauche, mais celui qui oppose des classes populaires encore « territorialisées » à une nouvelle classe globalisée, engendrée elle-même par un néocapitalisme financiarisé et de plus en plus déterritorialisé. Cette nouvelle classe s’est formée sous l’effet d’une intensification des mobilités dans un climat marqué par la déréglementation des marchés et des innovations technologiques rétrécissant l’espace et le temps. Face à elle, la frustration des classes populaires, et celle des classes moyennes menacées de déclassement, pourrait bien devenir le moteur d’une nouvelle lutte des classes.