Des années 1950 aux années 1980, l'Afrique du Sud blanche avait réussi à devenir la puissance dominante de la partie méridionale du continent, bien au-delà de ses frontières. La Namibie dépendait directement de Pretoria ; la Rhodésie jusqu'à l'abandon de 1979 avait constitué un allié proche, comme les pouvoirs coloniaux portugais jusqu'aux indépendances chaotiques suivies de guerres civiles en 1975 en Angola et au Mozambique. Cette puissance régionale reconnue avait su construire une armée efficace, héritière des unités terrestres, aériennes, navales, formées durant la seconde guerre mondiale sous supervision britannique - hélas contre l'Allemagne idéologiquement plus proche-.
LE DÉTESTABLE SUICIDE DE L'AFRIQUE DU SUD BLANCHE
La rupture progressive avec Londres après 1945, avait donné l'occasion de développer une industrie militaire autonome, très capable, en particulier dans les armes légères, les véhicules rustiques, tel le célèbre Ratel, la production sous licence, souvent copie avec amélioration de matériels européens éprouvés, tel le char Centurion anglais, base de l'Olifant, ou le chasseur léger Mirage III français, base du Cheetah (guépard). L'entraînement, intensif et adapté, avait élevé l'armée sud-africaine à un niveau d'excellence, qui avait permis de contenir voire de vaincre, les troupes gouvernementales angolaises et cubaines, alors surarmées d'un matériel soviétique supérieur, dans les années 1980. Elle a possédé aussi en 1980 la bombe atomique. Significativement, il y a lieu de regretter la renonciation, au nom d'illisibles intérêts supérieurs d'équilibres, le refus volontaire d'emporter des victoires décisives notamment lors des multiples sièges de Cuito Canavale (dont celui célèbre de 1988) ; de même la Rhodésie blanche a nonobstant toutes les déclarations de soutien et les aides significatives antérieures été franchement abandonnée en 1979, prélude sinistre au naufrage de l'Afrique du Sud elle-même a posteriori.
Enfin, problème à la fois intérieur et extérieur, on regrettera le peu d'efficacité de la propagande favorable à une immigration blanche, alors que le Sud de l'Europe des années 1950 aux années 1970 émigrait encore massivement, tout comme le manque de sérieux relatif de la politique de regroupement des Noirs dans des bantoustans appelés à devenir des républiques noires indépendantes, laissant l'Afrique du Sud à sa composante blanche comme minorité menacée structurellement, avec au maximum 20 % de la population totale, contre moins de 10 % aujourd'hui.
Tous les pouvoirs marxistes de la région, après 1975 de Luanda à Maputo, puis Harare après 1980, ont eux apporté une aide efficace, constante, aux opposants noirs à l'Afrique du Sud, principalement l'ANC - Congrès National Africain -, conjuguant fort bien racisme de fait antiblanc et forte influence des théories marxistes, assumées au moins jusqu'au milieu des années 1990.
Malgré quelques limites nettes, dont sur le plan extérieur une dimension un peu velléitaire qui a fini par se payer très cher, il faut reconnaître la réussite globale du régime de l'Apartheid, la construction effective d'une vraie puissance régionale. Une excellente armée correspondait au développement d'une véritable économie nationale, vivant une intéressante expérience de semi-autarcie, en s'appuyant sur les riches ressources naturelles de l'Afrique du Sud, avec des pistes encore aujourd'hui d'avenir, comme la transformation du charbon en carburants, en remplacement du pétrole, selon le procédé Fischer-Tropsch.
Même si les pressions extérieures, trop mollement combattues, ont été indéniables, jusqu'à d'iniques sanctions économiques, non bénignes contrairement à la légende dans les années 1980, l'effondrement de la domination blanche en Afrique du Sud a correspondu à un effondrement moral intérieur, un suicide volontaire collectif. Nous déplorons philosophiquement le suicide à titre personnel au collectif, privilégiant la lutte jusqu'au dernier souffle. On ne répétera jamais assez la faiblesse intrinsèque de l'idéal démocratique, conduisant mécaniquement à des abandons selon les caprices des foules ; il est impossible de les sauver contre elles-mêmes lorsque leurs humeurs deviennent morbides, autodestructrices. Le Parti national a fini par organiser lui-même la fin de l'Apartheid ; le cœur du débat a été sur la renonciation totale et immédiate dès le milieu des années 1980, avec les ultralibéraux, ou le démantèlement par étapes, avec les libéraux, derrière Frederik de Klerk, qui n'en est pas moins un traître, le soutien populaire même blanc n'excusant rien. Ce dernier, homme-clef à partir du milieu des années 1980, a conclu le processus par sa présidence de l'Afrique du Sud de 1989 à 1994 ; il ne faut pourtant pas idéaliser la présidence précédente de Pieter Botha de 1978 à 1989, clair précurseur, qui avait démantelé de nombreuses lois essentielles de l'Apartheid, comme l'interdiction des mariages racialement mixtes, et mené déjà cette politique extérieure de retraits constants, sinon de capitulations systématiques. Parfois, l'extrême-droite, politique ou militaire, a le devoir de se saisir du pouvoir, ou du moins de tenter de le faire, même si la masse démocratique opine en faveur du suicide collectif - 68 % de oui pour la poursuite de la politique de destruction de l'apartheid en 1992 - ; nos amis d'Afrique du Sud n'ont rien tenté de concret, beaucoup misant à tort sur l'échec de négociations face à la maximaliste ANC, des promesses non-tenues, ou d'illusoires percées électorales avant la catastrophe finale.
LES REVERIES DE L'A.N.C. ET L'ÉCHEC COMPLET DE L'AFRIQUE DU SUD NOIRE
Nelson Mandela avait su construire, dès les années 1960, une image de héros de tous les hommes noirs, sinon tous les "opprimés" de la planète, avec le soutien massif des média occidentaux, champions de la haine du Blanc, et des propagandes des pays communistes. La complaisance a été quand même étonnante : non Mandela n'a nullement désapprouvé la lutte armée, ni même les attentats terroristes frappant des civils ou les infrastructures économiques essentielles du pays. Jim Reeves l'a déjà assez démontré avec constance dans Rivarol et Ecrits de Paris, mais il est bon de le rappeler tant est forte la prégnance de la propagande du Système encensant un prétendu "Gandhi" sud-africain, ignorant délibérément tous ses aveux postérieurs publics au nom du prétendu processus dit de « vérité et réconciliation », chasse asymétrique systématique aux anciens responsables blancs. Il faut lui reconnaître une certaine habileté dans la manipulation de ses partisans ou adversaires, la détermination dans sa volonté de se donner l'apparence d'un martyr, prisonnier volontaire embarrassant pour un régime sud-africain en décomposition délibérée... Il n'a accepté d'être relâché que contre la certitude d'accéder au pouvoir.
La très grande majorité des populations noires vote massivement pour le candidat noir, Mandela, donc président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Il symbolise. C'est son action essentielle. Il laisse d'autres gouverner dans son ombre tutélaire, de façon parfaitement détestable, transformant l’État en État-Parti, celui de l'A.N.C, contrôlant la politique comme jamais le Parti National du temps des Blancs. L'effondrement économique, prévisible, n'est que partiel à cause de la forte hausse des cours des matières premières dans la seconde moitié des années 1990 ; à l'exception d'une élite noire ANC kleptomane, le niveau de vie des Noirs stagne, tandis que celui des Blancs s'effondre. La criminalité explose. Toutefois l'Afrique du Sud est constamment louée par le Système, car elle incarne une forme d'utopie mondialiste à son échelle. Bien évidemment, elle ne fonctionne pas plus que le mondialisme à l'échelle globale. À la volonté d'exemplarité a été couplée celle de la responsabilité régionale, la "nouvelle" Afrique du Sud devant assurer une forme de puissance imposant la paix sur une Afrique troublée, au Sud du Sahara, ou du moins de l'équateur. Cette dernière ambition, avec le legs sans heurts de l'excellente armée des Blancs, n'est pas apparue sur le coup absurde.
L'Afrique d'après 1994 a donc pour ambition d'incarner une vitrine africaine des rêves maçonniques du Nouvel Ordre Mondial. Derrière l'icône Mandela, personne la plus décorée au monde, dont un « prix Nobel » en 1993, croulant littéralement sous les milliers de distinctions au point de finir par en refuser systématiquement de nouvelles, devait se construire un modèle de démocratie, de diversité ethnique, de société harmonieuse, avancée en pointe dans lutte "antidiscriminations" jusqu'aux droits explicites pour les minorités sexuelles - avec le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels en 2006 -. On a vu l'échec des mythiques progrès économique et social.
Ces droits formels ne correspondent à rien de réel. Les Blancs, en particulier les courageux fermiers demeurés sur leur terre, sont constamment massacrés par des bandits noirs, impunis, tandis que leurs complices s'emparent des propriétés, transformant un grenier à blé de l'Afrique en agriculture vivrière sinon désert ; une évolution de long terme semblable au Zimbabwe voisin est à craindre. Outre la persécution de fait des Blancs, dont un million aurait quitté le pays - aucune statistique officielle évidemment-, les affrontements ethniques entre Noirs causent des centaines de morts chaque années ; ils sont dissimulés dans les chiffres, énormes et pourtant sous-évalués de l'insécurité générale. Quant aux Noirs étrangers, ils sont souvent violemment chassés, là encore avec des centaines, sinon des milliers de morts. Les Noirs seraient-ils racistes, contre les Blancs, mais aussi entre leurs différentes ethnies ? Le discours sur la prétendue harmonie devient de plus en plus comique tant le décalage avec les réalités s'accroit. Les minorités sexuelles demeurent fort peu appréciés dans les quartiers noirs, là encore avec des centaines de meurtres annuels ; les discours spontanés indigènes continuent à qualifier le vice de Laïos de « maladie des Blancs » ; toute la propagande officielle n'a guère de prise. Évidemment, les « droits des femmes » sont promus ; toutefois ils coexistent difficilement avec les droits coutumiers traditionnels, totalement réhabilités : ainsi le président sud-africain Jacob Zuma (au pouvoir depuis 2009), s'affirme un ferme partisan des traditions bantoues, dont le mariage avec plusieurs femmes, le pratique personnellement. Mandela n'avait eu que de multiples épouses successives, dont les enfants s'opposent d'ailleurs les uns aux autres, tandis que Zuma, polygyne toujours, mais aux multiples divorces, offre des motifs d'amusement aux caricaturistes de son pays, dont il apprécie d'ailleurs peu l'humour - nombreux procès pour offense au chef de l’État-. Il en est résulté des difficultés protocolaires régulières lors des rencontres internationales.
L'échec de la vitrine est total. Durant la Coupe du Monde de 2010, la sélection nationale a effectué une prestation pitoyable selon les experts, à défaut du degré de comique de l'équipe de France, tout aussi mélanoderme. Quant à la grande politique étrangère, concrète, vaut-elle mieux ? Elle souffre déjà du sabotage continue de l'armée sud-africaine, très réduite en volume, hommes, moins de 50 000 militaires, comme matériels, privée des exceptionnelles compétences des officiers blancs systématiquement chassés, avec comme conséquence immédiate la disparition ou presque des éléments prometteurs d'industrie de défense autonome. Evidemment, la bombe atomique a été sacrifiée. Au final, l'armée de Pretoria compte quelques chasseurs légers suédois Grippen qui ne volent plus, comme les 4 frégates et 3 sous-marins qui ne naviguent plus. Les équipements terrestres ont vieilli de vingt ans, sans guère de remplacement - il ne reste qu'une trentaine de vieux chars -, tout comme la restreinte mais essentielle capacité de projection. Quelques hélicoptères d'attaque Rooivalk, une douzaine, excellent type développé à la fin de l'Apartheid, volent encore et forment l'essentiel de la capacité offensive du pays. Elle ne serait plus en mesure d'assurer en dernier recours l'ordre intérieur, quand bien même l'ANC le voudrait. Ancienne première armée d'Afrique, elle est aujourd'hui bien loin de l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, même derrière l'Angola et le Nigeria, voire l'Ethiopie et l'Erythrée. Une grande armée n'est plus que la milice de l'ANC.
En conséquence les initiatives diplomatiques de l'Afrique du Sud ne sont absolument plus prises au sérieux. Les multiples médiations au Zimbabwe voisin, ou même dans l'enclavé Swaziland, n'ont débouché sur rien. A fortiori, les accords de paix, multiples, au Burundi, ont échoué, tout comme ceux pour le Congo démocratique, signés solennellement à Sun City en 2003 en Afrique du Sud ; la guerre ravage toujours terriblement l'Est de cet État, avec la guérilla du M23 au Kivu, encore soutenu par le Rwanda. Récemment, en mars 2013, l'Afrique du Sud a été humiliée à Bangui par la coalition Seleka, à la force armée pourtant faible ; les bataillons sud-africain défendant la capitale sud-africaine au nom de l'ONU ont subi une claire défaite. Ils ont depuis été rapatriés en urgence.
Aussi, dans tous les domaines, l'ANC a échoué. Même le prélat noir anglican, icône de la lutte contre l'Apartheid et ancien fervent supporter de l'ANC, Desmond Tutu, vient d'annoncer en termes durs sa très forte déception. Pourtant par les lois de la démocratie, elle se maintiendra vraisemblablement au pouvoir ; aucun opposition cohérente n'est construite. L'affaiblissement possible de l'ANC profiterait d'ailleurs davantage à une extrême-gauche raciste antiblanche noire, partisane de la confiscation des biens des Blancs, voire des riches en général - élite-ANC comprise donc -, d'une forme de socialisme panafricain, plutôt qu'à des centristes mous libéraux qui chantent l'impossible « nation arc-en-ciel ».
Un éventuel effondrement de l’État-ANC, fort possible, surtout en cas d'entrée en un cycle, même court, de baisse des prix des produits primaires, s'il déboucherait dans l'immédiat sur une situation encore pire pour les Blancs, pourrait peut-être enfin permettre la création indispensable du Volkstaat Afrikaner. Cet État légitime, plus ou moins promis en 1994 par Mandela dans le cadre de son Afrique du Sud de la diversité, demeure sans aucune réalisation pour l'instant. Il n'existe que la très symbolique enclave d'Orania, de 2000 habitants. Ce Volkstaat regrouperait les 5 % de Blancs de langue afrikaner, soit 2,5 millions d'habitants potentiels, sauvés de la disparition dans la Tour de Babel ingérable de l'Afrique du Sud de l'ANC. Il prendrait place sur les territoires semi-désertiques quasiment vides d'une partie de l'Ouest de l'Afrique du Sud actuelle. Les Blancs anglophones, moins de 2 millions aujourd'hui, plus urbains, arrivés plus tard, assez facilement cosmopolites, émigrent le plus facilement, particulièrement vers l'Australie, et le flux s'amplifierait.
Scipion de SALM Rivarol du 31 mai 2013
culture et histoire - Page 1859
-
L’échec total de la volonté de puissance de l’Afrique du Sud de l’ANC
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, immigration, international 0 commentaire -
Tous les espoirs sont permis
"[...] Oui, cette mobilisation a ceci d'historique qu'elle a "révélé", au sens chimique du terme, la République : pas une institution "républicaine" qui, aujourd'hui, ne soit discréditée aux yeux des Français, lesquels assistent, en direct, à la décomposition d'un régime qui, tout en recourant au mensonge institutionnel pour imposer le mensonge anthropologique, est parallèlement devenu incapable de dissimuler les pratiques mafieuses qui n'ont cessé d'alimenter ses profiteurs, droite et gauche confondues. C'est désormais à la page des faits divers qu'il faut prendre connaissance de la vie politique française, et ce, comble de l'indécence ou de l'insouciance, alors que le chômage touche désormais de plein fouet cinq millions de nos compatriotes ! Certes, le pays légal peut respirer ! Paris ne vaut plus une messe puisque NKM a été élue candidate de la droite parlementaire aux municipales parisiennes et que le prochain maire sera de toute façon sociétaliste. Hollande peut continuer en toute tranquillité à racketter les familles pour rééquilibrer une branche famille qui n'est en déséquilibre que parce que l'État la pille allègrement, puisque l'opposition, d'accord sur le fond, fait le service minimum. L'Europe peut continuer à faire semblant de nous donner des leçons et de vouloir nous imposer ses "réformes", puisque nos élites dénationalisées ont déjà tout abdiqué ! N'empêche, retourner à ses occupations comme si rien ne s'était passé, ce serait ignorer ce qui frappe les observateurs les plus impartiaux : à savoir que ce n'est pas un pays réel vieilli et fatigué qui s'est levé et s'est mobilisé, et ne cesse désormais de veiller, mais la jeunesse même du pays, celle qui, assurément, ne vole, ne casse ni n'organise de tournantes - c'est pour ça qu'elle n'intéresse pas Taubira - mais qui, en revanche, est destinée, demain, à prendre les rênes du pouvoir. À côté de cette jeunesse-là, la quadra NKM paraît d'un autre siècle - d'un vingtième qui n'en finit plus de se liquéfier dans ses utopies permissives.
Tous les espoirs sont permis. Ils le sont parce que ces jeunes ont eu, finalement, la chance à leur premier engagement d'être confronté au vrai visage de Marianne. Ils ont en même temps appris et compris que les fameuses valeurs républicaines dont ils étaient bassinés depuis l'enfance dissimulaient un mensonge et une compromission, bref, une imposture de tous les instants, sur fond de corruption et d'indifférence aux malheurs réels des Français. Oui, ce qui s'est levé depuis six mois finira bien par croître et produire ses fruits car cette espérance repose sur des racines solides : celle d'un peuple qui, en dépit des attaques de toutes sortes - morales, intellectuelles, démographiques, sociales et avant tout spirituelles - dont il est l'objet depuis tant de décennies, continue de résister. C'est à cette résistance du peuple français contre la tyrannie de l'imposture qu'il convient de consacrer toutes ses forces. La résurrection est à ce prix."
-
Votre bel aujourd’hui de Charles Maurras
En mars 1952, Charles Maurras était emprisonné depuis sept ans et demi à la suite de sa condamnation pour avoir soutenu le maréchal Pétain sous l’Occupation. Malade. il avait été transféré de la maison centrale de Clairvaux à l’hôpital de Troyes et il allait bénéficier d’une grâce médicale accordée par le président de la République d’alors, le socialiste Vincent Auriol. À peine libéré et assigné à résidence à Saint-Symphorien-lès-Tours, il adressait à ce dernier une lettre où il estimait qu’ayant été emprisonné injustement, sa liberté lui était due et où il demandait la tête de François de Menthon, garde des Sceaux de l’Épuration, qui avait couvert les milliers d’exactions et de condamnations iniques qui avaient accompagné la libération du territoire. Cette lettre - qui prouvait que Maurras, malgré son âge (84 ans) n’avait rien perdu de sa pugnacité, fit grand bruit, au point de provoquer l’interpellation du gouvernement à l’Assemblée nationale le jour du Vendredi-Saint ! Mais Maurras ne fut pas remis en prison...
Un ton pédagogique
Votre Bel Aujourd’hui est une autre lettre - une « lettre fleuve » de cinq cents pages - adressée par le maître de l’Action française à Vincent Auriol. Elle est une réponse à un ouvrage écrit par celui-ci en 1943 : Hier-Demain qui se voulait une analyse des événements ayant conduit au désastre militaire de 1940 et une présentation de projets pour l’après-guerre.
Maurras s’empare de l’ouvrage qui, sans lui, serait bien oublié aujourd’hui, le décortique et le réfute point par point. Le ton n’est pas agressif, bien que vigoureux. Il serait plutôt pédagogue. Maurras démontre à Auriol l’inconsistance et la malfaisance des « nuées » que ses amis politiques et lui ont professées et quels malheurs elles ont attirés sur la France. Convaincu que parvenu au sommet de l’État, Vincent Auriol perçoit mieux les hautes nécessités nationales, Maurras l’incite à préparer l’accession du Comte de Paris au pouvoir en se faisant le restaurateur de la monarchie. La plume de Maurras est animée d’une telle flamme, d’une telle force de conviction que cette conclusion n’a rien d’incongru et s’impose naturellement.
Achevé d’écrire en avril 1950 à Clairvaux, Votre Bel Aujourd'hui ne fut publié qu’en 1953 après la mort de Maurras. L’ouvrage a le caractère d’un testament politique à plusieurs titres. D’abord il est nourri par l’immense culture de son auteur et l’expérience de toute sa vie politique. D’où une foule de références qui éclairent le propos de Maurras. Ensuite, celui-ci y développe les thèmes essentiels de sa pensée. Enfin, l’ouvrage est une illustration de la méthode intellectuelle de l’auteur : l’empirisme organisateur. Maurras écrit (p. 182) : « ... Je ne veux être ici que le greffier des choses ». Il laisse parler les événements ou plutôt, il tire des événements les vérités qu’ils contiennent, en pratiquant une induction rigoureuse.
De solides vérités
On ne peut rapporter toutes les solides vérités contenues dans cet ouvrage. Évoquons-en quelques unes. Ainsi Maurras écrit-il, après Joseph Calmette, que la République a accordé « plus d’attention aux remous intérieurs qu’à la situation extérieure ». D’où les déboires de sa politique dont la France a fait les frais.
Signalons aussi le refus du principe des nationalités et de l’égalité des nations. Le nationalitarisme revendicateur et agressif de certains peuples ne doit pas être confondu avec le nationalisme français, essentiellement défensif. C’est pourquoi en 2005, ajouterons-nous, l’Europe des États doit être préférée à « L’Europe des nations ».
Ou encore : « L’histoire de nos rois avère deux choses. En monarchie, l’institution est encore plus importante que la personne du monarque bien que celle-ci passe tout. Et puis, dans cette longue liste de personnages royaux, si divers, il y eut de grands rois, de très grands rois, qui avaient été des dauphins discutés comme Louis XI, ou des « Monsieurs » aussi douteux que le futur Louis XVIII, frère médiocre, beau-frère regrettable envers Louis XVI et Marie-Antoinette. Il s’est rangé depuis dans les Pères de la Patrie : La prétendance n’est pas le règne. La monarchie est bien, comme on l’a dit, un état d’esprit, mais cet esprit royal procède de ce qu’on peut appeler géométriquement sa position ». Ce point est essentiel. L’homme le plus intelligent, le plus dévoué à l’intérêt public serait-il placé au sommet de l’État, il ne pourra réaliser une œuvre durable et efficace s’il ne dispose que d’un pouvoir éphémère et controversé.
Les deux cent vingt premières pages de Votre Bel Aujourd’hui sont consacrées à dénoncer la malfaisance de l’Idée révolutionnaire et à stigmatiser la légèreté des hommes qui l’ont incarnée. À la patrie idéologique chère aux socialistes, Maurras oppose la patrie concrète et il montre comment les intérêts de celle-ci ont été sacrifiés à l’idéologie démocratique. Ainsi sont survenues la catastrophe de 1940, puis la révolution de 1944. Maurras met le doigt sur les crimes de l’Épuration et les gabegies des débuts de la IVe République. Le « Demain » prophétisé par Vincent Auriol s’avère désastreux sur le plan moral, politique, social, économique.
Les Biens publics de la France
Dans la dernière partie de son ouvrage, Maurras met en évidence les quatre « Biens publics de la France » dont il démontre qu’à l’avenir ils ne pourront être assurés que par la monarchie : 1) la sauvegarde de l’indépendance nationale : l’État non envahi. 2) la restitution au peuple de ses libertés au sein d’un État organique. Il n’y a pas de contradiction foncière entre l’État et les « États » c’est-à-dire les libertés locales, régionales, professionnelles, si leurs domaines respectifs sont définis. 3) La Justice, dont tant de bons Français, victimes du terrorisme - sous le masque de la Résistance - et de l’Épuration ont été privés au cours d’une guerre civile dont la France subit encore les séquelles. Hélas, il n’y a pas eu de roi pour promouvoir la réconciliation nationale. 4) La concorde entre les citoyens. Maurras le répète : « Les nations sont des amitiés ». Il faut rejeter la haine entre les classes.
À la fin de sa lettre fleuve, Maurras aborde encore trois questions qui faisaient l’objet de débats il y a un demi-siècle : l’Europe, marquée par la permanence des nations ; l’union franco-allemande, dont on parlait déjà comme le moyen de réconcilier les deux peuples, mais dont Maurras montre les dangers ; enfin la bombe atomique dont il pense que la France doit se doter pour assurer sa défense et maintenir son rôle dans le monde.
Nous ne savons pas comment Vincent Auriol, dont le mandat de président de la République expira en décembre 1954, a réagi à la lettre géante de Maurras. Son successeur, René Coty, ne fut élu qu’après treize tours de scrutin. La IVe République annonçait - déjà - son déclin.
Pierre Pujo LAction Française 2000 du 15 décembre 2005 au 4 janvier 2006
* Librairie Arthème Fayard, 1953. -
Jean Thiriart : prophète et militant
"J'écris pour une espèce d'hommes qui n'existe pas encore, pour les Seigneurs de la Terre..."
(F. Nietzsche, La Volonté de puissance).
La disparition soudaine de Jean Thiriart a été pour nous comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, pour nous, militants européens qui, au cours de plusieurs décennies successives, ont appris à apprécier ce penseur de l'action, surtout depuis son retour à la politique active, après bon nombre d'années d'"exil intérieur" où il a médité et reformulé ses positions antérieures.
A plus forte raison, sa mort nous a surpris, nous, ses amis italiens qui l'avions connu personnellement lors de son voyage à Moscou en août 1992, où nous formions de concert une délégation ouest-européenne auprès des personnalités les plus représentatives du Front du Salut National. Ce front, grâce aux travaux de l'infatigable Alexandre Douguine, animateur mystique et géopolitique de la revue Dyenn (Le Jour), a appris à connaître et à estimer bon nombre d'aspects de la pensée de Thiriart et les a diffusés dans les pays de l'ex-URSS et en Europe orientale.
Personnellement, j'ai l'intention, dans les lignes qui suivent, d'honorer la mémoire de Jean Thiriart en soulignant l'importance que sa pensée a eue et a toujours dans notre pays, l'Italie, dès les années 60 et 70 et dans le domaine de la géopolitique. En Italie, sa réputation repose essentiellement sur son livre, le seul qui ait véritablement donné une cohérence organique à sa pensée dans le domaine de la politique internationale: Un Empire de 400 millions d'hommes, l'Europe, édité par Giovanni Volpe en 1965, il y a près de trente ans.
Trois années seulement venaient de se passer depuis la fin de l'expérience française en Algérie. Cet événement dramatique fut la dernière grande mobilisation politique de la droite nationaliste, non seulement en terre de France, mais dans d'autres pays d'Europe, y compris en Italie. Les raisons profondes de la tragédie algérienne n'ont pas été comprises par les militants anti-gaullistes qui luttaient pour l'Algérie française. Ils n'ont pas compris quels étaient les enjeux géopolitiques de l'affaire et que les puissances victorieuses de la seconde guerre mondiale entendaient redistribuer les cartes à leur avantage, surtout les Etats-Unis.
Combien de ces militants de l'Algérie française ont-ils compris, à cette époque-là, quel était l'ENNEMI PRINCIPAL de la France et de l'Europe? Combien de ces hommes ont-ils compris intuitivement que, sur le plan historique, la perte de l'Algérie, précédée de la perte de l'Indochine, tout comme l'effondrement de tout le système vétéro-colonial européen, étaient des conséquences directes de la défaite militaire européenne de 1945 ? Ce fut en effet non seulement une défaite de l'Allemagne et de l'Italie, mais aussi de l'EUROPE ENTIERE, Grande-Bretagne et France comprises. Pas une seule colonie de l'ancien système colonial qui ne soit devenue à son tour sujette d'une forme nouvelle, plus moderne et plus subtile, d'impérialisme néo-colonialiste.
En méditant les événements de Suez (1956) et d'Algérie, les "nationaux-révolutionnaires", comme ils s'appelaient eux-mêmes, finirent par formuler diverses considérations et analyses sur les conséquences de ces deux affaires tragiques, considérations et analyses qui les différenciaient toujours davantage des "droites classiques" de notre après-guerre, animées par un anti-communisme viscéral et par le slogan de la défense de l'Occident, blanc et chrétien, contre l'assaut conjugué du communisme soviétique et des mouvements de libération nationaux des peuples de couleur du tiers monde. En un certain sens, le choc culturel et politique de l'Algérie peut être comparée à ce que fut, pour la gauche, l'ensemble des événements d'Indochine, avant et après 1975.
La vieille vision de la politique internationale était parfaitement intégrée à la stratégie mondiale, économique et géopolitique de la thalassocratie américaine qui, avec la guerre froide, avait réussi à recycler les diverses droites européennes, les fascistes comme les post-fascistes (ou du moins prétendues telles), en fonction de son projet géostratégique de domination mondiale. Le tout pour en arriver aujourd'hui au "Nouvel Ordre Mondial", déjà partiellement avorté et qui semble être la caricature inversée et satanique de l'"Ordre Nouveau" eurocentré de mouture hitlérienne.
La Nouvelle Droite française, pour ne donner qu'un exemple, a commencé son cheminement au moment des événements d'Algérie pour entamer une longue marche de révision politique et idéologique, qui a abouti au voyage récent d'Alain de Benoist à Moscou, étape obligatoire pour tous les opposants révolutionnaires d'Europe au système mondialiste. La démarche a donc été faite par de Benoist, en dépit de ses rechutes et de ses reniements ultérieurs, appuyés par quelques-uns de ses plus minables affidés, lesquels n'ont évidemment pas encore compris pleinement la portée réelle de ces rencontres entre Européens de l'Ouest et Russes au niveau planétaire et préfèrent se perdre dans de stériles querelles de basse- cour, qui n'ont d'autres motivations que personnelles, relèvent de petites haines et de petits hargnes idiosyncratiques. Dans ce domaine comme tant d'autres, Thiriart avait déjà donné l'exemple, en opposant aux différences naturelles existant entre les hommes et les écoles de pensée l'intérêt suprême de la lutte contre l'impérialisme américain et le sionisme.
Pour revenir à l'Italie, nous devons nous rappeler la situation qui régnait en cette lointaine année 1965, quand a paru l'oeuvre de Thiriart: les forces national-révolutionnaires, encore intégrées au Mouvement Social Italien (MSI), étaient alors victimes d'un PROVINCIALISME vétéro-fasciste, provincialisme cyniquement utilisé par les hiérarques politiques du MSI, complètement asservis à la stratégie des Etats-Unis et de l'OTAN (une ligne politique qui sera par la suite suivie avec fidélité, même au cours de la brève parenthèse de la gestion "rautiste", soi-disant inspirée des thèses national-révolutionnaires de Pino Rauti, gestion qui a appuyé l'intervention des troupes italiennes en Irak, aux côtés de l'US Army).
Les chefs de cette droite collaborationniste utilisaient les groupes révolutionnaires de la base, composés essentiellement de très jeunes gens, pour créer des assises militantes destinées, en ultime instance, à ramasser les voix nécessaires à envoyer au parlement des députés "entristes", devant servir d'appui aux gouvernements réactionnaires de centre-droit. Et tout cela, bien sûr, non dans l'intérêt de l'Italie ou de l'Europe, mais seulement dans celui de la puissance occupante, les Etats-Unis. Et une fois de plus, nous avons affaire à un petit nationalisme centralisateur et chauvin, utilisé au profit d'intérêts étrangers et cosmopolites!
C'était aussi le temps où l'extrême-droite était encore capable de mobiliser sur les places d'Italie des milliers de jeunes qui réclamaient que Trente et Trieste soient et restent italiennes, ou pour commémorer chaque année les événements de Hongrie de 1956! Mai 68 était encore loin, semblait s'annoncer à des années-lumière de distance! La droite italienne, dans ses prospections, ne voyait pas que cette "révolution" s'annonçait. Dans un tel contexte humain et politique, vétéro-nationaliste, provincial et, en pratique, philo-américain (qui débouchera ensuite dans la farce pseudo-golpiste de 1970, qui aura pour conséquence, au cours de toute la décennie, les tristement célèbres "années de plomb", avec leur cortège de crimes d'Etat), l'oeuvre de Jean Thiriart fit pour un grand nombre de nationalistes l'effet d'une bombe; un choc électrique salutaire qui mit l'extrémisme nationaliste botté face à des problématiques qui, certes, n'étaient pas neuves, mais avaient été oubliées ou étaient tombées en désuétude. Aujourd'hui, nous ne pouvons donc pas ne pas tenir compte des effets politiques pratiques qui découlèrent de la pensée de Thiriart, même si ces effets, dans un premier temps, ont été fort modestes. Disons qu'à partir de la publication du livre de Thiriart, la thématique européenne est devenue petit à petit le patrimoine idéal de toute une sphère qui, dans les années suivantes, développera les thématiques anti-mondialistes actuelles.
Sans exagération, nous pouvons affirmer que c'est vers cette époque que se sont développés les thèmes de l'Europe-Nation, d'une lutte anti-impérialiste qui ne soit pas de "gauche", de l'alliance géostratégique avec les révolutionnaires du tiers monde. L'adoption de ce thème est d'autant plus étonnante et significative quand on sait que l'aventure de Jeune Europe a commencé par une lutte contre le FLN algérien. Thiriart avait, sur ce plan, changé complètement de camp, sans pour autant changer substantiellement de vision du monde, lui qui, quelques décennies auparavant, avait quitté les rangs de l'extrême-gauche belge pour adhérer à la collaboration avec le III° Reich germanique, sans pour autant perdre de vue le facteur URSS. Ces acrobaties politico-idéologiques lui ont valu les accusations d'"agent double", toujours aux ordres de Moscou!
En Italie, la section italienne de Jeune Europe (Giovane Europa) est rapidement mise sur pied. Malgré l'origine politique de la plupart des militants, Giovane Europa n'avait aucune filiation directe avec Giovane Italia, l'organisation étudiante du MSI (copiée à son tour de la Giovine Italia de Mazzini au 19° siècle); au contraire, Giovane Europa en était pratiquement l'antithèse, l'alternative contraire. Si bien qu'une fois l'expérience militante de "Giovane Europa" terminée, la plupart de ses militants se sont retrouvés dans le Movimento Politico Ordine Nuovo (MPON), opposé à la ligne politique prônant l'insertion parlementaire, comme le voulaient les partisans de Pino Rauti, retournés dans les rangs du MSI d'Almirante.
Si l'on tient compte du rôle UNIQUE qu'a joué la pensée de Julius Evola sur les plans culturel et idéologique en Italie, on ne doit pas oublier non plus que Jean Thiriart a impulsé, pour sa part, une tentative unique de rénovation des forces nationales dans ces années-là et dans les années qui allaient venir. Même un Giorgio Freda a reconnu lui-même ses dettes, sur le plan des idées, envers le penseur et le militant belge.
Autre aspect particulier et très important du livre Un Empire de 400 millions d'hommes, l'Europe, c'est d'avoir anticipé, de plusieurs décennies, une thématique fondamentale, revenue récemment dans le débat, notamment en Russie, grâce aux initiatives d'Alexandre Douguine et de la revue Dyenn, et en Italie, grâce aux revues ORION et AURORA: la GEOPOLITIQUE.
La première phrase du livre de Thiriart, dans la version italienne, est dédiée justement à cette science essentielle qui a pour objets les peuples et leurs gouvernements, science qui avait dû subir, dans notre après-guerre, un très long ostracisme, sous prétexte d'avoir été l'instrument de l'expansion nazie! Accusation pour le moins incongrue quand on sait qu'à Yalta les vainqueurs se sont partagés les dépouilles de l'Europe et du reste du monde sur base de considérations proprement géopolitiques et géostratégiques. Thiriart en était parfaitement conscient, en écrivant son premier chapitre, significativement intitulé "De Brest à Bucarest. Effaçons Yalta": "Dans le contexte de la géo-politique et d'une civilisation commune, ainsi qu'il sera démontré plus loin, l'Europe unitaire et communautaire s'étend de Brest à Bucarest". En écrivant cette phrase, Thiriart posait des limites géographiques et idéales à son Europe, mais bientôt, ils dépassera ces limites, pour arriver à une conception unitaire du grand espace géopolitique qu'est l'EURASIE.
Une fois de plus, Thiriart a démontré qu'il était un anticipateur lucide de thèmes politiques qui ne mûrissent que très lentement chez ses lecteurs, du moins certains d'entre eux...
Mais il n'y a pas que cela!
Conjointement au grand idéal de l'Europe-Nation et à la redécouverte de la géopolitique, le lecteur est obligé de jeter un regard neuf sur les grands espaces de la planète. Ce fut un autre mérite de Thiriart d'avoir dépasser le traumatisme européen de l'ère de la décolonisation et d'avoir recherché, pour le nationalisme européen, une alliance stratégique mondiale avec les gouvernements du tiers monde, non asservis aux impérialismes, en particulier dans la zone arabe et islamique, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il est vrai que ceux qui découvrent la géopolitique, ne peuvent plus faire autrement que de voir les événements du monde sous une lumière nouvelle, prospective.
Et c'est dans un tel contexte, par exemple, qu'il faut comprendre les nombreux voyages de Thiriart en Egypte, en Roumanie, etc., de même que ses rencontres avec Chou en Lai et Ceaucescu ou avec les leaders palestiniens. Partout où il était possible de le faire, Thiriart cherchait à tisser un réseau d'informations et d'alliances planétaires dans une perspective anti-impérialiste. Par ailleurs, notons tout de même que la révolution cubaine, avec son originalité, exerçait de son côté sa propre influence.
Avec son style synthétique, presque télégraphique, Thiriart lui-même avait tracé dans ses textes les lignes essentielles de la politique extérieure de la future Europe unie: "Les lignes directives de l'Europe unitaire: avec l'Afrique: symbiose avec l'Amérique latine: alliance avec le monde arabe: amitié avec les Etats-Unis: rapports basés sur l'égalité".
Mise à part l'utopie qu'était son espoir en des rapports égaux avec les Etats-Unis, on notera que sa vision géopolitique était parfaitement claire: il voulait de grands blocs continentaux et était très éloigné de toute vision étriquée d'une petite Europe "occidentale et atlantique" qui, comme celle d'aujourd'hui, n'est plus que l'appendice oriental de la thalassocratie yankee, ayant pour barycentre l'Océan Atlantique, réduit à la fonction de "lac intérieur" des Etats-Unis.
Bien sûr, aujourd'hui, après l'aventure politique de Thiriart, certaines de ces options géopolitiques, dans le milieu "national", pourraient sembler évidentes, voire banales, pour les uns, simplistes et intégrables pour d'autres. Mais mis à part le fait que tout cela n'est guère clair pour l'ensemble des "nationaux" (il suffit de penser à certaines résurgences racistes/biologistes et anti-islamiques d'un pseudo-néo-nazisme, utilisées et instrumentalisées par la propagande américaine et sioniste dans un but anti-européen), nous ne nous lasserons pas de répéter qu'il y a trente ans, cette option purement géopolitique de Thiriart, vierge de toutes connotations racistes, était très originale et courageuse, dans un monde bipolaire, opposant en apparence deux blocs idéologiques et militaires antagonistes, dans une perspective de conflictualité "horizontale" entre Est et Ouest et sous la menace de l'anéantissement nucléaire réciproque, surtout pour les "alliés" des deux puissances majeures en Europe.
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que si bon nombre d'entre nous, en Italie, en sont arrivés progressivement à dépasser cette fausse vision dichotomique de la conflictualité planétaire, et cela bien avant l'effondrement de l'URSS et du bloc soviétique, c'est dû en bonne partie à la fascination qu'ont exercée les thèses que propageait Thiriart à l'époque, à ses intuitions géniales.
Effectivement, on peut parler de "génialité", en politique comme dans tous les autres domaines du savoir humain, quand on PRE-VOIT et que l'on EX-POSE (du latin exponere, poser en dehors, mettre en exergue ou en évidence) des faits ou des événements qui sont encore occultés, méconnus, peu clairs pour les autres et qui ne se dégagent de leur phase occulte que graduellement pour n'advenir au monde en pleine lumière que dans un futur plus ou moins lointain.
Sur ce chapitre, nous voulons simplement rappeler les assertions de Thiriart relatives à la dimension géopolitique du futur Etat européen, consignées dans le chapitre (10, 1) intitulé "Les dimensions de l'Etat européen. L'Europe de Brest à Vladivostock" (pp. 28 à 31 de l'éd. franç.): "L'Europe jouit d'une grande maturité historique, elle connaît désormais la vanité des croisades et des guerres de conquêtes vers l'Est. Après Charles XII, Bonaparte et Hitler, nous avons pu mesurer les risques de pareilles entreprises et leur prix. Si l'URSS veut conserver la Sibérie, elle doit faire la paix avec l'Europe ‹ avec l'Europe de Brest à Bucarest, je le répète. L'URSS n'a pas et aura de moins en moins la force de conserver à la fois Varsovie et Budapest d'une part, Tchita et Khabarovsk d'autre part. Elle devra choisir ou risquer de tout perdre" (les caractères italiques sont dans le texte).
Plus loin: "Notre politique diffère de celle du général De Gaulle parce qu'il a commis ou commet trois erreurs: - faire passer la frontière de l'Europe à Marseille et non à Alger; - faire passer la frontière du bloc URSS/Europe sur l'Oural et non en Sibérie; - enfin, vouloir traiter avec Moscou avant la libération de Bucarest" (p. 31).
A la lecture de ces deux brefs extraits, on ne peut plus dire que Jean Thiriart manquait de perspicacité et de prévoyance! Or ces phrases ont été écrites, répétons-le, à une époque où les militants sincèrement européistes, même les plus audacieux, parvenaient tout juste à concevoir une unité européenne de Brest à Bucarest, c'est-à-dire une Europe limitée à la plate- forme péninsulaire occidentale de l'Eurasie; pour Thiriart, elle ne représentait déjà plus qu'une étape, un tremplin de lancement, pour un projet plus vaste, celui de l'unité impériale continentale. Qu'on ne nous parle plus, dès lors, des droites nationalistes, y compris celles d'aujourd'hui, qui ne font que répéter à l'infini leur provincialisme, sous l'oeil bienveillant de leur patron américain.
Il y a trente ans déjà, Thiriart allait plus loin: il dénonçait toute l'absurdité géopolitique du projet gaulliste (De Gaulle étant un autre responsable direct de la défaite de l'Europe, au nom du chauvinisme vétéro-nationaliste de l'Hexagone) d'une Europe s'étendant de l'Atlantique à l'Oural, faisant sienne, du même coup, cette vision continentale absurde, propre aux petits professeurs de géographie, qui trace sur le papier des cartes une frontière imaginaire à hauteur des Monts Ourals, qui n'ont jamais arrêté personne, ni les Huns ni les Mongols ni les Russes.
L'Europe se défend sur les fleuves Amour et Oussouri; l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe plus la Russie, a un destin clairement dessiné par l'histoire et la géopolitique en Orient, en Sibérie, dans le Far East de la culture européenne, et ce destin l'oppose au West de la civilisation américaine du Bible and Business. Quant à l'histoire des rencontres et des confrontations entre les peuples, ce n'est rien d'autre que de la GEOPOLITIQUE EN ACTE, tout comme la géopolitique n'est rien d'autre que le destin historique des peuples, des nations, des ethnies et des empires, voire des religions, en PUISSANCE. En passant, nous devons ajouter que la conception de Jean Thiriart, pour autant qu'elle ait été encore liée aux modèles "nationalistes" influencés par la France révolutionnaire, était finalement plus "impériale" qu'impérialiste. Il a toujours refusé, jusqu'à la fin, l'hégémonie définitive d'un peuple sur tous les autres.
L'Eurasie de demain ne sera pas plus russe qu'elle ne sera mongole, turque, française ou germanique: car quand tous ces peuples ont voulu exercer seuls leur hégémonie, ils ont échoué. Echecs qui devraient nous avoir servi d'enseignement.
Qui pouvait, il y a trente ans, prévoir avec autant de précision la faiblesse intrinsèque de ce colosse militaro-industriel qu'était l'URSS, qui semblait à l'époque lancée à la conquête de toujours plus de nouveaux espaces, sur tous les continents, en âpre compétition avec les Etats-Unis qu'elle allait bientôt dépasser ?
Avec le temps, finalement, tout cela s'est révélé un gigantesque bluff, un mirage historique probablement fabriqué de toutes pièces par les forces mondialistes de l'Occident pour maintenir les peuples dans la servitude, avec, à la clef, un chantage constant à la terreur. Tout cela pour manipuler les peuples et les nations de la Terre au bénéfice de l'intérêt stratégique suprême, unique, posé comme seul "vrai": celui de la superpuissance planétaire que sont les Etats-Unis, base territoriale armée du projet mondialiste. En fin de compte, pour parler le langage de la géopolitique, c'est la "politique de l'anaconda" qui a prévalu, comme la définissait hier, avec les mêmes mots, le géopoliticien allemand Haushofer, et la définissent aujourd'hui les géopoliticiens russes, à la tête desquels officie le Colonel Morozov; les Américains et les mondialistes cherchent toujours à éloigner le pivot territorial de l'Eurasie de ses débouchés potentiels sur les mers chaudes, avant de grignoter petit à petit le territoire de la "tellurocratie" soviétique. Le point de départ de cette stratégie de grignotement: l'Afghanistan.
Jean Thiriart avait déjà mis en lumière, dans son livre de 1965, les raisons brutes et crues qui animaient la politique internationale. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que l'un de ses modèles était Machiavel, auteur du Prince.
Certes, nous diront les pessimistes, si le Thiriart analyste de la politique a su anticiper et prévoir, le Thiriart militant, organisateur et chef politique du premier modèle d'organisation transnationale européiste, a failli. Soit parce que la situation internationale d'alors n'était pas encore suffisamment mûre (ou pourrie), comme nous le constatons aujourd'hui, soit parce qu'il n'y a pas eu de "sanctuaire" de départ, comme Thiriart l'avait jugé indispensable. En effet, il a manqué à Jeune Europe un territoire libre, un Etat complètement étranger aux conditionnements imposés par les superpuissances, qui aurait pu servir de base, de refuge, de source d'approvisionnement pour les militants européens du futur. Un peu comme le fut le Piémont pour l'Italie.
Toutes les rencontres de Thiriart au niveau international visaient cet objectif. Toutes ont échoué. Réaliste, Thiriart a renoncé à l'engagement politique, au lieu de reprendre son discours et d'attendre que l'occasion se représente, et même une meilleure occasion, celle d'avoir un grand pays auquel il aurait pu proposer sa stratégie: la Russie. Le destin de ce citoyen belge de naissance mais Européen de vocation a été étrange: il a toujours été "hors du temps", surpris par les événements. Il les a toujours prévus mais a toujours été dépassé par eux.
Sa conception de la géopolitique eurasienne, sa vision qui désigne GLOBALEMENT les Etats-Unis comme l'ennemi OBJECTIF absolu, pourraient être perçues comme les indices d'un "visionarisme" illuminé, freiné seulement par un esprit rationnel cartésien, et rationalisé en ultime instance.
Son matérialisme historique et biologique, son nationalisme européen centralisateur et totalisant, sa fermeture à l'endroit de thématiques écologiques et animalistes, ses positions personnelles face aux spécificités ethno-culturelles, son hostilité de principe à tout pathos religieux, son ignorance de toute dimension métapolitique, son admiration pour le jacobinisme de la Révolution française, pierre d'achoppement pour bon nombre d'anti-mondialistes francophones: tout cela constituait des limites à sa pensée et des résidus de conceptions vétéro-matérialistes, progressistes et darwiniennes, de plus en plus éloignées des choix culturels, religieux et politiques contemporains, chez les hommes et les peuples engagés, dans toute l'Eurasie et dans le monde entier, dans la lutte contre le mondialisme. Les idées "rationalistes", que Thiriart faisait siennes, au contraire, ont été l'humus culturel et politique sur lequel le mondialisme a germé au cours des siècles passés. Ces aspects de la pensée de Thiriart ont révélé leurs limites, pendant les derniers mois de son existence, notamment lors des colloques et conversations de Moscou en août 1992. Son développement intellectuel semblait s'être définitivement arrêté à l'époque de l'historicisme linéaire et progressiste, avec sa mythologie d'un "avenir radieux pour l'humanité".
Une telle vision rationaliste ne lui permettait pas de comprendre des phénomènes aussi importants que le réveil islamique ou le nouveau "mysticisme" eurasiste russe, ainsi que leur projections politiques d'une teneur hautement révolutionnaire et anti-mondialiste. Et ne parlons même pas de l'impact des visions traditionalistes d'un Evola ou d'un Guénon. Thiriart véhiculait donc cet handicap "culturel", ce qui ne nous a pas empêché de nous retrouver à Moscou en août 1992, où nous avons cueilli au vol ses innombrables intuitions politiques.
Quelques-unes de ces intuitions ont fait qu'il s'est retrouvé aux côtés de jeunes militants européens pour aller rencontrer les protagonistes de l'avant-garde "eurasiste" du Front du Salut National russe, rassemblés autour de la revue Dyenn et du mouvement du même nom. Nous avons découvert, ainsi, dans la capitale de l'ex-empire soviétique qu'il avait été parfaitement reconnu comme un penseur d'avant-garde par les Russes. Les enseignements géopolitiques de Thiriart ont germé en Russie, c'est indubitable, alors qu'en Occident ils ont toujours été méconnus voire méprisés. Thiriart a eu un impact lointain, dans les immensités glacées de la Russie-Sibérie, dans le coeur du Vieux Monde, près du pivot central de la tellurocratie eurasiatique.
Est-ce une ironie de l'histoire des doctrines politiques, qui surgit au moment de leur actualisation pratique ou est-ce la ennième confirmation de cet adage antique, "nul n'est prophète en son pays"? Le long "exil intérieur" de Thiriart semblait donc terminé, il s'était retiré de la politique active pour toujours et avait surmonté ce retrait qui, au départ, avait été une grosse déception. Il nous inondait de documents écrits, de comptes rendus d'interventions orales. Le flot ne semblait jamais devoir s'arrêter! Comme s'il cherchait à rattraper le temps qu'il avait perdu dans un silence dédaigneux.
Mu par un enthousiasme juvénile, parfois excessif et agaçant, Thiriart se remettait à donner des leçons d'histoire et de géopolitique, de sciences exactes et de politologie, de droit et toutes autres disciplines imaginables, aux généraux et aux journalistes, aux parlementaires et aux écrivains, aux politiciens de l'ex-URSS et aux militants islamiques de la CEI, et aussi, bien sûr, à nous, les Italiens présents qui avions, en même temps que lui, connu des changements d'opinion, en apparence inattendus. Et tout cela s'est passé dans la Russie d'aujourd'hui, où tout est désormais possible et rien n'est certain (et qui pourra être, qui sait, la Russie d'hier, quand cet article paraîtra); nous avons en effet affaire à une Russie suspendue entre un passé glorieux et un futur ténébreux, mais grosse de potentialités inimaginables. C'est là-bas que Jean Thiriart a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Dans une ville de Moscou qui survit au jour le jour entre l'apathie et la fébrilité, semblant attendre "quelque chose" dont on ne connaît encore ni le nom ni le visage; une ville où tout se passe, où tout peut se passer comme dans une dimension spéciale, entre ciel et terre. De la terre russe tout et le contraire de tout peut jaillir: le salut et l'extrême perdition, la renaissance ou la fin, une nouvelle puissance ou la désintégration totale d'un peuple qui fut impérial et est devenue, aujourd'hui, une plèbe misérable. Enfin, c'est là, et là seulement, que se joue le destin de tous les peuples européens et, en définitive, de la planète Terre. L'alternative est bien claire: ou nous aurons un nouvel empire eurasiatique qui nous guidera dans la lutte de libération de TOUS les peuples du globe ou nous assisterons au triomphe du mondialisme et de l'hégémonisme américain pour tout le prochain millénaire. C'est là-bas que l'écrivain et homme politique Jean Thiriart avait retrouvé l'ESPOIR de pouvoir mettre en pratique ses intuitions du passé, cette fois à une échelle bien plus vaste.
Dans cette terre de Russie, d'où peut surgir le messie armé des peuples d'Eurasie, nouvel avatar d'un cycle de civilisation ou Antéchrist des prophéties johanniques, nous aurons un espace pour toutes les alchimies et les expériences politiques, inconcevables si on les regarde avec des yeux d'Occidental. La Russie actuelle est un immense laboratoire, une terre politiquement vierge que l'on pourra féconder de greffons venus de loin, une terre vierge où la LIBERTE et la PUISSANCE vont se chercher pour s'accoupler et tenter de nouvelles synthèses: "Le chemin de la liberté passe par celui de la puissance", soulignait Thiriart dans son livre fondamental, "Il ne faudrait donc pas l'oublier, ou il faudrait l'apprendre à ceux qui l'ignorent. La liberté des faibles est un mythe vertuiste, une ingénuité à utilisation démagogique ou électorale. Les faibles n'ont jamais été libres et ne le seront jamais. Seule existe la liberté des forts. Celui qui veut être libre, doit se vouloir puissant. Celui qui veut être libre doit être capable d'arrêter d'autres libertés, car la liberté est envahissante et a tendance à empiéter sur celle des voisins faibles". Ou encore: "Il est criminel du point de vue de l'éducation politique de tolérer que les masses puissent être intoxiquées par des mensonges affaiblissants comme ceux qui consistent à "déclarer la paix" à ses voisins en s'imaginant ainsi pouvoir conserver sa liberté. Chacune de nos libertés a été acquise à la suite de combats répétés et sanglants et chacune d'entre elles ne sera maintenue que si nous pouvons faire étalage d'une force susceptible de décourager ceux qui voudraient nous en priver. Plus que d'autres, nous aimons certaines libertés et rejetons de nombreuses contraintes. Mais nous savons combien sont perpétuellement menacées ces libertés. Que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que nation, nous connaissons la source de la liberté et c'est la puissance. Si nous voulons conserver la première, nous devons cultiver la seconde. Elles sont inséparables" (p. 301-302).
Voilà une page qui, à elle seule, pourrait assurer à son auteur un poste dans une faculté d'histoire des sciences politiques. Quand tout semblait à nouveau possible et quand le jeu des grandes stratégies politiques revenait à l'avant-plan, sur un échiquier grand comme le monde, quand Thiriart venait à peine d'entrevoir la possibilité de donner vie à sa grande idée d'Unité, voilà qu'a surgi le dernier coup du destin: la mort.
En dépit de son inéluctabilité, elle est un événement qui nous surprend toujours, qui nous laisse avec un sentiment de regret et d'incomplétude. Dans le cas de Thiriart, le fait de la mort fait vagabonder l'esprit et nous imaginons tout ce que cet homme d'élite aurait encore pu nous apporter dans nos combats, tout ce qu'il aurait encore pu apprendre à ceux qui partagent notre cause, ne fût-ce que dans de simples échanges d'opinions, ne fût-ce qu'en formulant des propositions en matières culturelle et politique.
Enfin, il nous appartient de souligner la complétude de l'oeuvre de Thiriart. Plus que tout autre, il avait complètement systématisé sa pensée politique, tout en restant toujours pleinement cohérent avec ses propres prémisses et en demeurant fidèle au style qu'il avait donné à sa vie.
Lui, moins que tout autre, on ne pourra pas lui faire dire post mortem autre chose qu'il n'ait réellement dite, ni adapter ses textes et ses thèses aux exigences politiques du moment. Il reste le fait, indubitable, que sans Jean Thiriart, nous n'aurions pas été ce que nous sommes devenus. En effet, nous sommes tous ses héritiers sur le plan des idées, que nous l'ayions connu personnellement ou que nous ne l'ayions connu qu'au travers de ses écrits. Nous avons tous été, à un moment ou à un autre de notre vie politique ou de notre quête idéologique, les débiteurs de ses analyses et de ses intuitions fulgurantes. Aujourd'hui, nous nous sentons tous un peu orphelins.
En cet instant, nous voulons nous rappeler d'un écrivain politique, d'un homme qui était tout simplement passionné, impétueux, d'une vitalité débordante, le visage toujours illuminé d'un sourire jeune et l'âme agitée par une passion dévorante, la même que celle qui brûle en nous, sans vaciller, sans la moindre incertitude ou le moindre fléchissement.
Le cas Jean Thiriart? C'est l'incarnation vivante, vitale, d'un homme d'élite qui porte son regard vers le lointain, qui voit de haut, au-delà des contingences du présent, où les masses restent prisonnières. J'ai voulu tracer le portrait d'un PROPHETE MILITANT.Carlo Terracciano http://www.voxnr.com
-
Il y a 2500 ans, les Gaulois fabriquaient déjà leur propre vin
Des chercheurs américains ont mis en évidence sur le site antique de Lattara, dans l’Hérault, les vestiges du plus ancien pressoir à vin connu en France, qui date d’environ 425 avant JC.
Cultivée depuis 9.000 ans au Proche-Orient, la vigne a donné naissance à une culture millénaire qui s’est répandue dans tout le bassin méditerranéen : celle du vin. Propagée par les marins phéniciens dès 800 avant JC, elle était partagée par les habitants de l’Étrurie (centre de l’Italie) dès 600 avant JC, comme l’attestent des épaves de navires remplis d’amphores. Toutefois, une partie de l’histoire restait floue. [...]
« Maintenant, nous savons que les anciens Étrusques ont converti les Gaulois à la culture méditerranéenne du vin par l’importation de vin dans le sud de la France. Ceci a engendré une demande qui ne pouvait être satisfaite que par la création d’une industrie locale », poursuit le chercheur [Patrick McGovern]. [...]
-
Mark Twain ou l’Amérique qui bouge
L'esprit aventureux et l'humour peuvent très bien aller de paire. C'est ce que démontrent de façon irréfutable la vie et les œuvres de Samuel Langhorn Clemens, beaucoup plus connu sous le nom de Mark Twain.
À lui seul, d'ailleurs, le pseudonyme choisi par le grand humoriste américain fournit un reflet de son existence pour le moins agitée. Il vient, en effet, des quatre années que le père de " Tom Sawyer " passa comme pilote sur le Mississippi : " Mark twain ! ", était tout simplement le cri des veilleurs sur les «riverboats». annonçant deux fathoms (quatre mètres) de fond à la sonde.
Né en 1835 dans une petite ville du Missouri, Samuel Clemens était le fils d'un athée légèrement fou et d'une mystique impénitente. De plus, sa venue au monde avait coïncidé avec l'apparition de la comète de Halley. Il vécut avec l'idée que cette comète réapparaîtrait pour sa mort et, chose curieuse, il ne se trompa pas.
Un parfait garnement
Elevé sur les bords du Mississippi, dans l'univers qu'il sut si bien évoquer, des années plus tard, dans « Tom Sawyer » comme dans « Hukleberry Finn », le futur Mark Twain semble avoir grandi comme un parfait garnement, enclin aux pires méfaits et aux plus grandes audaces. Au point que, chaque fois qu'on lui rapportait son fils, fraîchement repêché dans le fleuve, sa mère proclamait :
- Je n'étais pas inquiète; les gens qui sont destinés à être pendus ne se noient jamais ...
À douze ans, en 1847, ayant perdu son père, il quitta l'école pour devenir apprenti typographe dans l'imprimerie et le petit journal que possédait son frère. Et, assez rapidement, il commença à écrire ses premiers articles, que la postérité n'a pas retenus.
À dix-huit ans, il quitta la petite ville d'Hannibal, cadre de ses premiers exploits, pour voyager dans tout le Sud des États-Unis, en louant ici et là ses services de typographe. Puis, en 1857, il prit le chemin de la Nouvelle-Orléans avec une grande idée en tête : s'embarquer pour l'Amérique du Sud et remonter jusqu'aux sources de l'Amazone. Mais il s'arrêta très vite en chemin et devint pilote sur le Mississippi.
La route de l'Ouest
Ce fut la Guerre de Sécession qui vint, en 1861, interrompre sa carrière fluviale. Sudiste fidèle, encore qu'anti-esclavagiste, Samuel Clemens devint, pour un court moment, sous-lieutenant dans un bataillon de volontaires confédérés, mais ne vit l'ennemi nordiste qu'une seule fois, d'une berge à l'autre d'une petite rivière.
En 1862, il prit la route de l'Ouest, encore sauvage, pour aller rejoindre son frère, nommé secrétaire du territoire de Carson City. Il tenta de se faire chercheur d'or, afin d'atteindre très vite la richesse, mais dut rapidement déchanter.
Il gagna donc San Francisco, où il devint journaliste et acquit très vite la réputation d'un humoriste impénitent. Encouragé par le romancier Bret Harte, il commença à écrire pour lui-même, et, en 1865, parut sa première nouvelle : « La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras ».
Dès ce moment, le succès était en route. Il se rendit aux îles Hawaii et entama ensuite, tout en continuant à écrire, une brillante carrière de conférencier.
Il fit une assez longue tournée en Europe, dans le bassin méditerranéen et jusqu'en Terre Sainte, dont il tira toute une série d'articles, publiés en série d'articles, publiés en volume en 1869 sous le titre " Innocents abroad ". Ayant épousé, en 1870 une jeune dame de la Nouvelle-Angleterre., l'homme du Missouri se fixa dans le Connecticut, « pour être enfin respectable », comme il le disait lui-même.
Mais, à ce qu'il semble, il ne tarda pas à étouffer un peu dans son nouveau milieu trop guindé. C'est alors qu'avec un léger esprit de provocation, il écrivit " Roughing it " (" À la dure "), où il contait avec une verve galopante ses aventures dans l'Ouest:
« S'il ne vous est jamais arrivé de faire un feu de camp le soir avec les flèches prélevées dans les cadavres des divers membres de votre famille, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. »
Affaires malheureuses
« Tom Sawyer » devait naître en 1876, « Le Prince et le pauvre » en 1882 et « Huckleberry Finn » - que certains considèrent comme son chef-d'œuvre en 1884. Entre deux romans. il continue à écrire des contes et des nouvelles, ainsi que des récits de voyage. En 1889, c'est « Un Yankee à la cour du roi Arthur », livre satirique de haute volée.
Mais, malheureusement pour lui, il tente aussi de faire des affaires - ne serait-ce, peut-être, que pour s'affirmer dans la société mercantile de Nouvelle-Angleterre. Il s'y monte aussi peu heureux que dans sa recherche d'or dans le Nevada, quelque trente ans plus tôt.
En 1893, malgré le succès qu'il continue à remporter auprès du grand public, il se retrouve pratiquement ruiné, criblé de dettes et accablé de toutes parts par les soucis, qu'ils soient financiers ou familiaux : deux de ses filles meurent et sa femme tombe gravement malade.
Extérieurement, il s'efforce de faire bonne figure et de jouer les éternels humoristes, notamment dans les tournées de conférences qu'il effectue dans le monde entier. Cependant, qu'il le veuille ou non, un aspect longtemps enfoui de son caractère est remonté à la surface, fait de mélancolie, de pessimisme foncier et même de misanthropie. Il connaît aussi hérédité maternelle ? - des crises d'angoisse religieuse où il se prend à considérer ses malheurs comme la punition et l'expiation de ses péchés.
Ses livres, de « Souvenirs persormels de Jeanne d'Arc » au dernier, « Le Mystérieux étranger », reflètent de plus en pius cet état d'esprit.
En avril 1910, la comète de Halley réapparaît et Mark Twain disparaît, suivant de six ans sa femme dans la tombe. La légende veut que, sentant le trépas venir, il ait fait ouvrir tous les rideaux pour contempler le ciel de la nuit.
Mais, comme les vieux soldats de la célèbre ballade, les grands humoristes ne meurent jamais. Tom Sawyer et son complice Huck Finn sont restés là pour enchanter des générations d'enfants épris d'aventure et les faire rêver des petites îles herbeuses du Mississippi, où l'on joue si facilement à cache-cache avec le monde gris des adultes. De courtes nouvelles comme « Les Jumeaux », « Le grand convoi de bœufs » ou « Comment je devins directeur d'un journal d'agriculture » la plus merveilleuse leçon de journalisme que connaisse l'auteur de ces lignes - continuent à faire rire aux larmes toute personne ayant la chance de les lire.
Et puis, humoriste éternel mais journaliste à l'œil aigu, Mark Twain demeure aussi le témoin privilégié d'une Amérique en mouvement, d'une Amérique qui bougeait vite et violemment.
Jean Bourdier National Hebdo janvier 1988 -
« Après la matraque, les rafles »

Il suffit d'un peu de mémoire pour conclure qu'il s'agit là d'une vieille histoire... Sans remonter trop loin, rendons hommage aux étudiants patriotes du 11 novembre 1940. Nombre de nos ainés « en étaient » ! Une nouvelle génération prend la relève. Le 26 mai au soir, elle a payé son écot... Un petit mot de notre frère d'armes Olivier Perceval, secrétaire général de l'Action française...
Chaque année l'Action française rend hommage aux étudiants patriotes qui ont bravé l'interdit de l'occupant allemand, le 11 novembre 1940. C'est toujours avec une certaine émotion que nous imaginons ces étudiants et lycéens, mains nues devant l'envahisseur nazi. Bon nombre d'entre eux étaient d'Action française, et nous avons encore des aînés chez nous pour témoigner de ce premier acte historique de résistance à l'occupant.
Dimanche soir, le 26 mai, c'étaient aussi et surtout des étudiants et lycéens qui faisaient face aux forces du régime. On est libre de ne pas me croire, mais j'affirme qu'il y a eu plus de blessés le 26 mai 2013 que le 11 novembre 1940.
Valls a lâché les chiens (policiers) sur les Français, comme jadis le gouverneur teuton du "Groß Paris".L'Action française, toujours consciente des risques que faisaient courir aux manifestants les grossières provocations policières, a ciblé (avec quelque succès), dans les échauffourées des Invalides, les policiers en civil qui tantôt faisaient mine d'agresser les CRS et tantôt mettaient prestement leurs brassards en sortant les matraques télescopiques pour exfiltrer avec une rare violence des manifestants un peu isolés.

Bilan : dix-sept interpellations et mises en garde à vue dans les seuls rangs de l'Action française, et plusieurs blessés, notamment par "flash ball" dont deux grièvement, poignets cassés et côtes fêlées, encore hospitalisés à l'heure où j'écris.
Cela continue... Lundi 27 mai 2013, à Buffon, des manifestants qui voulaient pacifiquement interpeller Hollande - venu célébrer la Résistance, un comble ! -, se sont fait embarquer manu militari par des CRS, au seul motif qu'ils portaient sur eux le polo de la Manif pour tous. Parmi eux, beaucoup de mères de famille.
Les Kapos de la "Reich-publique" s'affolent, frappent, traquent, raflent..
Le pouvoir rend fou, et, avec leur police, ses détenteurs se croient tout permis. Nos enfants dans les crèches et dans les écoles sont réellement en danger de viol idéologique, demandez à Bertinoti, Vallaud-Belkacem et Peillon ce qu'ils en disent.
À la violence aveugle d'un pouvoir sectaire aux abois, nous répondrons avec la force tranquille d'un peuple en marche, sûr de la victoire finale.Olivier Perceval
Secrétaire général de l'Action françaisePour couvrir les frais de justices nombreux, vous pouvez dès à présent adresser vos dons par chèque au CRAF, 10 rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris, ou bien via Paypal en suivant ce lien :
http://www.actionfrancaise.net/centre-royaliste-daction-francaise/soutenir-laction-francaise/
Photos des exactions commises sur l'ordre de Manuel Valls :
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Photos-des-exactions-commises-sur
À voir aussi, la vidéo de l'opération Bastille :
http://www.actionfrancaise.net/afe/?fich=731
Centre royaliste d'Action française
10 rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris
communication@actionfrancaise.net
www.actionfrancaise.net -
Les mots, la novlangue et les remplaçants
« Imbus de matérialisme et d’utilitarisme les tenants du Système qui nous oppresse tiennent le langage pour chose secondaire et négligeable.»
Bien que d’habitude on tienne les mots pour choses secondaires, négligeables, bien qu’on considère les questions qu’ils posent comme des questions byzantines, les mots – notre sang et notre sève – véhiculent un pouvoir plus que considérable : énorme, décisif ; un pouvoir qui découle non seulement de ce que les mots disent, mais de la façon dont ils le disent – c’est-à-dire de « l’aura poétique » qui entoure tout mot, y compris le plus banal.
Imbus de matérialisme et d’utilitarisme, les tenants, aussi bien à « droite » qu’à « gauche », du Système qui nous oppresse tiennent, eux aussi, le langage pour chose secondaire et négligeable. Ils le considèrent comme un simple « outil » de communication. Mais cet outil, ils sont passés maîtres dans l’art de le manipuler à leur guise ! Ils ont même mis sur pied toute une novlangue qui, transmise par la médiacratie, diffuse insidieusement partout, nomme l’air même du temps, les impositions de la Bienpensance.
La chose est si insidieuse qu’il peut même arriver que cet air pollué contamine, à l’occasion, la langue de ceux qui s’opposent au Système, à ses exactions et à sa bêtise. Ainsi, par exemple, les Tziganes se sont vus dépourvus – même parmi nous – de leur nom ancestral pour être désormais appelés « les roms » ou, d’une façon encore plus douceâtre, « les gens du voyage ».
Je l’avoue, pourtant : en ce qui nous concerne, c’est bien le seul cas de contamination langagière que je connaisse. C’est bien de pied ferme que nous faisons face à la langue de bois… pourri du Système. Tout un travail extrêmement important a été accompli, notamment par Polémia, consistant à dénoncer la dénaturalisation du langage qui se développe jour après jour sous nos yeux et au travers de nos langues.
Mais comme il nous arrive souvent dans d’autres domaines, la plupart de ce travail est « négatif ». Il consiste avant tout à dénoncer, à faire face, à aller à l’encontre de tout ce à quoi il faut s’opposer. Ce qui est très bien, sauf qu’il ne suffit pas de s’opposer. Il faut aussi créer, être imaginatif, inventif. Il faut trouver des mots justes, parlants, pertinents et surtout… impertinents.
Voilà qui, malgré tout, commence déjà petit à petit à se faire. « La Manif pour tous » (face au « “Mariage” pour tous ») est, par exemple, une grande trouvaille qui a fait fortune méritée. Il y en a d’autres : la « bienpensance » (terme beaucoup plus parlant, beaucoup plus ramassé que « la pensée du politiquement correct », à supposer que celle-ci soit une pensée) ; la « médiacratie » (au lieu des simples médias) ; la « novlangue » (celle-là nous la devons, depuis 1947, à un certain George Orwell et à son Big Brother).
Mais ces trouvailles – ces coups de fouet par lesquels la langue frappe droit, mieux que par un long discours, dans l’imagination et dans l’émotion des gens – sont encore trop peu nombreuses. J’en propose une autre. L’idée m’est venue l’autre jour à Paris, où chaque fois que je m’y rends je constate un nombre de plus en plus important d’immigrés. Puisque, grâce à Renaud Camus, le « Grand Remplacement » est une expression qui commence déjà à s’introduire dans notre langue, ce ne sont pas des immigrés, me disais-je, ces gens qui, venus d’ailleurs, vont chambouler toutes les données ethniques, culturelles et spirituelles de nos peuples. Ce sont des « remplaçants », puisque telle est la fonction pour laquelle nos oligarques, tout en tirant bénéfice des bas salaires qu’ils leur infligent, leur ont ouvert les portes.
Ne les désignons pas de ce mot – « immigrés » – qui évoque seulement le sort pénible de quiconque doit quitter son chez-soi pour aller chercher fortune ailleurs. Ils sont certes cela, les immigrés. Mais ce n’est pas cela qu’ils sont pour l’essentiel. Telle n’est ni la fonction objective qu’ils remplissent ni la raison pour laquelle nos maîtres – ces zombis dépourvus d’origine, d’attache et de tradition – leur ont ouvert grandes les portes. Ils sont là en vue d’accomplir le Grand Remplacement de populations qui est en train de submerger l’Europe. Ceux qui accomplissent un Remplacement d’une telle ampleur ce ne sont pas de simples immigrés. Ce sont des Remplaçants. Appelons-les donc du nom qui est le leur.
Javier Portella http://fr.novopress.info
Voir aussi :
- Le Dictionnaire de novlangue (Mise à jour janvier 2013) 1/2
- La Novlangue de l’Union européenne (première partie)
- Le Dictionnaire de Novlangue (Mise à jour janvier 2009)
- Dictionnaire de la réinformation – Cinq cents mots pour la dissidence(neuvième et dernière section T-U-V-W-X-Y-Z)Source : Polémia – 8/06/2013
-
L’après 24 mai : Enfin le divorce entre pays réel et pays légal ?
« Ita missa est » scandent prétentieusement nos adversaires depuis que la loi Taubira est votée, promulguée et inscrite dans les textes sacrés de notre bonne vieille république, cinquième du nom, catin décatie et fétide qui n’en finit plus de saper le bel édifice français. Les flonflons médiatiques et sponsorisés du premier mariage homo de France ont maintenant fini de sonner dans la nuit montpelliéraine. En fait de flonflons, si cette loi reste en l’état, elle sonnera le glas des fondements traditionnels de notre société. Dont acte.
Mais si la Famille en France a perdu une bataille, elle n’a pas perdu la guerre. Les troupes sont nombreuses et fraîches !
Car « le désespoir en politique est une sottise absolue », oserons-nous répondre à ces idolâtres de l’union des invertis de tous poils (en attendant le mariage à trois comme au Brésil et autres joyeusetés de ce genre). Fort heureusement, ce qu’une minorité, un groupuscule, une secte, aura réussi à obtenir contre la majorité des français ne devrait logiquement guère perdurer quand la Droite (la forte, populaire, sociale, moderne et humaniste, celle des gaullistes en mouvements ou celle qui a des idées… si, si, ça existe…), bref, quand le gang de Copé aura repris les clefs du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, on verra s’qu’on verra. Renvoyés dans les fin fonds du Marais, les pedzouilles et prière de s’empapaouter ailleurs !
Non ? Vous n’y croyez pas ? Ah, vous non plus…
Comme vous avez bien raison. Si par le plus grand des hasards ces loufiats de l’UMP arrivaient à déloger des affaires (de corruption) les camarades socialistes, vu les débats internes qui ont fait les délices de la campagne d’investiture à Paris, je parie mon stock de litière bio que rien ne changera et qu’ils se dépêcheront de figer la situation, histoire de ne pas froisser nos gay-lurons en mal de noces ou pire encore, être brocardés par de grimaçantes effigies lors d’une gay-pride de protestation. C’est que ça vous tue un homme politique ce genre de truc.
Encore faut-il arriver au pouvoir
Quelque chose me dit que le paysage politique pourrait être considérablement modifié, si d’aventure les piétons pacifiques de la « Manif pour tous » s’entêtaient à considérer, que ce pour quoi ils sont descendus dans la rue, était plus fort que leur inclinaison traditionnelle à voter habituellement et aveuglément pour l’UMP. Voter FN ? S’abstenir ? Voter blanc ? Voter Barjot (y paraitrait que cela puisse se faire…) ? Tout est envisageable, mais je ne suis pas sûr qu’à cette heure, nous puissions évaluer les conséquences électorales de ce mouvement de protestation. Quelles seront donc les réactions des marcheurs devant la pusillanimité des dirigeants de l’UMP ? Leur discours hésitant, contradictoire, alambiqué, est le reflet d’un manque de courage politique et d’une absence sidérante d’idées, qui pourraient détourner définitivement les sympathisants de la rue de Vaugirard et les faire lorgner vers d’autres rivages.
Tabler sur un rejet de la classe politique par une frange conséquente de l’électorat traditionnel de droite est-il envisageable ? Il est évident que le discours très consensuel de Marine Le Pen va séduire de plus en plus cette partie de l’électorat pour qui les valeurs traditionnelles ont encore de l’importance. Franchiront-ils le Rubicon ?
Quant aux électeurs de gauche, de plus en plus nombreux à se détourner d’un pouvoir socialiste qui n’a aucune politique ou embryon de politique pour résoudre les maux qui les accablent (pouvoir d’achat, chômage, impôts…), nul ne peut prévoir vers qui iront leurs prochains votes. Vers la gauche si le discours populo-démago de Mélanchon séduit encore ; vers Le Pen en cas de ras-le-bol d’une immigration-invasion qui suce nos ressources et écornent les diverses prestations sociales.
Voilà où est notre chance à nous les opposants de ce régime de corrompus, ce régime de haine et de division qui étouffe notre pays. Nous devons faire entendre une autre voix, celle d’une France pacifiée, délivrée des mercenaires qui se paient sur la pauvre bête, une France enfin débarrassée des sangsues professionnelles qui se gavent de nos richesses pour se faire une situation de rentiers à l’Assemblée Nationale, au Sénat ou au sein des Conseils Généraux.
Notre devoir est donc d’aller vers tous ces déçus du système pour leur présenter notre projet, notre royal projet. Et surtout, il faut le faire avant que la banqueroute générale ne mette notre pays dans une situation dramatique, quand nous serons tous ruinés et inféodés à un pouvoir technocratique imposé par la finance mondiale.
L’heure n’est pas encore à l’insurrection, mais on s’en rapproche peut-être.
ON NE LÂCHE RIEN !
REMBARRE !
Preuve que votre serviteur était bien présent dans la foule aux Invalides ce 24 mai 2013.
Vous noterez l’équipement de haute technologie en adéquation avec le projet, hélas avorté, de marche sur l’Elysée. La foule n’a pas suivi malgré mes exhortations et mes cris de ralliement. Y’a encore du boulot pour faire comprendre à nos concitoyens l’empirisme organisateur et la notion de violence au service de la raison…
-
« Illuminati », le nouveau livre de Laurent Glauzy
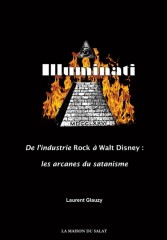 Le nouveau livre de Laurent Glauzy, qui connaît un remarquable succès, s’intitule Illuminati. De l’industrie rock à Walt Disney : les arcanes du satanisme. Il entend expliquer les techniques de manipulation et de « contrôle mental » que met en œuvre une petite minorité d’initiés sataniques, au sommet de la hiérarchie occulte mondiale.
Le nouveau livre de Laurent Glauzy, qui connaît un remarquable succès, s’intitule Illuminati. De l’industrie rock à Walt Disney : les arcanes du satanisme. Il entend expliquer les techniques de manipulation et de « contrôle mental » que met en œuvre une petite minorité d’initiés sataniques, au sommet de la hiérarchie occulte mondiale. En cliquant ici, vous pouvez écouter une émission avec l’auteur sur ce sujet, sur Radio Courtoisie.
Le livre est disponible à la vente ici.
15 euros. 108 p. + livret photos 8 p. Ed. Maison du Salat, 2012.
4e de couverture :
« Des dessins animés Walt Disney à la musique Rock, un code culturel universel dérivant de la culture de mort s’est définitivement imposé dans nos sociétés. Dans ce credo consensuel, la pornographie et les stupéfiants ont affecté les valeurs fondamentales de plusieurs générations. Les concerts sont devenus un lieu d’écoulement de drogues, alors qu’ils sont souvent organisés par de grands cartels pharmaceutiques comme Sandoz.
L’auteur dénonce sans concession l’action occulte de l’ordre supra-maçonnique des Illuminati et explique les mécanismes qui oeuvrent à l’aliénation de l’individu. Au fil des pages, une description passionnante des techniques de pointe hautement élaborées nous plonge dans l’univers des messages subliminaux et du Contrôle mental rattachés au programme Monarch et au Mk Ultra.
A cet égard, les vidéo-clips sont un laboratoire d’expérimentations où des messages mortifères en filigrane – incitant au suicide et à l’adoration de Satan – assaillent le public. Cette vague n’épargne ni le Rock chrétien, ni le Gospel, ni la Country.
Des témoignages extraordinaires de Hesekiel Ben Aaron, troisième membre de l’église de Satan et John Todd, directeur de plusieurs maisons d’enregistrement, dévoilent sans ambages l’existence d’un ordre luciférien.L’auteur :
Journaliste spécialisé dans la politique internationale, Laurent Glauzy est né en 1970 à Toulouse. Il possède de solides connaissances dans plusieurs langues, parmi lesquelles l’allemand, l’anglais, l’italien, le néerlandais, le roumain et le russe.
Après plusieurs années de collaboration au Libre Journal de la France Courtoise, où ses prises de position contre les mensonges du darwinisme et de l’évolutionnisme ne passèrent pas inaperçues, il écrit dans divers journaux, tels que Monde et Vie et Valeurs Actuelles. »

