La plupart des biographes de Lyautey ont été en général fort sobres au sujet de son court passage au gouvernement en qualité de ministre de la Guerre. Peut-être ont-ils pensé que cet épisode, dont la durée n'a pas excédé onze semaines, de fin décembre 1916 à mi-mars 1917, n'offrait dans une existence par ailleurs si riche et si bien remplie qu'un médiocre intérêt. Ou bien, cette brève période d'une grande carrière ayant constitué en somme un échec, convenait-il de ne point s'y appesantir. Erreur. La réussite ou l'échec dans la vie d'un homme n'ont point de signification majeure : il y a des échecs qui grandissent et des réussites qui déshonorent. En l'espèce, l'éphémère participation de Lyautey à un gouvernement métropolitain à un moment critique de la guerre de 1914 est très riche d'enseignements et projette une nouvelle clarté sur les qualités essentielles qui, si les circonstances s'y fussent prêtées, eussent fait de Lyautey un merveilleux conducteur de peuple.
Premières déceptions
La fin de l'automne 1916 et le début de l'hiver qui suivit marquait dans le déroulement de la Première Guerre mondiale une sorte de point mort, une phase d'attente avant l'ouverture indécise d'un nouveau chapitre. Un cauchemar, celui de Verdun, avait été clos au prix de sacrifices et d'un effort intenses. Après cette flambée d'héroïsme et cette affreuse hémorragie, quelle direction nouvelle fallait-il imprimer à cette guerre qui durait, s'invétérait comme un mal chronique dont on ne pouvait concevoir la fin ?
Le pays s'inquiétait. Chantilly s'endormait dans la sérénité olympienne d'un petit univers bureaucratique et clos : Plutarque commençait à mentir. Lourd de ses vingt-trois membres, le gouvernement sous la direction fluente de Briand était divisé, mal informé, impuissant à imprimer à la guerre une impulsion efficace et des impératifs méthodiques. L'opinion publique voulait qu'on sortît de l'immobilisme, réclamait des initiatives, s'énervait : Clemenceau lui prêtait sa voix.
Après des débats houleux à la Chambre, Briand obtint la confiance traditionnelle, mais assortie d'une mise en demeure de remanier son ministère pour en faire un organisme d'action. Il fallait donc choisir un ministre de la Guerre qui, après l'interrègne falot du général Roques, eût le prestige et l'autorité d'un Galliéni, prestige d'autant plus nécessaire qu'on allait démanteler la citadelle de Chantilly en substituant à son omnipotence dans la conduite de la guerre celle d'un Comité de Guerre composé, à l'exemple britannique, des ministres des Affaires étrangères, de la Guerre, des Finances et de l'Armement (celui-là nouvellement institué) et qu'on envisageait la nomination en qualité de commandant des Armées du Nord et de l'Est d'un nouveau généralissime effectif, tout en laissant à Joffre son titre assorti de celui de conseiller technique militaire du gouvernement.
Deux grands coloniaux dans la période initiale de la guerre avaient conjuré le désastre : Joffre et Galliéni. On compléta la trinité des coloniaux en recourant à Lyautey, et malgré certaines hésitations, en dépit de quelque pressentiments peut-être, le constructeur du Maroc ne pouvait pas ne pas répondre à l'appel pressant qui lui était adressé.
Mais d'entrée de jeu, certains procédés le surprirent et le froissèrent. C'est ainsi qu'il apprit par l'Agence Havas, sans en avoir été au préalable averti, que le Département de la Guerre n'aurait désormais plus sous son contrôle la direction de l'armement et des fabrications de guerre ni celle des transports et du ravitaillement. « On m'offre un ministère amputé », télégraphiait-il de Rabat. Aussi réservait-il son acceptation définitive après examen sur place de sa véritable situation au sein du gouvernement.
À l'arrivée à Paris, nouvelle déception. L'amiral Lacaze, intérimaire, a déjà investi le général Nivelle des fonctions de généralissime à la tête des Armées du Nord et de l'Est. Lyautey fut très contrarié de n'avoir eu aucune part à la prise d'une telle décision. La résolution complémentaire de créer au profit de Joffre le poste de conseiller technique du gouvernement le choquait également. L'état-major de ce conseiller technique n'allait-il pas entrer en conflit avec celui du ministre, et ce dernier, au demeurant, n'était-il point, en fait, le véritable et naturel conseiller du Comité de Guerre ?
Avant même d'avoir pris le moindre contact rue Saint-Dominique, Lyautey s'installa chez lui rue Bonaparte passablement hérissé, décidé à n'entrer en fonctions que sous bénéfice d'inventaire. Il fallait à tout prix calmer, apprivoiser ce pur-sang qui n'admettait guère la longe et qui déjà se cabrait... Philippe Berthelot, envoyé en éclaireur par Briand, accourut pour porter les premiers apaisements. La logique persuasive et le prestige lorrain de Poincaré, la caressante et cordiale bonhomie de Briand firent le reste. Le gouvernement comptait sur la camaraderie coloniale nouée à Madagascar pour atténuer la mauvaise humeur de Joffre qui parlait de se retirer sous sa tente. Lyautey avec un tact parfait réussit à faire accepter au vainqueur de la Marne un « modus vivendi » honorable.
De son côté, Lyautey finit par acquiescer à la réduction des attributions naguère dévolues à son département en cédant au caractère impérieux des nécessités nouvelles qui commandaient la mise au jour de deux ministères supplémentaires, celui du Ravitaillement et des Transports confié à Herriot et celui de l'Armement assumé par Albert Thomas, avec de part et d'autre deux sous-secrétaires d’État, Claveille et Loucheur. Il comprit, en outre, que le rôle du ministre était d'administrer l'armée et de pourvoir à ses besoins avec l'assistance de ces deux organismes et que la conduite politique de la guerre relevait du gouvernement qui fixait ses buts, le généralissime étant affecté à la conduite technique des opérations. Il reconnut enfin qu'il n'avait aucune prévention personnelle à l'endroit de Nivelle et qu'il l'attendait à l'œuvre et tout d'abord à l'exposé de ses conceptions.
« On va sacrifier des milliers de personnes pour rien… »
En fait, dès le lendemain de ses entrevues avec Poincaré et Briand, Lyautey reçut, toujours rue Bonaparte, la visite de Nivelle qui venait prendre contact et lui remit un petit papier résumant l'économie de ses projets. Lyautey ne manifesta point d'opinion, mais, relate Wladimir d'Ormesson, auteur d'un « Auprès de Lyautey » (dont il avait été l'officier d'ordonnance au Maroc) paru en 1963 chez Flammarion, « après le départ du général Nivelle, il donna de multiples signes d'agacement, d'impatience. On sentait qu'entre le généralissime et lui "ça n'avait pas collé" ».
Le 1er février 1917, les choses devaient d'ailleurs se gâter quand le colonel Renouard, mandaté par le GQG, vint exposer au ministre, dans tous ses détails, le fameux plan Nivelle.
André Maurois avait déjà donné une version dramatique de l'entrevue de Lyautey avec cet officier qui avait travaillé sous ses ordres dans le Sud-Oranais. Figé dans l'attitude que lui imposait la mission dictée par son chef du moment, il ne répondait rien aux objurgations de Lyautey qui, bouleversé par la communication dont il venait de prendre connaissance, lui demandait d'homme à homme, sous le sceau du secret, quel était son sentiment sur le document entre ses mains : « Allons, voyons, mon petit Georges, regarde-moi droit dans les yeux... Remets-toi un instant dans la peau de l'officier d'ordonnance d'Aïn-Sefra et dis-moi la vérité... Que penses-tu de tout cela ? » Alors le colonel abandonna son masque et se mit à pleurer : « Mon général, dit-il tout bas, je pense comme vous... »
Le surlendemain de l'entrevue avec le colonel Renouard, dans le train qui menait le général et sa suite sur le front belge pour une visite auprès du roi, Lyautey se retrouve avec M. d'Ormesson, qui témoigne : « Son courrier fait, Lyautey se mit à tourner en rond dans l'étroit wagon comme un écureuil dans sa cage. Cela lui arrivait parfois et c'était toujours le signe d'une grande émotion. Tout d'un coup il éclata. Il était au bord de la crise de nerfs. Il me dit - parce qu'il avait besoin de parler, de s'extérioriser : « Vois-tu, mon petit, c'est affreux... Je suis sûr, sûr, sûr... Je le sens, je le sais. C'est du « Kriegspiel », cela ne tient pas debout, c'est insensé, je l'avais pressenti du premier jour. Mes conversations avec Nivelle ne faisaient que me confirmer dans mes craintes, maintenant il n'y a plus le moindre doute dans mon esprit. J'ai compris, je suis sûr, sûr, sûr que je ne me trompe pas... Avant même de savoir ce que je sais à présent, j'avais fait part de mes anxiétés à Poincaré, à Briand... Ils me répondent toujours la même chose : « Cela ne vous regarde pas... Vous n'êtes pas chargé des questions militaires... Vous n'avez pas la responsabilité... Au surplus vous venez du Maroc... Vous n'avez pas manié de grandes masses... Vous n'avez pas l'expérience qu'ont nécessairement acquise ceux qui ont commandé sur le Front de France... » C'est peut-être vrai d'ailleurs... Peut-être Nivelle a-t-il raison ? Voit-il juste ? Peut-être ai-je tort ? Et pourtant non, non, non, je suis sûr que mon instinct ne me trompe pas... Je n'en peux plus d'assister aussi impuissant, désarmé, absorbé par des besognes stupides ou sans importance quand j'ai la conviction qu'on va sacrifier des milliers de personnes pour rien ; quand j'ai la certitude que la guerre n'est pas menée sérieusement ; que ce n'est pas comme cela qu'il faut agir ; qu'on perd un temps précieux, que nous sommes au trentième mois de la guerre et que la France était déjà saignée à blanc… » Lyautey était en proie à une véritable crise de désespoir. Il ne pouvait plus se contenir. »
Qu'on nous pardonne cette longue citation mais elle est capitale. Lyautey avait vu juste. Son don d'intuition, son sens critique s'insurgeaient contre l'élucubration dans l'abstrait, fondée sur le mépris de l'ennemi et la surestimation des forces propres dont on dispose, d'un de ces stratèges à plan (et rata-plan), imbus d'une immense satisfaction d'eux-mêmes et d'une obstination correspondante qui les font s'engager dans l'erreur et, c'est le pire, en dépit du résultat désastreux qui en est le fruit, persistent à soutenir qu'eux seuls avaient raison et que les faits seuls en l'occasion avaient tort. De récents conflits ont montré que l'espèce de ces dangereux va-t-en-guerre n'est pas éteinte.
En dehors des conseils et des audiences, des visites de parlementaires venus l'entretenir de petites histoires de leurs circonscriptions, recommandations ou passe-droits à rétablir affectant leurs électeurs, de colloques avec des généraux peu perméables, Lyautey devait faire face à tout moment à de menus accrochages ou obstacles répétés qui l'accablaient.
Afin de discuter de la conduite des opérations, la Chambre voulait une fois de plus instituer une séance secrète. Lyautey insista près de Briand pour que le gouvernement s'y opposât. L'aviation était encore une arme à ses débuts ; on ne pouvait étaler son programme de création, les problèmes délicats s'y rapportant, devant six cents parlementaires sans risque d'indiscrétion. Des dirigeants allemands ne s'étaient-ils pas vantés auprès de certains neutres d'avoir en main les comptes-rendus complets des débats en comité secret très peu de temps après les séances ? Briand avait pour méthode de ne point s'opposer de front à ses ministres ; quitte à « attendre et voir » et à en faire ensuite à sa tête. Il se déclara d'accord avec Lyautey. Fort de cette assurance, celui-ci partit pour Londres où une importante conférence interalliée allait avoir lieu. Briand, qui devait en faire partie, se récusa au dernier moment en raison du climat politique orageux qu'il convenait, assurait-il, de surveiller de près.
À son retour de Londres, le 14 mars, Lyautey, se rendant au Quai d'Orsay, y apprit que Briand n'avait pu résister à la pression parlementaire et se trouvait forcé d'accepter le comité secret. Il s'inclina, mais, durant le déroulement des débats, resta muet pour marquer sa réprobation, laissant s'expliquer les officiers désignés en qualité de commissaires du gouvernement.
Il ne prit la parole qu'à la reprise de la séance publique. Mais, voulant démonter l'inopportunité d'une telle procédure, il déclara tout à trac au début de son discours que cette méthode fâcheuse « exposait la Défense nationale à des risques pleins de périls ». La suite est souvent racontée. Aussitôt tumulte indescriptible, concert d'interruptions, clameurs. Malgré les efforts de Deschanel qui tentait d'apaiser la tempête, Lyautey ne put continuer, gagna la sortie. Le soir même, il démissionnait. Briand, pendant l'algarade, était resté immobile à son banc sans intervenir. Le départ de Lyautey allait entraîner d'ailleurs la chute du cabinet tout entier.
M. d'Ormesson se demande à la fois comment Lyautey avait pu commettre une telle faute de tactique oratoire et pourquoi ce manque d'adresse avait entraîné un tollé aussi violent. Il est bien certain qu'enrobée dans le cours ou à la fin d'un discours par ailleurs plein de bon sens et de vues saines et justes, d'après le texte qui nous en a été conservé, et que la Chambre ne devait pas connaître, la phrase incriminée aurait peut-être soulevé des « mouvements divers » mais que, survenant en guise d'exorde alors que l'attention de l'auditoire n'était pas encore émoussée, mais au contraire toute tendue, elle cinglait de front l'amour-propre à vif de l'assemblée nerveuse. La vérité est qu'il y avait, dans les couloirs et sur les travées de la Chambre, un climat défavorable à l'endroit de Lyautey alors même qu'il avait su plaire aux parlementaires ayant eu directement affaire à lui.
Lyautey avait ramené du Maroc ses fidèles immédiats, militaires de métier, gens du monde mobilisés, agents de la Carrière, tous hommes jeunes, certains bien titrés dans l'armoriai et convaincus de son génie. Du côté de Lyautey, aucune mégalomanie, pas de trace d'auto-mysticisme le transformant à ses yeux propres en oint du seigneur appelé par un décret nominatif de la Providence à s'identifier à la France, mais simplement, en une passe difficile de son histoire, le désir simple et puissant de la servir de toute la force de son intelligence et de son expérience. Un Lorrain patriote, sans croix de Lorraine.
Malheureusement ni l'un ni les autres ne connaissaient les milieux parlementaires, leur susceptibilité touchant leurs privilèges et leur méfiance vis-à-vis d'un soldat prestigieux, mais considéré comme réactionnaire, entré dans leurs jeux par la bande.
« Je me meurs de la France »
Les quelques semaines passées par Lyautey au ministère ne furent pourtant pas inutiles. Il fit preuve de clairvoyance non seulement dans l'examen du plan Nivelle qu'il déplorait et dont il fut impuissant à empêcher l'exécution qui devait confirmer ses craintes, mais encore dans les conférences interalliées de Rome et de Londres où il plaida chaleureusement la réorganisation du commandement dans le sens d'une unité étroite et solidaire que Clemenceau un peu plus tard devait faire aboutir.
Les décisions primordiales dans la conduite de la guerre prises tour à tour par Painlevé et Clemenceau, Lyautey en traça le chemin. Ce fut dans ces deux ministères que le ministère Lyautey porta ses fruits. « Son échec, dit M. d'Ormesson dans une excellente formule, fut un effort prématuré. » Ajoutons : fécond et décisif.
Il n'y eut pourtant que le maréchal Pétain pour rendre pleinement justice à l'action de Lyautey durant son ministère. Ministre de la Guerre à son tour en 1934, le jour des obsèques nationales du maréchal Lyautey, le vainqueur de Verdun déclara : « Dans une claire notion des exigences de l'heure, Lyautey comprit tout de suite qu'il fallait aux armées alliées un chef suprême, faute de quoi les efforts les plus héroïques resteraient vains et dispersés. C'est à la propagation de cette idée, à la réalisation de la concentration nécessaire des volontés et des moyens qu'il se consacra tout entier. Pour cela, il s'efforça de réunir dans ses mains, comme il l'avait toujours fait, toutes les ressources, toutes les forces, toutes les responsabilités. »
Après cette expérience avortée, en dépit des efforts de quelques semaines durant lesquelles l'imagination constructive et réaliste de Lyautey s'était heurtée à un bloc infranchissable, le retour au Maroc fut pour lui celui d'un prince exilé qui retrouve son royaume. Loin des contraintes et des résistances occultes ou déclarées, le chef respirait à nouveau, s'épanouissait à l'aise dans un cadre qui était le sien car il l'avait formé.
Cependant, il resta désormais dans l'âme de Lyautey une blessure secrète. Un ressort était atteint, qui ne fut jamais entièrement retendu. Introduit pour la première fois au sein d'un gouvernement dans une époque dramatique, Lyautey s'était cru capable, confiant en sa "baraka", de réaliser un haut dessein, s'il était appelé un jour à tenir la barre : la visée de redresser la destinée de son pays qu'il sentait depuis longtemps pleine de périls et d'incertitudes. Idée exempte chez lui de tout appétit de pouvoir pour le pouvoir, unique goût de rénover et de construire. Victime des circonstances et des hommes, il avait dû à jamais cesser de caresser la chimère d'une telle entreprise. Il en conçut une amertume qui le poursuivait sans cesse pendant sa vieillesse. Il n'avait pu donner sa mesure sur un théâtre plus vaste que celui du Maroc. Il n'avait plus foi en son étoile.
« J'ai raté ma vie », répétait-il souvent. Aveu poignant, injustifié, chez cet homme comblé d'honneurs, le dernier des grands proconsuls à l'apogée de notre Empire. Dans ces années 1930 qui marquèrent à la fois la fin de l'après-guerre de 14-18 et où commença l'avant-guerre de 1940-1944, voyant grandir la montée des périls, il ajoutait : « Je me meurs de la France. » Il mourut le 27 juillet 1934.
« Mon pays me fait mal », devait aussi dire dans sa prison, dix ans plus tard, et à la veille d'être fusillé, pressentant les horreurs en cours et à venir de la Libération, un jeune écrivain ardent et noble que Lyautey, s'il avait tenu un tel sort entre ses mains, n'aurait jamais fait mourir.
C'est une des mélancolies de l'histoire que d'y voir surgir des hommes comme Lyautey marqués pour un grand destin de conducteur ou de réformateur et qui n'ont pu l'accomplir parce qu'ils sont venus trop tôt ou trop tard, enfin pas au moment.
Frédéric BARTEL. Écrits de Paris décembre 2010

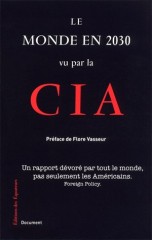
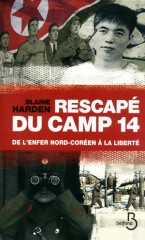 redoutables camps de travail de Corée du Nord, il est le seul auteur connu d’une incroyable évasion [...]
redoutables camps de travail de Corée du Nord, il est le seul auteur connu d’une incroyable évasion [...]

