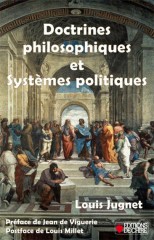Cent ans après son suicide et la fin de l'aventure boulangiste, un nouveau livre vient de paraître sur celui que l'on surnomma «le général Revanche». Il manqua de prendre le pouvoir, grâce à son incroyable popularité et aux ramifications d'un mouvement qui recrutait tant à l'extrême droite conservatrice qu'à l'extrême gauche révolutionnaire. Renonçant à franchir le pas d'un coup d'Etat, Boulanger fut finalement vaincu par l'ultime sursaut d'une «Ripouxblique» dont les scandales avaient accru la combativité. Le récit de Jean Garrigues (1) évoque parfois des problèmes plus actuels qu'il n'y paraît.
La formule est bien connue : « L'Histoire ne repasse pas les plats » et rien ne serait plus erroné ni même plus nocif que d'essayer de faire de la singulière aventure du général Boulanger la préfiguration d'autres échecs (le 6 février 1934) ou d'autres succès (le 13 mai 1958). On a comparé parfois - et l'auteur de ce livre ne s'en prive pas dans sa conclusion - Boulanger à La Rocque, à Pétain ou à de Gaulle. Ce n'est pas toujours faux. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus.
Encore faudrait-il connaître l'homme lui-même et ce livre est un assez bon guide du musée boulangiste. Physiquement, le militaire auquel il ressemble le plus, sur les caricatures du moins, est le général Massu, dont il avait sans nul doute et la bravoure militaire et le sens politique.
On a peine en ces temps paisibles à imaginer la carrière d'un jeune saint-cyrien de 1855 (promotion Crimée-Sébastopol). Né le 29 avril 1837, à Bourg-lès-Comptes, au pays gallo, fils d'un avoué breton et d'une aristocrate écossaise, le sous-lieutenant Georges Boulanger va se battre avec un fantastique courage. On le verra à la tête de ses hommes en Kabylie, en Italie où il est très grièvement blessé d'une balle qui lui traverse la poitrine de part en part, en Cochinchine ou au Cambodge. Promu capitaine au feu, il est à nouveau blessé devant Paris, par les Prussiens en 1890, puis par les Communards en 1871.
Il termine l'année terrible comme lieutenant-colonel. Ses notes sont éloquentes : « Caractère hautain, s'appréciant lui-même d'une façon légèrement exagérée. » En termes plus vifs, ce baroudeur est un ambitieux et même un arriviste. La vantardise et l'art du mensonge apparaissent vite comme ses armes favorites. Cet amateur de chevaux et de jolies femmes (au milieu de tant de passades, on lui connaîtra deux grandes passions : Tunis, son alezan noir, et sa maîtresse Marguerite de Bonnemains) va curieusement montrer autant de pusillanimité politique qu'il a fait preuve dans sa jeunesse de témérité guerrière.
De plus en plus mégalomane, au fur et à mesure qu'il assure sa carrière par un savant mélange d'esbroufe et d'hypocrisie, il se montre à la fois zélé clérical chantant à tue-tête, lors d'un pèlerinage, « Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur ! » et républicain avancé, patronné par Gambetta, ce qui ne l'empêche pas de faire sa cour au duc d'Aumale ! Faiseur et charmeur, il obtient ses étoiles en 1880, devenant à quarante-trois ans le plus jeune général de brigade de l'année française.
On n'a sans doute pas prêté assez d'attention au voyage qu'il accomplit en Amérique, pour diriger la mission militaire française, lors des festivités commémorant le centième anniversaire de la bataille de Yorktown.
Il rêve peut-être de devenir un «soldat politique», du style La Fayette. Outre-Atlantique, il découvre cette arme fantastique, inconnue encore en Europe, qu'est la publicité. Il lancera plus tard son mouvement comme Barnum son cirque ! Inculture et affairisme. ce continent a tout pour lui plaire, puisqu'il permet de fulgurantes réussites à qui a le sens de l'opportunité, peu de scrupules et un indéfectible optimisme allié à la certitude d'avoir toujours raison. L'innovation de Boulanger dans la vie politique française, ce sera peut-être d'y avoir tenté une carrière à l'américaine, d'autant qu'il a retrouvé aux States un camarade de Saint-Cyr, converti dans les affaires : le « comte» Dillon, qui va devenir un des hommes clés du boulangisme et son grand argentier.
Directeur de l'infanterie au ministère de la Guerre, Boulanger passe pour un «général républicain» de style radical. Clemenceau, son ancien condisciple au lycée de Nantes, ne jure que par lui. Il en reviendra.
En attendant, après un passage comme général de division commandant les troupes françaises en Tunisie, durant lequel il se fait surtout remarquer pour ses mauvais rapports avec le Résident, il est nommé, au début de l'année 1886, ministre de la Guerre.
Ce poste est pour lui un marchepied, ce qui ne l'empêche pas d'être un bon ministre, obsédé qu'il est par l'idée de revanche.
On ne comprend rien à Boulanger si on ne le replace pas dans le cadre du délire anti-allemand de son époque. Par ses foucades et ses discours, il incarne le coq gaulois contre l'aigle teuton. Son patriotisme belliqueux et revanchard coïncide parfaitement avec le climat, plus chauvin que social, qui constitue alors l'armature même de la République. Parlementaires radicaux ou «opportunistes» savent que le paravent tricolore permet de camoufler bien des intrigues sordides et bien des affaires juteuses, tout en obtenant la neutralité provisoire des conservateurs et des cléricaux. Pour tous ces bourgeois, l'essentiel est d'asseoir le régime des «bleus», tout en évitant le retour des «blancs» ou la revanche des «rouges».
UN CÉSAR D'OPÉRETTE
Quel meilleur éteignoir qu'un képi ? Boulanger sert à merveille les ambitions d'un régime qui ne tient pas à voir ni l'élite ni le peuple se mêler de trop près à des combines dont la plus ignoble sera le trafic des décorations par le propre gendre du président de la République !
Seulement, en intronisant un militaire ambitieux à un poste en vue, le gouvernement joue à l'apprenti-sorcier.
Arrive la revue du 14 juillet 1886. C'est là où tout commence. En une journée Boulanger devient brusquement ultra-populaire, échappant à toutes les tentatives de classification politique. Avant qu'on ne parle de lui comme d'un César, on découvre brutalement, dans ce général de belle prestance, ce que Jean Garrigues nomme très justement « la première star de la vie politique française ». Le retour de Longchamp, c'est-à-dire finalement un non-événement, peut se comparer à la venue de Pétain à Notre-Dame en 1944 ou au discours de De Gaulle à la Bastille une quinzaine d'années plus tard.
Ce qu'Adolf Hitler connaîtra à Nuremberg après la prise du pouvoir de 1933, Boulanger le connaît avant ! Car tout est là : il n'est pas au pouvoir. Il n'est encore que le pion d'une des innombrables combinaisons ministérielles de la IIIe République.
SANS DOCTRINE ET SANS SCRUPULES
Comment prendre le pouvoir ? Telle est la question qui va dominer ces cinq années, dont la courbe fiévreuse, malgré quelques sommets, va aller de la popularité à la solitude, de la griserie à l'échec, du rêve au néant.
Premier point, capital. Boulanger, qui prétend tout décider par lui-même et mener son mouvement comme une armée, n'a ni doctrine, ni méthode, ni clairvoyance, ni même volonté. Que lui reste-t-il alors ? Du charme et de la chance, et aussi une absence totale de scrupules qui permet parfois les plus brillantes manœuvres mais conduit souvent aux plus sombres déroutes, où tout est perdu, et l'honneur avec.
S'il n'a pas d'idées - il est seulement «révisionniste», ce qui veut dire désireux de réviser la Constitution le général a des amis (dont le temps montrera la lassitude et l'infidélité). Sensible à la flatterie, il confie les rouages du mouvement à qui l'encense ou pire encore, à qui le rétribue. Car toute cette aventure coûtera beaucoup d'argent.
Boulanger sera très vite prisonnier des médiocres (les fidèles) et des gredins (les bailleurs de fonds). Cela n'empêche pas une réussite initiale : rassembler des gens que tout séparait.
Cela va du politicard-type Alfred Naquet, sénateur et israélite, à Marie-Clémentine de Rochechouart-Mortemart, duchesse d'Uzès, chouanne richissime et chasseresse. Les deux piliers de l'entreprise boulangiste ne sont certes pas des hommes dépourvus de qualités : l'ex-marquis Henri de Rochefort-Luçay, aristocrate et communard (sur lequel il faut absolument lire le beau livre d'Eric Vatré, paru aux éditions Lattès) et Paul Déroulède, animateur des cent mille volontaires de la redoutable Ligue des Patriotes, dont l'Histoire a fait un pantin, alors qu'il fut un cœur pur et sans doute la meilleure tête politique du boulangisme. Déroulède et Rochefort symbolisent à eux deux la rencontre «nationale» et «socialiste» d'un mouvement que rejoindront, tôt ou tard, entre beaucoup d'autres, l'ancien général de la Commune Emile Eudes et le jeune écrivain nationaliste Maurice Barrès, l'antisémite catholique Drumont et la future communiste Séverine, le marquis de Morès et l'aubergiste Marie Quinton, la Belle meunière.
Tous sont unis par la haine des mêmes ennemis : les parlementaires républicains, qu'ils soient radicaux ou opportunistes, et qui ont depuis quelques années multiplié les faiblesses, les scandales et les trafics. On parle alors de «république des escrocs» comme on dira, sous Stavisky, la république des voleurs et aujourd'hui la «ripouxblique» ...
Voulant à la fois ne pas mécontenter les républicains durs et purs et les partisans de la monarchie, les banquiers juifs et les ouvriers rouges, les cléricaux et les libres penseurs, les bonapartistes et les blanquistes, Boulanger - as du flou artistique - se garde bien de mettre sur pied un grand parti structuré; il se contente d'accumuler les «coups électoraux», d'abord triomphaux puis catastrophiques.
On l'a, à tort, présenté comme une sorte de «pré-fasciste», en invoquant sa faculté de rassembler la droite et la gauche (et surtout l'extrême droite et l'extrême gauche). Mais il n'en a jamais opéré la fusion. Nul d'entre ses partisans ne s'est rallié à une synthèse «nationale-socialiste» mais chacun est resté au contraire prisonnier de ses origines, tout en imaginant que le général partageait ses idées.
L'ÉTERNEL RETOUR DE L'HOMME PROVIDENTIEL
Finalement, il n'y a pas plus de «boulangisme» que de «pétainisme» ou de «gaullisme». Peu d'idées, mais le ralliement à un homme providentiel. Qu'il fût coiffé d'un képi et qu'il traînât un sabre favorisa manifestement les choses, surtout dans les milieux les plus populaires qui sont aussi à l'époque les plus tricolores.
L'habileté de Boulanger a été de faire croire aux républicains qu'il allait épurer la république et aux royalistes qu'il allait ramener le roi, se présentant aux orléanistes comme une sorte de Franco avant la lettre.
Au début de juillet 1887, Boulanger n'est plus ministre et le gouvernement le met au vert à Clermont-Ferrand. Une manifestation monstre à la gare de Lyon marque son départ (on croirait Soustelle quittant Alger !). De son exil provincial, le général de division complote. Ce jacobin notoire n'hésite pas à rencontrer secrètement les chefs royalistes et bonapartistes. Il en obtient des promesses et des subsides qui, après sa mise en non-activité avec demi-solde, suivie d'une mise à la retraite officielle, lui permettront de se faire élire triomphalement député du Nord.
Désormais, il se croit tout permis en cette année 1888, où il conjugue les voix des ouvriers patriotes et des paysans conservateurs, obéissant aux consignes du comte de Paris ou du prince Napoléon.
1889 s'ouvre par son triomphe à Paris, encore plus boulangiste que la province (sauf dans les beaux quartiers). Seulement la république parlementaire, avec l'aide de la toute nouvelle Ligue des Droits de l'homme et des loges maçonniques, va savoir se défendre par tous les moyens y compris les moyens légaux, sous l'impulsion de Jules Ferry qui était peut-être une crapule mais pas un imbécile.
Une des premières manœuvres consiste à modifier la loi électorale quand on s'aperçoit qu'elle peut être favorable à Boulanger! La recette fera école.
On imagine mal l'ampleur de la lutte. Dillon lance une campagne à l'américaine. Fayard imprime à plus de trois millions de livraisons l'Histoire patriotique du général Boulanger. Le journal La Cocarde tire à quatre cent mille exemplaires. On diffuse cent mille de ses bustes en plâtre et des camelots écoulent photographies et images d'Epinal à la gloire de ce candidat que célèbrent les chansonniers. Toute une bimbeloterie fait recette et ses partisans portent même des bretelles boulangistes : «Plus de dos rond», dit la publicité.
Cette agitation fabrique un héros, mais ne peut longtemps cacher la médiocrité d'un homme. Quand le coup d'Etat est possible, le 27 janvier 1889, il se dérobe et se contente de passer la nuit chez sa maîtresse, qui va désormais totalement obérer sa carrière politique, d'autant qu'elle est gravement malade, phtisique au dernier degré. Le général à l'œillet rouge est amoureux fou de la dame aux camélias ...
Le gouvernement comprend vite qu'il a devant lui un irrésolu, si confiant par ailleurs en sa bonne étoile qu'il croit parvenir à la magistrature suprême par les seules élections.
Tandis que le général s'enfuit à Bruxelles, pour éviter la Haute Cour, le pouvoir prononce la dissolution de la Ligue des patriotes, véritable section d'assaut du comité républicain national, puisque telle est l'étiquette du mouvement boulangiste.
LA DÉROUTE
Condamné par contumace à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée pour atteinte à la sûreté de l'Etat, trahi par les notables conservateurs après avoir déçu les travailleurs révolutionnaires, isolé et secoué à son tour par ce que la presse révèle des coulisses de son mouvement, Boulanger connaît, à l'automne 1889, une véritable déroute électorale dans un pays dont le cœur ne bat plus pour le beau général. Réfugié à Jersey avec sa maîtresse moribonde, il n'est désormais qu'un proscrit sans aucun avenir politique.
Les élections municipales de Paris, qui fut naguère son plus solide bastion, se soldent par une catastrophe. Au printemps 1890, le boulangisme est fini.
Voici tout juste cent ans, en 1891, Marguerite de Bonnemains meurt à Bruxelles, le 16 juillet. Son amant, le 20 septembre, se suicide d'un coup de pistolet sur sa tombe. Celui qui l'a naguère mis en selle, Georges Clemenceau, prononce la plus cinglante des épitaphes :
 Le samedi 13 avril 2013 un dîner-débat fut organisé, à l’initiative de Thomas Joly, secrétaire général du Parti de la France, sur un sujet très occulté par les médiats officiels. Dans une ambiance bon-enfant les invités étaient conviés à joindre les plaisirs de la bouche à ceux de l’esprit. Johan Livernette, jeune de 28 ans, a entretenu les convives sur l’origine, les tenants et les aboutissants de la franc-maçonnerie, secte luciférienne, où il nous apprend que le mot “secret” est le principe premier.
Le samedi 13 avril 2013 un dîner-débat fut organisé, à l’initiative de Thomas Joly, secrétaire général du Parti de la France, sur un sujet très occulté par les médiats officiels. Dans une ambiance bon-enfant les invités étaient conviés à joindre les plaisirs de la bouche à ceux de l’esprit. Johan Livernette, jeune de 28 ans, a entretenu les convives sur l’origine, les tenants et les aboutissants de la franc-maçonnerie, secte luciférienne, où il nous apprend que le mot “secret” est le principe premier.