Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique
http://www.oragesdacier.info/2016/02/nous-allons-devoir-reapprendre-vivre.html
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
http://www.oragesdacier.info/2016/02/nous-allons-devoir-reapprendre-vivre.html
Ecoutons le biologiste Konrad Lorenz dans son livre L’agression : une histoire naturelle du mal :« Dans la pensée occidentale, il est devenu courant de considérer comme étranger au monde des valeurs tout ce qui peut être expliqué par les lois de la nature. Être scientifiquement explicable équivaut à une dévalorisation ».
La société de consommation, aux ordres du mondialisme néglige notre environnement, dans un silence complice. Cette volonté du profit à outrance, détruit le monde rural et agricole, au nom d’un soi-disant progrès industriel, afin d’éliminer en assouvissant les derniers métiers encore libres. Les » ripoux » qui nous gouvernent, falsifient l’histoire en faisant de notre passé « des temps obscurs » pour ainsi installer leur « prêt à penser » dans une société d’esclaves, délocalisables pour un enfer mondialiste. Il ne faut pas que le peuple comprenne la lente robotisation qui s’installe. Notre écologisme est fondé sur le drame de l’homme déraciné, la dégradation des rapports humains, l’inhumanité des villes, la destruction de la nature n’est que la partie visible de cette tragédie…
Afin de mieux contrôler le monde agricole, on brevette les graines, de telle sorte qu’il deviendra impossible d’ensemencer sans passer par les grands groupes agroalimentaires qui détiendront les semences et empêcheront toute initiative personnelle de culture, comme cela se fait depuis la création. Imagine-t-on un catalogue de semences autorisée ? Peut-on breveter le vivant et de quel droit ? Alors que les semences appartiennent à l’humanité ? Seule une invention peut l’être, jusqu’où iront-ils ? Puis vient l’ère des OGM, semences, fertiles qu’une fois, permettant au monde agro-alimentaire de contrôler définitivement toute production mondiale. Une question vient à l’esprit, qui gouverne ? La France était autrefois autosuffisante. Depuis l’industrialisation du monde agricole, fin des années 50, elle est devenue importatrice de nourriture, qu’elle produisait avant ! Comme l’Europe d’ailleurs. « Il n’y a plus de sécurité alimentaire, le devoir d’un Etat c’est de nourrir sa population ?S’insurge l’ingénieur agronome Claude Bourguignon, spécialiste de la microbiologie des sols, puis il poursuit : « On a fait disparaitre 92% de nos agriculteurs depuis 1950, grave constat de faillite. Un phénomène de désertification des campagnes a suivi, la diversité des légumes a fait place aux grandes terres ensemencées pour une seule culture. Ces surfaces énormes furent industrialisés à coup de fertilisants et pesticides sortant des usines qui en temps de guerre fabriquent les gaz de combat. Pour éliminer les petits producteurs fabriquant des fromages fermiers, on fait imposer à l’Europe par du lobbying des normes d’hygiène extrêmes… afin d’être dans les normes, comme le petit fermier ne peut suivre, il disparait et des zones se désertifient…En un siècle nous avons détruit autant de terres qu’en 6000 ans d’agriculture qui nous ont précédées ».
Il dénonce la mort des terres étouffées par les engrais chimiques, comme par un profond labourage devenu destructeur. Ces affirmations inquiétantes, nous laissent présager un avenir dramatique quant à la survie de l’humanité. Quant aux produits sortis de cette industrie alimentaire, quelles sont les conséquences à plus ou moins longue échéance sur le métabolisme humain ? Lorsque nos sols appauvris ne pourront plus donner le nécessaire vital, que ferons-nous ? Selon Claude Bourguignon :« L’état désastreux des sols ne nous permet déjà plus de faire vraiment de la culture, pour autant que cela consiste encore à faire pousser des plantes saines. Tout ce que nous sommes actuellement capable, c’est d’essayer, par des moyens chimiques, « de maintenir en vie des plantes qui ne demandent qu’à mourir tellement elles sont malades »
Le réchauffement climatique risque de changer la face du monde, dans sa géographie, comme dans ses multiples conséquences environnementales. Il est important que l’homme soit à l’écoute de ce qui l’entoure car la disparition d’une espèce pourrait avoir de graves conséquences pour notre survie. On est proche de la catastrophe avec les abeilles, mais on continu à traiter les champs jusqu’à quand ? Ne faut-il pas sortir d’un monde consumériste nous entraînant vers une faillite risquant de nous être fatal ? Ne faudrait-il pas retrouver les valeurs de notre civilisation qui pendant des siècles produisait dans l’esprit de la qualité et du beau, dans le soucis du consommateur, en respectant le rythme des saisons ? Comment continuer à soutenir une agriculture intensive et consommer des produits qu’il faut traiter avec des combinaisons et des masques ? Existe-t-il des gens pour croire qu’ils n’absorbent pas cette chimie et qu’elle ne les rendra pas malade à plus ou moins brève échéance, voir les tuer. Mais désire-t-on la santé des citoyens, le business compte plus, alors que la nourriture, le disait Hippocrate, reste la première médecine ! La dégradation de l’environnement, la déforestation, les migrations des peuples, la pollution et le gaspillage, tout cela va changer non seulement les sociétés mais tout l’écosystème.
C’est la vie de l’homme à travers les espèces, d’abord, qui est en danger, l’environnement, saccagé aura de graves conséquences… Notre destin n’est-il pas de préserver et d’enrichir au lieu de détruire ? L’écologie, c’est transmettre le respect des hommes et de toute vie dans le cycle de l’ordre naturel. N’est-il pas préférable de produire moins mais de meilleure qualité ? Nous préserverions alors l’écosystème dans une gestion plus responsable des denrées alimentaires. Au-delà des questions de gâchis, se posent celles d’une société de consommation produisant à outrance et appauvrissant les sols. N’est-il pas urgent au nom de l’expérience positive, de renouer avec les temps où nous vivions mieux et plus sainement. Le relèvement souhaitable implique de renouer ce qui fut dénoué, de ramener ce qui fut éloigné, de rappeler ce qui fut oublié, bref, de faire une révolution vers la richesse de notre passé et de se réenraciner dans l’essentiel de la vie communautaire, l’humanisme de notre identité. Je garde à l’esprit que dans toute souffrance humaine ou animale, il y a le regard qui vous transperce, l’appel à l’aide et à la charité. Que pour être vraiment ce que nous devons être, telle l’ancienne chevalerie, nous devons aider, soutenir, défendre, bref répondre à l’appel. Tout cela ne peut se faire qu’avec humilité et détachement.
Notre résistance sera celle d’hommes désirant retrouver les libertés contre ce monde de robots. Nous reprendrons notre destin face à ce monde vieillissant. Bref des citoyens retrouvant toute l’étendue autonome de leurs droits sur les affaires des communautés proches. Une sorte d’anarchie où plutôt une autonomie, laissant au sein de l’Etat, une famille qu’une couronne écologique semée de lys représentera mieux, comme elle le fit jadis, notre destinée… Alors
Libérons-nous ! Notre jour viendra…
Frédéric Winkler
La Provence possède par ses calanques un paysage et une faune extraordinaire transmis de génération en génération. Il est regrettable que dans cette transmission, ait été inclus depuis 120 ans, l’habitude de rejeter l’aluminium dans la mer Méditerranée. En effet, en 1893 fut installée à Gardanne une usine d’aluminium spécialisée dans la fabrication d’alumines spéciales. Celles-ci ont la particularité de produire des déchets toxiques de couleur rouge. Aujourd’hui, l’usine appartient à Alteo, premier producteur d’alumines et ces pratiques écologiquement désastreuses persistent. Pourtant, dès 1963 le biologiste Alain Bompard dénonçait déjà le processus dévastateur.
Malgré cette mise en garde, rien n’a été fait pour enrayer la catastrophe. Il aura fallu attendre la fin de l’année dernière pour apercevoir un vague changement de discours. Alteo a en effet déclaré qu’il cesserait de rejeter de la boue rouge dans la mer à partir du 31 décembre 2015 - il bénéficie de l’autorisation de rejeter pendant six ans ses déchets dans l’eau-. Il s’agit donc de savoir pourquoi Alteo bénéficie d’une telle indulgence depuis le début du scandale des boues rouges ? Pourquoi Manuel Valls et Ségolène Royal ont appuyé la reconduction d’autorisation d’Alteo comme le révèle le Canard enchainé ? Tout simplement parce qu’Alteo a pratiqué ce qu’on appelle le chantage à l’emploi. L’entreprise fournit en effet dans la région, de l’emploi direct à 400 personnes et indirectement contribue à celui d’un millier de personnes. Dans une région en crise, Alteo a alors beau jeu de déclarer que tout encadrement de son activité l’obligerait à licencier ou à fermer. Obsédés par l’idée de croissance et guère sensibles à la question du rapport entre la personne et son environnement, nos hommes politiques ont cédé à ce chantage. L’économie et la sainte croissance valaient bien de tuer un environnement millénaire et nuire à la santé des personnes. Il y a là, la marque d’un double problème de nos dirigeants : premièrement, ceux-ci, depuis la Révolution, considèrent que leurs actions visent uniquement au bien-être économique traduit par la courbe de croissance. [.....]
La suite sur La page Facebook de l’Action française Provence
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Billet-hebdomadaire-de-l-Action
La COP21 s’achève à Paris avec l’adoption d’un accord présenté comme une victoire majeure dans la lutte contre le « réchauffement climatique ». Une réussite française attribuée à François Hollande, Laurent Fabius et Ségolène Royal…
Commençons par le commencement. Y a-t-il un changement climatique, et l'homme en est-il responsable ? À la première question, il faut évidemment répondre par l'affirmative, étant donné que le temps à toujours connu des fluctuations. Il y eu une période particulièrement chaude aux temps médiévaux, où la vigne était répandue en Grande-Bretagne... Il y a une quarantaine d'années, des scientifiques prédisaient une catastrophique chute des températures sur un ton aussi alarmiste que les annonces actuelles du réchauffement « anthropogénique ». La réalité, c'est que depuis 18 ans et 9 mois exactement, alors même que les émissions de C02 continuent de progresser sur le plan global, la température mondiale stagne.
Gaz indispensable à la vie, le C02 est un fertilisant des végétaux, et il compose notamment l'air que l'homme expire. Ce n'est pas un poison ; il représente une fraction de « l’effet de serre » principalement causé par la vapeur d'eau. Le C02 d'origine humaine représente quelque 3,5 % de la totalité du C02 naturellement émis dans l'atmosphère et moins de 1 % des gaz à effet de serre - nécessaires à la vie de l'homme sur terre ! La quantité de dioxyde de carbone mesurée à la dernière grande ère glacière était largement plus importante que celle relevée aujourd'hui...
Tourner le dos à 86 % de l'énergie actuellement utilisée
Mais parce qu'un groupe d'études sous l'égide de l'ONU - le GIEC - a décidé que l'homme faisait chauffer la terre avec « l’énergie fossile », près de 200 pays ont dit l'urgence d'opérer une véritable révolution. Aujourd'hui plus de 86 % de l'énergie qui permet à l'homme de faire tourner l'économie - c'est-à-dire de se nourrir, de se vêtir, de construire son habitat, de se chauffer ou de se rafraîchir - provient des dites énergies fossiles, abondantes, fiables et bon marché. Il s'agit de la remplacer par des énergies « renouvelables » : chères, incertaines lorsqu'il s'agit de profiter de l'ensoleillement ou du vent, destructrices des paysages comme les éoliennes, et nécessairement accompagnées de solutions de rechange telles des usines à charbon...
Les négociateurs de Paris se sont donc mis d'accord pour lutter contre un fléau dont on n'est pas sûr qu'il existe, par des moyens dont nul ne sait s'ils vont réellement jouer un rôle sur la température du globe.
Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette « grande peur des années 2000 » permet des décisions internationales très politiques et aux conséquences considérables pour les pays développés. Ces derniers se sont engagés à réduire progressivement leurs émissions de C02 en vue de maintenir la croissance de la température de la terre bien en deçà des 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, sur la foi de calculs scientifiques appuyés sur des modélisations informatiques que la réalité ne vient pas actuellement vérifier.
100 milliards par an pour les pays en développement
Les « pays en développement », eux, « devraient » concourir à la baisse des émissions, mais avec davantage de latitude eu égard à leur industrialisation insuffisante. Ils recevront en outre à partir de 2020 une somme de 100 milliards de dollars annuels, et davantage si les objectifs sont révisés à la hausse, pour faire leur transition énergétique.
Ou pour dire les choses plus exactement : les contribuables des pays riches, de plus en plus matraqués par le coût exorbitant des « renouvelables », en situation de concurrence encore plus défavorisée par rapport aux pays émergents aux bas salaires et aux systèmes de sécurité sociale hypothétiques, vont devoir payer. Qui exactement ? L'accord ne le dit pas. C'est une somme globale dont la répartition sera suivie comme le lait sur le feu par une multitude de mécanismes, d'organismes et d'autres « champions » travaillant sous l'égide de l'ONU. Y gagneront, naturellement, les fabricants de "renouvelables".
Notez que la Chine et la Russie sont des pays en développement au sens du FMI. Elles ont toutes deux participé aux négociations et imposé leur point de vue, la première en annonçant qu'elle continuera d'émettre davantage de C02 en construisant de nouvelles usines à charbon, la seconde en annonçant une baisse de ses émissions... directement liée à sa désindustrialisation post-communiste. Toutes deux ont évidemment intérêt à voir les pays développés pieds et poings liés. Au fait, la Chine émet près de 30 % du C02 mondial par an, deux fois plus que les États-Unis.
L'accord de la COP21, un leurre ? Sur le plan de la protection de la nature, certainement. Sa réussite est ailleurs, elle est politique et idéologique : dans sa promesse aujourd'hui partagée d'abandonner le « modèle de développement économique » que le monde a connu depuis la révolution industrielle - avec ses côtés négatifs, mais aussi l'amélioration de la santé, de la longévité, du niveau de vie. C'est Christiana Figueres, principale organisatrice de la Conférence des parties, qui l’a dit...
Jeanne Smits monde&vie 14 décembre 2015
Dans sa livraison de janvier, le mensuel La Nefconsacre un dossier à la COP21, en en soulignant notamment les limites. Abordant le sujet du réchauffement climatique, Christophe Geoffroysouligne que c'est
"loin d’être le seul problème écologique qui menace la planète – et c’est une autre faiblesse des grandes réunions comme la COP21 de polariser l’attention sur ce seul aspect, alors que l’écosystème forme un tout."
Néanmoins, il tombe dans le travers du réchauffisme en ajoutant :
"Dès lors, que veulent prouver les climato-sceptiques en niant l’origine humaine du réchauffement et en se moquant du souci écologique ?"
Mais les climato-sceptiques (et même, pour être plus exact, les CO2-sceptiques) se moquent-ils vraiment de l'écologie ?
Distinguer les sujets
Et c'est sur ce dernier aspect que le bât blesse le plus. En 2011, Georges Dilliger, qui n'est pas climato-sceptique mais est CO²-sceptique, avait déjà répondu à la question de Christophe Geoffroy, dans un ouvrage sur le sujet. S'interrogeant sur les profits réalisés par certains lobbies profitant de la campagne d’enfouissement ou de « séquestration » du CO2, Georges Dillinger mettait en cause la fixation des esprits sur une thèse non prouvée, qui permet de relativiser d’autres en jeux écologiques importants, comme la pollution et le manque d’eau, la détérioration des sols, la déforestation, la régression de la diversité biologique ou, comme on peut le constater dans l’actualité, les ravages de la malbouffe. Pour Stanislas de Larminat, réduire le CO² ne sert à rien... sinon peut-être à maintenir le continent africain en état de dépendance.
En dénonçant l'idéologie du réchauffisme, ce luxe de pays développé, il ne s'agit donc pas de sauver un système, puisque c'est ce même système qui tente de survivre à coups de milliards (avec des taxes en tout genre comme la taxe carbone) tout en voulant empêcher le développement des pays pauvres.
Etre CO²-sceptique, ce n'est pas se moquer de l'environnement.
En 2008 déjà, Benoît XVI plaidait pour "une écologie de l'Homme" fondée sur le respect de la distinction entre hommes et femmes, prenant le contre-pied de l'idéologie du genre. Lorsque l'Eglise catholique prend la défense de la Création, oeuvre de Dieu,
"elle ne doit pas seulement défendre la terre, l'eau et l'air (...) mais aussi protéger l'homme contre sa propre destruction [...] si les forêts tropicales méritent notre protection, l'homme (...) ne la mérite pas moins [...] Une écologie de l'homme, justement comprise, est nécessaire [...] parler de la nature de l'être humain comme homme et femme et demander que cet ordre de la création soit respecté ne relève pas d'une métaphysique dépassée [...] L'homme veut se faire seul et disposer seul de ce qui le concerne, mais en agissant ainsi il vit contre la vérité, il vit contre son créateur".
Et l'encyclique Laudato Si du pape François nous appelle à cette écologie intégrale :
"Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps àretrouver l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée»."
Le problème de la COP21 et du réchauffisme en général, c'est de croire encore que l'on peut sauvegarder l'environnement sans respecter la personne humaine. Dans le dernier numéro de L'Homme Nouveau, le père Yannick Bonnet écrit, à propos de la manipulation des médias :
"L’important, bien sûr, c’est de sauver la planète ! La profonde stupidité de ce slogan échappe à l’esprit de nos jeunes, qui ignorent qu’avant la présence des hommes, ladite planète avait subi des percussions violentes de météorites colossaux, des éruptions volcaniques ravageuses et des variations de températures et de niveau des océans, considérables. Et personne ne nous explique comment l’on contrôlera les variations d’émissions énergétiques du soleil, comment on évitera les chocs de météorites et comment on domptera le volcanisme. Comment se fait-il que si peu de nos contemporains ne soient pas frappés par le fait que ce discours dominant « pue » l’orgueil et une volonté sous- jacente de domination mondiale, servie par des moyens financiers incontrôlés ?
En décembre, Stéphanie Bignon, éleveur dans le Brionnais, appelait simplement à respecter les saisons et les personnes :
"Sauver le climat quand on ne respecte pas les saisons c’est du volontarisme révolutionnaire. La réalité de l’échelon local est méprisée au profit de l’idéologie et de la toute-puissance du Régime globalisateur. Le propre de l’idéologie est de s’intéresser à l’universel, au global sans partir du particulier. [...]
Mais il faut aller jusqu’au bout du raisonnement et réaliser que tout de nos vies est décidé à notre place (naissance, éducation, mariage, mort…) par un système de plus en plus jacobin et mondial auquel toute formation politique doit faire allégeance pour exister. [...]"
L'idéologie (monocausale, étatique, révolutionnaire...) du réchauffisme nous empêche de nous pencher sur les vrais sujets environnementaux. Pour en sortir, il faut d'abord retrouver notre liberté, cesser de confier à l'Etat nos faux-problèmes : ce n'est pas la COP21 ni la COP22 qui règleront la température de la Terre... Les idéologues du réchauffisme nous polluent car ils veulent maintenir leur volonté de puissance, leur étatisme, en nous culpabilisant. C'est à nous de changer nos modes de vies. D'être des dissidents dans tous les domaines. Sur le plan médiatique avec ce blog et les autres contre-médias, sur le plan scolaire, en soutenant les écoles libres, nées de l'initiative privée. Et pour lutter contre le gaspillage et apprendre à user avec mesure de chaque chose, rien de mieux qu'une bonne éducation, les familles nombreuses en savent quelques chose. Pas besoin de l'Etat et de son tri sélectif. De façon similaire, il existe déjà de nombreuses initiatives privées et locales dans le domaine de l'alimentation (panier des familles, livraisons directes entre éleveurs/producteurs et consommateurs,...) et même commercial, grâce notamment à l'essor d'internet, qui permet par exemple la vente en direct et le recyclage (adieu les grandes surfaces made in China, bienvenue aux marchés privés -notamment scolaires- et aux Gens de confiance...).
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/01/ce-que-le-r%C3%A9chauffisme-occulte.html
Enquête sur l’huître triploïde qui représente plus de 50% du marché français. Au menu : hécatombe dans les parcs ostréicoles depuis 2008. Aperçu du rôle trouble de l’Ifremer, censé contrôler la production ostréicole, et qui détient pourtant le monopole de la vente des huîtres génétiquement trafiquées en France. Enfin, grand angle sur des ostréiculteurs qui se battent pour commercialiser (et le signaler aux clients) des huitres « naturelles ».
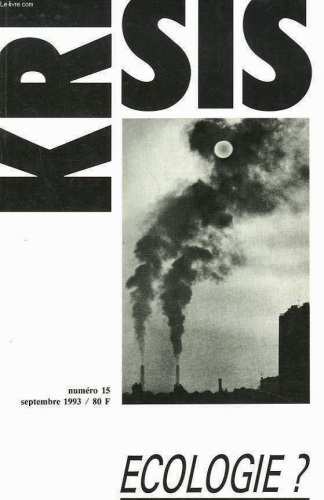 Ces positions ont permis le rapprochement entre ces théoriciens conservateurs, en particulier Goldsmith, et l’école de pensée connue sous le nom de « Nouvelle Droite ». En effet, son principal théoricien, Alain de Benoist, s’est rapproché durant les années 1990 des milieux écologistes. En 1993, il consacre un numéro de sa revue Krisis à cette question tandis qu’un numéro d’Eléments, publie un dossier sur l’écologie. Cette même année voit le XXVIIe colloque annuel du GRECE, la principale structure néo-droitière, consacrée aux « Enjeux de l’écologie ». Par la suite, un livre de Goldsmith, Le défi du XXIe siècle, est même vendu dans les pages centrales de celui-ci. Edward Goldsmith participe en 1994 au XXVIIIe colloque annuel du GRECE (« Gauche-droite : la fin d’un système »). Cette politique eut quelques succès. Antoine Waechter dialogua avec la Nouvelle Droite, un dialogue facilité par le fait que celui-ci refuse de positionner l’écologie sur l’échiquier politique. Dans un entretien accordé à Krisis en 1993, il affirme que« l’écologie politique s’accompagne d’une philosophie de l’action complètement distincte de celle portée par le clivage gauche-droite, qui structure le paysage politique français depuis deux siècles et montre aujourd’hui des signes d’essoufflement évident ».
Ces positions ont permis le rapprochement entre ces théoriciens conservateurs, en particulier Goldsmith, et l’école de pensée connue sous le nom de « Nouvelle Droite ». En effet, son principal théoricien, Alain de Benoist, s’est rapproché durant les années 1990 des milieux écologistes. En 1993, il consacre un numéro de sa revue Krisis à cette question tandis qu’un numéro d’Eléments, publie un dossier sur l’écologie. Cette même année voit le XXVIIe colloque annuel du GRECE, la principale structure néo-droitière, consacrée aux « Enjeux de l’écologie ». Par la suite, un livre de Goldsmith, Le défi du XXIe siècle, est même vendu dans les pages centrales de celui-ci. Edward Goldsmith participe en 1994 au XXVIIIe colloque annuel du GRECE (« Gauche-droite : la fin d’un système »). Cette politique eut quelques succès. Antoine Waechter dialogua avec la Nouvelle Droite, un dialogue facilité par le fait que celui-ci refuse de positionner l’écologie sur l’échiquier politique. Dans un entretien accordé à Krisis en 1993, il affirme que« l’écologie politique s’accompagne d’une philosophie de l’action complètement distincte de celle portée par le clivage gauche-droite, qui structure le paysage politique français depuis deux siècles et montre aujourd’hui des signes d’essoufflement évident ».