NOTICE ROUGE D'INTERPOL
Source
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
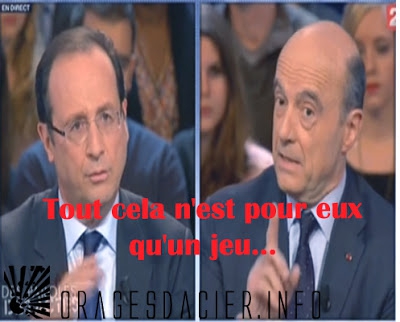
Le Figaro N°20 991
L’économiste souverainiste n’en pose pas moins expressément trois conditions de réussite : établissement d’un contrôle des mouvements de capitaux, remise de la Banque de France sous tutelle gouvernementale, réutilisation du levier des taux d’intérêt
Pour la plupart des spécialistes, une sortie de la France de la zone euro serait une catastrophe. Pas pour Jacques Sapir. L’économiste souverainiste renverse même la perspective en expliquant qu’“une sortie de l’euro est nécessaire si l’on veut éviter une catastrophe non seulement en France, mais aussi en Europe”. Balayant les unes après les autres les objections avancées contre cette sortie – les traités ne la prévoient pas, les dettes exploseraient, etc. – Jacques Sapir n’en pose pas moins expressément trois conditions pour une sortie réussie de l’euro : établissement d’un contrôle des mouvements de capitaux, remise de la Banque de France sous tutelle gouvernementale, réutilisation du levier des taux d’intérêt. “Il s’agit ni plus ni moins de passer d’une situation de libéralisation financière totale à une situation de finance contrôlée” explique-t-il en esquissant en détail le scénario de cette bascule lors d’un week-end qu’il qualifie lui-même de “crucial”. Mais pour Jacques Sapir, aucun doute, l’opération ne peut être que bénéfique. “L’incertitude ne porte pas sur la mécanique de ce changement, qui est assez bien maîtrisée, mais sur ses effets. Ces derniers seront-ils positifs ou… très positifs ?” lance-t-il avec une belle assurance.
Propos recueillis par Philippe Plassart
Une sortie de l’euro est possible et nécessaire si l’on veut éviter une catastrophe, non seulement en France mais aussi en Europe. Or si la France sort de l’euro, alors l’euro se disloquera à coup sûr et n’existera plus en réalité. Cela veut dire que les Français – et avec eux les Italiens – ont d’une certaine manière l’avenir de l’Europe entre leurs mains. Cela relève de leur responsabilité. La zone euro se désagrégerait parce que le choc de compétitivité consécutif à la sortie de la France – et/ou de l’Italie – sera beaucoup trop élevé à supporter par les autres pays. L’effet de dislocation serait rapide : si l’Italie sortait la première de la zone, la France lui emboîterait nécessairement le pas quelques semaines après. Et si la France décidait de sortir la première, l’Italie sortirait en même temps. Je pense à l’Italie parce que quand on regarde les statistiques de croissance de ce pays, notamment l’évolution du PIB par habitant, la situation est dramatique. Et en Italie, le scénario d’une sortie de l’euro est ouvertement posé sur la table, que ce soit par le mouvement 5 étoiles, Forza Italia (qui est l’équivalent un peu plus à droite des Républicains chez nous) ou Berlusconi, qui se montre de plus en plus eurosceptique.
L’euro, un handicap pour la croissance
La sortie de l’euro est souhaitable et possible. Elle est souhaitable parce que l’on constate que la croissance dans la zone, y compris l’Allemagne, est durablement depuis 1999 inférieure, de l’ordre 1 point, à la croissance des autres pays européens hors zone euro. Et si on retire l’Allemagne, l’écart de croissance au détriment de la zone euro est encore plus élevé (1,3 %). Sur une quinzaine d’années, le gap est considérable. Le décrochage se fait sentir avant même la création de l’euro dans les années 1996/1999, c’est-à-dire à partir du moment où les pays font des efforts d’ajustement, en vue précisément de se qualifier dans la zone euro. Depuis lors, tous les pays hors de la zone euro, que ce soit la Norvège, la Suède ou la Grande-Bretagne, font mieux que les pays de la zone. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est ce qui se passe au niveau de l’investissement.
“On constate que la croissance dans la zone, y compris l’Allemagne, est durablement depuis 1999 inférieure, de l’ordre 1 point, à la croissance des autres pays européens hors zone euro”
Dans la zone euro, celui-ci stagne et est toujours à peu de chose près à son niveau de 1999. Et rapporté à la population, le recul du flux d’investissement par tête – le ratio qui compte, car c’est lui qui conditionne la croissance future d’une économie – est tout à fait impressionnant, sauf en France où l’investissement public a été maintenu au prix d’un déficit important des finances publiques. Mais même en tenant compte de cette spécificité, l’investissement par tête demeure inférieur depuis 1999 en France par rapport à la Grande-Bretagne, et très inférieur par rapport à la Suède. Ce déficit de croissance et d’investissement s’explique par le frein qu’exerce l’euro du fait de l’impossibilité d’ajuster le change vis-à-vis en particulier de l’Allemagne, et qui pèse sur la compétitivité. Cet effet est très visible sur l’agriculture. Il y a un point extrêmement important qui doit être pris en considération : les besoins d’investissement sont en France très différents de l’Allemagne. Outre-Rhin, l’investissement est trop faible, ce qui est dommageable, mais en même temps, les besoins sont moindres du fait de la diminution de la population.
Le corset préjudiciable d’un change fixe
Si nous étions restés avec les monnaies nationales, le franc se serait déprécié de 10 % par rapport au cours de l’euro actuel, tandis que le mark se serait apprécié d’environ 25 % à 30 %. Cet ajustement monétaire – au total de l’ordre de 40 % – qui n’a pas eu lieu explique la quasi-totalité des difficultés du porc et du lait français qui souffrent de la concurrence allemande. Il y a d’une part cet effet de la fixité des changes, et il y a eu aussi l’effet de la surévaluation de l’euro vis-à-vis du dollar entre 2002 et 2014. L’euro, avant d’être une monnaie, est avant tout un système de change fixe intra-européen qui rend impossible les ajustements pourtant nécessaires.
“Si nous étions restés avec les monnaies nationales, le franc se serait déprécié de 10 % par rapport au cours de l’euro actuel, tandis que le mark se serait apprécié d’environ 25 % à 30 %”
De ce point de vue là, il est comparable à l’étalon or dans les années 30 qui a joué, à l’époque, un rôle néfaste dans l’approfondissement de la crise. Il est essentiel de laisser la possibilité aux monnaies s’ajuster, en particulier en période de crise. Certes bien sûr, dans un régime de changes flottants, la spéculation existe, mais cette dernière peut être largement combattue par des politiques de contrôle des capitaux. Le change fixe nous oblige à mener une politique de dévaluation interne en pesant sur les salaires et sur l’emploi. Ce qui ne va pas sans poser de problèmes politiques. Dans les pays à faible croissance, le chômage augmente, ce qui accroît les problèmes sociaux. D’après mes calculs, environ 1,1 million de chômeurs supplémentaires en France peuvent être attribués à l’euro sur la période 2008-2015. Et l’on retrouve la même équation en Italie ou en Espagne du fait des politiques d’ajustements mise en place pour “sauver” la zone euro.
Le risque d’une voie fédérale au rabais
Deuxième point, tout aussi important : la constitution de l’euro a retiré l’arme de la politique monétaire des mains du gouvernement. Et par voie de conséquence, dans un système de change fixe, l’autonomie de la politique budgétaire. Un abandon qui a même été institutionnalisé par le TSCG [traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ndlr] voté en septembre 2012. Résultat : les Parlements nationaux, quand ils votent le budget, deviennent de pures chambres d’enregistrement, ce qui fait éclater l’un des fondements de la démocratie.
“Le seul moyen pour faire coexister des États ayant des économies et des structures très différentes, à l’instar des États fédérés des États-Unis, c’est l’existence d’un budget fédéral tout à fait important”
Le seul moyen pour faire coexister des États ayant des économies et des structures très différentes, à l’instar des États fédérés des États-Unis, c’est l’existence d’un budget fédéral tout à fait important (aux États-Unis, les dépenses fédérales représentent 60 % des dépenses totales). Mais cela impliquerait au premier chef l’acceptation par l’Allemagne d’une multiplication par 6,5 du montant des transferts bruts, de 41 milliards d’euros aujourd’hui à 240 milliards, voire 280 milliards. Soit l’équivalent de huit points de son PIB. Ce qui est impensable. Dans ces conditions, le pire risque serait d’emprunter une voie fédérale au rabais, c’est-à-dire où les décisions fiscales et budgétaires seraient fédéralisées, mais sans flux de transfert. Ce scénario serait la chronique de la mort annoncée de nos économies.
L’euro, un processus réversible
On connaît les objections à une sortie de l’euro. La première : elle n’est pas prévue dans les traités. Il faut faire preuve d’un minimum de réalisme : en politique, les traités, “on s’assoit dessus”. Les traités ne servent que les jours de beau temps, pas dans la tempête. C’est si vrai que durant la dernière crise grecque, certains n’ont pas hésité à menacer d’expulser la Grèce de la zone euro, procédure qui n’est pourtant pas prévue dans les traités ! Si l’hypothèse d’une expulsion d’un pays de la zone euro est envisageable, pourquoi une sortie volontaire ne le serait-elle pas ? Un autre argument est parfois mis en avant contre une sortie de l’euro : les liaisons inextricables des contrats libellés en euros entre eux. Un faux argument : tous les contrats peuvent être re-libellés dans les monnaies anciennes. C’est si vrai que les banques londoniennes ont maintenu dans leurs comptes des lignes avec les monnaies préexistantes des pays de la zone euro. Même si elles sont inscrites à zéro, des lignes en francs français existent toujours à Londres ! Et il y en a aussi en deutschemarks, en lires, en pesetas… Du jour où la zone euro est dissoute, il sera possible instantanément de re-libeller les contrats.
Le quasi faux problème des dettes
Les arguments avancés contre une sortie de l’euro jouent sur la peur irrationnelle et sur la méconnaissance de la population. Les sujets étant techniques, on peut facilement effrayer les gens. En ce qui concerne la dette publique, le principe de base est que la dette est libellée dans la monnaie du pays signataire du contrat. Pour l’heure, la dette française est libellée en euros, puisque la monnaie ayant cours légal en France est l’euro. Mais si demain, la France décide que sa monnaie redevient le Franc, la dette française sera libellée en francs. Ce principe figure dans tous les manuels de droit. Actuellement, à peine 3 % de la dette publique française n’est pas libellée depuis Paris, mais en contrats étrangers (essentiellement des contrats négociés à la City). Cette proportion est beaucoup plus élevée dans un seul pays, la Grèce, qui a, à cause de la crise, émis beaucoup de titres de dette non pas depuis Athènes mais depuis Francfort, voire Paris. En cas de dissolution de la zone euro, les Grecs auraient de ce fait un problème et devraient probablement faire défaut sur leur dette. Mais pour la France, les choses se présenteraient très différemment.
“Si demain, la France décide que sa monnaie redevient le Franc, la dette française sera libellée en francs”
La dette en euro serait convertie en franc au cours de un pour un. Puis en fonction de l’évolution du franc, qui est appelé à se déprécier – c’est l’un des buts recherchés – sur le marché des changes. Mais par rapport à la lire qui nous accompagne dans le mouvement, la situation française sera plus favorable. Et puis parallèlement, la France (et l’Italie) mettrait en place un circuit de financement interne en opérant une sorte de renationalisation de la dette. Et comme dans ce scénario, l’économie se redresse – et avec elle les comptes publics –, les besoins de financement de la dette se réduisent pour ne concerner que les émissions de renouvellement de la dette arrivée à maturité. L’enjeu ne porte plus que sur la partie “roulée” de la dette. Un raisonnement rassurant peut aussi être tenu pour la dette des ménages, qui ressort à 98,5 % du droit français. Le problème ne se pose que pour une partie infime de la dette des ménages (1,5 %).
Pour la dette des entreprises, le problème est plus compliqué – pas pour les PME et ETI qui se sont endettés avec des contrats de droit français, mais pour les grandes entreprises, pour qui les contrats en droit étranger représentent 40 % du montant de leur dette. Sauf que si une partie de leurs dettes est réévaluée vis-à-vis des monnaies en hausse par rapport au franc, leur chiffre d’affaires réalisé dans ces pays le sera tout autant. Si bien que pour elles, les choses s’équilibrent à peu près. Quant aux banques et aux assurances, elles ont largement rapatrié leur capital après la crise financière et ont recentré leur activité en France. L’impact global d’une sortie de l’euro serait, via les comptes de leurs filiales étrangères, des pertes comprises entre 0 et au pire 5 milliards d’euros. Il n’y a que pour les banques et les assurances espagnoles que les dégâts ont une certaine ampleur, ce qui pourrait justifier le maintien d’aides européennes de façon transitoire pour lisser le choc. Au total, quand on prend tous les compartiments de la dette, le retour aux monnaies nationales ne pose pas de problème insurmontable, excepté pour la Grèce. L’hypothèse d’une nécessaire renationalisation des banques ne concerne que les pays qui subiraient un choc bancaire important – la Grèce et sans doute l’Espagne, mais pas la France.
Les trois conditions d’une sortie de l’euro réussie
Les taux de change correspondent fondamentalement à l’état des balances des paiements et à des balances commerciales qui jouent comme force de rappel. C’est la raison pour laquelle nous tablions dans un chiffrage établi en 2013 avec Philippe Murer [Philippe Murer a rejoint le Front national en 2014 et est devenu conseiller économique de Marine Le Pen, ndlr] et Cédric Durand sur une dépréciation du franc de l’ordre de 10 %, qui pourrait aller, cela n’est pas à exclure, jusqu’à -20 %. Il y aurait en même temps un mouvement inverse d’appréciation du deutschemark. Ces mouvements justifieraient que l’on réintroduise entre les pays des mécanismes de contrôle des mouvements de capitaux. Ce sera même indispensable. Comme il sera indispensable de rehausser encore le niveau de surveillance du système bancaire dans la ligne du renforcement opéré dans le cadre de l’Union bancaire. Enfin, il faut passer à un nouveau mode de financement de la nouvelle dette, pas de la dette ancienne. Et à cette fin, il faudra renationaliser la Banque de France en vue de rompre avec le cadre financier mis en place à l’occasion du traité de Maastricht. Cet élément est clé : il faut que la Banque de France puisse racheter de la dette publique en monétisant partiellement cette dernière. C’est une mesure extrêmement importante de nature à faire pivoter le système financier français vers un cadre dit de “répression financière”, celui-là même qui est de plus en plus défendu par les experts du FMI, par opposition à la finance libéralisée.
“Ces mouvements justifieraient que l’on réintroduise entre les pays des mécanismes de contrôle des mouvements de capitaux”
Répression financière ? Je n’aime pas trop cette terminologie qui laisse croire que l’on “réprime” la finance. Concrètement, ce cadre repose premièrement sur la remise de la Banque centrale sous la tutelle du gouvernement. La Banque centrale, redevenue l’instrument du gouvernement, peut racheter une partie des titres de dette publique à des taux qui peuvent être à zéro. Un rachat à l’émission de 20 à 30 % des titres de dette constitue une enveloppe suffisante pour assurer la liquidité du marché interbancaire, il est inutile que la Banque centrale achète 100 % des titres. La Banque centrale doit ensuite reprendre la main sur la fixation des taux d’intérêt, comme le Conseil national du Crédit l’a fait dans les années 60 ; de la sorte, elle pourra imposer une baisse des taux d’intérêt réels. Il est vrai que les taux d’intérêt nominaux n’ont jamais été aussi bas qu’actuellement mais parallèlement, l’inflation n’a jamais été aussi basse, si bien qu’on se retrouve avec des taux d’intérêt réels élevés, de l’ordre de 3 à 4 %.
“Les taux d’intérêt nominaux n’ont jamais été aussi bas qu’actuellement mais parallèlement, l’inflation n’a jamais été aussi basse, si bien qu’on se retrouve avec des taux d’intérêt réels élevés, de l’ordre de 3 à 4 %. Des niveaux de taux meurtriers”
Des niveaux de taux meurtriers pour les entreprises et pour les financements des grands projets d’investissements, qui requièrent des taux de 1 %, voire 1,5 % au maximum. Pouvoir actionner le levier des taux d’intérêt sur l’économie est indispensable. Or dans un système de liberté totale de circulation des capitaux, cette reprise en main n’est pas possible. Ré-introduire le contrôle des capitaux, reprendre le contrôle de la Banque de France et de la fixation des taux d’intérêt : ces mesures forment un tout indissociable et nécessaire qui s’appelle la politique de répression financière. Est-ce une rupture ? Assurément oui par rapport à ce qui existe aujourd’hui, mais pas par rapport au passé. Ce système, qui est celui qui fonctionne en Chine et dans d’autres pays, nous renvoie au modèle de financement de l’économie qui prévalait grosso modo jusqu’à la fin des années 70. Si le contrôle des mouvements de capitaux à court terme est impératif, il n’y a en revanche aucune raison de contrôler les mouvements de capitaux à long terme. Actuellement, sur les marchés des changes, 97 % des volumes traités sont à moins de trois jours.
Les jours cruciaux du scénario de sortie
Le candidat qui fera la proposition de sortir de l’euro devra indiquer vers quoi il veut diriger le pays – “l’euro est condamné, il faut retrouver notre souveraineté monétaire” – mais il ne doit rien dire quant aux moyens ne serait-ce que pour maintenir les marchés dans un état d’incertitude. Par contre, dès qu’il sera élu et qu’il aura pris ses fonctions, ce (ou cette) Président(e) devra agir très vite, parce que de toutes les manières, la France sera l’objet d’attaques spéculatives importantes. À ce stade, l’idée d’organiser un référendum sur la sortie de l’euro post-élection présidentielle ne tient pas opérationnellement. Une attaque spéculative – avec hausse brutale des spreads sur les taux d’intérêt – pourrait toutefois servir au nouvel exécutif pour considérer que le bon fonctionnement des institutions est mis en cause. Un constat qui pourrait lui donner une bonne raison de déclencher l’article 16. Cela lui permettrait dans une période pas nécessairement très longue de prendre des mesures décisives, comme d’organiser la sortie de l’euro, prendre le contrôle sur la Banque de France, instaurer le contrôle des capitaux, avoir un œil sur les banques pour être sûr qu’elles ne fassent pas de bêtises.
Personnellement, je ne fais pas trop confiance à nos banquiers. Il n’y a qu’à voir le lobby d’enfer qu’ils ont fait pour éviter de séparer les banques de dépôts des banques d’affaires… L’impératif sera dans ces circonstances d’agir vite, impérativement en moins d’un mois et même plus vite dans la mesure du possible. La sortie de l’euro sera une opération importante en termes de mesures à prendre sur le plan réglementaire. Il s’agit ni plus ni moins de passer d’une situation de libéralisation financière totale à une situation de finance contrôlée. Une bascule qui doit être techniquement préparée très soigneusement en amont, avant même l’élection présidentielle. Mais une fois la mécanique lancée, les événements peuvent se dérouler vite. L’annonce de la décision de sortir doit naturellement être prise en concertation avec les autres membres de la zone euro. Le Président français téléphone à la chancelière allemande, au président du conseil italien, au Premier ministre espagnol pour leur annoncer l’intention de la France de sortir de la zone euro.
“L’impératif sera dans ces circonstances d’agir vite, impérativement en moins d’un mois et même plus vite dans la mesure du possible”
Et il leur demande s’ils sont d’accord pour décider une auto-dissolution de la zone à l’occasion d’une conférence qui aurait lieu quelques jours plus tard ou, s’ils préfèrent, laisser les Français agir seuls. Dans cette dernière hypothèse, le Président français en prendrait acte et il n’y aurait rien à négocier. L’essentiel sera de tenir le cap et de savoir par quel chemin y aller. Ces heures cruciales devront être naturellement les plus courtes possibles pour ne pas laisser le temps aux marchés d’imaginer d’autres scénarios – les marchés sont très imaginatifs ! – qui pourraient contrecarrer la marche à suivre. Il faudra savoir où aller, comment, et s’y tenir. Des instruments spécifiques peuvent être mobilisables mais à ce stade, je préfère rester discret sur eux.
“Le scénario de loin préférable est le suivant :”
1) Décision de sortie prise dans la nuit du vendredi au samedi. 2) Information et consultation de nos partenaires le samedi. 3) Mise en place des instruments techniques de la sortie le dimanche. 4) Bascule opérationnelle le lundi matin, plaçant les marchés – et les agents économiques – devant le fait accompli. Les euros s’appellent les francs, actifs et dettes sont libellés en francs. J’ai testé ce scénario auprès de professionnels. Il tient la route. Ce qui a été fait dans un sens – passer en 1999 des monnaies nationales à l’euro –, il est possible de le faire dans l’autre sens. Sans doute faudra-t-il fermer la bourse et le marché des changes pendant trois jours. Un laps de temps qui ne pose pas de problèmes majeurs. Certes, il y aura certainement inévitablement des tentations de fuites de capitaux. Ce ne sont pas les valises qui sont les plus déstabilisantes, mais les comptes des entreprises. Il faudra être extrêmement vigilants.
Les effets attendus d’une sortie de l’euro
Certes tout n’est pas prévisible et il demeure des incertitudes. Pour moi, l’incertitude majeure ne porte pas sur la mécanique de ce changement, qui est assez bien maîtrisée, mais sur ses effets. Ces derniers seront-ils positifs ou… très positifs ? D’après les premiers calculs de Cédric Durand et Philippe Murer, une sortie de l’euro générerait 3,5 millions d’emplois. Une estimation haute car passé le lot des nouvelles embauches, les plus faciles à réaliser, la situation du marché tend à se durcir au fur et à mesure qu’elle concerne les salariés les moins bien formés. Si bien que nous avons convenu avec mes deux collègues de réduire l’effet net positif prévisible à 2 millions d’emplois. Ce qui n’est déjà pas si mal.
L’idée d’un Front de libération nationale
J’ai parlé de la constitution d’un Front de libération nationale, terme qui a été employé pour la première fois par Stefano Fassina, un ancien ministre italien et ancien dirigeant du PCI. Mon approche est ici plus politique qu’économique. Ce front pourrait inclure toute une série de partis, on pense au Parti de Gauche et à Debout la France, mais aussi inclure une partie des députés issus des Républicains, l’aire politique des partisans d’une sortie de l’euro étant assez large. Les évolutions récentes du discours des dirigeants du Front national posent désormais le problème de sa possible participation.
“La bataille de l’euro doit amener à des rapprochements, même avec des gens avec qui on peut avoir de graves désaccords”
Quoi qu’il en soit, la bataille de l’euro doit amener à des rapprochements, même avec des gens avec qui on peut avoir de graves désaccords, car on voit bien que parmi les partisans de l’euro se constitue une “sainte alliance” des possédants, bien décidée à tout faire pour conserver l’euro. Il faut ici citer Louis Aragon qui, dans le poème ‘La Rose et le Réséda’, écrivait en 1943 ceci : “Celui qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas / (…) Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat / Fou qui songe à ses querelles / Au cœur du commun combat”.
Une approche globale de la souveraineté
La souveraineté, qui est nécessaire pour l’exercice de la démocratie, ne se découpe pas en tranches. Elle est globale et doit inclure la souveraineté monétaire. Mon plaidoyer pour un retour au franc ne repose que très peu sur l’idée qu’il faudrait à tout prix récupérer ce symbole de notre souveraineté – un argument somme toute assez limité – mais sur le constat des effets néfastes de l’euro sur notre économie, notre société politique, et plus généralement sur la société française. Mon approche de la souveraineté relève de la question de la démocratie. Il y a eu historiquement – et il y a encore – beaucoup d’États souverains qui n’étaient pas démocratiques, mais on ne compte pas un seul État démocratique qui n’est pas souverain. Le droit ne peut être défini uniquement en légalité, il doit l’être aussi en légitimité. Le pouvoir de dire ce qui est légal, une cour, un tribunal l’ont, mais dire le juste renvoie nécessairement à un consensus social qui ne peut se forger qu’au sein d’un corps politique rassemblé et capable de prendre des décisions.
“Il y a eu historiquement – et il y a encore – beaucoup d’États souverains qui n’étaient pas démocratiques, mais on ne compte pas un seul État démocratique qui n’est pas souverain”
C’est cela pour moi la souveraineté. Cette conception n’a rien à voir avec une approche beaucoup plus fondamentaliste de la souveraineté, qui renverrait par exemple à l’idée même de Dieu… La Banque centrale européenne est ainsi un organisme légal mais qui n’a pas de légitimité, non pas au sens où elle n’est pas légitime à faire ce qu’elle fait, mais elle n’a pas de légitimité au sens où elle n’exprime pas un peuple européen. Certes, la théorie même de la souveraineté accepte l’idée de transferts de souveraineté, mais elle ne parle pas d’abandons. Et une délégation de transferts dans un sens, une décision en sens inverse peut l’annuler. C’est un processus réversible. La démocratie ne peut exister que dans le cadre national. Pour qu’il y ait démocratie en Europe, il faudrait qu’il y ait un peuple européen. Or ce dernier n’existe pas. Le fait de revendiquer le souverainisme n’implique pas de vouloir constituer un isolat sans avoir de contact avec les autres. Les relations entre pays, l’histoire l’a montré, peuvent être coopératives, voir Ariane ou Airbus, qui étaient au départ des projets entre nations avant de devenir européens. Le retour au franc est un moyen de reconstruire la démocratie, que ce soit la démocratie politique, économique ou sociale. Il doit permettre la nécessaire remise en cohérence de ces trois plans, notamment par la lutte contre le chômage et les discriminations, afin de redonner à chacun le contrôle de ses conditions d’existence. Un objectif qui ne me paraît pas possible sans une monnaie nationale.
Jacques Sapir est docteur en économie, spécialiste de l’ex-URSS et la Russie, directeur de recherches à l’EHESS. Il a présenté en 1986 sa thèse sur les modes de régulation de l’économie soviétique sous la direction de Michel Aglietta. Il dirige depuis 1996 le Centre d’études des modes d’industrialisation de l’EHESS, et enseigne en parallèle à l’Ecole économique de Moscou. Économiste à la gauche de la gauche, convaincu du “retour des nations” et de la nécessité du protectionnisme, il s’est progressivement rapproché de la mouvance souverainiste dont il plaide le regroupement des composantes sous l’égide d’un Front de libération nationale, dont il n’exclut plus expressément, dans cet entretien, le Front national. Signe révélateur : il est intervenu, via une vidéo enregistrée dans un atelier consacré au thème “L’Europe après le Brexit”, au rassemblement du Front national de Fréjus le 17 septembre dernier.
Hallucinant mais tellement prévisible :
"Seize anciens commissaires européens de la Commission José Manuel Barroso, qui ont quitté leur poste en 2014, perçoivent toujours des versements mensuels de plus de 8000 euros, rapporte l’hebdomadaire allemand Die Zeit.
Cela s’appelle l’allocation transitoire. Elle permet d’éviter des conflits d’intérêts et d’empêcher les commissaires d’accepter des postes clés dans les secteurs de l’industrie immédiatement après avoir quitté leur poste à la Commission européenne. Le problème ? Ces allocations sont l’équivalent de leur salaire d’antan qui était alors faramineux (...).
On y apprend que la plupart de ces commissaires concernés ont depuis belle lurette retrouvé de hauts postes extrêmement bien rémunérés« en tant que lobbyistes, gestionnaires ou membres d’autres bureaux politiques » (...)"
Être propriétaire d’une maison ou d’un appartement, c’est avantageux. Cependant, n’oublions pas les charges qui vont avec. L’une des plus importantes est la taxe foncière, et le montant augmente de plus en plus chaque année, notamment dans certaines régions.
La taxe foncière, c’est quoi au juste ?
La taxe foncière est un impôt dont tous les propriétaires d’un bien immobilier doivent s’acquitter chaque année. Cette somme est ensuite remise aux régions respectives. Cet impôt est à payer en plus de la taxe d’habitation s’il s’agit de votre résidence principale. Le montant à payer dépend de chaque commune.
À chaque commune sa taxe.
En effet, le montant de la taxe à payer varie selon chaque commune. Elle fixe un taux d’imposition (qui est voté par les collectivités locales). C’est à partir de ce taux que le montant de la taxe est calculé, ainsi qu’en fonction de la valeur locative cadastrale du bien imposable.
Pour faire clair, c’est ce taux d’imposition qui fait varier le montant de la taxe à payer par zone géographique.
Évolution des taxes foncières.
Si l’on se réfère aux chiffres publiés par l’UNPI (Union National des Propriétaires Immobiliers), les communes sont de plus en plus gourmandes en matière de taxes foncières. Entre 2010 et 2015, le montant de cet impôt a connu une forte hausse, et cela, sur toute la France (+14,7% en 5 ans).
Résultat, la facture s’alourdit pour les propriétaires immobiliers, spécialement dans la défiscalisation immobilière. La plus forte hausse concerne les propriétaires de la région lilloise, où la taxe a augmenté de 23% depuis 2010. Les habitants d’Angers ne sont pas en reste, ainsi que ceux de Clermont-Ferrand, Lyon ou encore Créteil, avec une hausse respective de près de 20%.
Toutefois, certaines villes ont choisi de ne pas mettre la barre trop haute. Des villes comme Grenoble, Nice ou encore Roubaix ont enregistré une hausse d’environ 7%, toujours depuis 2010.
Et l’année 2016 ?
Le bilan publié par l’UNPI le 13 octobre dernier est sans appel. Pour l’année 2016, la liste des départements qui ont choisi d’augmenter la taxe foncière s’est allongée par rapport à l’année 2015. Pas moins de 35 départements ont augmenté le montant de leurs taxes foncières cette année.
La palme de la hausse la plus importante revient au département des Yvelines avec une augmentation de… 68%. C’est tout simplement le record en matière de taxe foncière.
Cette hausse parait démesurée comparé aux chiffres enregistrés dans le Val d’Oise, le Nord, et le Loir-et-Cher, qui affichent pourtant des augmentations respectives de 30%, 27% et 26%.
Toutefois, si les unes taxent plus leurs habitants, d’autres villes comme Nantes, Lille ou encore Argenteuil ont décidé de rester sous la barre des 15%. Mieux encore, d’autres communes, à l’instar de Paris, n’ont pas changé (ou presque) leurs taux d’imposition, pour le plus grand bonheur des propriétaires immobiliers.
http://www.medias-presse.info/taxe-fonciere-des-records-de-hausse/62903
Jean Vincent Placé, sénateur dissident écologiste devenu secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de la simplification, avait annoncé le 11 mars dernier une « simplification massive » des procédures concernant les énergies renouvelables. Il avait également indiqué qu’il allait charger son allié le député Denis Baupin à siéger au Conseil de la simplification pour les entreprises.
Sous le nom de Repowering, Jean Vincent Placé vient d’annoncer la publication d’un décret concernant la suppression des demandes de permis de construire préalables pour « moderniser » les éoliennes existantes. Cette mesure lorsqu’elle sera publiée officiellement permettra aux promoteurs éoliens d’augmenter la puissance et la hauteur des éoliennes industrielles, c’est à dire de les faire passer de 100 m à 200 m de haut par exemple, sans pratiquement aucune barrière de protection légale pour les riverains.
Au moment où pour les simples citoyens, la loi sur le logement de Cécile Duflot durcit les lois concernant le logement à tel point que la construction d’un abri de jardin devient un casse-tête juridique environnemental, Jean-Vincent Placé et Denis Baupin arrangent la mise en place des 20.000 à 50.000 éoliennes géantes prévues par la Transition énergétique de François Hollande et Ségolène Royal, au mépris des lois de l’environnement et sans aucune protection des riverains ayant à subir les pollutions sonores et lumineuses de ces éoliennes industrielles à seulement 500 mètres de leur habitation.
A titre d’exemple, peut-on imaginer qu’il serait accepté qu’un promoteur immobilier puisse doubler la taille de la tour Montparnasse sans être contraint de déposer au préalable un nouveau permis de construire ?
La Fédération Environnement Durable regrette que depuis plusieurs années, le parti écologiste aie comme objectif obstiné, de couvrir la France de machines industrielles géantes, de supprimer les protections environnementales et particulièrement celles ayant un impact sur la santé, la sécurité, l’environnement des riverains et de dénaturer les paysages de la France.
L’obstination du duo Jean Vincent Placé – Denis Baupin à vouloir modifier coûte que coûte la législation existante sur les éoliennes industrielles, ne peut qu’interpeller et conduit à s’interroger sur les liens qui pourraient exister entre ce groupe et le lobby des nouvelles fortunes industrielles privées construites sur l’économie du vent.
Il s’agit d’une version adaptée à la publication écrite. Cette allocution a été donnée, de façon sensiblement modifiée, le vendredi 21 août de 21h à 22h lors de l’université d’été d’Academia Christiana à Sées.
Les références à l’Encyclique Papale Laudato Si’ qui complètent le propos sont indiquées entre crochets.
L’intervention de ce soir tournera autour du thème suivant : Résister au capitalisme dans un système capitaliste ou les alternatives au capitalisme dans un système capitaliste.
Deux façons d’aborder le sujet suivant, à savoir comment sortir de la matrice : on parlera plutôt d’opposition dynamique que d’alternative. Résister et opposer me semblent être les termes adéquats.
Sur le groupe Facebook, sous le visuel de présentation il est écrit : « Consommation, individualisme, déracinement, peut-on guérir notre société de ces maux ? Peut-on échapper à ces phénomènes ? » Je vais effectivement donner des pistes.
Débutons par un cadrage rapide. La France est un système hybride entre étatisme et capitalisme, notre propos doit donc prendre place dans le cadre national, quand bien même nous sommes dans une société marquée par la mondialisation. Mais on ne peut pas aborder en France une « résistance au capitalisme » sans aborder la résistance à l’Etat.
Si l’omnipotence de l’Etat est pour beaucoup de « libéraux » le signe que la France n’est pas vraiment un pays libéral au sens où eux l’entendent : c’est à dire la liberté complète en matière économique, qui effectivement n’existe pas en France pour la majorité des citoyens, c’est en revanche l’Etat qui a permis au capitalisme de devenir dans notre pays un fait anthropologique total. L’Etat en France, c’est en grande partie l’administration et la bureaucratie. Exemple simple : c’est l’Etat qui a contribué au développement de l’agriculture productiviste, donc de l’industrie-agro-alimentaire, donc des grandes surfaces, donc des zones commerciales, donc de la mort de la paysannerie traditionnelle et des commerces de proximité, de la sociabilité locale au profit de territoires entièrement dédiés à la consommation (et de la vente des centres villes aux enseignes comme H&M, Zara, Starbucks, Subway, Carrefour contact, etc…). Cette consommation entraîne d’importantes mobilités, et ces mobilités sont donc un élément du déracinement et de l’atomisation des rapports sociaux (via la voiture individuelle).
Par cet exemple simple, on comprend mieux le lien entre consommation, déracinement et individualisme. On comprend mieux aussi pourquoi on parlera de « fait anthropologique total ». Le rapport à l’Etat a aussi pour conséquence de renforcer l’individualisme : puisque l’État papa ou l’État maman est là (c.a.d : la version rassurante ou répressive de l’Etat), alors quel intérêt d’entretenir des liens de solidarité ? Nous sommes « seuls ensembles ». On devient un « sujet de l’Etat » et finalement tout le monde accepte tacitement le contrat : payer ses impôts pour avoir des « droits à » mais aussi le « droit de ». La loi prend la place de la coutume (locale) ou de la décence commune (pour replacer direct du Michéa).
Le Leviathan étatique permet l’intégration de la quasi totalité de la population, d’une manière ou d’une autre, au système capitaliste : par la formation (école), par l’aménagement du territoire (routes, permis de construire, grands travaux, etc…), par la culture qui est diffusée (télé, théatre, pub, …), par (tout simplement) les modes de vie, par la consommation (on peut consommer grâce aux aides sociales) [Encyclique Laudato Si’ – VI – 203]. Personne n’échappe réellement à la matrice et l’Etat doit vérifier que rien n’échappe à la matrice. Mais cela n’est pas étonnant, puisque tout pays capitaliste a besoin de l’Etat, au moins pour deux institutions : l’armée et la police. L’armée qui sécurise l’approvisionnement, et la police qui protège la propriété privée et les appareils de production. Mais l’armée et la police ont aussi pour fonction de protéger les citoyens et donc de déplacer le rapport de force des communautés humaines vers les Etats (c’est à dire que les peuples n’entrent plus en confrontation que si l’Etat le décide).
Par conséquent, je disais dès le début que résister au capitalisme c’était résister à l’Etat, mais résister à l’Etat c’est se mettre hors la loi. C’est donc la quadrature du cercle, comment résister au capitalisme de façon légale ? A la lumière de mon introduction, on pourrait s’imaginer que c’est contradictoire. En réalité, sauf sur quelques éléments, il est possible de se soustraire légalement à l’Etat sur un certain nombre de domaines, d’utiliser une partie du système contre lui. Toute sortie intégrale d’un quelconque système que ce soit est de toute façon chimérique. Citons en ce sens Serge Latouche : « Si la rigueur théorique exclut les compromissions de la pensée, le réalisme politique suppose des compromis pour l’action ». Même les moines ont besoin des touristes qui achètent leurs bières ou leurs confitures… car l’échange, même commercial, n’est pas forcément la recherche de l’enrichissement. Partons des moines pour poser notre plan : 1) comme le moine résister c’est donc d’une part une démarche individuelle (retourner le système c’est sûrement retourner l’individu contre l’individualisme), 2) résister au capitalisme c’est constituer une communauté sur des valeurs et d’une identité communes, 3) comme le moine, résister au capitalisme, c’est s’approprier un lieu, un territoire
1) Résister c’est agir soi-même
Démarrons par un extrait de Dominique Venner : « Etre un insoumis ne consiste pas à collectionner des livres impies, à rêver de complots fantasmagoriques ou de maquis dans les Carpates. Cela signifie être à soi-même sa propre norme par fidélité à une norme supérieure. »
Résister au capitalisme partira toujours d’une démarche individuelle. C’est bien l’intérêt d’une formation comme Academia Christiana, faire germer en chacun de vous un questionnement sur ce sujet pour qu’ensuite vous puissiez agir: seul, avec les autres et sur un territoire souvent en consommant différemment.
Être sa propre norme par fidélité à une norme supérieure, dans un contexte chrétien, cette « norme supérieure » est évidemment religieuse et biblique.
Retenons simplement ce passage de l’Evangile selon Saint Matthieu au Chapitre VI verset 24: « Nul ne peut servir deux maîtres : car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la Richesse. » (Mammon) [Encyclique Laudato Si’ – VI – 217]
Pour résister au capitalisme il faut donc adopter une éthique. Éthique de la responsabilité, éthique de la limite. Il faut être responsable dans l’actionet accepter la limite. Pour les chrétiens, comme pour la philosophie païenne greco-romaine, la limite est liée au divin, qu’il soit sous sa forme païenne ou sous sa forme chrétienne. On songera bien sur à l’orgueil. Chez les Grecs, l’hybris est suivi de la colère des dieux (c’est ainsi qu’Herodote explique la défaite des Perses du roi Xerxès). Dans le christianisme, l’orgueil sera rangé au rang des péchés. Mais dans une société où « Dieu est mort » pour reprendre Nietzsche, il n’y a plus de limite. Dans la religion du progrès, qui ne se limite pas au capitalisme mais aussi à certaines formes de socialisme, marquée par l’économisme et le fétichisme de la croissance, l’objectif est de toujours « repousser les limites ».
La première étape de la résistance au capitalisme et ses corollaires consiste donc à adopter cette double éthique de la responsabilité et de la limite et à décoloniser son imaginaire (lire le papier de Serge Latouche dans le dernier numéro de La Décroissance). Cette décolonisation de l’imaginaire est une étape essentielle. Pour un catholique, la Bible devrait être un moyen de décoloniser l’imaginaire de la société capitaliste marquée par le matérialisme, l’accumulation et la soif d’enrichissement. Il ne faut pas accorder d’intérêt à tout ce qui nous pousse à consommer. Il faut résister à la séduction publicitaire (à la tentation). Il faut sans cesse se questionner : est-ce responsable ? Est-ce juste ? Est-ce bon ? Il n’y a pas de résistance au capitalisme sans recul sur le monde et la société et donc une prise de distance avec ces normes. La réussite, est-ce être un homme riche ou est-ce être un homme juste et bon ?
Autre élément qu’on pourrait citer dans la décolonisation de l’imaginaire : le rapport au temps. Une des mutations anthropologique majeure induite par le progrès technique, c’est le changement de notre rapport au temps. On ne peut aller plus vite que le cheval que depuis la fin du XIXeme siècle. La « société de la vitesse » a donc émergée et aucun régime, y compris les régimes qui voulaient lutter contre l’homme libéral, n’a été contre la société de la vitesse. Il est nécessaire qu’il y ait une part prométhéenne mais on n’en maîtrise pas toujours les conséquences. La vitesse, si elle a contribué à la « grandeur des nations », a aussi favorisé une philosophie puis une pratique néo-nomadiste. Le déplacement fait parti de notre façon d’habiter le territoire. J’y reviendrai en troisième partie. Il faudrait donc repenser notre rapport au temps, prendre le temps, faire moins de « choses » mais mieux : la « philosophie de l’escargot » des décroissants.
Une fois qu’on a entrepris cette démarche, elle peut se retranscrire dans un certain nombre de gestes quotidiens, qu’ils soient marchands ou non marchands. Dans les gestes marchands il y aura évidemment ce que nous achetons et ce que nous n’achetons pas. 1 euro qui ne part pas dans la matrice ou 1 euro qui part à soutenir un projet économique alternatif et c’est 1 euro que l’on retire du circuit économique classique. Il faudra donc viser peu à peu la désertion des grandes surfaces, le refus d’acheter certains produits (huile de palme, en raison des conditions de production, le propriétaire de telle ou telle entreprise comme Monsanto ou Coca-Cola) [Encyclique Laudato Si’ – VI – 208]. Dans les gestes non marchands, il y a tout ce qu’on peut faire au quotidien chez soi : par exemple utiliser des outils non électriques dans certaines tâches, se déplacer à pied ou à velo. [Encyclique Laudato Si’ – VI 211]. Prendre le temps pour écrire des lettres ou pour lire : la lecture demeure une activité de résistance au capitalisme (encore faut-il bien choisir ce qu’on lit et donc ne pas être sensible aux phénomènes de mode). Plus de télé (aliénation). Tendre vers la frugalité volontaire. « Un homme heureux consomme peu. » S. Latouche [Encyclique Laudato Si’ – VI – 204 et VI – 223]
Continuer d’acheter des revues et journaux papier, aller pour certains ouvrages dans des librairies indépendantes (donc pas la FNAC). Aller chez les bouquinistes. Et c’est possible aussi dans d’autres domaines comme la musique ou l’habillement. Il est possible d’aller chez les revendeurs ou les friperies (exemple : Oxfam). Privilégier la réutilisation, le rapiéçage, la revente ou le don, à l’achat dans des magasins. Selon l’ADEME chaque habitant se débarrasse de 17 kilos de textile par an dont 9 kilos de vêtements. Agir en refusant de contribuer à la société du jetable, c’est forcément passer par des petits commerces (le bouquiniste, le cordonnier, la mercerie, …). Possibilité également d’acheter dans des magasins de qualité et français comme 1083 pour les jeans ou les chaussures.
Là aussi, paradoxalement, accepter dans un premier temps ses limites : vous ne pourrez pas tout faire, tout de suite, et dans certains domaines ce sera plus compliqué que dans d’autres pour x raisons. Vous serez par exemple confrontés à des réalités financières, il est possible de se nourrir bien pour pas trop cher, mais il est difficile de s’habiller bien pour pas trop cher. Par ailleurs la problématique de l’habillement nous renvoie à un autre élément qui moi me paraît central dans la société actuelle : les gens sont souvent mal habillés, la culture « sportswear » y est extrêmement développée. Là aussi c’est un signe de l’influence de la société capitaliste : le bougisme, la culture urbaine moderne, encouragent à se vêtir avec des chaussures de sport ou des vêtements de sport. Mais cela contribue souvent à l’enlaidissement et à la vulgarité de la foule. (voir un ouvrier avant et après). S’habiller correctement en ville, c’est une façon de ne pas succomber à la médiocrité et à la facilité ambiante. C’est la « tenue » chère à Dominique Venner. C’est aussi l’esthétique.
En définitive comme le dit André Gorz : « la critique de la croissance n’a de sens, et de portée révolutionnaire, qu’en référence à un changement social total. »
A l’issue de cette première partie, nous aurons vu la quasi totalité des 8 R de Serge Latouche : réévaluer, reconceptualiser, réduire, réutiliser et recycler. Il nous resterai restructurer, redistribuer et relocaliser à traiter.
2) Résister c’est agir avec les autres
Restructurer et redistribuer c’est agir avec les autres. C’est adopter de nouvelles façons d’organiser la vie sociale et économique. Zentropa a publié un article intitulé « la communauté ou le cauchemar du système ». La communauté, ce n’est pas le communautarisme. La communauté c’est l’affirmation des liens qui unissent des individus, qui favorisent l’entraide et la coopération dans une perspective d’autonomie. L’entraide est un facteur d’évolution chez Kropotkine, par opposition au darwinisme social de la loi du plus fort. La foi par exemple, ne peut pas simplement se vivre seul, elle se vit aussi dans la messe. Qu’est-ce que l’Eglise si ce n’est l’Ecclesia grecque, l’assemblée. Même le moine (du grec monos, seul), vit dans une « communauté monastique ». Ce n’est ni un ermite, ni un anachorète. Dans l’histoire du christianisme, la communauté a été prépondérante et la force de la communauté d’autant plus. Lors des persécutions, la force de la communauté a empêché l’empire romain de vaincre le christianisme. [Encyclique Laudato Si’ – VI – 219]. Aujourd’hui, pour résister à l’empire de la marchandise il faut agir en communauté. Le troc, le don, les systèmes associatifs (AMAP), les coopératives, les SEL (systèmes d’échanges locaux), les monnaies locales, les microcrédits, le prêt au sein de la communauté, l’autogestion, etc… Le Mouvement d’Action Sociale est un exemple de réponse.
Cela nous réapprend l’organisation collective, le partage, la confiance, etc… Il faut monter des ateliers : cuisine, couture, jardinage, lecture, … tout ce qui favorise le partage, la mutualisation. Il est important de prendre le temps de cuisiner, de partager un repas, sans avoir la télé qui hurle dans le salon. Faire des activités sportives ensemble: la marche, l’auto-défense. (on ne fait pas du sport simplement pour faire du sport, mais aussi pour être ensemble). Vous pouvez inventer vos propres formes de communauté. La communauté est également la garantie de maintenir vivante la norme (à laquelle sont attachés des valeurs et des principes) et de pouvoir trouver un « refuge » en cas de doute. On peut faire part de ses doutes à sa communauté. C’est aussi la nourrir, la réorienter, l’approfondir.
Il est nécessaire de pouvoir exclure du groupe, et sanctionner (et non de punir, la sanction est éducative, pas la punition), la communauté a des règles, elle «pose le « NON ». Dans la société individualiste, c’est l’absence de règle qui devient la norme. D’où l’inversion des valeurs. L’argent permet de tout s’acheter, de tout transgresser, d’échapper à la loi, etc… La première communauté à faire vivre : c’est le couple, première sphère d’entraide, de coopération d’échange, de complémentarité, de prise de décision collective.
Il ne s’agit pas ici d’une utopie (du grec u-topos qui signifie absence de lieu) mais bien au contraire de la mise en place de quelque chose de concret, de réel, de palpable, de sensible… la communauté est-elle même un « lieu », elle a en tout cas la capacité à s’inscrire et à sa manifester dans des lieux, sur un territoire.
3) Résister c’est agir sur un territoire
Tous les actes de la vie se déroulent dans des lieux : logement, travail, école, commerce, … Fréquenter d’autres lieux, c’est aussi résister aux « lieux du Capital ». Le choix de son logement, de son travail, de l’école de ses enfants, de là où on consomme, de là où on voyage, tout cela a une importance. Privilégier la densité du bâti à l’étalement urbain, le microfermage, l’agroforesterie, le bocage, la permaculture, etc… à l’openfield. C’est ce qu’on lit dans l’AT : « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, Et qui joignent champ à champ, Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace, Et qu’ils habitent seuls au milieu du pays » (Isaïe 5,8)
La communauté devra s’enraciner sur un territoire dans lequel elle agit. La communauté aura donc d’autant plus de pertinence qu’elle peut agir localement. D’une façon générale le localisme est une façon de rompre peu à peu avec la matrice. La maîtrise de son propre territoire est fondamentale. Dans l’idéal il faudrait en connaître la faune ou la flore. Il faut donc se réapproprier le territoire par la marche (ou le vélo).
Paradoxalement l’urbain maîtrise mieux son territoire que le néo-rural. Le territoire c’est l’enracinement (qui peut être incomplet / imparfait). S’enraciner, ce qui suppose donc un territoire, ce n’est pas refuser les mobilités, c’est se questionner sur la pertinence de nos mobilités et sur la façon donc nous nous déplaçons sur le territoire. Bien évidemment on adoptera pas la même « stratégie » si on est au centre-ville d’une métropole ou dans un petit village de la Creuse. Mais il y a pour tous les types de territoire des façons d’agir et des questionnements à avoir. L’Église elle même a constitué un maillage territorial au sein duquel elle agit.
Dans l’histoire, toutes les communautés se sont appropriées un territoire. Au sein d’un territoire il est plus simple de définir des rôles, complémentaires. Chaque personne peut exprimer ses talents sur le territoire et trouver une place au sein de la communauté. On ne définit pas arbitrairement des rôles, on les définit en fonction des besoins, ou on agit en fonction des talents comme c’est le cas dans un réseau. Ce territoire n’est pas une forteresse bastionnée mais peut être un camp de base, un centre, un point de ralliement et un lieu à partir duquel on s’ouvre au monde. Par définition le territoire est marqué par la limite : il est délimité, et il est possible pour la communauté de définir, sur le plan géographique, ce qui peut ou non passer la limite. Par exemple, le touriste, parfois mal vu par l’autochtone, qui « transgresse son territoire quotidien ».
Transgression des distances, des limites : on ne s’en rend même plus compte. On assiste à un retour au réel dans les banlieues : ces zones de non-droit sont en réalité des zones d’un autre-droit ce qui démontre l’importance du territoire. Quels sont nos espaces d’autonomie ? Où sont nos Républiques autonomes? Où est la souveraineté populaire ? C’est ce qu’on retrouve au sein des ZAD ou au sein des BAD, quant elles ne sont pas abordées sous l’angle du survivalisme anglo-saxon du seul contre tous, mais comme précisément une BASE, AUTONOME et DURABLE. Plutôt que durable, je préférerai le terme de « collective ». Ne cherchez pas plus loin la force du capitalisme, celle des gauchistes ou des « jeunes de banlieue »: c’est leur capacité à s’approprier le territoire qui fait leur force. Les premiers par les rapports de prédation marchande et de spéculation, les deuxièmes par des alternatives et les derniers par le contrôle social, l’économie souterraine et la violence (qui peut trouver une explication sur le plan anthropologique).
Conclusion :
1a) Décoloniser son imaginaire, éthique de la responsabilité et de la limite
1b) Modifier ses habitudes quotidiennes (dé-consommation, frugalité volontaire)
1c) Faire attention à sa Tenue et à l’esthétique (image)
2a) Agir avec les autres (entraide, coopération)
2b) Monter et soutenir des projets collectifs (autonomie)
2c) Savoir dire NON (limite)
3a) Fréquenter d’autres lieux
3b) Agir sur un territoire (localisme, enracinement)
3c) Constituer des lieux et s’approprier un territoire (ZAD, BAD)
Jean / C.N.C.
Première publication sur academiachristiana.wordpress.com
-----
Bibliographie indicative:
Ouvrages :
ALLEMAND, Sylvain, ARSCHER François, LEVY Jacques, Les Sens du mouvement. Modernité et mobilités, Paris, Belin, 2005
BAUDRILLARD, Jean, La société de consommation, Paris, Denoël, 1970
CHEYNET, Vincent, Décroissance ou décadence, Vierzon, Editions « le pas de côté », 2014
COLLECTIF OFFENSIVE, Divertir pour dominer, La culture de masse contre les peuples, Montreuil, Éditions l’Échappée, 2010
DARDEL, Eric, L’homme et la Terre, Nature de la réalité géographique, Paris, Éditions CTHS, 1990
DEBRY, Jean-Luc, Le cauchemar pavillonnaire, Montreuil, L’Echappée, 2012
ELLUL, Jacques, Anarchie et christianisme, Paris, Editions de la Table Ronde, réed. 1998
ELLUL, Jacques, Le Système technicien, Cherche midi, réed. 2012
TRUILHE, Mathilde, GIBELIN, Fanny, Tour d’Europe, 6000 kilomètres à pied, Les Amis du Livre Européen, 2015
LATOUCHE, Serge, L’âge des limites, Mille et une Nuit, 2012
LATOUCHE, Serge, Le pari de la décroissance, Paris, Fayard Pluriel, réed. 2010
LUSSAULT, Michel, De la lutte des classes à la lutte des places, Paris, Grasset, 2009
LUSSAULT, Michel, L’homme spatial, Paris, Seuil, 2007
MAUSS, Marcel, Essai sur le don, Paris, PUF, réed. 2008
MICHEA, Jean-Claude, La double pensée, retour sur la question libérale, Paris, Flammarion, 2008
NAESS, Arne, Ecologie, communauté et style de vie, trad. Charles Ruelle, Paris, Editions MF, 2009
OZON, Laurent, France, les années décisives, BIOS, 2014
PAPE FRANCOIS, Loué sois-tu, Lettre encyclique Laudato Si’ sur la maison commune, Éditions Artège, 2015
TURKLE, Sherry, Seuls ensembles, De plus en plus de technologies de moins en moins de relations humaines, L’Echappée, Montreuil, 2015
VENNER, Dominique, Un Samouraï d’occident : Le bréviaire d’un insoumis, PGDR, 2013
WEIL, Simone, L’enracinement, Paris, Gallimard, réed. 2011
Articles :
LATOUCHE, Serge, LE CARBONEL, Guillaume, NAUDIN, Arnaud, « Serge Latouche : « la décroissance n’a pas à se situer sur l’échiquier politique », fr.novopress.info, 2014
LATOUCHE, Serge, « Pourquoi la décroissance implique de sortir de l’économie », La Décroissance n°121, juillet/août 2015
LE CARBONEL, Guillaume, « La décroissance pour les nuls », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
LE CARBONEL, Guillaume, « Ecologie politique et combats locaux », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
FELTIN-TRACOL, Georges, « Villes – banlieues, un constat accablant », europemaxima.com, 2012
Franck, « Chronique de livre : Fanny Truilhé et Mathilde Gibelin, Tour d’Europe », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
GRIMAL (de), Frédéric, « Coca-Cola:entre boycott et alternatives locales », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
MARTIN, Aristide, « Chronique de livre: Eric Dardel et l’homme et la Terre », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
NAUDIN, Arnaud, « Chronique de livre : Thierry Paquot, désastres urbains », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
Rüdiger, « Une sortie au Centre commercial », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2012
Rüdiger, « Les vacances dont tu ne veux pas … », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
Rüdiger et Ann, « Et toi, tu passes ta vie dans les bouchons », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2013
Rüdiger et Ann, « Le goût de rien, où comment l’homme se perd », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
Rüdiger et Ann, « Notre Sainte bagnole », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
TERROIR, Jean, « Chronique de livre: Jean-Luc Debry, le cauchemar pavillonaire », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
TERROIR, Jean, « La France du localisme. », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2015
TERROIR, Jean, « Chronique de livre: Christophe Guilluy, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
TERROIR, Jean, « Chronique de livre: Laurent Ozon, France les années décisives », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
TERROIR, Jean, « Chronique de livre: Vincent Cheynet, Décroissance ou décadence », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2014
TERROIR, Jean, « Chronique de livre : Anarchie et Christianisme », cerclenonconforme.hautetfort.com, 2013
ZENTROPA, « La communauté ou le cauchemar du système », zentropa.tumblr.com, 2012
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/