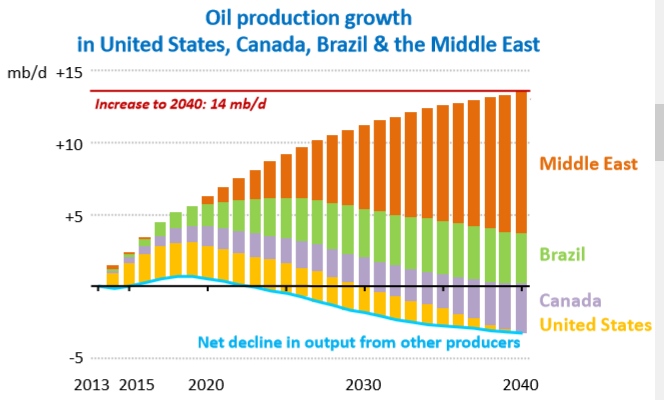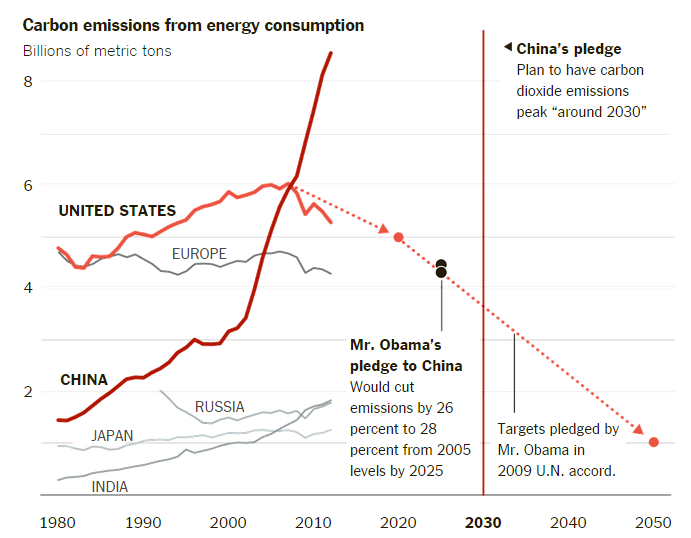Si la culture générale d’un nationaliste inclut la connaissance de l’histoire, à commencer par celle de son pays, l’étude de la doctrine nationaliste, qui est un outil d’analyse indispensable permettant le décryptage et l’analyse juste des événements, elle doit aussi inclure des éléments d’économie. Et parmi ceux-ci, les questions monétaires occupent une place majeure car la monnaie, en tant qu’équivalent général des richesses produites et outil d’échange des biens et des marchandises, constitue la clef de voûte de l’ordonnancement économique et par suite de l’ordre social. En clair, celui qui maîtrise la monnaie se donne les moyens de maîtriser les peuples. Comme le disait Mayer Amschel Rothschild dans une citation bien connue : « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. »
Sous cet aspect, l’époque dite moderne se caractérise moins par le développement des techniques que par la mise sous tutelle des États par les détenteurs de la création monétaire, autrement dit, les banquiers et les financiers. Ce n’est plus un Philippe le Bel qui dicte sa loi mais bien les financiers, à commencer par la dynastie des Rothschild.
Cet aspect de l’histoire des deux derniers siècles est généralement occulté, et pour cause : ceux qui détiennent les principaux leviers de décision n’ont aucun intérêt à apparaître au grand jour. La réussite de leur action passe par la discrétion.
Un utile ouvrage de vulgarisation économique
Jusqu’à présent, des études souvent érudites avaient été publiées sur ces questions mais ne traitaient que de périodes ou d’aspects particuliers du problème. Henri Coston (1910-2001) avec ses nombreux ouvrages tels L’Europe des banquiers, La Haute Finance et les révolutions, Le Secret des dieux, La France à l’encan avait mis en valeur les agissements de la finance cosmopolite en tant que cause majeure de bien des événements du XXe siècle. Plus récemment, par exemple, nous avons eu à disposition l’ouvrage d’Eustace Mullins, Les secrets de la Réserve fédérale, qui apporte un éclairage de première importance sur le pouvoir de la finance aux États-Unis. En ce qui concerne les liens plus ou moins officiels, plus ou moins occultes entre le monde de la finance et celui des cercles de pensée mondialiste issus de la lignée des Illuminatis et autres sociétés sataniques, nous pouvons lire avec profit l’ouvrage d’Epiphanius Maçonnerie et sectes secrètes, le côté caché de l’histoire.
Le public nationaliste, non spécialiste de ces questions, manquait d’un ouvrage général, aisé à lire, qui retraçât sur les deux siècles écoulés les principaux aspects de l’histoire de la finance occidentale et de ses connections étroites avec l’histoire de cette période, les guerres, les crises économiques et les troubles sociaux dont elle a été l’instigatrice pour renforcer son pouvoir et faire avancer son dessein de domination mondiale.
Or, même si ce n’est pas son but premier, cet ouvrage nous est en quelque sorte proposé par un universitaire chinois, Hongbing Song, auteur du livre La Guerre des monnaies publié en 2007 en Chine et qui vient d’être traduit en français et publié par les éditions Le retour aux sources. La « grande presse » n’en fera pas grand écho, nous pouvons nous en douter, tant sa diffusion pourrait provoquer une prise de conscience parmi le grand public, en dépit de son anesthésie mentale et intellectuelle.
En Chine, l’ouvrage a connu un grand succès et cela se comprend aisément lorsque l’on sait que la monnaie est une arme efficace utilisée par les États dans la guerre économique qu’ils se livrent, laquelle n’est qu’un aspect d’une lutte plus générale et plus globale dont l’enjeu est la domination de la planète et, singulièrement, pour les États-Unis, qui ne sont que le bras armé de cercles dirigeants financiers et nourris d’idéologie mondialiste, et qui veulent assurer la position dominante qu’ils ont acquise dans le monde.
Le mondialisme et l’arme monétaire
La monnaie est, cela n’est jamais assez mis en valeur, l’expression d’un rapport de force entre puissances politiques, déclarées ou non comme telles. La Chine est particulièrement consciente de l’enjeu et les dirigeants chinois savent qu’ils ont plus à craindre d’une « guerre sans fumée », à savoir une guerre financière, qu’une guerre armée au sens traditionnel du terme. L’auteur, dans son avant-propos, l’écrit sans ambiguïté : « Même si les attaques militaires visent généralement à détruire des infrastructures et des installations et qu’elles tuent des êtres humains, si l’on tient compte du vaste espace chinois, une guerre conventionnelle aurait beaucoup de mal à occasionner des dommages capitaux aux secteurs vitaux de l’économie. En revanche, une fois l’ordre économique attaqué par la guerre financière, des troubles civils verraient immédiatement le jour… conduisant à une guerre civile » qui serait bien entendu un moyen efficace d’affaiblir la Chine de l’intérieur par effet mécanique.
En Europe, nous savons combien cette guerre financière est la cause de la mise sous tutelle de l’U.E. par la finance cosmopolite et de l’affaiblissement des États qui la composent avec, à terme, leur désintégration si le processus devait se poursuivre.
Quant au Japon, le présent livre rappelle (pp. 290-296) comment l’arme financière a enrayé pour longtemps la montée en puissance du Pays du Soleil levant. Après avoir soutenu la bulle spéculative qui a gonflé au Japon entre 1982 et 1989, les États-Unis eurent recours aux instruments financiers alors nouveaux que sont les marchés à terme sur les indices boursiers, pour transformer l’inévitable dégonflage de cette bulle en une véritable déroute (la Bourse de Tokyo perdit en trois ans 60% de sa valeur) qui, en rendant le système financier japonais incapable de financer les investissements dont ce pays avait besoin pour continuer son développement et par suite, provoquant une récession qui n’est toujours pas achevée, en dépit de l’action de l’actuel Premier ministre japonais, Shinzo Abe.
Nous pourrions continuer avec le pillage dont fut victime la Russie après 1991, de même que les anciens pays du Bloc soviétique, des gens comme Georges Soros et Paul Volker (Président de la Réserve fédérale américaine) étant à la manœuvre.
La connaissance de l’ennemi – qui est ici la finance cosmopolite actuellement centrée sur « l’Axe City/Wall Street » – est donc primordiale et l’ouvrage de Hongbing Song y parvient utilement.
Les Rothschild et l’axe Londres-New York
Le livre commence ainsi par narrer l’origine de la constitution de « l’insaisissable première fortune mondiale », à savoir celle des Rothschild, nous rappelant l’origine de la famille dont l’ancêtre commun avait su placer dans les différents États d’Europe qui comptaient alors chacun de ses fils, comment, à l’occasion de la bataille de Waterloo, l’un d’entre eux, par la qualité de ses réseaux d’informateurs, Nathan, avait pris le contrôle de la banque d’Angleterre, comment un autre, James, avait fait main basse sur la France dès Louis XVIII, etc., au point qu’au « début du XXe siècle, on calculait que la famille contrôlait la moitié de la richesse mondiale totale » (p. 49), ce qui leur donne une puissance considérable. Comme le montre d’ailleurs Hongbing Song au cours des chapitres suivants « les Rothschild ont été les souverains de la City, les fondateurs d’Israël, les ancêtres des réseaux de renseignement, les mentors des cinq plus grandes familles de Wall Street, les décideurs du cours de l’or et, jusqu’à aujourd’hui, les véritables opérateurs de l’axe Londres/Wall Street », ceux-ci ayant « mis Bill Gates et Warren Buffet (deux des plus grandes fortunes mondiales, n.d.r.) sur le devant de la scène pour mieux se cacher derrière, leur fortune dépassant de très loin » celle de ces deux personnages. (p. 298)
Nous passons alors aux États-Unis dont l’auteur résume l’histoire ainsi : « La véritable histoire du développement des États-Unis relève essentiellement de la mise en œuvre de complots par les forces internationales. La pénétration et la subversion de ce pays par les forces financières internationales constituent sûrement le chapitre le moins connu de son histoire mais il est le plus troublant ». (p. 51). Est alors expliqué comment les premiers présidents des États-Unis, Andrew Jackson notamment (1829-1837), firent tout leur possible pour éviter que leur pays ne tombe sous la coupe des financiers et déjoue les manœuvres des banquiers, le tout étant ponctué de la mort étrange des présidents Harrisson et Taylor qui refusaient de créer une banque centrale privée comme le souhaitaient les banquiers. Il faudra attendre 1914 pour que cela devienne une réalité avec la création de la Réserve fédérale américaine à laquelle le chapitre 3 du présent ouvrage est consacré, montrant le rôle joué par J.P. Morgan mais aussi par Paul Warburg, personnage très compétent qui sera la cheville ouvrière de ce projet lancé dans des conditions peu communes.
Entre-temps, aura eu lieu la Guerre de Sécession « guerre d’intérêts entre la souveraineté d’un État et les forces financières internationales concurrentes » et l’assassinat de Lincoln aura été commis. Or Lincoln avait décidé de se passer des services des banquiers en créant sa propre monnaie, évitant la création d’un service de la dette publique, privant ainsi les banquiers d’importantes sources de revenus. Dès son assassinat, les mesures de souveraineté monétaires qu’il avait prises furent supprimées.
Un autre président connut le même sort en 1881 : James Garfield qui avait compris peu avant que le seul moyen pour les États-Unis de mettre fin à la crise économique qui sévissait alors était de mettre la finance au pas. Et, plus près de nous, l’assassinat aux causes jamais officiellement élucidées de John Kennedy (pp. 230-236) : l’intention de Kennedy, concrétisée par le décret présidentiel n°11110, était de reprendre à la Réserve Fédérale le contrôle de l’émission de la monnaie américaine en ne versant plus d’intérêts à cette Banque d’État qui en fait une banque privée. Ce décret fut, on peut s’en douter, très vite abrogé par son successeur, Lyndon Johnson.
Les banquiers fauteurs de crises économiques
L’ouvrage consacre évidemment de nombreuses pages au rôle des financiers transatlantiques dans la guerre de 1914-1918 et surtout à leurs manœuvres au cours de l’entre-deux guerres 1919-1939, traitant entre autres de l’origine de la crise de 1929, de la politique du New Deal américain et des relations financières avec l’Allemagne.
Ainsi est rappelé comment les États-Unis financèrent dès 1914 la France et l’Angleterre, sur une recommandation de la banque Rothschild de France à la banque Morgan de New York, en dépit des fortes réserves du gouvernement Wilson. Mais celui-ci, au bout du compte, cornaqué par le Colonel House (dont le rôle dans la création du CFR est étudié au chapitre 6 consacré aux officines mondialistes), conduisit une politique conforme à celle que voulaient les banquiers et qui aboutit à l’engagement des États-Unis contre l’Allemagne en 1917, les faits tels que le torpillage du Lusitania, paquebot aménagé en transport d’armements, n’étant que des prétextes utilisés pour mieux masquer des intérêts liés à des rivalités économiques.
Ces développements ont l’intérêt de mettre en lumière la nature prédatrice des banquiers dans le phénomène de « tonte des moutons », à savoir la spoliation d’autrui au moyen de l’utilisation de l’alternance « phase de prospérité et récession économique », souvent provoquée délibérément par les banquiers. Sont ainsi passées en revue la dépossession de leurs biens des agriculteurs américains en 1921 et la « crise de 1929 ».
Hongbing Song décrit clairement le mécanisme (p. 126) : « Tout d’abord, il faut étendre le crédit, puis faire éclater la bulle, attendre la frénésie spéculative du public, enfin stopper les financements pour induire une récession économique et un effondrement des actifs. Lorsque le prix des actifs de qualité tombe à 10 % de leur prix initial, voire à 14 %, les banquiers les rachètent pour rien… Après l’invention de la banque centrale privée, l’intensité et la portée de la "tonte des moutons" atteint un niveau sans précédent ».
Toutes les « crises » que nous avons connues au cours du XXe siècle jusqu’à l’époque contemporaine peuvent être ramenées à ce schéma. Le présent livre en décrit un certain nombre.
La crise de 2008 (dont l’histoire « secrète » mais déjà assez bien connue n’est pas décrite ici) n’échappe pas à ce schéma, même si elle est largement liée d’une part à la dérive d’un système fondé sur la création de monnaie ex-nihilo, par ailleurs bien décrit dans les pages consacrées au mécanisme du système de réserves fractionnaires (p. 319 et suiv.), l’institutionnalisation de fait du dollar papier source de l’endettement « infini » des États-Unis, d’autre part à la pratique généralisée de la spéculation institutionnalisée et de ses outils, les « dérivés de crédits » et leur corollaire, la « titrisation » (p. 335 et suiv.), qui, en diluant les risques et en contaminant d’une manière difficilement identifiable la part de « toxicité » que contiennent les effets financiers, tous liés entre eux d’une manière ou d’une autre, créent une situation d’incertitude et de perte de confiance de tous les acteurs financiers qui conduit à une crise de liquidité, chacun hésitant à prêter à l’autre. Sont bien détaillés les mécanismes des CDS, le rôle des agences de notation.
Mais le phénomène de resserrement de la masse monétaire est en fait inéluctable dans la mesure où le dollar, étant une monnaie d’endettement, des sommes de plus en plus importantes doivent être affectées au remboursement des emprunts et assèchent ainsi le circuit monétaire. Les déversements de signes monétaires par les banques centrales, comme l’a fait la Réserve Fédérale avec Ben Bernanke, son président, appelé « Helicopter Ben » (parce qu’il reprenait la formule de l’économiste Milton Friedman qui conseillait d’inonder les marchés de liquidités distribuées par hélicoptères) n’empêcheront pas la contraction déflationniste des circuits financiers. D’aucuns assurent que le chaos ainsi programmé provoquera une telle panique dans le monde que la solution d’un gouvernement mondial apparaîtra comme la bouée de sauvetage à laquelle tous se rallieront dans la panique…
La monnaie et les rapports de force
Mais la monnaie, devons-nous le répéter, est l’expression d’un rapport de forces entre États ou plus généralement entre groupes d’intérêts, ce qui dans le cas des États-Unis et du dollar signifie l’expression du rapport de forces entre le groupement d’intérêts de ceux qui se sont emparé du pouvoir des États-Unis aux fins de se servir de la puissance de cet État afin de réaliser leur objectif messianique de gouvernement mondial, la finance étant le principal levier de ce dessein, et les forces qui s’y opposent ou sont susceptibles de s’y opposer.
Le présent livre ne manque pas de relater comment, depuis la fin des années 1960, les États-Unis ont agi pour maintenir et asseoir la suprématie du dollar dans les échanges économiques internationaux. D’abord avec la rupture du lien entre dollar et or, intervenue le 15 août 1971 ; ensuite avec la remise en selle du dollar grâce à la crise pétrolière de 1973, organisée par les États-Unis en concertation avec l’OPEP et bien décrite dans ses principes (p. 267 et suivantes) qui vit le prix du pétrole quadrupler à condition que ce prix fût libellé en dollars. Le rôle du FMI est bien sûr évoqué.
Dans ce processus de mainmise d’un petit groupe de personnes sur le monde entier, nous retiendrons les pages consacrées à la World Conservation Bank (WCB), créée par Edmond de Rothschild en 1987 avec l’onction de l’ONU et rebaptisée en 1991 Fonds pour l’environnement mondial (FEM – Global Environment Facility en anglais), institution qui regroupe 179 États. Sous couvert de mobiliser des ressources de financement pour préserver l’environnement et mieux le gérer, le projet consiste à terme à s’approprier les terres des pays pauvres endettés en garantie des emprunts qu’ils ne peuvent rembourser : il s’agit de transférer les dettes des pays du Tiers monde à cette banque, ces pays donnant leurs terres en garantie à celle-ci. Bien entendu, tout ceci est présenté comme ayant un but altruiste qui nécessite de mobiliser de sommes énormes : la lutte contre le CO2 qui est la cause du réchauffement climatique, affirmation non prouvée mais dont la contestation déclenche de nos jours des foudres aussi violentes que celle de l’histoire officielle imposée juridiquement.
Cela précisé, arrivons à l’objet premier de ce livre. Hongbing Song n’a pas écrit cet ouvrage pour faire œuvre d’historien mais dans le but politique de prévenir les dirigeants chinois des dangers qui les guettent dans la guerre monétaire en cours et de se donner les moyens d’y parer. La guerre monétaire répond à « deux objectifs fondamentaux des banquiers internationaux en Chine (qui) sont de contrôler l’émission de sa devise et d’organiser la désintégration contrôlée de son économie. La mise sur pieds d’une devise mondiale et d’un gouvernement supranational dirigé par l’axe Londres/Wall Street supprimera le dernier obstacle aux rêves de contrôle absolu des banquiers internationaux… Leur plus grand rêve est de mettre la main sur le monopole de l’émission monétaire dans le monde entier. » (p. 417) Notons qu’en Europe, la création de l’euro fait partie de ce plan et que le futur marché transatlantique en cours de négociation, qui doit à terme déboucher sur la création d’une monnaie transatlantique en constitue une étape plus avancée.
Les ambitions chinoises
Hongbing Song explique comment la Chine peut se retrouver très vite dans les mains des financiers internationaux si elle laisse les banques étrangères développer leurs propres réseaux financiers chez elle et ainsi s’emparer de fait du contrôle de la monnaie chinoise : « Le plus grand danger vient de ce que les banques à capitaux étrangers octroieront des crédits aux entreprises chinoises et aux particuliers, ce qui les impliquera directement dans le domaine de l’émission monétaire en Chine ». (p. 418) Par conséquent il invite les dirigeants chinois à « se prémunir contre les banques à capitaux étrangers, les fonds spéculatifs internationaux et les pirates de la finance qui sévissent de manière coordonnée. » (p. 420)
Pour lui, la solution consiste à mettre fin au système de la monnaie d’endettement et à adosser le renminbi (autre nom du yuan) à l’or, se fondant sur le fait que jadis les monnaies comme la livre sterling et le dollar ont construit leur puissance sur leur convertibilité avec l’or et que la rupture de ce lien les a conduites à leur dévalorisation. Bien sûr, en tant que Chinois, tout en mesurant les faiblesses actuelles de la Chine « qui a encore beaucoup de retard à rattraper en ce qui concerne l’innovation scientifique et technique » (p. 422), il ne peut que proposer un nouvel ordre monétaire mondial fondé sur la devise chinoise ainsi consolidée par son adossement à l’or et à l’argent, invitant le gouvernement chinois à acheter le plus possible d’or pour constituer les réserves les plus importantes possibles. Alors qu’elles sont actuellement faibles. Il précise lui-même que son livre « se concentre essentiellement sur une seule idée : injecter des éléments d’or et d’agent » dans le système monétaire.
Il semble que le gouvernement de Pékin suive ce conseil car la Chine achète massivement de l’or, alors que, dans le même temps, depuis 2004, les Rothschild se sont retirés ostensiblement de cette instance hautement stratégique qu’est le « fixing » londonien qui fixe le cours de l’or physique au jour le jour (p. 356). En 2013, profitant de cours assez bas, la Chine a acheté plus de 1 000 tonnes d’or en une seule année, record absolu en 5 000 ans d’histoire du monde, soit 50% de plus que l’année précédente dépassant désormais l’Inde comme premier importateur de métal jaune au monde. En deux ans et demi, la Chine a acheté 2 500 tonnes d’or, c’est-à-dire l’équivalent de la totalité du stock d’or de la France (2 435 tonnes). De plus, elle conserve à l’intérieur de ses frontières l’or que produisent toutes ses mines, soit plus de 400 tonnes par an.
Le rétablissement d’un système fondé sur l’étalon or (qui n’est pas nécessairement la seule solution) sera néanmoins difficile dans la mesure où, dans la conscience des hommes, l’or a perdu la puissance que lui conférait la croyance en sa nature sacrée en tant que seule monnaie valable : ainsi, même rétabli, à la première difficulté, il est vraisemblable qu’il se trouvera toujours un dirigeant pour s’affranchir de la contrainte de l’or… à moins qu’une terreur panique enlève un jour et pour longtemps une telle idée des esprits. En outre, pour parvenir à un tel accord, il faut un rapport de forces équilibré entre les principales puissances jouant un rôle mondial. Nous n’y sommes pas.
Il n’en demeure pas moins cette réalité : tous les peuples de la planète, à commencer par les peuples d’Europe, sont menacés dans leur existence même par ce projet de pouvoir mondial qui vise à les dissoudre, tant politiquement qu’ethniquement, pour reconstruire un monde qui lui sera soumis. Nous savons que la question monétaire est l’un des éléments du combat à mener et qu’une partie de la victoire des nations contre le mondialisme, à commencer par les nations blanches, passe par le rétablissement de la souveraineté monétaire des États fondée non pas sur la monnaie d’endettement aux mains des banquiers et la spéculation sous toutes les formes qu’elle peut prendre, mais sur une monnaie émise en fonction des seuls besoins de l’économie réelle dans le cadre d’un circuit monétaire contrôlé dans l’intérêt du développement des économies nationales.
L’intérêt de l’ouvrage de Hongbing Song consiste à démonter le système financier mondial et à en montrer toute la dimension messianique et géopolitique qui est la sienne, tout autant que les intentions de la Chine dans ce conflit en cours entre un monde blanc affaibli et asservi à quelques syndicats d’intérêts dont les objectifs ne concordent pas avec les impératifs de vie qui sont les siens, et une Chine qui veut légitimement s’imposer comme pilier majeur d’un nouvel ordre planétaire. Sa lecture ne peut qu’être hautement formatrice pour tout nationaliste digne de ce nom.
Par André Gandillon, président des « Amis de RIVAROL ».
Publié dans RIVAROL, n°3139, 2 mai 2014.
http://www.scriptoblog.com/index.php/component/content/article/35-actu-scripto/actualite-des-editions-le-retour-aux-sources/1593-recension-de-la-guerre-des-monnaies-dans-rivarol