Chers Amis de Radio-Libertés,
Focalisés par la campagne présidentielle française, les commentateurs politiques ne se sont pas intéressés aux élections provinciales survenues en Inde ce printemps. À tort ! Cinq provinces (l’Uttar Pradesh, Goa, Manipur, le Pendjab et l’Uttarakhand) renouvelaient leur parlement local. L’enjeu était de taille pour le Premier ministre fédéral, le nationaliste Narendra Modi. D’abord, avec 220 millions d’habitants, l’Uttar Pradesh est l’État le plus peuplé de l’Union indienne, ce qui donne une indication fiable de l’opinion publique. Ensuite, en novembre 2016, afin de lutter contre la corruption, l’enrichissement mafieux et le travail au noir, Modi ordonna le retrait immédiat des grosses coupures alors que 98 % des transactions financières se réalisent par des paiements liquides, provoquant ainsi un incroyable chaos économique et monétaire. Enfin, ces élections avaient valeur de test national pour le BJP (Parti du peuple hindou) au pouvoir depuis juin 2014. À la surprise générale, le BJP de Modi a remporté quatre provinces sur cinq, seul le Pendjab est revenu à l’opposition (le Parti du Congrès). En Uttar Pradesh, le scrutin majoritaire uninominal à un tour accorde au BJP près de 310 sièges sur 403 !
Créé en 1980, le BJP obtint quatre ans plus tard 7,74 % et deux sièges de députés fédéraux. Au pouvoir entre 1998 et 2004 dans le cadre de l’Alliance démocratique nationale (ADN) qui fédère vingt-quatre partis dont le Shiv Shena du Maharashtra et l’étonnant Parti socialiste révolutionnaire bolchevik au Kérala, le BJP conforte son assise électorale pour les échéances de 2019 et renforce la popularité de son chef. En fin politique, Narendra Modi a choisi comme Ministre en chef (Premier ministre régional) de l’Uttar Pradesh un sadhu, un ascète hindou. Ancien député fédéral de 44 ans, Shri Yogi Adityanah souhaite interdire l’abattage des vaches au nom de l’Hindutva (l’hindouité). Poursuivi dans dix-huit affaires judiciaires pour incitation à la haine et un temps emprisonné pour incitation à la violence, le nouvel homme fort de l’Uttar Pradesh s’oppose avec force aux deux religions étrangères qui menacent l’identité spirituelle indienne : l’islam (les musulmans sont 138 millions, soit 13,4 %) et les différents prosélytismes chrétiens.
Il est regrettable de ne pas s’intéresser à l’Inde, car une véritable révolution nationale s’opère dans ce pays qui,en 2050, sera le plus peuplé au monde.
Bonjour chez vous !
Georges Feltin-Tracol
• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 37, diffusée sur Radio-Libertés, le 9 juin 2017.
http://www.europemaxima.com/revolution-nationale-en-inde-par-georges-feltin-tracol/
 Le texte à quelques semaines mais
Le texte à quelques semaines mais 
 Bruno Bilde, adjoint à la mairie d’Hénin-Beaumont, est arrivé en tête dans la 12e circonscription du Pas-de-Calais avec le meilleur score de France (35,53 %) juste après Marine Le Pen. Selon [les] pronostics [de Présent], il est l’un des trois députés FN qui peuvent entrer à l’Assemblée nationale dimanche soir.
Bruno Bilde, adjoint à la mairie d’Hénin-Beaumont, est arrivé en tête dans la 12e circonscription du Pas-de-Calais avec le meilleur score de France (35,53 %) juste après Marine Le Pen. Selon [les] pronostics [de Présent], il est l’un des trois députés FN qui peuvent entrer à l’Assemblée nationale dimanche soir.
 Agnès Buzyn, la nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, déclare au
Agnès Buzyn, la nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, déclare au 

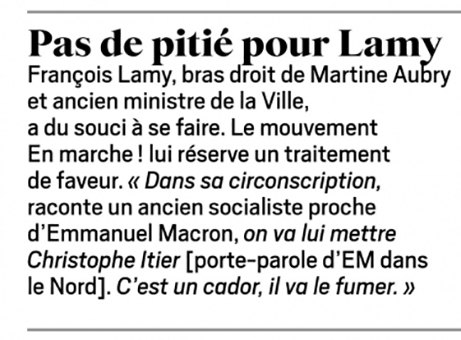
 Il y a une seule triangulaire en France, elle est dans l’Aube entre le candidat En Marche Grégory Besson-Moreau (29,86 %) le LR Nicolas Dhuicq (25,68 %) et le FN Bruno Subtil (24,89 %). Ce dernier répond à Caroline Parmentier dans
Il y a une seule triangulaire en France, elle est dans l’Aube entre le candidat En Marche Grégory Besson-Moreau (29,86 %) le LR Nicolas Dhuicq (25,68 %) et le FN Bruno Subtil (24,89 %). Ce dernier répond à Caroline Parmentier dans