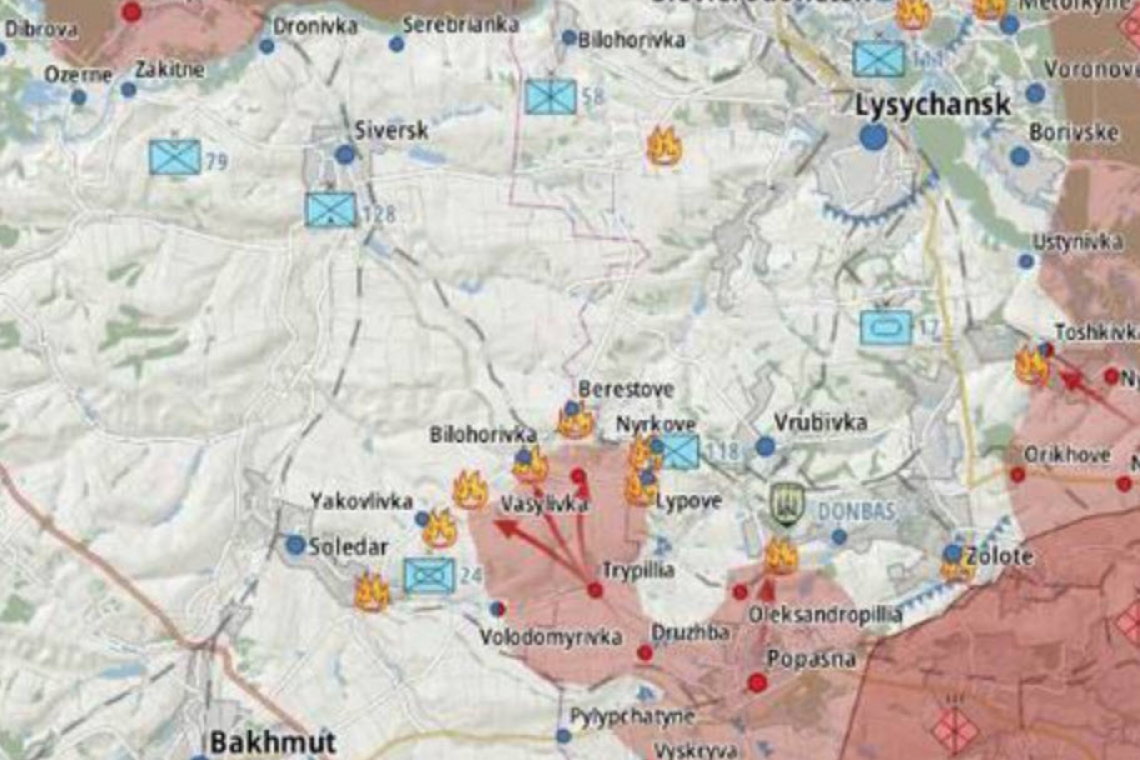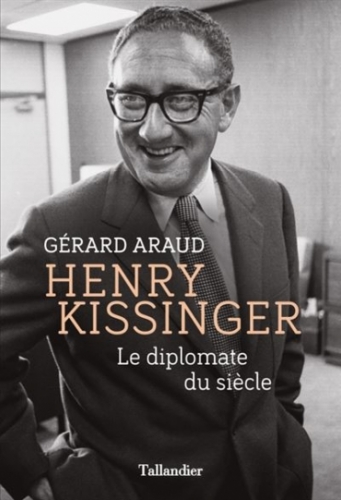Au moins 6 morts et 15 blessés dans le centre de Donetsk après une attaque hier de l'artillerie lourde ukrainienne.
Que des civils. Deux écoles touchées. Aucune, absolument aucune, réaction internationale pour ce qui est un crime de guerre.
Mais l'Ukraine est soutenue, pour son malheur, par l'Occident, elle est donc du côté du "Bien". Etrange "bien" que celui qui autorise de viser des civils, de tirer sur des écoles. En toute impunité. Une telle désertion morale ne peut conduire qu'à la catastrophe de tout un peuple.