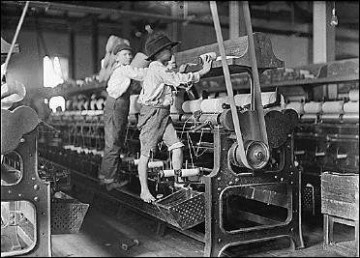Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Bon mes amis, j’ai fait une promesse à ma femme. Enfin, non, pour être plus précis ma femme a exigé de moi que je lui promette de ne pas vous parler du coronavirus pendant au moins une journée, car elle en a assez que je compte et recompte les boîtes de raviolis à la disposition de la famille en cas de disette et autre calamité calamiteuse.
Je vais donc vous parler du chômage… oui, je ne vous dis pas que c’est un sujet folichon, mais c’est quand même important, car si nous ne mourrons pas tous dans d’horribles souffrances pandémiques, notre boulot et celui de nos proches restera un sujet important. C’est vrai qu’en Chine, il y a 700 millions de Chinois qui ne travaillent plus et restent cloîtrés chez eux ce qui correspond tout de même à 10 % de la population mondiale en quarantaine, rien que cela, mais je ne vous en parlerai pas, parce que je l’ai promis à ma femme, et qu’à la maison, je ne sais pas pour vous, mais le vrai patron, c’est la patronne !!