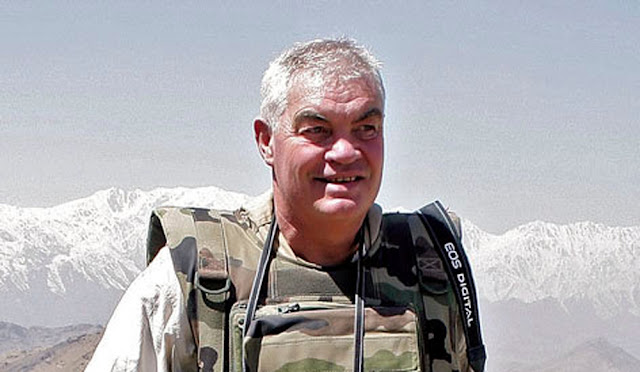Ex: http://mediabenews.wordpress.com/
La guerre contre l’Iran n’aura pas lieu… pour le moment. La guerre d’Iran n’aura pas lieu de sitôt même si ‘Pierrot le fou’ – Benjamin Netanyahu, Premier ministre d’Israël – crie « Aux loups, aux loups » à la Knesset – parlement israélien – pendant qu’Ahmadinejad – le Président iranien – ne l’écoute pas, ne l’entend pas, et pour cause…
L’Iran connaît parfaitement les plans de l’hyène américaine et l’Ayatollah Khamenei sait également que le renard israélien ne commande pas au loup états-unien. C’est plutôt l’inverse (1).
Tout ce que la Terre porte d’analystes, d’observateurs, d’experts militaires se sont émus la semaine dernière à l’annonce qu’un porte-avions de la Ve flotte américaine, furetant dans le secteur du détroit d’Ormuz, loin de son port d’attache, avait été chassé de la région par un exercice militaire iranien. Le navire risquait en effet de provoquer un incident-accident entre les deux belligérants se disputant le Golfe persan (2).
L’incident n’était pourtant qu’un exercice de réchauffement avant la conflagration à venir. Après avoir assisté à ce coup monté, dites-vous que l’une des prochaines fois sera la bonne et que cet incident provoqué déclenchera non pas la ‘troisième guerre mondiale’ mais l’attaque américano-israélienne contre l’Iran que l’Amérique attend depuis si longtemps.
Pourquoi pas cette fois, ni la prochaine, mais la suivante seulement ? Et pourquoi en 2013 et pas avant ? Pour répondre à ces questions il faut savoir pourquoi les USA en veulent tant à l’Iran. Si l’on ne sait pas répondre à cette question préalable, on en est réduit à conjecturer – à spéculer – à colporter les papiers d’intoxication médiatique des éditorialistes américains et israéliens.
Posons d’abord une prémisse évidente. Neuf pays de par le monde possèdent l’arme atomique. Ce sont les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l’Inde, la Chine, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël – entre 100 et 200 ogives – (3). Y a-t-il plus criminel que le gouvernement états-unien ? Y-a-t-il plus hystérique que le gouvernement israélien ? Y-a-t-il plus instable que le gouvernement pakistanais ? Y-a-t-il plus imprévisible que le gouvernement coréen ? Y-a-t-il plus soumis que le gouvernement du Royaume-Uni ? Y-a-t-il plus cynique que le gouvernement de Russie ? Y a-t-il plus agité que le gouvernement de Sarkozy ? Pourtant, ni l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) ni l’ONU ne suggèrent le désarmement nucléaire de ces gouvernements menaçants et incompétents.
Il faut en conclure que la propagande à propos du danger nucléaire iranien n’est qu’un faux-semblant qui cache autre chose, d’autant plus que celui qui s’en dit le plus préoccupé-menacé est justement le seul qui ait utilisé l’arme atomique deux fois plutôt qu’une (Hiroshima et Nagasaki) et qu’il menace encore une fois de l’utiliser contre l’Iran – bombes de type Blu-117 – (4). Qui plus est, les États-Unis possèdent 2 200 têtes nucléaires et 800 vecteurs, de quoi détruire la planète toute entière (5). Que feront les deux ou trois bombes nucléaires iraniennes – à supposer qu’elles existent – montées sur des missiles Shihab-3 – 2 200 km de portée maximum – alors que les États-Unis se situent à 11 000 kilomètres du Golfe persique ? Moins d’une heure après une prétendue attaque iranienne, mille bombes nucléaires américaines pulvériseraient l’Iran ne laissant plus une âme qui vive (77 millions d’habitants). Espérons que nous en avons terminé avec cette fadaise de la menace nucléaire iranienne tout juste bonne à effrayer les retraités des salons de thé.
Mais alors qu’est-ce qui justifie l’acrimonie états-unienne à l’encontre de la destinée iranienne ? Dans un papier, il y a tout juste une année, nous avions répondu à cette question – « Regardez du côté du détroit d’Ormuz », disions-nous (6).
L’Iran a commis le crime de lèse-majesté de ne pas trembler quand Georges W. Bush l’a désigné à la vindicte de sa ‘communauté internationale’. L’Iran a l’outrecuidance de développer sa propre politique nationale plénipotentiaire. L’Iran a le culot de vendre son pétrole à la Chine en devises souveraines iraniennes. L’Iran s’approvisionne en armement auprès de la Russie honnie. L’Iran a choisi le camp de l’impérialisme chinois – l’ennemi irrédentiste de l’impérialisme américain. Enfin, l’Iran a le mauvais goût de posséder une frontière sur le détroit d’Ormuz par où transite près de 35 % du pétrole mondial, point de passage pétrolier que les États-Unis entendent bien entraver ou faire entraver ! Pour que ce plan machiavélique fonctionne, les États-Unis doivent cependant colmater au moins deux brèches dans le dispositif de verrouillage pétrolier de la région du Golfe persique. Le projet Nabucco, un oléoduc irano-irako-syrien destiné à acheminer le pétrole iranien et irakien jusqu’en Méditerranée via le territoire syrien et le projet d’oléoduc des Émirats Arabes Unis destiné à contourner le détroit d’Ormuz pour l’acheminer directement jusqu’au port de Foujeirah (7). Pour ce dernier oléoduc ce ne sera pas compliqué ; les Émirats Arabes Unis sont sous protectorat américain et leur pétrole sera acheminé aux clients que Washington aura accrédités ; pour le premier cependant, rien n’est assuré et la subversion récemment entreprise contre la Syrie vise justement le contrôle de cet oléoduc.
Dans un récent article nous demandions pourquoi la France et l’Euroland endossent la stratégie américaine visant leur propre étranglement pétrolier (8) ? En effet, si le détroit d’Ormuz est interdit à la navigation, c’est la Chine et l’Europe qui seront privées de carburant et non les États-Unis qui s’approvisionnent autrement. Ceci nous amène à conclure que l’Union Européenne devrait réviser ses politiques vis-à-vis de la Syrie et de l’Iran prochainement.
L’agression américaine contre la Syrie et l’Iran s’inscrit comme une étape de la guerre que se livrent les trois grands camps de l’impérialisme mondial – le camp états-unien – le camp de l’Euroland allié au camp américain jusqu’au 8 décembre dernier et dont il tente dorénavant de s’éloigner pour ne pas couler avec le dollar plombé – et le camp chinois, la superpuissance industrielle montante à laquelle sont associées l’Iran, la Syrie et la Russie.
Un expert affirme que ce que nous décrivons ci-haut : « ce modèle militaire mondial du Pentagone en est un de conquête du monde » (9). Les États-Unis n’envisagent nullement de conquérir le monde. Leur puissance technico-militaire est énorme mais leur capacité militaire conventionnelle – humaine – est bien en-deçà de telles ambitions. Les Américains souhaitent simplement détruire les infrastructures urbaines, les infrastructures portuaires et les raffineries iraniennes de façon à punir ce pays pour sa dissidence ; faire un exemple auprès de tous les autres pays en voie de développement qui caressent des rêves d’indépendance nationale.
Les États-Unis ne cherchent pas à s’emparer du pétrole iranien, ils en seraient bien incapables puisqu’ils ne songent nullement à débarquer des détachements de Marines et à s’installer à Téhéran. Quand on est impuissant à mater les talibans afghans, on ne songe même pas à occuper l’Iran.
Les États-Unis cherchent plutôt à provoquer une crise économique, financière, monétaire mondiale qui frappera toutes les puissances impérialistes, dépréciera leurs monnaies (le Yuan et l’Euro – le Dollar, lui s’en va déjà à vau-l’eau) et les rendront dépendantes des marchés boursiers et des ressources énergétiques du monde anglo-saxon (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada) où la valeur des entreprises pétrolières s’élèvera de façon vertigineuse en même temps que la valeur de l’or noir (Golfe du Mexique, Alaska, Sables bitumineux de l’Alberta et Mer du Nord).
Ce coup de « poker » démentiel et meurtrier ne provoquera pas la ‘troisième guerre mondiale’ – les deux autres blocs impérialistes concurrents ne sont pas encore prêts à engager un affrontement militaire contre la superpuissance nucléaire américaine représentant la moitié des dépenses militaires de la planète (10).
Les peuples du monde souffriront énormément de cette crise économique profonde accompagnée d’une inflation importante, d’une hausse du chômage déjà catastrophique, d’une déprime boursière, de l’effondrement des hedge funds et des caisses de retraite des travailleurs ; cette crise enclenchera des soulèvements ouvriers, des grèves et des occupations d’usines jalonneront la guerre de classe – travail contre capital – sur le front économique que les opportunistes petits-bourgeois auront mission de liquider en proposant divers slogans réformistes pour sauver le système capitaliste.
L’attaque américano-israélienne contre l’Iran n’aura pas lieu en 2012 – année d’élection américaine. Le sort de la Syrie doit d’abord être tranché ; pour Méphisto Obama et pour le Minotaure Netanyahu rien ne presse. Après l’élection il sera temps d’ouvrir les portes de l’enfer et de libérer les Cerbères des Guerres puniques contemporaines.
Un indice pour ceux qu’il presse de savoir quand cela surviendra : il suffit de compter les grands navires de guerre américains qui mouillent dans le Golfe persique ; quand il n’en restera plus aucun, le combat de l’Armageddon tonnera dans la fournaise persane.
Robert Bibeauhttp://euro-synergies.hautetfort.com/
________________________________________
(1) « Déclarations d’Hillary Clinton et du secrétaire à la Défense Leon Panetta : « aucune option n’est écartée ». Panetta a toutefois indiqué qu’« Israël ne devrait pas envisager d’action unilatérale contre l’Iran », tout en soulignant que « toute opération militaire d’Israël contre l’Iran doit être appuyée par les États-Unis et coordonnée avec eux ». (Déclaration de Leon Panetta le 2 décembre au Saban Center, cité dans U.S. Defense Secretary : Iran could get nuclear bomb within a year – Haaretz, 11 décembre 2011. C’est l’auteur qui souligne.).
(2) Il faut souligner toutefois que la flotte de guerre iranienne est chez-elle près des côtes d’Iran alors que la Ve flotte américaine est une intruse à 11 00 kilomètres des côtes américaines. 3.1.2012. http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/01/03/le-bras-de-fer-entre-l-iran-et-l-occident-se-poursuit_1624979_3218.html
(3) Mordechaï Vanunu en entrevue avec Silvia Cattori. 2005. « non seulement on ne s’en prend pas à Israël, mais on aide même ce pays en secret. Il y a une coopération secrète entre Israël et la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Ces pays ont décidé de contribuer à la puissance nucléaire d’Israël afin de faire de ce pays un État colonial, dans le monde arabe. Ils aident Israël, parce qu’ils veulent que ce pays soit à leur service, en tant que pays colonialiste contrôlant le Moyen-Orient, ce qui leur permet de s’emparer des revenus pétroliers et de maintenir les Arabes dans le sous-développement et les conflits fratricides. Telle est la principale raison de cette coopération. ». http://www.silviacattori.net/article2313.html
(4) Michel Chossudovsky 6.1.2012. Mondialisation. « (…) attaque contre l’Iran, mais aussi que cette attaque pourrait inclure l’utilisation d’armes nucléaires tactiques antiblockhaus ayant une capacité explosive allant de trois à six fois celle d’une bombe d’Hiroshima. » http://www.centpapiers.com/l%E2%80%99iran-face-a-une-attaque-a-l%E2%80%99arme-nucleaire-%C2%AB-aucune-option-n%E2%80%99est-ecartee-%C2%BB/91431
(6) La guerre contre l’Iran aura-t-elle lieu ? 14.01.2011. http://bellaciao.org/fr/spip.php?article112543 et dans cet écrit datant de novembre dernier, Menacer l’Iran préparer l’invasion de la Syrie. 17.11.2011. http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=27724
(7) http://www.voltairenet.org/Les-Etats-Unis-suspendent-leurs et http://www.cyberpresse.ca/international/moyen-orient/201201/09/01-4484169-emirats-un-oleoduc-pour-eviter-le-detroit-dormuz-bientot-operationnel.php
(8) Deux mille douze avant et après ? http://www.centpapiers.com/deux-mille-douze-avant-et-apres/91333
(9) Pierre Khalaf. Guerre au Proche-Orient : anatomie d’une menace. 24.10.2011. http://www.voltairenet.org/Guerre-au-Proche-Orient-anatomie-d
Manlio Dinucci. Les USA ‘tournent’ la page et s’apprêtent à de nouvelles guerres. 7.1.2012. http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=28526