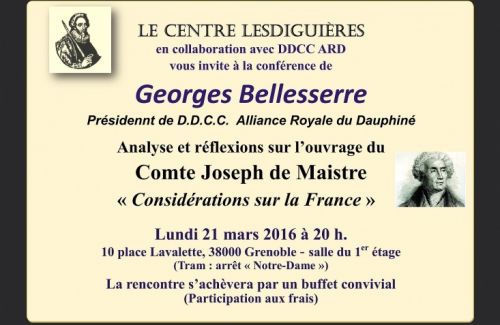Au-delà de la diversité culturelle du continent européen, les nations qui le composent sont peu ou prou prisonnières d’un même paradigme. À savoir, une vie politique dominée par deux partis majoritaires, lesquels adhèrent à des conceptions communes dont les principales sont la mondialisation, le libéralisme économique, et la construction européenne sur la base des transferts de souveraineté.
Dans tous ces pays existent des partis en opposition avec l’idéologie dominante. Il s’agit techniquement de partis souverainistes, bien que cette déclinaison soit suffisamment vague pour qu’on puisse y classer aussi bien la gauche radicale que l’extrême-droite. Les mouvements souverainistes sont fréquemment catégorisés comme « populistes ». Le populisme revêt une signification spécifique selon que l’on parle de sciences politiques ou de sociologie électorale.
Pour faire simple, en sciences politiques le populisme peut être considéré comme l’ensemble des revendications politiques citoyennes non-représentées, car elles ne trouvent aucun réceptacle au sein des partis de gouvernement.
En termes de sociologie électorale, le populisme correspond à la remise en cause par les classes populaires des valeurs et des outils de gouvernance défendus par les classes dirigeantes. Dans les circonstances actuelles, le qualificatif de populiste, adressé par les classes dirigeantes au diagnostic critique du paradigme libéral-mondialiste, revêt une connotation péjorative et révélatrice d’un mépris de classe.
Le populisme : émanation des promesses non-tenues
Il n’y a pas de vrai débat entre les partis de gouvernement et les partis d’opposition. C’est justement là où l’anathème populiste trouve son intérêt pour ceux qui l’emploient. Il sert à disqualifier autrui, à balayer la protestation populaire, à considérer l’alternative comme étant démagogique, irresponsable, extrémiste. Avec cela, on escamote le débat de fond sur le modèle de société auquel on pourrait aspirer.
En fait, les partis populistes représentent tout ce que les partis de gouvernement ont abandonné. La gauche populiste incarne un socialisme orthodoxe basé sur la protection des catégories populaires et donc en opposition avec le social-libéralisme qui accepte le principe de déflation salariale au nom de la compétitivité dans une économie mondialisée.
Quant à la droite populiste, elle incarne la vision assimilatrice de la société, par opposition au multiculturalisme auquel la droite de gouvernement a fini par céder. On notera toutefois que dans le cas de la droite, la diversité politique européenne aboutit à des reproches divergents. Ainsi, la droite populiste française reproche à la droite de gouvernement d’avoir abandonné le patriotisme économique et la logique protectionniste, là où la droite populiste anglaise critiquera l’abandon du libéralisme classique au profit de l’hyper-réglementation générée par les normes européennes.
Paradoxe de gauche
La gauche européenne, sous l’égide de la social-démocratie, a renoncé à un électorat ouvrier dont l’intérêt de classe n’était plus convergent avec l’ouverture à la mondialisation. En France, le PS a un socle électoral largement composé de retraités et de fonctionnaires. La perte des ouvriers a poussé le parti à réorienter son offre électorale vers la petite bourgeoisie des métropoles (les fameux bobos), ainsi que vers les immigrés.
De ce choix découle la favorisation de mouvements émancipatoires, tel que le féminisme et l’extension des droits LGBT. De même, son ouverture vers l’électorat d’origine immigrée se manifeste par une islamophilie assumée et un multiculturalisme revendiqué. Cependant, l’islam, comme toutes les grandes religions, induit dans sa déclinaison politique un modèle de société patriarcal. Ainsi, plus cette religion s’épanouie, plus elle se manifeste dans l’espace public, et vient ainsi renforcer la critique des politiques libertaires dont sont issus les mouvements LGBT et féministes.
Notons que la gauche de la gauche possède aussi son propre paradoxe, dans la mesure où elle en appelle au peuple et tente de ressusciter la mythologie ouvrière, alors que les principaux concernés se sont tournés vers le Front National. Tout comme le PS, la gauche radicale célèbre l’immigration comme une chance pour la France. Mais la concurrence mondiale a ruiné l’industrie française, tandis que la gentrification des métropoles a évincé le prolétariat des grandes villes. Le logement social est devenu le seul parc foncier qui lui soit accessible. Ne souhaitant plus cohabiter avec des populations issues de flux migratoires constants et devenir minoritaires sur leur territoire, les ouvriers ont migré à l’écart des villes-monde, modifiant ainsi les implantations démographiques traditionnelles, et bouleversant la géographie politique du même coup. Cette réalité n’échappe pas aux leaders de la gauche radicale, mais cette dernière ne peut pas non plus renoncer à ses inclinations xénophiles, ce qui la condamne à prêcher dans le désert.
Paradoxe de droite
À droite, le bourgeois classique et l’électeur populaire issu du périurbain et de la ruralité ont en commun un rejet de l’immigration et une hostilité de fait envers l’expression du multiculturalisme, bien que ce concept soit soumis à tous les amalgames.
Cependant, économiquement, un monde sépare ces deux catégories. Les classes aisées profitent de la mondialisation et de l’ouverture des frontières. La libéralisation décuple leurs opportunités et les conforte dans leur domination. Pour les classes populaires c’est l’inverse, libéralisation et mondialisation riment avec concurrence déloyale et précarisation.
Ces électorats sont séparés jusque dans leur répartition sur le territoire, puisque la bourgeoisie traditionnelle peuple les métropoles dynamiques et adaptées à la concurrence mondiale, là où les catégories populaires de droite vivent dans des zones de déclin économique, éloignées de la création de richesses, et où le taux de revenu annuel est particulièrement faible.
Les bourgeois et retraités aisés veulent plus d’Europe, ou au moins le maintien de ce qui est acquis. Les classes populaires ne veulent plus d’intégration européenne et souhaitent même revenir sur les fondamentaux de l’UE.
Se pose ainsi pour les partis de droite classiques, tout comme pour les partis de la droite antisystème, la problématique suivante : comment capter sur la base de l’immigration deux électorats diamétralement opposés sur les grandes orientations politiques et institutionnelles de leur pays ?
Quand la communication remplace la politique
L’outil miracle permettant de surmonter ces difficultés existe bel et bien : il s’agit de la synthèse.
La synthèse est ce qui permet de faire cohabiter au sein d’une même famille politique, et à travers une seule personnalité, des courants totalement antagonistes. Elle s’obtient en substituant l’action politique par la communication politique.
L’action politique vise à dire ce que l’on va faire, et à faire ce que l’on a dit. La communication politique consiste à adopter une posture temporaire définie par le contexte politique immédiat et par le public électoral auquel on est confronté. Dans une synthèse, on distribue donc des promesses contradictoires à des corps électoraux dont les intérêts divergent, en sachant très bien que certains seront floués.
Dans le contexte européen actuel, il apparait que la synthèse semble plus aisée à gauche. L’électorat favorable aux mouvements d’émancipation LGBT et/ou féministes incline favorablement vers le modèle de société multiculturaliste, et admet donc l’affirmation de l’islam comme identité du citoyen musulman. Pourtant, l’expansion d’un certain islam, de coloration salafiste, génère des dérives communautaires et des manifestations d’intolérance. Face à ces dérives, nombreux sont les responsables de gauche à fermer les yeux, voire à tolérer l’intolérance, tant qu’elle provient d’un client électoral. Mieux, le fait d’attendre en embuscade que la droite s’empare de ces sujets à des fins de polémiques, ce qui ne manque jamais d’arriver, permet à la gauche de ressouder l’ensemble de son électorat, en invoquant la lutte contre l’islamophobie et la droitisation des esprits.
En France, l’appel à la défense des valeurs républicaines est devenu un élément de langage phare du discours socialiste. Mais l’emploi qui en est fait est un contre-sens, puisque la République, qui symbolise la réunion d’individus divers dans leurs origines et leur culture au sein d’une communauté nationale, est ici invoquée dans un discours global qui exalte les particularismes communautaires.
La synthèse à droite paraît plus malaisée. Si Nicolas Sarkozy est le dernier à l’avoir réussie en 2007, il semble aujourd’hui impossible de rééditer une telle manœuvre, ce en raison de l’hostilité croissante et globale envers l’Europe. Comment bailler à la droite des métropoles l’accentuation de l’intégration européenne, ainsi que la libre-circulation des travailleurs et des marchandises, tout en promettant protection et justice sociale à une droite de la périphérie qui exige le retour de l’État dans l’économie et le rétablissement des frontières ?
La mondialisation a bouleversé le champ politique national en scindant les bases électorales de la gauche et de la droite, ce dans tous les pays, y compris aux États-Unis. Si le clivage gauche-droite est devenu secondaire, il constitue toujours un repère sur l’idée que l’on se fait de la société dans laquelle on souhaite vivre. Chaque camp se trouve ainsi contraint de surmonter les paradoxes nés de la mondialisation et de recoller les différentes pièces de son électorat par le biais de la synthèse. Ce à moins que la nouvelle géographie politique commune à tout l’Occident, opposant la métropole à la périphérie, ne donne naissance à une nouvelle forme d’entité politique, balayant définitivement les fossiles démocratiques que sont le bipartisme, la coalition au centre, et l’alternance unique.
La politique, une affaire de générations
Un trait d’union supplémentaire unit les nations occidentales dans leur diversité, il ne doit pas être sous-estimé car il est un facteur majeur dans le conservatisme politique et institutionnel de ces pays : Il s’agit de la démographie.
Les pays occidentaux ont une démographie faible et de ce fait une population vieillissante. Comparée au dynamisme démographique des autres continents, cette faiblesse dans le renouvellement de la population autochtone occidentale alimente l’idée du déclassement, tandis que les flux migratoires nourrissent la peur instinctive de la disparition de son pays, de sa culture, et au final de soi-même.
Ces considérations sont prégnantes dans les mouvements de droite, aussi bien classiques que populistes, même si ces derniers les assument beaucoup plus aisément, notamment en Grande-Bretagne avec UKIP, en Belgique avec le Parti Populaire, ou en Suède avec les Démocrates Suédois. Le fait de rompre un tel tabou et de rouvrir le débat sur la coexistence des civilisations facilite leur classement à l’extrême-droite. Pourtant, les problématiques issues de la coexistence ne sont pas liées aux pays de l’Europe blanche et chrétienne. Une enquête réalisée par Ipsos en 2011 révèle que ce phénomène touche aussi aux autres continents, il s’agit d’un phénomène inhérent à l’être humain, il est donc universel.
La faible démographie occidentale a également un effet pervers sur le renouvellement des classes politiques et institutionnelles. Par essence, les partis qui occupent le pouvoir représentent les classes dominantes, ils sont donc nécessairement conservateurs, puisque leur objectif est de demeurer en place. Ces mouvements sont largement soutenus par des populations qui, sociologiquement, ont toutes les raisons de vouloir préserver leurs acquis.
En Europe, cette population correspond à celle des baby-boomers, lesquels ont désormais atteint l’âge où leur place dans la société est faite et dont le but est de s’y maintenir. S’ajoute à cela les populations retraitées qui, même lorsqu’elles sont modestes, n’aspirent pas tant au changement qu’au statu quo, sachant par ailleurs que les retraités sont sensibles aux effets de l’inflation, et prisent donc la stabilité politique.
Pour les générations suivantes, l’héritage des baby-boomers consiste essentiellement en l’évocation quasi mythologique d’un âge d’or, les Trente Glorieuses, contrastant avec la crise économique qui a suivi et qui semble s’amplifier, le tout ponctué d’un legs écologique désastreux et d’une dette monstrueuse à supporter. S’ajoute à cela la rancœur devant le peu de perméabilité d’un marché du travail encore dominé par ceux qui ont connu dans leur jeunesse le plein emploi. La classe politique française symbolise cet égoïsme à la perfection. L’amertume est justifiée, mais il n’y a pas d’affrontement entre générations, car pour le jeune d’aujourd’hui le baby-boomer est aussi un parent, ou un grands-parents.
Il est de notoriété publique que les personnes âgées votent en masse et que l’absentéisme est fort chez les jeunes. La colère envers les classes dominantes qui régissent le monde occidental est certaine, les partis populistes montent, le changement semble de plus en plus à portée de main, il se fait entendre, mais il ne vient pas. Tout simplement parce que les forces du conservatisme sont plus fortes encore, même si elles sont silencieuses.
Tant qu’il n’aura pas résolu ses problèmes démographiques, l’Occident semble destiné à s’enfoncer dans un marasme économique et dans une crise existentielle, sans espoir d’une reprise en main par le haut, par le politique. Le paradoxe occidental, c’est de constater son déclin mais de juger néfaste ce qui pourrait y remédier. Une affaire de générations.
Par Jean-Baptiste de Marigny
 L’imposture de l’Art contemporain – Une utopie financière
L’imposture de l’Art contemporain – Une utopie financière