Philippe Baccou, ENA. Conseiller-Maitre à la Cour des comptes (ER), essayiste, contributeur de Polémia
♦ Voici un texte ancien sur les limites à apporter au libre-échange. C’est la reprise d’une intervention tenue à l’université du Club de l’Horloge le 23 novembre 2013 mais, comme tous les bons textes, il s’est bonifié en vieillissant. Il est long. Polémia le publiera sous forme de PDF global et en 5 parties :
1-Libre-échange versus protectionnisme : les fondements du débat ;
2-Les hommes ne sont pas des choses : l’immigration n’est pas l’objet du libre-échange ;
3-La sécurité stratégique, l’identité culturelle, la protection de l’environnement ne sont pas bradables ;
4-Il est légitime de se protéger de l’échange inégal et déloyal ;
5-Garder le sens des proportions, ne pas jouer sur les peurs.
Polémia
1-Libre-échange versus protectionnisme : les fondements du débat
Le 16 juin 2013, l’International Herald Tribune a cité d’intéressants propos du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Ces propos, tenus quelques jours auparavant, critiquaient la position, exprimée par la France, que la culture soit exclue, au moins initialement, des négociations sur un accord de libre-échange transatlantique à ouvrir entre les Etats-Unis et l’Union européenne
Selon M. Barroso, tout cela, « c’est une partie de ce programme anti-globalisation que je considère comme complètement réactionnaire. Certains disent qu’ils appartiennent à la gauche, mais en fait ils sont culturellement extrêmement réactionnaires ».
Cette condamnation de la position de la France a soulevé un tollé de la part des socialistes français. L’un des plus vigoureux fut le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui déclara dans Le Parisien du 26 juin : « Barroso est un homme dépassé. Il n’a rien compris au film, sa manière d’agir est insupportable (…). Mais surtout, Barroso incarne une Europe qui ne correspond plus au monde actuel. C’est l’Europe du XXe siècle, celle de la libre circulation des marchandises et des capitaux, de la marche forcée vers l’austérité. Barroso, ce n’est pas l’Europe du XXIe siècle, plus protectrice, plus préoccupée par la croissance et l’emploi ».
Quelques jours auparavant, le 23 juin, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait affirmé : « Barroso est le carburant du Front national. Voilà la vérité », ce à quoi José Barroso avait immédiatement répondu, le 24 juin : « Certains souverainistes de gauche ont exactement le même discours que l’extrême droite ».
Prudemment, le socialiste Pascal Lamy, à l’époque encore directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, s’était alors tenu sur la réserve, mais cela ne l’a pas empêché de déclarer quelques semaines après, le 17 septembre 2013, à propos du patriotisme économique cher à Arnaud Montebourg, « je crois que tout ce qui tourne autour du protectionnisme à la papa ne fait pas sens ».
Cet incident, dont la portée ne doit évidemment pas être surestimée, est révélateur d’une certaine crispation du débat sur le libre-échange. Voilà donc des hommes de gauche, ou venus de la gauche – M. Barroso, aujourd’hui homme du centre, fut maoïste dans sa jeunesse –, et dont les options ne sont sans doute pas si éloignées que cela, qui s’accusent mutuellement d’être passéistes, voire, suprême injure, de faire le jeu des populistes !
Quelle opinion peut-on avoir de tout cela lorsqu’on n’est ni centriste, ni socialiste ?
Je serai d’emblée très clair sur un premier point. N’attendez pas de moi une apologie du protectionnisme. Je pense au contraire que dans les controverses actuelles, bon nombre des arguments des avocats du libre-échange sont tout à fait recevables.
Ces avocats nous disent qu’il n’y a guère de controverse qu’en France à propos du libre-échange. Ce n’est pas faux.
Ils nous expliquent que les mécanismes de l’échange et de la spécialisation ne sont pas fondamentalement différents, que l’on se place à l’échelle de l’individu, de l’entreprise, de la région ou à celle d’un pays ou d’un continent. Que si le protectionnisme est absurde chez l’individu, qui ne saurait vivre comme Robinson sur son île, il l’est donc tout autant aux autres niveaux. Cet argument n’est pas sans valeur.
Ils ne sont pas d’accord avec l’idée souvent exprimée aujourd’hui qu’une dose de protectionnisme européen serait une bonne solution à nos difficultés. Je ne vois pas non plus, pour ma part, en quoi la protection économique des frontières serait une meilleure chose à l’échelle de l’Europe qu’à celle de la France.
Ils nous disent que derrière les arguments hostiles au libre-échange, il y a souvent non pas des raisons d’intérêt général, mais des intérêts corporatifs puissants, qui cherchent à garder ou à accroître leurs rentes : on met en avant les petits qui souffrent pour mieux préserver les plus gros qui se portent très bien. C’est souvent exact, et le même jeu existe d’ailleurs aussi bien en ce qui concerne les échanges internes à un pays qu’en ce qui concerne l’échange international.
Ils affirment que l’Europe n’est pas une passoire : les droits de douane dans l’Union européenne, aux Etats-Unis et au Japon représentent à peu près le même pourcentage du commerce de chacun d’entre eux ; en moyenne, les droits chinois ne sont pas supérieurs à ceux de l’Europe : et l’Europe se protège tout autant, voire plus que les Etats-Unis par des barrières non tarifaires. Tout cela mérite d’être entendu.
Ces avocats rappellent encore que les protectionnistes acceptent le libre-échange entre pays de même niveau et qu’ils centrent leur argumentaire sur la concurrence des pays émergents. Or, nous disent les libre-échangistes, un pays comme la France réalise 60 % de ses échanges commerciaux avec l’Union européenne et près des trois quarts avec des pays de son niveau, alors que la Chine représente moins de 10 % de nos importations. Même si ces chiffres peuvent prêter à discussion (car, par exemple, une partie des exportations chinoises est réimportée en provenance d’autres pays de l’Union européenne), l’argument reste acceptable. On peut l’exprimer d’une autre façon en disant qu’en vingt ans l’Europe, contrairement à la France, n’a pas perdu de part du marché mondial ; que d’autres pays parmi nos voisins ont donc fait mieux que nous ; et qu’avant de rétablir des barrières douanières avec ses voisins, il vaudrait sans doute mieux chercher à remédier à d’autres causes de notre moindre performance.
Ces avocats ont enfin beau jeu de nous rappeler les résultats peu encourageants obtenus par des pays qui ne pratiquent pas le libre-échange, à commencer aujourd’hui par la Corée du Nord. Mais on pourrait aussi citer notamment, pour les échanges de capitaux, le cas du Venezuela, cher à M. Mélenchon, où l’instauration d’un contrôle draconien des changes n’a servi qu’à produire le rationnement et la pénurie, avec une inflation de l’ordre de 30 % en 2013.
Mais cela étant dit, il y a aussi des bémols et des limites à poser au libre-échange. Toute idée peut devenir folle si elle est poussée jusqu’au-delà du raisonnable. Lorsque le libre-échangisme, doctrine du libre-échange, oublie ses propres conditions de validité, lorsqu’il devient un impératif moral, une sorte de religion économique, il ne peut qu’engendrer des excès, et c’est ce qu’on lui reproche aujourd’hui de plus en plus.
Je centrerai mon propos sur les relations économiques internationales, sur lesquelles se focalise le débat, et je l’organiserai autour de quatre questions qui permettent de bien marquer les limites de l’extension et des bienfaits du libre-échange :
Qui échange, et qu’est-ce qu’on peut échanger ?
A quelles activités le libre-échange est-il susceptible de s’appliquer ?
Comment l’échange fonctionne-t-il ?
Et enfin, quels sont les enjeux du libre-échange ?
Philippe Baccou 23/11/2013
(A suivre)
https://www.polemia.com/les-exces-du-libre-echangisme-et-les-limites-a-apporter-au-libre-echange-15/

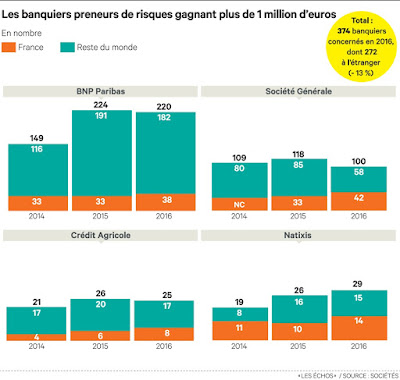
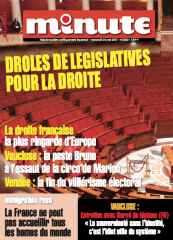 Pour
Pour