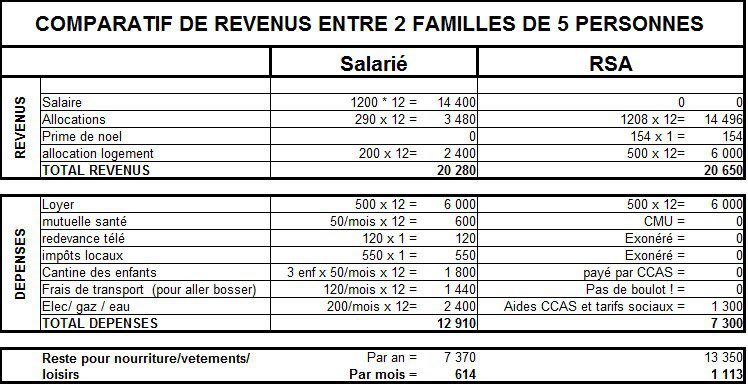Au moment où l’on spécule sur la santé du président Abdelaziz Bouteflika, et sur sa candidature incertaine à sa réélection en avril 2014, dans quel état se trouve l’Algérie ? À la lecture des articles du professeur Abderrahmane Mebtoul, économiste algérien et expert international en management stratégique, on réalise que la situation économique du pays est loin d’être aussi rassurante que le mirobolant excédent de devises pourrait le laisser penser…
Auteur passionné et prolixe, réputé pour son franc-parler, le professeur Abderrahmane Mebtoul commence souvent son propos en rappelant le paramètre majeur de l’économie algérienne : 98 % des exportations du pays sont issues des seuls hydrocarbures ; ceux-ci ont généré quelque 600 milliards de dollars de recettes en devises entre 2000 et 2012, selon les bilans de Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures.
Cette manne a permis à l’Algérie d’éteindre sa dette depuis plusieurs années et de disposer à fin 2012 de réserves de change considérables, couvrant trois années d’importations : 200 milliards de dollars selon le FMI, 190 milliards selon la banque d’Algérie. Ce « trésor », auquel il faut ajouter 173 tonnes d’or, est d’autant plus considérable que le PIB algérien reste modeste – à 188,6 milliards de dollars en 2012 selon le FMI, dont plus de 40-45 % générés par les hydrocarbures – pour un pays de 37,9 millions d’habitants au 1er janvier 2013, selon l’estimation de l’Office national des statistiques (ONS).
Côté importations aussi, l’Algérie se trouve dans une situation rare : 70 à 75 % des besoins des ménages et des entreprises sont satisfaits par des achats à l’étranger. C’est dire que l’on ne produit pas grand-chose dans le pays le plus étendu et le plus peuplé du Maghreb.
« Il faut bien considérer que l’Algérie vit dans une économie de rente, souligne le Professeur Mebtoul lors d’un récent entretien sur RFI. Que se passera-t-il lorsque la rente diminuera, ou s’éteindra quasiment, au rythme de la baisse prévisible des devises issues des hydrocarbures, du fait de leur épuisement et de leur remplacement progressif par d’autres sources d’énergie ? Les équilibres macrofinanciers actuels sont éphémères sans de profondes réformes institutionnelles et microéconomiques ».
Inflation en hausse, IDE en baisse
L’inflation en hausse et les investissements directs étrangers (IDE) en baisse sont deux autres points d’inquiétude. Favorisée elle aussi par la rente pétrolière, l’inflation a bondi à 8,89 % en 2012 – et même 15 % pour les produits de première nécessité – contre 4 % en 2011, selon l’ONS. « Mais encore faut-il considérer, affirme le professeur Abderrahmane Mebtoul, que le taux officiel d’inflation est contenu par des subventions généralisées et non ciblées, dont les transferts sociaux, qui ont représenté plus de 10 % du PIB en 2012. C’est encore un produit du cancer de la rente des hydrocarbures ! »
Quant aux IDE, s’ils n’ont jamais été très attirés par l’Algérie (hors hydrocarbures), ils ont encore reculé depuis la promulgation de la loi de Finances complémentaire de 2010, qui interdit à tout investisseur étranger de détenir plus de 49 % des parts d’une société locale, et l’oblige donc à accepter un actionnariat algérien majoritaire, à 51 % minimum. À l’époque, devant les multiples critiques internationales, le pouvoir algérien a argué de sa « souveraineté » et dénoncé « l’ingérence étrangère ». Mais aujourd’hui, les effets néfastes de cette « règle du 49/51 » sont avérés : selon un bilan publié en mars par la Banque d’Algérie elle-même, les IDE ont enregistré en 2012 une baisse de 15 %, à 1,7 milliard de dollars contre 2 milliards de dollars en 2011. Outre la règle du 49/51, l’autre facteur responsable de ce recul serait l’obligation, faite aux soumissionnaires étrangers de contrats publics, de trouver des partenaires locaux.
Un climat des affaires toujours plus dégradé
La dégradation du climat des affaires en Algérie s’est donc encore accentuée ces dernières années, ainsi que le constate le rapport « Doing Business 2013 » de la Banque mondiale, qui « classe l’Algérie à la 152e position sur 185 pays pour les facilités accordées à l’investissement, en recul de quatre places par rapport à 2012 », souligne le Pr Mebtoul dans une récente contribution au site alterinfo.net.
L’examen dans le détail de ce classement sur la qualité de l’environnement entrepreneurial dans le monde est tout aussi accablant : l’Algérie arrive en 82e position pour la protection des investisseurs, à la 156e pour le lancement d’une entreprise, à la 129e place pour l’obtention d’un crédit, au 138e rang pour l’obtention d’un permis de construire, à la 129e place pour les procédures de facilitation d’exportation accordées aux PME, en 126e position en matière d’application des contrats, à la 170e place pour les procédures de paiement des impôts…
Des taux de chômage et de coissance qui posent question
Par ailleurs, le taux officiel de chômage, 10 % – relativement modeste au regard des autres pays du Maghreb, mais aussi de l’Espagne et de la Grèce, toutes deux autour de 27 % au T1 2013 -, met surtout en exergue la faible crédibilité de certaines statistiques algériennes. D’une part, parce que selon, le rapport 2012 de l’ONS, le secteur informel représente autour de 50 % de l’activité économique du pays. D’autre part, relève le Pr Mebtoul, parce que « ces statistiques incluent des emplois fictifs – comme faire et refaire des trottoirs… – ou faiblement productifs, d’ailleurs de plus en plus nombreux dans l’administration, où l’on approche des 2 millions de fonctionnaires » pour une population active totale estimée à 11,5 millions en 2012 par la Banque mondiale.
Reste la question du taux de croissance. À 2,5 % en 2012, il pourrait faire rêver bien des pays européens. En fait, « il est dérisoire, assène l’économiste. Avec les quelque 500 milliards de dollars de dépense publique prévue entre 2004 et 2013, selon les comptes rendus de plusieurs conseils des ministres, le taux aurait dû s’élever à 10-15 % (…) Cela montre qu’il existe un divorce entre la bonne santé financière de l’État, due aux hydrocarbures, et la sphère réelle de l’économie, en léthargie ».
« Un manque patent de tansparence »
À ce propos, « comment ne pas relever, assure le Pr Mebtoul, que la Direction générale de la prévision et des politiques (DGPP) du ministère algérien des Finances a déclaré, le 7 mai 2013 – information reprise par l’agence officielle APS -, que les deux plans quinquennaux successifs ont été respectivement dotés de 100 et de 286 milliards de dollars, soit une enveloppe budgétaire globale de 386 milliards, pour la décennie 2005-2014. L’écart entre le niveau de décaissement effectif, incluant les prévisions pour l’année en cours – qui restent cependant provisoires -, et celui inscrit dans les deux programmes – 500 milliards de dollars – s’explique par la faiblesse de la capacité du marché algérien à absorber les investissements projetés, notamment du secteur du BTP.
Pourquoi a-t-on donc parlé initialement d’une dépense publique de 500 milliards de dollars pour la situer ensuite à 386 milliards, alors qu’aucun bilan n’a été réalisé à ce jour ? Puisque la DGPP parle uniquement d’investissement, la différence est-elle due aux matières premières importées – le taux d’intégration, tant des entreprises publiques que privées algériennes, ne dépassant pas 15 % – et inclues dans la dépense publique ?… Nous sommes, ici encore, devant un manque patent de transparence, à l’instar de ce qui se passe dans la gestion des réserves de change ».
Les contre-performances des banques et des TIC
Autre indicateur négatif, attestant de la difficulté du pays à épouser son époque : l’Algérie est toujours à la traîne pour le développement des TIC. « Elle est même en recul dans le classement mondial établi par le World Economic Forum. En 2013, l’Algérie est classée 131e, alors qu’elle s’était hissée à la 118e place en 2012, souligne l’économiste. L’indice “Networked Readiness Index“, qui a permis au World Economic Forum d’établir son classement, évalue l’impact des TIC sur l’économie et la compétitivité de 144 pays. Selon cet indice, l’Algérie se classe respectivement à la 100e place pour l’usage individuel des TIC, au 144e rang pour leur utilisation dans les affaires, et pointe seulement en 139e position pour la mise en œuvre des TIC dans la sphère institutionnelle et gouvernementale. »
Pour compléter ce tableau de contre-performances, il faut encore évoquer l’archaïsme notoire du système bancaire : 90 % du financement de l’économie, dont 100 % du secteur public et plus de 77 % du secteur privé, se fait par les banques publiques. « Les financements bancaires à long terme sont généralement inaccessibles pour les PME, faute de garanties (…) et pourtant les banques publiques croulent sous les liquidités oisives. C’est une des conséquences de la règle du 49/51, qui les place en situation de monopole. »
De fait, selon le professeur Mebtoul, 40 à 50 % de la masse monétaire est en circulation hors des banques, voire plus si l’on inclut les transactions en nature pour 65 % des marchés de première nécessité : fruits et légumes, poisson et viande, textile et cuir. « Selon des données des douanes algériennes, 75 % des transactions commerciales en 2012 se sont faites en cash. Il ne s’agit pas de corruption, bien évidemment, mais l’informel est un terrain fertile pour son développement », estime l’économiste, cité par le site du quotidien pro-gouvernemental El Moudjahid du 6 mars 2013.
Piètre gouvernance et « corruption socialisée »
Pour autant, l’ampleur de la corruption, y compris aux plus hauts niveaux de l’État, est désormais connue et reconnue de tous. Dans la plus récente affaire impliquant la Sonatrach, où il est question de pots-de-vin versés par une compagnie italienne pour décrocher de gigantesques contrats pétroliers, et qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, on trouve l’ancien ministre de l’Energie parmi les cadres dirigeants mis en cause.
Pour le professeur Abderrahmane Mebtoul, « c’est le mode de gouvernance qui, par la distribution massive de la rente et la corruption socialisée, a anesthésié la majorité de la population active. Il en résulte une forte crise de confiance entre l’État et les citoyens, et cela ne peut que conduire le pays au suicide collectif ».
Face à « ce manque de visibilité et de cohérence dans la politique socio-économique actuelle, qui a montré ses limites en dépensant sans compter », l’actuel Premier ministre, Abdelmalek Sellal, « homme intègre » selon le professeur Mebtoul, « joue au pompier face aux tensions sociales croissantes, n’ayant aucun pouvoir de décision réel, l’actuelle constitution concentrant tous les pouvoirs au niveau du président de la République ».
Dernière illustration de cette piètre gouvernance, voire de la « hogra » (mépris) des gouvernants dont les citoyens se plaignent en permanence : début mai, les parlementaires algériens auraient décidé d’augmenter leurs indemnités – déjà équivalentes à 20 fois le smic algérien – de 5 fois la valeur de celui-ci, qui se situe entre 150 et 200 euros, selon que l’on se réfère au cours officiel des devises ou à celui du marché parallèle. La nouvelle aussitôt connue, le professeur Mebtoul a encore une fois pris sa plume, le 5 mai, pour faire connaître son indignation. Dans sa Lettre ouverte au président Abdelaziz Bouteflika et au Premier ministre Abdelmalek Sellal, il dénonce ce « véritable scandale moral » et demande « l’annulation de cette décision irresponsable ». On attend toujours la réponse des deux premiers personnages de l’État algérien… En revanche, le président de l’Assemblée populaire nationale a démenti dimanche 12 mai avoir été favorable à cette augmentation. Mais des députés l’ont contredit, affirmant qu’il devait signer la révision des indemnités le 6 mai, avant de se rétracter devant « la polémique et la colère ressenties chez les citoyens à la suite de la diffusion de l’information par la presse », écrit Achira Mammeri sur le site “Tout sur l’Algérie”, tsa-algerie.com.
Euromed (blog La Tribune) http://fortune.fdesouche.com/